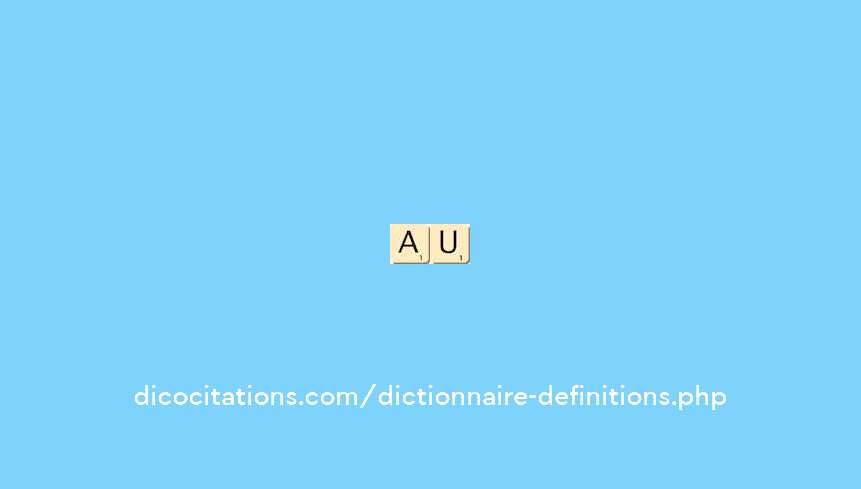À, prép.
ÉTYMOL. ? Corresp. rom. : prov., ital., esp., cat., port., roum.
a.
I.? Attestations. ? [1
reattest. 842,
Serm. cf. inf. C1].
A.? Notions se rattachant à
ad : mouvement, direction, instrument, etc.
1. a) Mil.
xies. Mouvement vers un lieu (
Alexis, éd. Paris et Pannier 16a ds T.-L. : vint ... dreitement
a la mer);
ca 1100, vers une pers. (
Rol., éd. Bédier, 70 : Seignurs baruns
a Carlemagnes irez); emploi fig. : notion de finalité (
Alexis, 10e ds T.-L. : de tot en tot ad
a deu son talent);
doner a + inf. (
ibid., 51e,
ibid. : as plus povres le
donet a mangier);
b) mil.
xies. constr. prép. avec valeur :
? de datif lat. :
parler a (
ibid., 34d,
ibid. : parler al visitor),
doner a (
cf. sup. Alexis, 51e);
? de génit. lat. (
ibid., 9b ds
Gdf. : Filie
ad un comte de Rome ...).
2. Notion de situation : 881, dans le temps (
Eul., 12 ds Meyer ds
Gdf. : Chi rex eret
a cels dis sovre pagiens); mil.
xies., dans un lieu (
Alexis, 34d ds T.-L. : serveit
a l'alter).
3. Notions :
a) d'instrument : 881 (
Eul., 22 ds
Gdf. :
ad une spede li roverent tolir le chief);
b) de manière :
ca 1100 (
Rol., éd. Bédier, 1276 : L'escut li freinst, Ki est
ad or e
a flurs);
c) de rapport : mil.
xies. (
Alexis, 5e ds T.-L. : Enfant nos done qui seit
a ton talent),
tenir a (
ibid., 14a ds
Gdf. : celui
tien ad espos, Qui ...);
d) de compar. :
ca 1100 (
Rol., éd. Bédier, 1598 : Beste nen est Ki poisset curre
a lui [qui puisse courir comme lui]).
B.? Notions se rattachant à
ab : séparation, orig., etc.
1. Mil.
xies.
prendre congiet a (
Alexis, 120c ds T.-L. :
prenent congiet al cors saint Alexis).
2. 1172-1174, notion d'orig. (G. de
P. Sainte-Maxence,
S. Thomas, éd. Hippeau,
ibid. : a ses clers prist conseil); 1176 (
Chrétien de Troyes,
Clig., éd. Micha, 2824 : Que ses oncles li mande Qu'
a lui pes ne trives n'atande).
3. Av. 1167, notion d'agent (
Marie de France,
Lais, éd. Roq.,
Laustic, 225 ds
Gdf. : Ki se faiseit amer
a tus).
C.? Notions se rattachant à
apud : relation, accompagnement.
1. 842, notion de relation (
Serm., Bartsch ds
Gdf. : Et
ab Ludher nul plaid nunquam prindrai).
2. 2
emoitié
xes., notion d'accompagnement (
Pass., éd. Avalle, 428 : Castel Emaus
ab elz entret,
Ab elz ensemble si sopet);
id. (
St Léger, ds Förster et Koschwitz, 8 : Primos didrai uos dels honors Quae il auuret
ab duos seniors).
II.? Étymologie. ? A.? Du lat.
ad exprimant les notions de mouvement, de direction : vers un lieu (dep.
Liv. Andr., 28 ds
TLL s.v., 485, 40; fréq. chez
Plaute,
ibid., passim; maintenu en lat. médiév. ds
Mittellat. W. s.v., 148, 10 sq.); vers une pers. (fréq. ds Plaute, ds
TLL, 478, 65 sq.); constr. verbe de mouvement +
ad + inf. :
dare ad manducare [class.
dare + inf.],
Itala, Johan., 6, 52, cod. vercellensis
ibid., 559, 62.
? Constr. prép. alterne surtout en lat. vulg. ? avec datif :
Plaute,
Epid., ibid., 475, 15 : ad hostes exuvias dabit (
cf. 741-744,
Lex Baiuv., 1, 1 ds
Mittellat. W., 149, 38 : alodem suam ad ecclesiam ... donare), d'où
donner à, Horace,
Satirae, 2, 6, 90 ds
Väänänen,
Lat. vulg., § 249 : tandem urbanus ad hunc ... inquit (
cf. Trad. ratisb., 25 ds
Mittellat. W., 153, 69, ad ipsum abbatem loqui), d'où
parler à; voir
G. De Poerck et
L. Mourin,
Réflexions sur la prép. ad,
Vox rom., XIII, 279-281; ? avec le génit. :
Itala, Aggaeus, 2, 23 ds
TLL, 558, 47 : unusquisque in gladio ad fratrem suum (
cf. fin
vies.,
Form. andec., 28 ds
Mittellat. W., 153, 39 : terra ad illo homine).
? De la notion de mouvement, celle de proximité, puis de situation (sans mouvement) : dans le temps, dep. Pacuv., (
Trag., 363 ds
TLL, 556, 50 : terra exhalat auram ad auroram humidam;
cf. début
ixes.,
Annal. Einh. ds
Mittellat. W., 150, 66 : anno 771, ad II nonas dec.); dans un lieu, dep. Plaute, (
Truc., 281 ds
TLL, 522, 15 : quid apud [ad A] nostras negoti ... est aedis tibi?).
? De la notion de proximité, celles : ? d'instrument : dep. 1
ers. ds
TLL, 551, 50
sq. (
cf. avec 3 a :
Vég.,
Mil., 3, 24,
ibid., 77 : ad latiores lanceas ... beluas occidebant); ? de manière (
cf. avec b :
Pline,
Epist., 5, 6, 13,
ibid., 551, 42 : formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam); ? de rapport (dep. Plaute,
ibid., 80
sq.; cf. avec c :
ixes.,
Sangall., p. 81, 5 ds
Mittellat W., 152, 59 : ad mensura egrotantis);
tenir a « considérer comme »,
cf. anno 774,
Concilium Suess, can. IX ds
Bourc. 1956, § 236 b : nullus sacratam feminam ad mulierem habeat; ? de compar. (
cf. avec d :
Cic.,
De Orat., éd. Courbaud, 2, 25 : sed nihil ad Persum).
B.? Du lat.
ab exprimant les notions : ? de séparation, dep. lat. arch. :
discedere ab « se séparer de (qqn) » dep. Plaute, ds
TLL s.v. discedere, 1278, 80
sq.; cf. avec 1 : ? d'orig. avec verbe « espérer », « craindre », « attendre » + nom de pers. (Tite-Live, 21, 13, 3,
ibid., s.v. ab, 31, 59, d'où 2; exprimant l'agent (dep. Plaute,
passim ibid., 28, 71
sq.), d'où 3,
cf. aussi hyp. de H. Fr.
Müller,
Orig. et hist. de la prép. «
à »
dans les loc. du type «
faire faire qqc. à qqn » (cr. par Rübel ds
Z. rom. Philol., XXXVIII, 371-373) qui y voit la trace d'un
dativus graecus compl. de l'inf. passif puis actif, remplacé par le tour prép., opinion reprise par
Gam. Synt. 1957, § 85, et Spitzer ds
Z. rom. Philol., XLIII, 279
sq. C. ? Du lat.
apud (
Fouché Phonét. 1952, 659, rem. IV), par l'intermédiaire de *
abu, hyp. confirmée par forme
ab des
Serments; prép.
apud, fréq. à partir
vies., surtout en Gaule, pour exprimer notions de relation et d'accompagnement;
cf. avec 1 :
Merov., 70, p. 62, 51 ds
Mittellat. W., s.v., 832, 23 : quod exinde socer suos [e. suus] concammio apud ipso Magnoaldo fecisset;
cf. avec 2 : anno 726-727,
Hist. Franc., 10, 252 ds
Mittellat, W., s.v., 832, 27 : rex omnem exercitum suum
apud [
cum ds Greg. Turon.] armorum apparatu jussit venire;
cf. a. fr.
o(d). ? A partir de l'époque mérov., confusion fréq. entre
a(b) et
ad (
cf. TLL, s.v. ad, 558, 78
sq.; Mittellat. W., s.v. ad, 155, 12
sq.) et entre
ad et
apud (
cf. TLL, s.v. apud, 344, 35-54;
Mittellat. W., s.v. apud, 832, 1-17) ce qui explique la triple orig. de l'a. fr.
a.
HIST. ? En a. fr. la prép.
à, dont les orig. lat. sont très diverses (
cf. étymol.), a un emploi beaucoup plus large qu'en fr. mod. Au cours de l'hist. de la lang.,
à ne cesse de lutter contre des prép. concurrentes anc.
(en, de, pour) ou de création plus récente
(chez, dans, avec), le mouvement gén. étant un mouvement de recul, en partic. devant un subst. de l'animé.
I.? Emplois stables. ? Dep. l'a. fr., la prép.
à a exprimé le mouvement vers (ou jusqu'à) une limite non franchie, tant au sens concr. qu'au sens fig. Cette stab. ne va pas sans fluctuations de détail au cours de la longue période considérée.
A.? Dans le syntagme verbal. 1. Constr. indir. simple. ? À noter une concurrence
à /
de devant l'inf. (
cf. I A 1 b, rem. 3).
? En a. fr.,
à s'emploie apr. des verbes auj. suivis de
de : souffrir à,
jurer à,
menacer à (T.-L.).
? Au
xviies. :
oublier à;
manquer à;
prescrire à;
rechercher à;
risquer à;
omettre à;
retarder à;
se proposer à;
il est aisé à;
avoir accoutumé à;
prendre garde à; etc. (
Haase 1914, pp. 327-331).
? Rem. 1. Inversement
de a pu s'employer apr. des verbes suivis auj. de
à. Citons, au
xvies. :
apprendre de;
chercher de;
s'offrir de (
Goug. Gramm. 1951, p. 154).
2. À noter aussi la constr. en a. fr.
à + inf., là où le fr. mod. a la constr. dir. : Alerent
a veoir Costantinople.
Villehardouin, 192 (T.-L.).
2. Verbes à double constr.
? Concurrence des prép.
à /
de devant l'inf. dans le type
inviter qqn à + inf. (
cf. I B 4 a) : au
xvies.
de s'emploie là où l'usage mod. est de mettre
à : convier qqn de;
inciter qqn de (
Goug. Gramm., p. 154).
3. Dans le compl. circ.
a) Dans le compl. circ. de lieu (
cf. I D, rem. 1 et 3)
? Concurrence
à /
en. Ses causes : . les orig. lat. de
à, qui lui donnaient les valeurs de
en <
in et notamment celles du locatif, avec idée de pénétration. ? On sait que le lat. class. opposait
esse in urbe « être en ville » ou « à la ville », d'une part à
ire in urbem « aller en ville » (avec franchissement d'une limite et pénétration) et d'autre part à
ire ad urbem « aller vers la ville » ou « à la ville » (avec tout au plus atteinte de la limite mais sans pénétration). Il est évident que la prép.
ad s'imposait quand la pénétration était inconcevable : cas d'obj. n'ayant pas d'intériorité accessible (
ire ad januam « aller vers la porte » ou « à la porte »; cas des pers. (
ire ad aliquem « aller vers qqn » ou « à qqn »)). Le lat. vulg. avait simplifié ce système d'oppos. trop subtiles et avait fini par dire indifféremment d'une part,
ire in ou
ad urbem « aller vers la ville », « à la ville », « en ville » (sans considération de limite approchée, atteinte ou franchie) et d'autre part,
esse in urbe ou
ad urbem « être en ville » ou « à la ville » (sans considération de mouvement); cette ext. à l'expr. du locatif avait été facilitée par des tours class. exceptionnels, comme
stare ad januam « se tenir à la porte », d'où l'idée de mouvement est exclue; . un accident phonét. ? On sait que phonétiquement *
à le donne
au, mais que de même *
en le donne
el, eu, ou et risque ainsi de se confondre avec
au. C. Fahlin (
cf. bbg.,
op. cit., pp. 62-63) cite comme 1
erex. de la confusion ainsi créée,
Merlin (fin du
xiiies. ou début du
xive) où l'on trouve simultanément : (... il n'a
el monde chastiel (I, 198); (...) c'est la chose
ou monde (I, 11); (...) canques il voit
au monde (II, 179). Ses manifestations : . devant les subst. masc. à initiale vocalique
(enfer) et les subst. fém.
(forêt) qui appellent une prép. ayant le sens de « à l'intérieur de »,
en s'est imposé au prix du sacrifice de l'art., tandis que
au supplantait apparemment
en ? qu'en fait il contient ? devant les subst. masc. à initiale consonantique :
cf. en
forêt, en
enfer, mais
au bois, au paradis; . devant les subst. masc. à initiale vocalique
(hôtel) ou les subst. fém.
(maison, tête) devant lesquels la prép. peut signifier soit l'approche, soit la pénétration, l'alternance
en /
à est possible :
à la maison / en
maison de; à la tête / en
tête; à l'hôtel /
en l'hôtel; devant les subst. masc. à initiale consonantique
au supplante
en : au logis, au visage; . même phénomène pour les noms de pays et de provinces : en a. fr. la prép. usuelle est
en, à étant très rare. Or devant ces noms, précédés ou non de la prép., s'introduit l'usage de l'art., rare encore au
xiiies. puis avec une fréquence croissante jusqu'au
xvies., la tendance étant ensuite à l'élimination de l'art. Aussi trouve-t-on
en devant les noms de pays masc. à initiale vocalique et les noms fém. (l'élimination totale de
à la ou
à l' au profit de
en sans art. ne date que du
xixes. où l'on trouve les dernières attest. de
à la Chine, à la Floride). Devant les noms de pays masc.
au < *
en le ou *
à le est resté, même devant les noms très anc. (
au Portugal, au Danemark); . devant les noms de ville,
à concurrence
en, qui devient rare, dès les
xiieet
xiiies. sauf dedant les noms de villes bibliques ou lointaines. Aux
xiveet
xves.
à cède parfois la place à
en (ou à
dedanz) quand on veut souligner qu'on est à l'intérieur de la ville. D'autre part
en semble se réintroduire devant les noms de ville à initiale vocalique (
cf. C. Fahlin,
op. cit., pp. 137-145). Au
xviies. on trouve encore en
Damas, en
Florence, en
Paris et en
Alexandrie, en
Épidaure, etc. (
Haase, p. 341). Pour
en Avignon, cf. sup. I D 1, rem. 3. . Au suj. de l'oppos.
au printemps / en
été, en
automne, en
hiver, les grammairiens sont divisés. Beaucoup, tels Bally et Wartburg, la justifient par l'absence de l'art. devant
été, automne, hiver ? s'agissant de véritables noms propres l'art. était inutile ? et par sa présence (dans
au) devant
printemps <
primum tempus, à l'orig. simple nom commun ayant donc besoin d'un déterm. (sur cette question controversée
cf. C. Fahlin,
op. cit., pp. 107-111-114-116 et W. v.
Wartburg,
Problèmes et méthodes de la linguistique, pp. 113-114). . Au
xviies.
à est encore concurrencé par
en devant déterm. On trouve a)
s'intéresser en
ma conversation, en
leurs maux; avoir quelque part en
vos bonnes grâces; se confier en
la bonne fortune; croire en
les livres de Moïse; b)
mourir en
la peine; mettre en
la place de; être en
la disposition de, etc. (
Haase, pp. 341-343).
? Concurrence
à /
dans, sur, vers : . La prép.
dans s'impose vers le mil. du
xvies. (
cf. C. Fahlin,
op. cit., p. 159) et tend à supplanter
à devant les subst. ou apr. des verbes appelant une prép. signifiant « à l'intérieur de ». Mais au
xviies. l'anc. état de lang. est encore abondamment attesté par des tours comme :
se baigner au sang d'un frère; renfermer qqn à de petites choses; se jeter à d'autres desseins; être blessé à une attaque; tomber au désespoir; laisser qqn au besoin; entrer au détail; tremper au complot (
Haase, pp. 313-317).
? Rem. Inversement l'usage a imposé
à là où le
xviies. employait
dans :
s'intéresser dans
les affaires; abandonner qqn dans
sa folie; pousser les choses dans
les dernières violences; trouver du goût dans
la vie; oublier sa dignité dans
la vue de; être attaché dans
cette bienheureuse terre (
Haase, pp. 346-347). . La prép.
à a été concurrencée également par d'autres prép. de sens concr. Pour le
xviies., citons :
à supplanté par
sur : rétablir qqn au trône; trouver le diable à son chemin; insister toujours aux mêmes principes (
Haase, p. 314);
à supplanté par
vers : se frayer un chemin à la foi (
Haase, p. 321).
b) À concurrencé par le degré zéro dans le compl. circ. de temps (
cf. I E 3, rem. 1). ? Des compl. circ. auj. constr. sans prép., étaient souvent, en m. fr., précédés de la prép.
à :
au lendemain matin, à ce matin, au soir (
Goug. Gramm., p. 185).
c) Concurrence
à /
pour dans le compl. de but. ? La prép.
à avec une valeur finale a perdu du terrain au profit de
pour, comme en témoignent les emplois suiv. :
? au
xvies. : Et aultres instruments requis
a bien arboriser.
Rabelais,
Gargantua, 23.
? Au
xviies. :
avoir des appuis à se soutenir; se servir de ses mains à faire qqc.; se faire un prétexte de qqc. à ne pas ...; chercher la solitude à cacher qqc.; s'en prévaloir à éviter qqc.; n'avoir rien à rendre content; faire son possible à (
Haase, p. 331).
? Rem. Inversement
à a été parfois préféré à
pour dans l'usage mod. :
être destiné pour
posséder qqc.; se tuer pour
remarquer toutes ces choses (
Haase, p. 363).
B.? Dans le syntagme nom. ? Le syntagme nom. présente dès l'a. fr. les caractères mod. du syntagme nom. dont le subst. déterminé est un subst. concr.
1. À marquant la destination (
cf. III D 1).
? À + subst. sans art. :
à est suivi normalement d'un subst. non actualisé : boîtes
a ongement.
Meng. Rag., 1849 (T.-L.). Cependant
à + art. + subst. est plus répandu qu'en fr. mod. : fourche
au fiens.
Jub. N. Rec., II, 164, (T.-L.).
2. À marquant l'accompagnement (
cf. III D 3).
? À + subst. sans art. :
à est suivi normalement d'un subst. non actualisé : chape
a manches.
Men. Reims, 145, (T.-L.).
3. À introduisant un compl. qui exprime le moy. par lequel fonctionne un appareil ex.
roue à aubes (cf. III D 2), semble ne pas avoir existé en a. fr.
II.? Emplois en régression. ? A.? Dans le syntagme verbal. 1. Constr. indir. simple (
cf. I A 1 a, rem. 1).
? Recul du compl. indir.
à + subst. de l'animé, certains verbes qui ont maintenant un régime dir. de l'animé s'étant constr. au
xvies. avec
à + subst. de l'animé :
aider à qqn; assister à qqn; satisfaire à qqn; favoriser à qqn; rencontrer à qqn; supplier à qqn; éclairer à qqn (
Goug. Gramm., pp. 149-150).
2. À devant l'attribut de l'obj. (
cf. I C 1 pour les emplois mod. qui subsistent).
? La prép.
à a reculé au profit de
pour et
comme. En a. fr.,
à est la prép. normale apr. les verbes
avoir, prendre, vouloir : Rochebrune a
a non.
Bast., 87 (T.-L.). La concurrence
à /
pour existe dès l'a. fr. : Ne vos taing or mie
por sage ne por cortois / Ne vos an taing or mie
a sage ne por cortois.
R. Charr., 140 (T.-L.). Au
xviies., on trouve encore largement
à devant des subst. abstr. :
réputer, recevoir à faveur; compter à grand malheur; tenir à bonheur, à infamie; interpréter à mal; avoir à mépris; devenir à rien (
Haase, p. 315).
3. Dans le compl. circ.
a) Recul de
à devant un subst. de l'animé (
cf. I D, rem. 2) au profit de
chez, vers, sur : en a. fr.,
à sert très couramment à indiquer le mouvement vers une pers. : .
à signifiant « envers » :
a li n'a pas häine.
Berte, 1377, (T.-L.); .
à signifiant « sur » : traoient
as noz.
Villehardouin, 218 (T.-L.); .
à signifiant « vers, chez » :
a vos m'anvoie.
Ch. lyon, 5072 (T.-L.).
? Au
xviies.
à est encore largement empl. devant l'animé : . « chez » :
souffrir qqc. à un homme comme vous. (
Haase, p. 315); . « vers » : (
se)
tourner à un officier. (
Haase, p. 314); . « sur » :
se lancer à lui. (
Haase, p. 314).
? Recul de
à devant un subst. de l'animé au profit de
avec, contre, pour exprimer l'accompagnement, la relation. . En a. fr. :
à lui se vuet asseyer.
Rich., 2217 (T.-L.). Tobie
a sa fame ne jut.
Tob., 1011 (T.-L.)... de cumbatre
as Turs avoient grant ardour.
Bast., 170 (T.-L.). Et va a chascun(s) demandant Qui est li sire
a cui il vont Et cil lors respondu li ont Qu'il vont au seignor de Cocagne.
Joufr., 1370 (T.-L.). « Je tire
a vous de l'erbalestre » c'est-à-dire : « Je tireray
avec vous de l'erbalestre ».
Fabri,
Art. de Rhetor, I, 13 (Hug.). . Au
xviies. : Tu suis mes ennemis, t'assembles
à leur bande.
Malh., I, 7, 89 (Haase, p. 320). Je m'amuse
a votre fille.
Sev., II, 444 (Haase, p. 320). . A noter, en fr. mod., l'alternance
à /
avec /
contre apr.
se battre, se mesurer. ? Recul de
à marquant l'intérêt. ? En a. fr., le tour suiv. est fréq. :
Au conte ocïent son cheval.
G. Gui. I, 5404 (T.-L.). Aux
xviieet
xviiies., on hésite entre
à et
pour : On fait
pour Camille un crime de sa flamme.
Corneille,
Othon, IV, 1, 1206 (Haase, p. 363). Ce n'est pas un petit avantage
à un homme ... de n'avoir point à faire de guerre à sa patrie.
Balzac,
Dissert. chrét., V (Haase, p. 335). D'autre part la prép.
à continue en a. fr., la prép. lat.
ab marquant l'orig. : prent cungé
a ses freres.
S. Brand., 145 (T.-L.). Apprenneiz
a mi, ke ...
S. S. Bern., 17, 25 (T.-L.).
A cui marceant l'acaterent.
Fl. et Bl., 511 (T.-L.). Cette constr. a été éliminée par
de et des loc. adv. comme
auprès de, de la part de. ? L'agent (apr. un inf. dépendant de
laisser ou
faire à la voix pronom.) a cessé de pouvoir être constr. avec
à (
cf. I B 2) : La Grèce ne lui a point reproché de s'être laissé gouverner
à Nestor.
Balzac,
De la Cour. disc. I (Haase, p. 337).
b) Recul de
à devant un subst. de l'inanimé.
? Recul de
à au profit de
avec, pour exprimer la manière, la circonstance (
cf. I F 1). Troverent le conte Loeys
a grand plenté de bons chevaliers.
Villehardouin, 498 (T.-L.). Noter dans les ex. suiv. la c?xistence de
avec ou
od + subst. de l'animé et de
à « avec » + subst. de l'inanimé : Tut li altre passerent od le rei l'ewe de Cedron
a plainte,
a duleur e
a plur.
Rois, II, XV, 22 (Gdf.). Revenoient
avec leurs peres ...
a mains d'avoir et
a plus de pechiez.
L. Mest., 236 (T.-L.). En fr. mod.
à subsiste encore dans des compl. circ. figés :
à foison, à grands cris, etc.
? Recul de
à au profit de
par, de, pour exprimer une circonstance explicative (
cf. I F 2 c) :
Al sanc qu'il ot perdu et
al caut quil destraint se pasma quatre fois.
R. Alix., 188, 1 (T.-L.).
A l'orgueil de ce traître De mes ressentimens je n'ai pas été maître.
Molière,
Tart. V, 3, 1709 (Haase, p. 324).
? Rem. Pour
à par, symétrique de
de par, cf. par. B.? Dans le syntagme nom. ? Une modification fondamentale se produit dans le syntagme nom. : la prép.
à a cessé d'introd. le compl. d'appartenance et a été remplacée par
de. On disait en a. fr.
la nef à cil saint home; la terres as dous freres; la mere au roi; l'amor au saint home; la coe au lion, etc. (d'apr. T.-L.) : Se jo ne sui fille
de roi Si sui je fille
a rice conte.
Parton., 10216, Crapelet (Gdf.).
? Rem. Dans ce dernier ex. on notera la coexistence des 2 prép.
à et
de. En m. fr.
à + subst. de l'animé est encore fréq., mais
de est devenu la constr. usuelle : La bauge du sanglier, du cerf la reposee, La ruche de l'abeille et la loge
au berger.
D'aubigné,
Trag. II, 1525 (Goug., p. 211). Auj. la constr. ne survit plus que dans la lang. pop. et fam. :
la cousine à Germaine; un fils à papa (
cf. III D 6 b, rem. 1).