Définition de « oeuf »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot oeuf de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur oeuf pour aider à enrichir la compréhension du mot Oeuf et répondre à la question quelle est la définition de oeuf ?
Une définition simple : oeuf
Définitions de « oeuf »
Trésor de la Langue Française informatisé
OEUF, subst. masc.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Masse de matière arrondie et enveloppée d'une coque calcaire, que pond la femelle des oiseaux et qui renferme le germe de l'oiseau futur, enveloppé de liquides destinés à nourrir celui-ci jusqu'à son éclosion. Œuf de poule, de canard, de pigeon, d'autruche, etc. Les oiseaux pondent des œufs, couvent des œufs. Faire éclore des œufs. Le mâle et la femelle ont abandonné leurs œufs.
ŒUF se dit absolument pour l'Œuf de poule employé comme aliment. Blanc d'œuf. Jaune d'œuf. Coquille d'œuf. Œuf frais. Une douzaine d'œufs. Faire cuire des œufs à la coque, sur le plat, au beurre noir, brouillés, pochés, etc. Œuf mollet. Œuf dur. Gober un œuf. Battre des œufs pour faire une omelette. Des œufs farcis. Battre des blancs d'œufs. Des œufs au lait, à la neige. Œufs rouges, Œufs durs dont la coque est teinte en rouge et qu'il est d'usage de vendre vers le temps de Pâques. Par analogie, Œuf de Pâques, Sorte de friandise, en sucre ou en chocolat, qui a la forme d'un œuf. Fig. et fam., Donner un œuf pour avoir un bœuf, Faire un léger présent dans l'espoir d'en obtenir en retour un considérable. Fam., Plein comme un œuf, Tout à fait plein. Fam., Il tondrait sur un œuf se dit d'un Homme fort avare, qui cherche à faire du profit sur les moindres choses. Fig. et fam., Mettre tous ses œufs dans le même panier, Placer tous ses fonds dans une même affaire. Il signifie aussi Faire dépendre d'une seule chose son sort, sa fortune, son bonheur, etc. Fig. et fam., Marcher sur des œufs, Marcher avec une précaution excessive. Il signifie aussi Être obligé par des circonstances délicates de se conduire avec une extrême circonspection.
ŒUF se dit, par analogie, d'un Objet en bois, en forme d'œuf de poule, dont on se sert pour repriser plus commodément les bas. Il se dit aussi, par extension, des Produits des animaux vivipares qui servent à leur reproduction. Œuf de poisson. Œuf de serpent. Œuf de fourmi, de ver à soie. Il signifie encore, au figuré, Germe, principe, commencement. Tuer dans l'œuf. Écraser une sédition dans l'œuf.
Littré
-
1Masse qui se forme dans les ovaires et les oviductes des oiseaux, et qui, sous une enveloppe commune, renferme le germe animal futur (ovule), et certains liquides destinés à le nourrir pendant quelque temps. Des ?ufs de rossignol. Les oiseaux viennent d'?ufs, pondent des ?ufs, couvent des ?ufs. On a pris la mère sur les ?ufs.
Dès qu'un ?uf est pondu, il commence à transpirer, et perd chaque jour quelques grains de son poids par l'évaporation des parties les plus volatiles de ses sucs
, Buffon, Ois. t. III, p. 112.Ces ?ufs [d'autruche] sont très durs, très pesants et très gros?; mais on se les représente quelquefois encore plus gros qu'ils ne sont, en prenant des ?ufs de crocodiles pour des ?ufs d'autruche
, Buffon, ib. t. II, p. 252.L'?uf de poule est composé de blanc, de jaune, de ligaments qu'on nomme glaire, de la cicatricule, d'une membrane mince intérieure, et d'une coquille solide placée au dehors et servant d'enveloppe à toutes les parties qui en constituent l'ensemble
, Fourcroy, Connaiss. chim. t. X, p. 307, dans POUGENS. -
2 Absolument, ?ufs se dit pour ?ufs de poule, qui sont d'un grand usage comme aliment. Un ?uf mollet. Un ?uf dur. Une omelette de six ?ufs.
Elle [la grenouille] qui n'était pas grosse en tout comme un ?uf
, La Fontaine, Fabl. I, 3.Notre laitière ainsi troussée Comptait déjà dans sa pensée Tout le prix de son lait, en employait l'argent, Achetait un cent d'?ufs, faisait triple couvée
, La Fontaine, ib. VII, 10.Il [Charlemagne] ordonnait qu'on vendit les ?ufs des basses-cours de ses domaines et les herbes inutiles de ses jardins
, Montesquieu, Esp. XXXI, 18.Pour juger qu'un ?uf est frais, les ménagères le présentent à la lumière d'une chandelle?: s'il est transparent et plein, c'est la preuve qu'il vient d'être pondu
, Parmentier, Instit. Mém. scienc. 1806, 2e sem. p. 47.?uf à la mouillette, ?uf à la coque, ?uf cuit dans la coquille de manière que le blanc soit seul pris, et que le jaune reste liquide.
?ufs clairs, ?ufs qui n'ont pas été fécondés par le coq.
Ces ?ufs pondus sans coq sont ce qu'on appelle vulgairement des ?ufs clairs, et l'on ne sait pourquoi ils ont été accusés d'être moins sains et moins savoureux que les autres
, Parmentier, Instit. Mém. scienc. 1806, 2e sem. p. 37.?ufs rouges, ou ?ufs de Pâques, ?ufs durcis dont la coque est teinte en rouge et qu'on vend vers le temps de Pâques. Autrefois c'était l'usage le lundi de Pâques de donner aux enfants des ?ufs durcis et teints, avec lesquels ils jouaient à certains jeux?; cet usage tend à se remplacer par l'usage d'?ufs en carton dans lesquels on met comme dans une boîte de petits jouets et des bonbons.
Mme R? était vêtue d'un rouge foncé qui lui sied mal?; et notre ami lui disait?: Comment?! chère s?ur, vous voilà belle comme un ?uf de Pâques
, Diderot, Mém. t. I, p. 339, dans POUGENS.?ufs de Pâques, dans le Midi, ?ufs que les paroissiens donnent à leur curé qui va bénir les maisons.
Fig. et familièrement. Donner à quelqu'un ses ?ufs de Pâques, lui faire quelque présent à Pâques.
Ô mes anges, daignez recevoir pour vos ?ufs de Pâques ce Droit du seigneur [comédie de Voltaire]
, Voltaire, Lett. d'Argental. 10 avr. 1762.?uf blanc, celui qui ne renferme pas de jaune.
?uf de coq ou cocatrix, ?uf regardé par la superstition populaire comme résultat de l'accouplement d'un serpent et d'une poule, ou d'un vieux coq et d'une couleuvre?; ce n'est qu'un ?uf avorté de poule qui a de la ressemblance avec les ?ufs véritables de couleuvres, dont la présence est assez fréquente dans les poulaillers.
Le cultivateur du Bocage qui trouve un ?uf de coq dans sa basse-cour se signe et l'écrase du pied, de peur qu'il ne soit trouvé par un chat?; condition nécessaire pour qu'un basilic vienne au monde
, Viaud-Grand-Marais, les Serpents de la Vendée, dans Revue de Paris, 20 nov. 1867, p. 286.Fig. Marcher sur des ?ufs, aller avec précaution, ménagement.
Le premier [Villeroy] était vendu au duc du Maine?; l'autre [l'évêque de Troyes], marchant sur des ?ufs, n'osait être que complaisant
, Saint-Simon, 422, 93.Dubois avait marché sur des ?ufs à l'égard du parlement
, Saint-Simon, 508, 199.Je marche sur des ?ufs entre ces deux partis
, Mme du Deffand, Lett. à H. Walpole, t. II, p. 207, dans POUGENS.Plein comme un ?uf, tout à fait plein.
Être plein comme un ?uf, avoir bien mangé.
Chercher à tondre sur un ?uf, agir en avare qui cherche à faire du profit sur les moindres choses.
Fig. Il pond sur ses ?ufs, il couve ses ?ufs, se dit d'un homme riche qui n'a pas besoin de travailler.
Fig. Mettre tous ses ?ufs dans un même panier, mettre tout son avoir dans une même entreprise, dans un même placement, de manière que, s'il y a un revers, on perdra tout?; et aussi faire dépendre d'une seule chose son sort, sa fortune, son bonheur.
Je jure de ne plus mettre Tous mes ?ufs dans un panier
, Boursault, Lett. nouv. t. III, p. 394, dans POUGENS.Se ressembler comme deux ?ufs, se dit de choses qui se ressemblent tout à fait.
Un ?uf n'est pas plus semblable à un ?uf que les observations de Bullus le sont aux miennes
, Jurieu, dans BOSSUET 6e avert. 80.Cela est égal comme deux ?ufs, se dit d'une chose indifférente.
Fig. Donner un ?uf pour avoir un b?uf, faire de petits présents dans l'espérance d'en recevoir de gros en retour.
Comme il n'y a pas de proportion entre ces choses-là, je n'aime point à donner un ?uf pour avoir un b?uf
, Rousseau, Lett. à Panckoucke, 21 déc. 1764.Je ne lui ai dit ni ?uf ni b?uf, je ne lui ai dit ni grosse ni petite injure.
Il ne saurait pas tourner un ?uf, se dit d'un maladroit qui ne sait rien faire.
Il aimerait mieux deux ?ufs qu'une prune, se dit d'un homme qui ne fait pas le dégoûté.
Ris-t-en, Jean, on te frit des ?ufs, se dit pour se moquer de quelqu'un qui rit.
Populairement. Elle a cassé ses ?ufs, se dit d'une femme qui accouche avant terme.
-
3 Par extension, le nom d'?ufs se donne aux produits, analogues aux ?ufs des oiseaux, qui se forment dans le corps des femelles appartenant à de tout autres classes d'animaux. ?ufs de couleuvre. ?ufs de brochet. Un ?uf de tortue. Des ?ufs de ver à soie.
Il est des ?ufs d'insectes qui ont une sorte de couvercle que le petit fait sauter ou qu'il soulève pour venir au jour
, Bonnet, Contempl. nat. ?uv. t. VIII, p. 327, dans POUGENS.?ufs de fourmis, très petits ?ufs, presque imperceptibles, qui donnent naissance aux larves et nymphes, dites improprement ?ufs de fourmis (voy. FOURMI).
- 4Chez les mammifères, on donne le nom d'?uf au produit de la conception, quand il est parvenu dans la matrice?; jusque-là il porte celui d'ovule.
-
5En un sens plus général, dans le langage des physiologistes, ?uf désigne à la fois l'ovule ou germe dont l'existence est absolument générale, et l'?uf proprement dit qui résulte de l'addition successive à l'ovule de nouvelles parties durant son évolution et son trajet.
Harvey prétend que l'homme et tous les animaux viennent d'un ?uf, que le premier produit de la conception chez les vivipares est une espèce d'?uf, et que la seule différence qu'il y ait entre les vivipares et les ovipares, c'est que les f?tus des premiers prennent leur origine, acquièrent leur accroissement, et arrivent à leur développement entier dans la matrice, au lieu que les f?tus des ovipares prennent à la vérité leur première origine dans le corps de la mère, où ils ne sont encore qu'?ufs?
, Buffon, Hist. anim. chap. 5.Il [Vallisnieri] ajoute qu'il est persuadé que l'?uf est caché dans la cavité du corps glanduleux [l'ovaire], et que c'est là où se fait tout l'ouvrage de la fécondation, quoique, dit-il, ni moi ni aucun des anatomistes en qui j'ai eu pleine confiance, n'ayons jamais vu, ni trouvé cet ?uf
, Buffon, ib. -
6 Terme d'anatomie. ?ufs de Graaf, ou vésicules de Graaf, petits sacs membraneux qui se trouvent dans l'ovaire.
?ufs de Naboth, nom donné à des concrétions globuleuses distendant les follicules qui occupent la membrane interne du col de l'utérus.
- 7?uf de serpent, espèce d'amulette des druides, auquel ils attribuaient de grandes vertus, et qu'ils croyaient formé de la bave des serpents, lorsqu'ils étaient entortillés ensemble.
-
8?uf primitif, ou ?uf d'Orphée, symbole mystérieux de certains philosophes anciens pour désigner le principe intérieur de fécondité.
?uf philosophique, la matière préparée des alchimistes, pour produire le grand ?uvre, ou transmutation des métaux.
- 9?uf de vache, ?uf de chamois, espèce de bézoard, qui se trouve dans le ventre de ces animaux.
- 10Tout ce qui a la forme d'un ?uf. Les femmes se servent d'?ufs en bois pour raccommoder les bas.
- 11Se disait, chez les Grecs, de petites pièces de poésie, dont les vers, de différentes longueurs et placés les uns sous les autres, représentaient grossièrement la forme d'un ?uf?; on en trouve des exemples dans l'Anthologie.
- 12 Terme de marine. ?uf d'autruche, sorte de bouchon pour boucher les trous de boulet.
- 13?ufs fossiles, pierres qui paraissent être des échinites.
-
14?uf du diable, espèce de champignon.
Petits ?ufs, espèce d'agarics.
?ufs à l'encre, à la neige, divers champignons.
-
15?uf marin, oursin.
?uf de poule ou ?uf papyracé, coquille univalve.
?uf de vanneau, autre coquille univalve.
HISTORIQUE
XIIIe s. ?Comme est l'escaille d'un uef, qui enclost et enserre ce qui est dedanz
, Latini, Trés. p. 110. Et maintenant fist atourner cuir de beuf de quatre doubles, ausi ront come un oef
, Ch. de Rains, p. 95. Une geline oï cover, Que desor li avoit douze oes
, Ren. 23389. Atant es vos une mesenge Sor la branche d'un chesne crues [creux], Où ele avoit repost ses oes
, ib. 1728.
XIVe s. Un vaisselet d'argent à mangier ?ufs, que donna à Monseigneur Mons r d'Estampes
, De Laborde, Émaux, p. 424. Une couppe d'un euf d'autruce, et est d'argent blanc, greneté dedans
, De Laborde, ib. p. 407. Lesquelz allerent demander leur potage, que en appelle eufs de pasques
, Du Cange, ovum.
XVe s. Mais se je truis [si je trouve] le kokin et le sourt, Lequel on dit qu'il voelt [veut] nos oes humer?
, Froissart, Poésies mss. p. 300 dans LACURNE. Et estoit son scel, sa bouche et son dire lettriage, leal comme or fin et entier comme un ?uf
, Chastelain, Éloge du bon duc Philippe.
XVIe s. M'as-tu donc baillé ceste bride?? M'as-tu pellé cest ?uf mollet [joué ce mauvais tour]??
Rec. de farces, etc. p. 393. Huile d'?ufs
, Paré, V, 29. Alembic, calcinatoires, fours secrets des philosophes, ?ufs des philosophes, cornue
, Paré, t. III, p. 638. Il partiroit un ?uf en deux?; il trouveroit à tondre sur un ?uf?; il ne donneroit pas un gros ?uf pour un menu?; pour dire il est avare
, H. Estienne, Précell. p. 77 et 78. Il est fait comme quatre ?ufs [mal fait, de mauvaise grâce]
, Oudin, Curios. franç. À l'aventure met on les ?ufs couver
, Leroux de Lincy, Prov. t. I, p. 187. Je mange un ?uf mollet, je suis bien empesché
, Leroux de Lincy, ib. t. II, p. 205. Ne romps l'?uf mollet, si ton pain n'est apresté
, Leroux de Lincy, ib. p. 354. Tel cuide avoir des ?ufs au feu, qui n'a que des escailles
, Leroux de Lincy, ib. p. 420. Un ?uf ne vault guere sans sel
, Leroux de Lincy, ib. p. 432. Aigle né dans le haut des plus superbes aires, Ou bien, ?uf supposé, puisque tu degeneres, Degeneré Henri
, D'Aubigné, Tragiques, Princes.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
?UF. Ajoutez?:Ce sont les ouvriers de Nuremberg qui firent les premières montres portatives que l'on avait à la cour de Charles IX et de Henri III? les plus ordinaires, de forme ovale ou d'amande, étaient nommées à Paris, dit-on, des ?ufs de Nuremberg, Journ. offic. 28 août 1876, p. 6649, 3e col.
Encyclopédie, 1re édition
?UF, dans l'Histoire Naturelle, c'est cette partie qui se forme dans les femelles des animaux, & qui, sous une écaille ou écorce qu'on nomme coque, renferme un petit animal de même espece, dont les parties se développent & se dilatent ensuite, soit par incubation, soit par l'accession d'un suc nourricier.
Les especes d'animaux qui produisent des ?ufs se nomment en particulier ovipares ; & la partie de la femelle dans laquelle l'?uf se forme, se nomme ovaire. Voyez Ovaire.
Comme de tous les ?ufs ceux des poules ou ceux dont se forment les poulets sont les plus communs & en même tems ceux qui ont été plus observés, nous dirons quelque chose ici de leur structure & de la maniere dont les poulets s'y engendrent.
La partie extérieure d'un ?uf de poule est donc la coque, écorce blanche, mince, friable, qui renferme & garantit toutes les autres parties des injures qu'elles auroient à craindre du dehors. Immédiatement après la coque il y a une membrane commune, membrana communis, qui tapisse toute la cavité de la coque, & qui lui est attachée très-serrée, excepté dans le gros bout de l'?uf, où on découvre entre ces deux parties une petite cavité qui peu-à-peu devient plus considérable. Dans cette membrane sont contenus les deux albumina ou blancs, enveloppés chacun dans sa membrane propre. Dans le milieu du blanc est le vitellus ou jaune, enveloppé aussi particulierement dans son enveloppe ou membrane particuliere : l'albumen extérieur est oblong ou ovale, & il suit la figure de la coque ; l'intérieur est sphérique, & d'une substance plus crasse & plus visqueuse, & le jaune est de la même figure. A chacune de ses extrémités est un chalaza, & les deux ensemble sont comme les poles de ce microcosme : ce sont des corps blancs, denses, dont chacun est composé de trois petits globules, semblables à des grains de grêle joints ensemble. Non-seulement c'est dans ces chalazas que les différentes membranes sont jointes ou attachées ensemble, ce qui fait que les différentes liqueurs se tiennent chacune dans sa place ou sa position respective ; mais ils servent encore à tenir toujours une même partie de l'?uf en en haut, de quelque côté qu'on se tourne. Voyez Chalaza.
Vers le milieu, entre les deux chalazas, sur le côté du jaune & dans sa membrane, est une petite vessie de la figure d'une vessie ou lentille, qu'on appelle en latin cicatricula, & en françois germe, & que quelques auteurs nomment aussi l'?il-de-b?uf, & qui contient une humeur dans laquelle le poulet s'engendre.
Toutes ces parties qu'on distingue dans l'?uf de poule, se trouvent aussi dans les autres ?ufs : l'une des parties de l'?uf est ce dont l'animal se forme, & le reste est destiné à sa nourriture ; suivant cela, la premiere semence ou stamen du poulet est dans la cicatricule.
L'albumen est le suc nourricier qui sert à l'étendre & à le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne gros, & le jaune lui sert de nourriture lorsqu'il est tout-à-fait formé, & même en partie lorsqu'il est éclos ; car il reste après que l'?uf est éclos une bonne partie du jaune, laquelle est reçue dans le ventre du poulet comme dans un magasin, & portée de-là par les appendicula ou canal intestinal, aussi bien que par entonnoir, dans les boyaux, & qui sert comme de lait. Voyez Eclore & Punctum saliens.
Un ?uf proprement dit est ce du total dequoi l'animal se forme ; tels sont ceux des mouches, des papillons, &c. qu'Aristote appelle vermiculi.
Il y a entre cette derniere espece d'?ufs & la premiere, cette différence, qu'au lieu que ceux de la premiere espece (aussi-tôt que la femelle les a pondus) n'ont plus besoin que de chaleur & d'incubation, sans aucune nourriture extérieure, pour porter le f?tus à sa perfection ; ceux de la derniere espece, après qu'ils sont tombés de l'ovaire dans la matrice, ont besoin des sucs nourriciers de la matrice pour s'étendre & grossir : c'est aussi ce qui fait qu'ils restent plus long-tems dans la matrice que les autres.
La principale différence qui se trouve entre les ?ufs proprement dits, c'est qu'il y en a qui sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils ne manquent d'aucune des parties que nous venons de décrire, lors même qu'ils sont-dans l'ovaire ou dans la matrice ; & d'autres imparfaits, qui n'ont toutes ces parties à-la-fois qu'après qu'ils sont pondus : tels sont les ?ufs des poissons, où se forme un albumen pour les garantir de l'eau lorsqu'ils sont déja hors du corps de la mere.
Une autre différence, c'est qu'il y en a de fécondés & d'autres qui ne le sont point : les premiers sont ceux qui contiennent un sperme que le mâle injecte dans le coït, pour les disposer à la conception ; les autres ne sont point imprégnés de ce sperme, & ne donnent jamais des petits par incubation, mais seulement par putréfaction. Un ?uf fécondé contient les rudimens du poulet avant même que la poule ait commencé à le couver. Le microscope nous fait voir à découvert dans le milieu de la cicatricule la carcasse du poulet qui nage dans le liquamen ou l'humeur ; elle est composée de cinq petites zones ou cordons que la chaleur de l'incubation future grossit en rarefiant & liquefiant la matiere premiere de l'albumen, & ensuite celle du germe, & les faisant entrer dans les vaisseaux de la cicatricule pour y recevoir encore une préparation, une digestion, une assimilation & une accrétion ultérieure, jusqu'à ce que le poulet devenu trop gros, ait rompu la coque & soit éclos.
On croyoit autrefois qu'il n'y avoit que les oiseaux & les poissons, avec quelques autres animaux, qui fussent produits ab ovo, par des ?ufs ; mais le plus grand nombre des modernes inclinent plutôt à penser que tous les animaux & les hommes mêmes sont engendrés de cette maniere. Harvé, Graaf, Kerkringius, & quelques grands anatomistes, ont si bien défendu cette opinion, qu'elle est à-présent généralement reçue.
On voit dans les testicules des femmes de petites vésicules qui sont environ de la grosseur d'un pois verd, qu'on regarde comme des ?ufs : c'est ce qui a fait donner par les modernes le nom d'ovaires à ces parties, que les anciens appelloient testicules ; ces ?ufs fécondés par la partie la plus volatile & la plus spiritueuse de la semence du mâle, se détachent de l'ovaire & tombent par le conduit de Fallope dans la matrice, où ils se forment & grossissent. Voyez Conception & Génération.
Plusieurs observations & plusieurs expériences concourent pour donner plus de poids à ce système, & pour le confirmer. M. de Saint-Maurice ayant ouvert une femme à Paris en 1682, lui trouva un f?tus parfaitement formé dans le testicule.
M. Olivier médecin de Brest, assure qu'en 1684, une femme qui étoit grosse de sept mois accoucha dans son lit d'un grand plat d'?ufs, liés ensemble comme une grappe de raisin, & de différentes grosseurs, depuis celle d'une lentille, jusqu'à celle d'un ?uf de pigeon. Wormius rapporte avoir vu lui-même une femme qui étoit accouchée d'un ?uf ; & Bartholin confirme la même chose, Cent. prem. hist. anat. IV. p. 11. Le même auteur dit qu'il avoit connu à Coppenhague une femme, qui au bout de douze semaines de grossesse, avoit jetté un ?uf enveloppé d'une coque mollasse. Lauzonus, Dec. 11. ann. IX. obs. xxxviij. p. 731. des mém. des curieux de la nature, rapporte la même chose d'une autre femme grosse de sept semaines. L'?uf qu'elle rendit, n'étoit ni aussi gros qu'un ?uf de poule, ni aussi petit qu'un ?uf de pigeon : il étoit couvert de membranes, au lieu de coque. La membrane extérieure appellée chorion, étoit épaisse & sanguinolente ; l'intérieure nommée amnios, étoit déliée & transparente ; & elle renfermoit une humeur blanchâtre, dans laquelle nageoit l'embryon attaché par les vaisseaux umbilicaux, lesquels ressembloient à des fils de soie.
Bonnet dans sa lettre à Zuinger, publiée dans les éphémérides des curieux de la nature, Déc. ann. 2. observ. clxxxvj. p. 417. rapporte qu'une jeune fille avoit rendu une grande quantité de petits ?ufs. Conrade Virsungius dit qu'en faisant l'anatomie d'une femme qui avoit une descente, il trouva dans une des trompes des ?ufs de différentes grosseurs. Enfin, on voit encore de semblables exemples dans Rhodius, Cent. 111. observ. lvij. & dans différens endroits des mémoires des curieux de la nature : de sorte que Berger dans son traité de naturâ humanâ, liv. II. chap. j. p. 461. n'hésite point de penser que la seule différence qu'il y ait entre les animaux qu'on nomme vivipares, & ceux qu'on appelle ovipares, c'est que les derniers jettent leurs ?ufs hors de leur corps, & les déposent dans un nid, & que leurs ?ufs contiennent toute la nourriture nécessaire à leur fruit ; au lieu que dans les derniers, les ?ufs sont déposés des ovaires dans la matrice, qu'ils ont peu de suc, & que la mere fournit le reste de l'aliment.
Il n'y a pas jusqu'aux plantes dont Empedocles, & depuis Malpighi, Rallius, Fabrice d'Aquapendente, Grew, & d'autres, n'ayent prétendu que la génération se fait par des ?ufs. Voyez Plante.
D'un autre côté, nous avons plusieurs exemples où les animaux ovipares ont produit leurs petits tout vivans & sans ?ufs. On en rapporte en particulier d'un corbeau, d'une poule, de serpens, d'un poisson, d'anguilles, &c. Voyez Isibord, ab Amelanxen, breviar. memorabil. n°.28. in append. mém. nat. cur. dec. 11. an. 4. p. 201. Lyserus, observ. VI. envoyée à Bartholin, Aldrovand. hist. serp. & dracon. p. 309. Seb. Nuremberg, de miraculis naturæ in Europ. c. xlj. franc. Paulin, de anguilla, sect. prem. chap. ij. &c.
Ce n'est pas tout : les Physiciens rapportent des exemples de mâles qui ont jetté des ?ufs par le fondement. Ce fait paroîtra si ridicule à un lecteur sage, qu'on pourroit nous blâmer de transcrire ici les passages sur lesquels on l'appuie ; & ainsi nous nous contenterons de renvoyer le lecteur qui aura assez de curiosité pour les confronter aux auteurs d'où nous aurions pû les tirer : savoir, Christophe Paulin, Cynograph. curios. sect. I. liv. III. §. 56. M. nat. cur. Dec. 11. ann. 8. observ. cxvij. p. 261. & Dec. 1. ann. 2. observ. ccl. & Dec. 11. ann. 4. append. 199. Schculk, hist. monast. p. 129. &c.
M. Hotterfort pense qu'il a bien pu se faire au moins dans quelque cas, que ce qu'on avoit pris pour des ?ufs, ne fût que des alimens mal digérés & coagulés, ainsi qu'il l'a trouvé une fois lui-même. Quant aux ?ufs des femmes, Wormius & Fromann, lib. III. de fascinat. v. 6. cap. xx. §. 9. pag. 882. ont cru que c'étoit un effet du pouvoir du démon ; mais M. Bartholin & M. Stotterfoht, se moquent avec raison de cette relation.
Gousset, de causis linguæ hebraïcæ, taxe le sentiment moderne de la génération ab ovo, d'être contraire à l'Ecriture ; & d'autres ont cru voir dans la semence des animaux mâles, l'animal en vie & tout formé. Voyez Animalcule & Semence.
Malpighi fait des observations très-curieuses avec le microscope de tous les changemens qui arrivent dans l'?uf qu'une poule couve de demi-heure en demi-heure. Vossius & divers autres auteurs sont fort embarrassés de décider cette question, lequel a existé le premier de l'?uf ou de la poule, de idol. lib. III. cap. lxxviij.
En Egypte, on fait éclore les ?ufs par la chaleur d'un fourneau ou d'un four, & on en fait quelquefois éclore sept ou huit mille tout-à-la-fois. On trouve la maniere dont on se sert pour cela décrite dans les Transactions philosophiques. Voyez Éclore. Voyez ces fours, Pl. d'Agricul.
On dit qu'à Tunquin on conserve les ?ufs pendant trois ans, en les enveloppant d'une pâte faite de cendre & de saumure. La tortue fait, à ce qu'on dit, jusqu'à quinze cens ?ufs qu'elle couvre de sable, & qu'elle abandonne à la chaleur du soleil pour éclore ; les ?ufs d'Autruche éclosent de la même maniere. Villugh. Ornithol. Lib. II. c. viij. §. 1.
Dans les acta eruditorum de Lips. Leypsik, année 1683. p. 221. il est parlé d'un ?uf de poule tout semblable aux ?ufs ordinaires, au milieu duquel on en trouva un autre de la grosseur d'un ?uf de pigeon. Voyez Superfétation.
Les ?ufs à double coque ne sont pas rares ; Harvey donne fort au long dans son traité de la génération de l'animal, l'explication de cette apparence.
Chez les anciens l'?uf étoit le symbole du monde, & c'étoit une tradition parmi eux que le monde avoit été fait d'un ?uf, ce qui rendit les ?ufs d'une grande importance dans les sacrifices de Cybele, la mere des dieux : quelques-uns de leurs faux-dieux étoient aussi venus d'un ?uf.
?uf vuide, voyez Vuide.
?uf de vache, c'est un nom que quelques auteurs donnent à une espece de besoard qu'on trouve dans l'estomac de la vache.
?uf, en Architecture, ornement de forme ovale qu'on pratique dans l'echinus ou quart de rond du chapiteau ionique & composite, le profil ou le contour de l'échinus s'enrichit d'?ufs & d'ancres placés alternativement. Voyez nos Pl. d'Architecture. Voyez aussi Echinus, Ove, &c.
?uf philosophique, en Chimie, voyez Philosophique.
?uf, (Physique générale.) on trouve quelquefois des ?ufs extraordinaires en petitesse, en grosseur, en figure, sans coque, sans jaune ; d'autres qui ont une double coque ; d'autres qui renferment un second ?uf ; d'autres qui contiennent des corps étrangers, comme des pois, des lentilles, des épingles, &c. Enfin, j'ai recueilli beaucoup d'observations en ce genre ; mais il suffira d'en citer quelques-unes.
Le petit ?uf, ou l'?uf nain, que les Ornithologistes nomment communément, ovum centeninum, est le dernier que la poule ponde de la saison. Cet ?uf pour l'ordinaire ne contient pas de jaune, mais une espece de glaire ou de blanc. Il n'est pas surprenant que ce dernier ?uf soit si petit ; mais il est assez étonnant qu'une poule ne ponde jamais que de ces ?ufs nains.
Malpighi vous donnera la raison pourquoi ces ?ufs sont stériles, & ne produisent jamais de poulets.
Il y a d'autres ?ufs qui surpassent de beaucoup les ?ufs communs en grosseur. On les nomme ova gemellifica ; il semble même qu'Aristote s'en soit apperçu : mais il est certain qu'il n'y a que les oiseaux domestiques qui pondent de ces sortes d'?ufs : ils contiennent deux blancs & deux jaunes, & M. Harvey remarque que communément ils renferment deux poulets, qui quoiqu'éclos ne vivent pas.
De tous les ?ufs extraordinaires, il n'y en a guere de si remarquables que ceux qui ont une double coque, & que Harvey appelle ovum in ovo : cet habile homme explique en même tems les causes de ce phénomene dans son traité de generatione animalium.
Le petit ?uf renfermé dans un grand, est ordinairement de la grosseur d'une olive, pointu par le bout, couvert d'une membrane dure, épaisse, & cassante. L'humeur qu'il contient est moins jaune que dans les autres ?ufs.
M. Méri a montré à l'académie des Sciences un ?uf de poule cuit, dont le blanc renfermoit un autre petit ?uf revétu de sa coque & de sa membrane intérieure, & rempli de la matiere blanche sans jaune.
On a fait voir à la même académie en 1745, un ?uf de poule d'Inde, dans lequel étoit renfermé un autre ?uf garni de sa coque. Ceux qui savent que la coque de l'?uf ne se forme que dans l'oviductus, ou canal qui conduit l'?uf de l'ovaire au-dehors de l'animal, sentiront combien doivent être rares les circonstances nécessaires pour produire un pareil effet.
M. Petit porta en 1742 à la même académie un petit corps oviforme d'environ dix lignes de longueur, & de cinq lignes de diametre, qu'il avoit trouvé dans le blanc d'un ?uf. Ce corps qui étoit lui-même une espece de petit ?uf, n'étoit attaché au grand que par un pédicule assez court, & qui avoit peu de consistance : on y voyoit quatre enveloppes : l'extérieure étoit assez solide, puisqu'en étant séparée, elle conservoit sa forme & se soutenoit par elle-même, ce que ne faisoient point les autres. A chaque séparation des trois premieres enveloppes, ainsi prises extérieurement, le petit corps conservoit sa figure ; mais on n'eut pas plutôt séparé la quatrieme, que tout ce qui y étoit renfermé s'échappa en forme de blanc d'?uf sans jaune.
Il y a des poules qui par un effet de la structure de leur ovaire, pondent toujours des ?ufs sans jaune. Il y en a d'autres qui n'en pondent que quelquefois ; savoir, lorsque dans des efforts, on par quelque cause extérieure, le jaune de l'?uf se creve dans l'oviductus ; mais la cause n'étant pas constante, elles en font aussi de bien conditionnés.
Quant aux poules qui pondent quelquefois des ?ufs sans coque, cela vient ou de quelque maladie qui irritant la trompe, leur fait chasser l'?uf avant le tems ; ou bien par une grande fécondite qui ne leur donne pas le loisir de les mûrir tous : il y a des poules qui font le même jour un ?uf bien conditionné, & un autre sans coque.
Le défaut d'une suffisante quantité de cette humeur dans certaines poules, peut encore en être la cause. Les ?ufs sans coque s'appellent ?ufs hardés. Voyez ?uf hardé.
Quoique beaucoup de personnes, d'ailleurs raisonnables, croyent avec le peuple que les coqs pondent des ?ufs, & en particulier les ?ufs qui sont sans jaune ; que ces ?ufs étant trouvés dans du fumier ou ailleurs, on en voit éclore des serpens ailés, qu'on appelle basilics ; cette erreur n'a d'autre fondement qu'une ancienne tradition, que les préjugés de l'éducation & l'amour du merveilleux entretiennent.
On a trouvé quelquefois dans des ?ufs de poule des corps étrangers, comme des pois, des lentilles, & même une épingle. Ces pois & ces lentilles qui ont germé & porté du fruit, étoient entre le blanc & le jaune de l'?uf : peut-être que ces graines, ainsi que l'épingle dont j'ai parlé, se sont insinuées dans les poules pendant l'accouplement qui se sera fait dans un endroit où il y avoit beaucoup de pois & de lentilles : peut-être sont-ils entrés du jabot dans l'ovaire. (D. J.)
?uf hardé, (Hist. nat.) il n'est pas rare de trouver des ?ufs de poule sans coque : on les appelle des ?ufs hardés. Leurs liqueurs ne sont contenues que par la membrane épaisse qui tapisse l'intérieur de la coquille des autres. Cette enveloppe cede sous le doigt en quelqu'endroit qu'on la presse : on tenteroit très-inutilement de faire éclore le poulet d'un ?uf sans coque ; la transpiration s'y fait avec une trop grande facilité ; bien-tôt la membrane qui est sa seule enveloppe, se plisse, se ride, & se chiffonne très-irrégulierement en différens endroits. Au bout de peu de jours l'?uf a totalement perdu sa forme, & les deux tiers, ou même les trois quarts de son volume : il ne contient plus que des matieres épaissies au point d'être devenues solides & dures. Peut-être néanmoins ne seroit-il pas impossible, dit M. de Réaumur, de faire développer le poulet d'un ?uf hardé : mais il faudroit, ajoute-t-il, que l'art lui donnât l'équivalent de ce que la nature lui a refusé. Il faudroit suppléer par quelque enduit à la coquille qui lui manque, lui en faire une de plâtre, ou de quelque mortier, ou de quelque ciment poreux. Cette expérience qui ne seroit que curieuse, ne réussiroit sans doute, qu'après avoir été tentée bien des fois, & ne nous apprendroit rien de plus que ce que nous savons déja sur la nécessité d'une transpiration mesurée. (D. J.)
?ufs, conservation des, (Physique générale.) il n'est pas indifférent de pouvoir conserver des ?ufs, & en particulier des ?ufs de poule, frais pendant long-tems. Tous les ?ufs que couve une poule, ne sont pas également frais ; si elle les a tous pondus, il y en a tel qui est de quinze à seize jours plus vieux qu'un autre. L'embryon périt dans l'?uf, lorsque l'?uf devient trop vieux, parce que l'?uf se corrompt ; mais il y vivroit quelquefois plus long-tems, si on empêchoit l'?uf de se corrompre.
Malgré la tissure compacte de sa coque écailleuse, malgré la tissure serrée des membranes flexibles qui lui servent d'enveloppe immédiate, l'?uf transpire journellement, & plus il transpire & plutôt il se gâte. Il n'est personne qui ne sache que dans un ?uf frais & cuit, soit mollet, soit au point d'être dur, la substance de l'?uf remplit sensiblement la coque ; & qu'au contraire il reste un vuide dans tout ?uf vieux qui est cuit, & un vuide d'autant plus grand, que l'?uf est plus vieux. Ce vuide est la mesure de la quantité du liquide qui a transpiré au-travers de la coque. Aussi, pour juger si un ?uf même qui n'est pas cuit, est frais, on le place entre une lumiere & l'?il ; la transparence de la coque permet alors de voir que l'?uf vieux n'est pas plein dans sa partie supérieure. Mais des observations faites par les Physiciens, leur ont découvert les conduits par lesquels l'?uf peut transpirer. Ils ont vu que dans les enveloppes qui renferment le blanc & le jaune de l'?uf, il y a des conduits à air qui communiquent au travers de la coque avec l'air extérieur. On voit où sont ces passages, lorsqu'on tient un ?uf sous le récipient de la machine pneumatique dans un vase plein d'eau purgée d'air. A mesure qu'on pompe l'air du récipient, celui qui est dans l'?uf sort par des endroits où la coque lui permet de s'échapper.
Un fait qui prouve encore très-bien que la coque de l'?uf est pénétrable à l'air, c'est que le poulet prêt à éclore fait entendre sa voix avant qu'il ait commencé à becqueter sa coque, & avant qu'il l'ait même filée. On l'entend crier très-distinctement, quoique sa coque soit bien entiere ; malgré sa tissure serrée, l'?uf transpire ; il est pour nous d'autant plus vieux, ou, pour parler plus exactement, d'autant moins bon, qu'il a transpiré davantage. Les paysans de nos provinces & des autres pays agissent comme s'ils savoient cette physique. Pour conserver long-tems leurs ?ufs en bon état, ils les tiennent dans des tonneaux où ils sont entourés de toutes parts de cendre bien pressée, de son, de sciure de bois de chêne, &c. cette cendre, ce son, cette sciure de bois de chene s'applique contre les coques, en bouche les pores & rend leur transpiration difficile. Les ?ufs ainsi conservés sont mangeables dans un tems où ils eussent été entierement corrompus sans ces précautions.
M. de Réaumur a imaginé d'abord un meilleur moyen d'empêcher l'insensible transpiration des ?ufs, c'est en les enduisant d'un vernis impénétrable à l'eau ; ce vernis est composé de deux parties de gomme, laque plate, avec une partie de colophone dissoute dans de l'esprit-de-vin. Une pinte d'esprit-de-vin, dans laquelle on dissout une demie livre de laque plate & un quart de livre de colophone, peut vernir 72 douzaines d'?ufs, c'est-à-dire que la dépense en vernis pour chaque douzaine d'?ufs ne sauroit aller à un sol ; & si l'on fait les couches très-minces, cette dépense n'iroit qu'à la moitié du prix.
Quoique la composition de ce vernis & son application soient faciles, M. de Réaumur a trouvé depuis qu'on pouvoit substituer à ce vernis une matiere moins chere encore, plus connue & aisée à avoir par-tout, c'est de la graisse de mouton fraîche. Les ?ufs qui ont été enduits de cette graisse, se conservent frais aussi long-tems que ceux qui ont été vernis. Cette graisse ne coûte presque rien de plus que le suif ordinaire, qui réussiroit également, mais qui blesseroit l'imagination. On fait fondre de la graisse de mouton fraîche ; & après l'avoir rendue liquide, on la passe à-travers un linge, on la met dans un pot de terre, on l'échauffe près du feu, on plonge chaque ?uf dans cette graisse, & on le retire sur le champ : s'il est bien frais, il peut se conserver ainsi pendant près d'une année.
On peut plonger l'?uf dans la graisse avec des pinces, dont l'attouchement ne se feroit que dans deux points ; & quand la graisse seroit figée sur tous les autres endroits, on porteroit avec une plume ou un pinceau une petite goutte de graisse liquide sur les deux endroits qui sont restés découverts. Mais pour n'avoir plus à revenir à l'?uf après qu'il a été tiré du pot, il sera peut-être plus commode de donner à chaque ?uf un lien d'un brin de fil long de 6 à 7 pouces ; on entourera l'?uf vers son milieu, c'est-à-dire à distance à-peu-près égale de ses deux bouts avec ce fil, on lui fera une ceinture arrêtée par un double n?ud, lequel n?ud se trouvera très-près d'un des bouts de ce fil, c'est par l'autre bout du fil qu'on tiendra l'?uf suspendu pour le plonger dans la graisse liquide. Celle qui s'attachera sur la partie du fil qui entoure l'?uf, arrêtera aussi-bien toute évaporation dans cet endroit, que celle qui sera immédiatement appliquée contre la coquille. On imaginera peut-être qu'il est difficile de mettre un ?uf en équilibre sur un tour de fil, & de faire que cet ?uf ne s'échappe pas ; mais pour peu qu'on l'éprouve, on trouvera le contraire.
La graisse de mouton ne communique pas le plus léger goût de graisse à l'?uf ; car quand on le retire de l'eau bouillante, il n'y a que le-dessus de la coquille qui soit un peu gras, & on emporte toute trace de graisse en frottant l'?uf avec un linge. L'enduit de graisse est préférable au vernis pour les ?ufs destinés à être couvés, parce qu'il est difficile de dévernir les ?ufs, & que l'enduit de graisse est très aisé à enlever. Enfin on pourroit par le moyen de l'enduit de graisse transporter dans les divers pays un grand nombre d'?ufs d'oiseaux étrangers, les y faire couver, & peut-être, en naturaliser plusieurs. Cependant, malgré toutes ces vérités, ni le vernis des ?ufs, ni leur enduit de graisse proposés l'un & l'autre par M. de Réaumur, n'ont point encore pris faveur dans ce royaume. (D. J.)
?uf, (Chimie.) voyez Substances animales.
?uf, (Diete, Pharmac. & Mat. méd.) les ?ufs les plus employés à titre d'aliment sont ceux de poule. On mange aussi en Europe les ?ufs d'oie, de canne, de poule-d'inde, de paon, de faisan, &c. Les Africains mangent les ?ufs d'autruche, & ceux de crocodile. Les ?ufs de tortue sont un aliment très-usité dans les îles de l'Amérique.
C'est aux ?ufs de poule que convient principalement ce que nous allons en observer en général, & cela instruira suffisamment sur les qualités essentielles des autres ?ufs qu'on mange quelquefois dans ce pays ; ce qui peut mériter quelque considération particuliere sur les qualités spéciales des autres, par exemple, sur ceux de tortue, sera rapporté à cet article particulier. Voyez Tortue d'Amérique.
Les ?ufs de poule, que nous n'appellerons plus que les ?ufs, doivent être choisis les plus frais qu'il se pourra ; on veut encore qu'ils soient bien blancs & longs. On connoît à ce sujet les vers d'Horace.
Longa quibus facies ovis erit, illa memento
Ut succi melioris, & ut magis alba rotundis
Ponere.
Les ?ufs nourrissent beaucoup : ils fournissent un bon aliment, utile en santé comme en maladie. Les auteurs de diete s'accordent tous à assûrer qu'ils augmentent considérablement la semence, qu'ils réveillent l'appétit vénérien, & disposent très efficacement à le satisfaire. On les prépare de bien des manieres, & on en forme différens mets qui sont d'autant plus salutaires qu'ils sont plus simples. Car toutes ces préparations recherchées où les ?ufs sont mêlés avec des laitages, du sucre, des parfums, &c. déguisent tellement la vraie nature de l'?uf qu'il peut y perdre toutes ses bonnes qualités. Il est observé même que les laitages chargés d'?ufs subissant dans les premieres voies, l'altération à laquelle ils sont naturellement sujets, la communiquent aux ?ufs, & que la corruption d'un pareil mélange devient pire que n'auroit été celle du lait seul. On peut donc établir que tous ces mélanges délicats d'?ufs & de lait, comme crèmes, &c. sont des alimens au-moins suspects, comme le lait. Voyez Lait. Quant à la meilleure façon de préparer les ?ufs seuls, on peut la déterminer d'après cette seule regle ; savoir qu'en général ils doivent être modérement cuits ; la raison en est, dit Louis Lemery, que quand ils le sont trop peu, ils demeurent encore glaireux, & par conséquent difficiles à digérer. Quand au contraire ils sont trop cuits, la chaleur en a dissipé les parties aqueuses, qui servoient à étendre les autres principes de l'?uf, & à leur donner de la fluidité ; or ces principes se trouvant dépourvûs de leur humidité naturelle, s'approchent & s'unissent étroitement les uns aux autres, & forment un corps compact, resserré en ses parties, pesant à l'estomac. Ainsi l'?uf ne doit être ni glaireux, ni dur, mais d'une substance molle & humide, comme on le peut voir par ce vers de l'école de Salerne.
Si sumas ovum, molle sit atque novum.
Lemery, Traité des alimens.
Il est assez reçu que les ?ufs échauffent beaucoup, quand ils sont vieux ; cette qualité n'est pas annoncée par des effets assez déterminés, mais il est toujours sûr qu'ils sont d'un goût desagréable, & qu'ils sont plus sujets à se corrompre dans l'estomac que les frais.
Les plus mauvais de tous sont donc les vieux ?ufs durs, tels que les ?ufs de Pâques qu'on vend au peuple à Paris & dans plusieurs autres pays. Ces ?ufs sont sujets à peser sur l'estomac, à exciter des rapports fétides & âcres, des coliques, en un mot des vraies indigestions d'autant plus fâcheuses qu'elles sont ordinairement accompagnées de constipation ; car la propriété de resserrer le ventre qu'on attribue communément aux ?ufs durs, est très-réelle. Nous ne saurions cependant approuver la pratique fondée sur cette propriété qui fait des ?ufs durs un remede populaire & domestique contre les dévoimens.
Les auteurs de diete ont rapporté plusieurs signes, auxquels on peut reconnoitre si les ?ufs sont frais ou non ; mais les paysanes & les plus grossieres cuisinieres en savent plus, à cet égard, que n'en peuvent apprendre tous les préceptes écrits.
Mais quant à l'art de les conserver dans cet état de fraîcheur, il faut rendre justice à la science, elle a été plus loin que l'économie rustique. Le principal secret qu'avoit découvert celui-ci, & qui est encore en usage dans les campagnes consistoit à les garder sous l'eau ; mais M. Réaumur ayant considéré que les ?ufs ne perdoient leur état de fraîcheur que par une évaporation qui se faisoit à-travers les pores de leur coquille, laquelle en diminuant le volume des liqueurs dont l'?uf est formé, exposoit ces liqueurs à une altération spontanée, une espece de fermentation, un commencement de corruption, en un mot aux inconvéniens auxquels sont sujets les liqueurs fermentables gardées en vuidange ; il pensa que si l'on enduisoit les ?ufs d'un vernis qui empêchât cette transpiration, on parviendroit à retarder considérablement leur corruption. Le succès répondit à ses espérances : des ?ufs enduits d'un vernis à l'esprit-de-vin quelconque, d'une légere couche de cire, d'un mélange de cire & de poix résine, de graisse de mouton, &c. se conservent pendant plusieurs mois, & même pendant des années entieres dans l'état de la plus parfaite fraîcheur. Les enduits de colle de poisson, de gomme arabique &c. arrêtent moins parfaitement cette transpiration, parce que la liqueur que l'?uf exhale étant aqueuse, peut dissoudre une partie de ces dernieres substances, & se frayer ainsi quelques routes. On conserve aussi très-bien les ?ufs sous l'huile, mais cette liqueur bouche les pores bien moins exactement que les matieres graisseuses & résineuses concretes. Le suif y seroit très-bon, mais quoiqu'on puisse l'enlever facilement, l'idée de son emploi est toujours dégoûtante. M. de Réaumur donne la préférence à la graisse de mouton, parce qu'elle coûte très-peu, & qu'elle se sépare facilement de l'?uf en le faisant tremper dans l'eau chaude. La maniere de les enduire de graisse de mouton proposée par cet académicien, est fort simple & plus facile dans l'exécution, comme il l'observe lui-même, qu'on ne seroit tenté de croire d'abord. Il ne s'agit que de suspendre un ?uf à un fil, dans lequel on l'engage comme dans une espece de ceinture au moyen d'un n?ud coulant, & de le tremper une seule fois dans de la graisse fondue sur le feu. Voyez l'Histoire des insectes de M. de Réaumur, tome II. & Mémoires de l'académie royale des Sciences, année 1735.
Ce que nous avons dit des ?ufs jusqu'à présent convient à l'?uf entier, c'est-à-dire au blanc & au jaune mangés ensemble, & se tempérant mutuellement ; car chacune de ces substances considérée en particulier a des qualités diétetiques différentes. Le blanc ou partie glaireuse est beaucoup plus nourrissante, c'est à celle-là que convient principalement l'exagération d'Avicenne qui dit des ?ufs qu'ils engendrent autant de sang qu'ils pesent. Le jaune est moins nourrissant & plus échauffant ; c'est à cette substance qu'appartient spécialement la qualité aphrodisiaque ou excitant à l'amour, observée dans les ?ufs.
Boerhaave, qui a donné dans sa chimie un long examen du blanc d'?uf sans dire un mot du jaune, observe que cette matiere albumineuse étant portée jusqu'à la putréfaction vraiment alkaline, produit les plus terribles effets dans le corps animal, prise en la plus petite quantité, pauxillum, & même que sa seule odeur dissout les humeurs de notre corps à l'égal du venin de la peste, solo putrido halitu suo humores corporis nostri mirificè dissolvit, instar veneni pestilentialis. Cette proposition ne nous paroît guere moins outrée que celle de ce singulier Hecquet, qui dit dans son Traité des dispenses du carème, qu'un ?uf est une quintessence naturelle, un soufre, un volatile, un feu prêt à s'allumer.
Plusieurs auteurs ont accordé aux ?ufs des vertus vraiment médicamenteuses. Hippocrate recommande les blancs d'?ufs battus dans de l'eau de fontaine comme une boisson humectante, rafraîchissante & laxative, très-propre aux fébricitans, &c. Tout le monde connoît l'usage des bouillons à la reine, dont la base est le jaune d'?uf dans la toux & dans les coliques bilieuses. Ce dernier usage qui est le moins connu, peut être cependant regardé comme le meilleur par l'analogie qu'a le jaune d'?uf avec la bile, qu'il est capable d'adoucir en s'y unissant.
La même qualité du jaune d'?uf, savoir, sa qualité analogue à la bile, c'est-à-dire, savonneuse, capable de servir de moyen d'union entre les substances huileuses & les aqueuses, le rend très-propre à appaiser les tranchées violentes, & les autres accidens qui suivent quelquefois l'usage des violens purgatifs résineux : car le jaune d'?uf est capable de s'unir chimiquement à ces résines, & de les disposer par là à être dissoutes & entraînées par les liqueurs aqueuses, soit celles que fournissent les glandes des intestins, soit celles qu'on peut donner aux malades à dessein, quelque tems après lui avoir fait prendre des jaunes d'?uf.
On l'emploie d'avance au même usage, c'est-à-dire à prévenir ces accidens, si on ne donne ces résines âcres, qu'après les avoir dissoutes dans une suffisante quantité de jaune d'?uf, & étendus ensuite en triturant dans suffisante quantité d'eau, ce qui produit l'espece d'émulsion purgative dont il est parlé à la fin de l'article Émulsion. Voyez cet article.
Les baumes & les huiles essentielles peuvent aussi commodément être unis aux jaunes d'?uf, comme au sucre, pour l'usage médicinal : ce composé, qu'on pourroit appeller éléoon, est entierement analogue à l'éléosaccharum. Voyez cet article.
On trouve dans la pharmacopée de Paris un looch d'?uf, qui est un mélange d'huile d'amandes douces, de sirop & d'eaux distillées fait par le moyen d'un jaune d'?uf : l'union que tous ces ingrédiens contractent, est très-légere ; ainsi on peut en évaluer l'action particuliere par les vertus respectives de ces différens ingrédiens : quant à sa qualité commune ou collective, celle qu'elle doit à sa forme, à sa consistence de looch, & à la maniere de l'appliquer, voyez Looch.
Le jaune d'?uf trituré avec de la térébenthine, ou un autre baume naturel pour en composer les digestifs ordinaires des chirurgiens, exerce dans ce mélange la même propriété : il se combine avec ces baumes, en corrige par-là la ténacité & l'âcreté, les rend en partie miscibles aux sucs lymphatiques & capables d'être enlevés de dessus la peau par des lotions aqueuses. Au reste, il ne leur communique cependant ces propriétés qu'à demi, parce qu'il n'entre point dans ce mélange en assez grande quantité.
Le jaune d'?uf employé à la liaison des sausses, y opere encore par la même propriété : il sert à faire disparoître une graisse fondue qui y surnage en la combinant, la liant avec la partie aqueuse qui fait la base de ces sausses.
L'huile par expression retirée des jaunes d'?ufs durcis, passe pour éminemment adoucissante dans l'usage extérieur ; mais elle ne possede évidemment que les qualités communes des huiles par expression. Voyez le mot Huile.
Le blanc d'?uf est l'instrument chimique le plus usité de la clarification. Voyez Clarification.
La propriété qu'a le blanc d'?uf dur exposé dans un lieu humide, de se resoudre en partie en liqueur, d'éprouver une espece de défaillance, le rend propre à dissoudre certaines substances dont on le remplit après en avoir séparé le jaune : les ?ufs durs ainsi chargés de myrrhe, fournissent l'huile de myrrhe par défaillance, voyez Myrrhe ; chargés de vitriol blanc & d'iris de Florence en poudre, un collyre fort usité, &c.
Le blanc d'?uf entre dans la composition du sucre-d'orge, de la pâte de réglisse blanche & de celle de guimauve, &c.
Enfin les coques ou coquilles d'?uf se préparent sur le porphyre pour l'usage médicinal : c'est un absorbant absolument analogue aux yeux d'écrevisse, aux écailles d'huitre, aux perles, à la nacre (voyez ces articles), & par conséquent on ne peut pas moins précieux. C'est par un pur caprice de mode que quelques personnes se sont avisées depuis quelque tems de porter dans leur poche une boîte de coquilles d'?ufs porphyrisées, qu'on envoie de Louvain. Cette substance terreuse est un des ingrédiens du remede de mademoiselle Stephens. Voyez Remede de mademoiselle Stephens.
?ufs des insectes. (Hist. nat. des insect.) la maniere dont les insectes mâles commercent avec les femelles, quoique très-variée, rend la femelle féconde, & la met en état de pondre des ?ufs lorsqu'il en est tems.
La variété qu'il y a entre ces ?ufs est incroyable, soit en grosseur, soit en figures, soit en couleurs. Les figures les plus ordinaires de leurs ?ufs sont la ronde, l'ovale & la conique : les ?ufs des araignées & d'un grand nombre de papillons, quoique ronds, sont encore distingués par bien des variétés ; mais il faut remarquer que dans ces mêmes figures il y a beaucoup de plus ou de moins, & que les unes approchent plus des figures dont on vient de parler que les autres. Pour ce qui regarde les couleurs, la différence est plus sensible. Les uns, comme ceux de quelques araignées, ont l'éclat de petites perles ; les autres, comme ceux des vers-à-soie, sont d'un jaune de millet ; on en trouve aussi d'un jaune de soufre, d'un jaune d'or & d'un jaune de bois. Enfin il y en a de verds & de bruns ; & parmi ces derniers, on en distingue de diverses especes de bruns, comme le jaunâtre, le rougeâtre, le châtain, &c.
La matiere renfermée dans ces ?ufs (car la plûpart des insectes sont ovipares) est d'abord d'une substance humide, dont se forme l'insecte même qui en sort quand il est formé.
Tous les insectes ne demeurent pas le même espace de tems dans leurs ?ufs. Quelques heures suffisent aux uns, tandis qu'il faut plusieurs jours, & souvent même plusieurs mois aux autres pour éclorre. Les ?ufs qui pendant l'hiver ont été dans un endroit chaud, éclosent plutôt qu'ils ne le devroient, selon le cours de la nature. Les ?ufs fraîchement pondus sont très-mous ; mais au bout de quelques minutes ils se durcissent. D'abord on n'y apperçoit qu'une matiere aqueuse, mais bientôt après on découvre dans le milieu un point obscur, que Swammerdan croit être la tête de l'insecte, qui prend la premiere, selon lui, sa consistance & sa couleur.
L'insecte est plié avec tant d'art, que malgré la petitesse de son appartement, il ne manque pas de place pour former tous les membres qu'il doit avoir. On ne peut s'empêcher, en voyant ces merveilles, d'admirer la puissance de celui qui a su mettre tant de choses dans un si petit espace. Un très-grand nombre d'insectes semblent n'avoir presque d'autre soin pour leurs ?ufs, que celui de les placer dans des endroits où leurs petits, dès qu'ils seront éclos, trouveront une nourriture convenable. Aussi est-ce alors tout le soin que demandent ces ?ufs, & que le plus souvent les meres ne peuvent prendre, puisque quantité d'entr'elles meurent peu après qu'elles ont pondu ; ce soin cependant n'est pas toujours borné-là, bien des fois il est accompagné d'autres précautions.
Plusieurs enveloppent leurs ?ufs dans un tissu de cire très-serré ; d'autres le couvrent d'une couche de poils tirés de leur corps. Quelques especes les arrangent dans un amas d'humeur visqueuse, qui se durcissant à l'air, les garantit de tout accident. Il y en a qui font plusieurs incisions obliques dans une feuille, & cachent dans chacune de ces incisions un ?uf. On en voit qui ont soin de placer leurs ?ufs derriere l'écorce des arbres, & dans des endroits où ils sont entierement à couvert de la pluie, du mauvais tems & de la trop grande ardeur du soleil. Quelques-uns ont l'art d'ouvrir les nervures des feuilles & d'y pondre leurs ?ufs ; de maniere qu'il se forme autour d'eux une excroissance qui leur sert tout-à-la-fois d'abri, & aux petits éclos d'alimens. Il y en a qui enveloppent leurs ?ufs d'une substance molle qui fait la premiere nourriture de ces animaux naissans, avant qu'ils soient en état de supporter des alimens plus solides, & de se les procurer. D'autres enfin font un trou en terre, & après y avoir porté une provision suffisante de nourriture, ils y placent leur ponte.
Si un grand nombre d'insectes, après avoir ainsi placé leurs ?ufs, les abandonnent au hasard, il y en a d'autres qui ne les abandonnent jamais ; tels sont par exemple quelques sortes d'araignées qui ne vont nulle part, sans porter avec elles dans une espece d'enveloppe tous les ?ufs qu'elles ont pondus. L'attachement qu'elles ont pour ces ?ufs est si grand, qu'elles s'exposent aux plus grands périls plutôt que de les quitter. Telles sont encore les abeilles, les guêpes, les frélons & plusieurs mouches de cet ordre. Les soins que les fourmis ont de leurs petits va encore plus loin, car ils s'étendent jusqu'aux nymphes dans lesquels ils doivent se changer. Les insectes ayant en général tant de soin de leurs ?ufs, il est aisé de comprendre la multitude incroyable de ces petits animaux sur la terre, dont une partie périt au bout d'un certain tems, & l'autre sert à nourrir les oiseaux & autres animaux qui en doivent subsister. (D. J.)
?uf de serpent, (Littérat.) Une grande superstition des druides regardoit l'?uf des serpens. Selon ces anciens prêtres gaulois, les serpens formoient cet ?uf de leur propre bave, lorsqu'ils étoient plusieurs entortillés ensemble. Dès que cet ?uf étoit formé, il s'élevoit en l'air au sifflement des serpens, & il falloit, pour conserver sa vertu, l'attraper lorsqu'il tomboit ; mais celui qui l'avoit ainsi pris montoit d'abord à cheval pour s'enfuir, & s'éloignoit au plus vîte, parce que les serpens, jaloux de leur production, ne manquoient pas de pour suivre celui qui la leur enlevoit, jusqu'à ce que quelque riviere arrêtât leur poursuite.
Dès que quelqu'un avoit été assez heureux pour avoir un de ces ?ufs, on en faisoit l'essai en le jettant dans l'eau, après l'avoir entouré d'un petit cercle d'or ; & pour être trouvé bon, il falloit qu'il surnageât ; alors cet ?uf avoit la vertu de procurer à celui qui le possédoit gain de cause dans tous ses différends, & de lui faire obtenir, quand il le desiroit, un libre accès auprès des rois mêmes.
Les druides recherchoient avec grand soin cet ?uf, se vantoient souvent de l'avoir trouvé, & en vendoient à ceux qui avoient assez de crédulité pour ajouter foi à toutes leurs rêveries. Pline, en traitant ce manege de vaine superstition, nous apprend que l'empereur Claude fit mourir un chevalier romain du pays des Vocontiens (de la Provence), pour cette seule raison qu'il portoit un de ces ?ufs dans son sein, dans la vue de gagner un grand procès. Il nous reste un ancien monument sur lequel sont deux serpens, dont l'un tient dans la gueule un ?uf que l'autre façonne avec sa bave. (D. J.)
?ufs de mer, (Hist. nat.) ce sont des échinites ou oursins pétrifiés.
?ufs de serpens, (Hist. natur.) ovum anguium, nom donné par Boëce de Boot & par quelques autres naturalistes à une espece d'échinites ou d'oursins pétrifiés.
?uf philosophique, espece de petit matras ayant la forme d'un ?uf, & portant son cou à l'un de ses bouts, c'est-à-dire selon la direction de son grand diametre. Ce vaisseau doit être fait d'un verre très-épais & très fort. On l'emploie aux digestions de certaines matieres peu volatiles, & ordinairement métalliques, qu'on y enferme en le scellant hermétiquement. (b)
?uf des druides, (Hist. anc.) chez les Celtes ou les premiers habitans des Gaules, les druides ou prêtres exerçoient la Médecine ; ils attribuoient sur-tout des vertus merveilleuses à ce qu'ils appelloient l'?uf des serpens. Cet ?uf prétendu étoit formé, selon eux, par l'accouplement d'un grand nombre de serpens entortillés les uns dans les autres : aussi-tôt que ces serpens commençoient à siffler, l'?uf s'élevoit en l'air, & il falloit le saisir avant qu'il fût retombé à terre ; aussi tôt après il falloit monter à cheval, & fuir au galop pour éviter la fureur des serpens, qui ne s'arrêtoient que lorsque le cavalier avoit franchi quelque riviere. Voyez Pline, Hist. nat. liv. XXIX. ch. iij. Voyez plus haut ?ufs de serpent.
?uf d'Orphée, (Hist. anc.) symbole mystérieux dont se servoit cet ancien poëte philosophe, pour désigner la force intérieure & le principe de fécondité dont toute la terre est impregnée, puisque tout y pousse, tout y végete, tout y renaît. Les Egyptiens & les Phéniciens avoient adopté le même symbole, mais avec quelque augmentation ; les premiers en représentant un jeune homme avec un ?uf qui lui sort de la bouche ; les autres en mettant cet ?uf dans celle d'un serpent dressé sur sa queue. On conjecture que par-là les Egyptiens, naturellement présomptueux, vouloient faire entendre que toute la terre appartient à l'homme, & qu'elle n'est fertile que pour ses besoins. Les Phéniciens au contraire, plus retenus, se contentoient de montrer que si l'homme a sur les choses insensibles un empire très-étendu, il en a moins sur les animaux, dont quelques-uns disputent avec lui de force, d'adresse & de ruses. Les Grecs, qui respectoient trop Orphée pour avoir négligé une de ses principales idées, assignerent à la terre une figure ovale. Voyez l'Histoire critique de la Philosophie par M. Deslandes. (G)
?uf d'Osiris, (Hist. anc.) les Egyptiens, si l'on en croit Hérodote, racontoient qu'Osiris avoit enfermé dans un ?uf douze figures pyramidales blanches pour marquer les biens infinis dont il vouloit combler les hommes ; mais que Typhon son frere ayant trouvé le moyen d'ouvrir cet ?uf, y avoit introduit secrettement douze autres pyramides noires, & que par ce moyen le mal se trouvoit toujours mêlé avec le bien. Ils exprimoient par ces symboles l'opposition des deux principes du bien & du mal qu'ils admettoient, mais dont cette explication ne concilioit pas les contrariétés. (G)
?ufs, en terme de Metteur en ?uvre, sont de petites cassolettes ou boîtes de senteur qui sont suspendues à chaque côté de la chaîne d'un étui de piece. Voyez Étui de piece.
?uf, (Rafin. de sucre.) on nomme ainsi dans les moulins à sucre, le bout du pivot du grand tambour, à cause qu'il a la figure de la moitié d'un ?uf d'oye. Cette piece s'ajoute au pivot, & y tient par le moyen d'une ouverture barlongue qu'on y fait ; elle est d'un fer acéré posée sur une platine ou crapaudine de même matiere.
Étymologie de « oeuf »
Berry, ?u?; bourg. eu?; wallon, oû?; picard, ué, ?uf, u, ?ufs?; provenç. ov, uov, ueu?; cat. ou?; espagn. huevo?; port. ovo?; ital. uovo?; du lat. ovum?; grec, ????; all. Ei?; angl. egg.?; gaél. ubh?; bas-bret. ui?; irl. ugh. Comme on a pour ??? les formes dialectales argien ????? et lesbien ????, on peut supposer, pour forme grecque primitive, ?????, répondant à ovum, et que Benfey, approuvé par Curtius, a conjecturé représenter en sanscrit un avyam, qui serait un adjectif venant d'avi, oiseau, et qui équivaudrait pour le sens à ?????????.
oeuf au Scrabble
Le mot oeuf vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot oeuf - 4 lettres, 3 voyelles, 1 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot oeuf au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
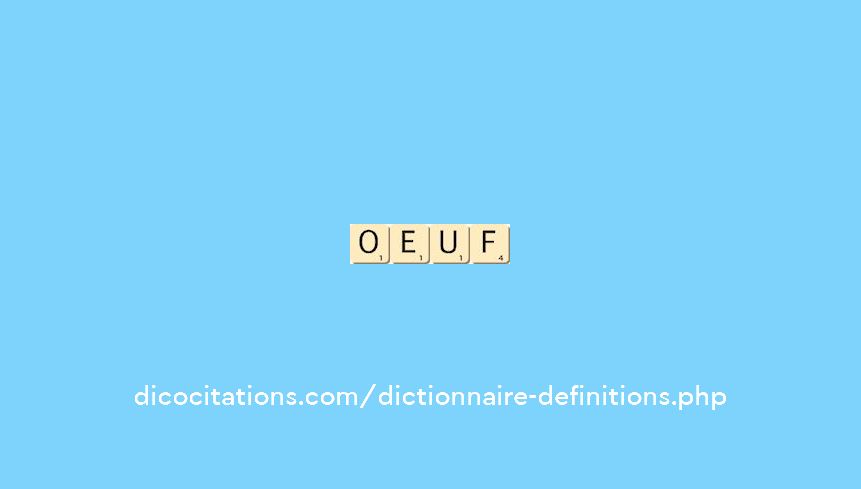
Les rimes de « oeuf »
On recherche une rime en 9F .
Les rimes de oeuf peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en 9f
Rimes de veufs Rimes de quarante-neuf Rimes de trente-neuf Rimes de soixante-neuf Rimes de pont-neuf Rimes de boeuf Rimes de cinquante-neuf Rimes de bluffent Rimes de veufs Rimes de veuf Rimes de neuf Rimes de dix-neuf Rimes de bluffes Rimes de quatre-vingt-neuf Rimes de bluff Rimes de quatre-vingt-dix-neuf Rimes de bluffe Rimes de vingt-neuf Rimes de meuf Rimes de oeils-de-boeuf Rimes de bluffs Rimes de boeuf Rimes de neuf Rimes de keuf Rimes de arrête-boeuf Rimes de keufs Rimes de veuf Rimes de soixante-dix-neuf Rimes de teuf-teuf Rimes de neufs Rimes de meufs Rimes de puff Rimes de oeil-de-boeuf Rimes de oeufMots du jour
veufs quarante-neuf trente-neuf soixante-neuf pont-neuf boeuf cinquante-neuf bluffent veufs veuf neuf dix-neuf bluffes quatre-vingt-neuf bluff quatre-vingt-dix-neuf bluffe vingt-neuf meuf oeils-de-boeuf bluffs boeuf neuf keuf arrête-boeuf keufs veuf soixante-dix-neuf teuf-teuf neufs meufs puff oeil-de-boeuf oeuf
Les citations sur « oeuf »
- Avis à tous les consommateurs: comment reconnaître un n'oeuf belge? Quand vous le cassez dans une poêle, il fait: «Piou piou, une fois!»Auteur : Laurent Ruquier - Source : Je ne vais pas me gêner (2000)
- Les oeufs et les casseroles c'est pour faire la cuisine chez moi.Auteur : Emmanuel Macron - Source : Au collège Louise-Michel de Ganges, le 20 avril 2023
- De trois choses, Dieu nous garde:
De boeuf salé sans moutarde,
De valet qui se regarde,
Et de femme qui se farde.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique, nous sommes programmés depuis l'oeuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure vivante n'a pas d'autre raison d'être, que d'être.Auteur : Henri Laborit - Source : Eloge de la fuite (1976)
- Mettez tous vos oeufs dans le même panier et surveillez ce panier.Auteur : Andrew Carnegie - Source : Sans référence
- Est-ce qu'un toréador se dit parfois qu'il est en train de se battre contre un boeuf Strogonoff ou contre des roulades?...Auteur : Stanislaw Jerzy Lec - Source : Nouvelles pensées échevelées (2000)
- Le grand public pense que les livres, comme les oeufs, gagnent à être consommés frais. C'est pour cette raison qu'il choisit toujours la nouveauté.Auteur : Johann Wolfgang Goethe - Source : Maximes et réflexions
- Les levers de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les oeufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des barques s'évertuent sans avancer.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919)
- Janvier frileux - Gèle la merlesse sur les oeufs.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Il se balançait sur ses jambes torses, mais il ne fléchissait pas, d'une solidité de roc, d'une force musculaire à charrier un boeuf.Auteur : Emile Zola - Source : La Terre (1887)
- A leurs yeux, les familles qui s'alliaient à la nôtre demeuraient étrangères et indignes. Ils appelaient leurs beaux-frères et belles-soeurs: «Les pièces rapportées», «Les oeufs de canard», et les traitaient avec condescendance.Auteur : André Maurois - Source : Mémoires, I
- Pource que les boeufs demouroient trop à venir, ilz se soubmeirent tous deux vouluntairement au joug.Auteur : Jacques Amyot - Source : Solon, 57
- Le boeuf mange la paille, et la souris le blé.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- Le pré qui donne aux boeufs sa riante verdure, - D'une grasse litière attend la fange impure, - Et des sels du fumier se forment en secret - Le parfum de la rose et le teint de l'oeillet.Auteur : abbé Jacques Delille - Source : Poème des Trois Règnes
- Après l'interdiction des boyaux de boeuf, les charcutiers protestent en criant qu'on veut leur peau... Non, justement, on n'en veut plus!Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Mais on le sait ; là où boivent les boeufs, il n'y a pas de calebasses. Pour ma part, je préfère ces jarres d'eau fraîche que les villages traversés nous apportent en guise de remerciement.Auteur : Massa Makan Diabaté - Source : Une hyène à jeun
- Une aubergiste d'Helvoet demanda à george II deux guinées pour deux oeufs. George lui dit: - «Est-ce que les oeufs sont si rares ici? - - Non, lui répondit-elle, mais les rois, oui.»Auteur : Denis Diderot - Source : Voyage en Hollande (1774)
- Quatre boeufs attelés, d'un pas tranquille et lent,
Promenaient dans Paris le monarque indolent.Auteur : Nicolas Boileau-Despréaux - Source : Le Lutin - Entre l'éclosion des oeufs et l'essor des oisillons, la tâche d'un couple de mésanges confond l'observateur.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Histoires pour Bel-Gazou
- Le caviar c'est des oeufs de poisson. Je comprends que ça coûte cher. Rien que l'emballage et la main d'oeuvre pour les ranger par douze.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
- Les boeufs ? Les flics, si vous préférez. Oui, car si chez nous le flic est un poulet, au Québec c'est un boeuf. Et en Angleterre, c'est un pig, un cochon. C'est comme ça. Nous n'avons pas la même lecture zoomorphique du représentant de l'ordre.Auteur : Barry Gifford - Source : No steak (2013)
- On vient de décoder entièrement le génome de la poule. Il suffit désormais de décoder celui de l'oeuf pour savoir qui est arrivé en premier.Auteur : Hervé Le Tellier - Source : Guerre et plaies (2003)
- Qui vole un boeuf est vachement musclé!Auteur : Yvan Francis Le Louarn, dit Chaval - Source : Sans référence
- Il est facile de reconnaître un n'oeuf belge: quand vous le multipliez par 10, ça fait nonante au lieu de 90!Auteur : Laurent Ruquier - Source : Je ne vais pas me gêner (2000)
- A qui la fortune est belle,
Son boeuf vèle.Auteur : Proverbes allemands - Source : Proverbe
Les mots proches de « oeuf »
Oeuf Oeuvé, ée Oeuvre OeuvréeLes mots débutant par oeu Les mots débutant par oe
Oeudeghien oeuf oeufs oeuvraient oeuvrait oeuvrant oeuvre oeuvre oeuvré oeuvrent oeuvrer oeuvrera oeuvres oeuvres oeuvrette oeuvrettes oeuvrez oeuvrions
Les synonymes de « oeuf»
Les synonymes de oeuf :- 1. embryon
2. foetus
3. germe
4. graine
5. ovocyte
6. ovule
7. oosphère
8. lente
synonymes de oeuf
Fréquence et usage du mot oeuf dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « oeuf » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot oeuf dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Oeuf ?
Citations oeuf Citation sur oeuf Poèmes oeuf Proverbes oeuf Rime avec oeuf Définition de oeuf
Définition de oeuf présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot oeuf sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot oeuf notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
