La définition de Déesse du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Déesse
Nature : s. f.
Prononciation : dé-è-s'
Etymologie : Provenç. deuessa, diuessa ; espagn. diosa ; portug. deosa ; de Dieu ou Dios (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de déesse de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec déesse pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Déesse ?
La définition de Déesse
Divinité mythologique représentée sous les traits d'une femme. Junon, Minerve, Latone étaient des déesses.
Toutes les définitions de « déesse »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Divinité païenne du sexe féminin. Les dieux et les déesses. La déesse Junon. La déesse Cérès. Les trois déesses qui se soumirent au jugement de Pâris. Elle a le port d'une déesse, se dit d'une Femme qui est d'une beauté majestueuse.
Littré
-
1Divinité mythologique représentée sous les traits d'une femme. Junon, Minerve, Latone étaient des déesses.
Pour une jeune déesse, Vous êtes bien du bon temps
, Molière, Amph. Prologue.Voudrais-je, de la terre inutile fardeau, Trop avare du sang reçu d'une déesse, Attendre chez mon père une obscure vieillesse??
Racine, Iph. I, 2.Oubliait-on qu'ici les déesses des morts Sont du dieu des banquets les compagnes cruelles??
Lemercier, Agamemnon, IV, 5.Est-il vrai qu'on a vu des déesses livides Dans nos sombres forêts cacher leurs pas perfides??
Ducis, Macbeth, II, 3.Bonne Déesse, nom d'une divinité ancienne, fort honorée par les dames romaines.
La déesse aux cent voix, la renommée personnifiée.
La déesse à cent voix qui du sein d'Atropos Sauve les noms fameux et les faits des héros, La renommée?
, Boursault, Fables d'Ésope, I, 6.La déesse du matin, l'aurore.
Déjà l'amante du Zéphire Et la déesse du matin
, La Fontaine, ?uvres posth.Déesse se dit des être féminins abstraits que l'on personnifie. La déesse de la raison ou la déesse Raison.
Déesse de la liberté, femme qui, choisie pour sa belle apparence, figurait, dans certaines fêtes de la première révolution, comme la représentation de la liberté.
Est-ce bien vous, vous que je vis si belle Quand tout un peuple, entourant votre char? De nos respects, de nos cris d'allégresse, De votre gloire et de votre beauté, Vous marchiez fière?; oui, vous étiez déesse, Déesse de la liberté
, Béranger, Déesse. -
2Elle a l'air et le port d'une déesse, se dit d'une femme qui dans sa taille et sa démarche a de la majesté et de la noblesse.
Fig. et absolument. C'est une déesse, c'est une femme d'une grande beauté.
-
3Familièrement et avec les adjectifs possessifs, déesse signifie une amante.
Il suivit l'espace de quatre lieues le char de sa déesse
, Voltaire, Crocheteur.
HISTORIQUE
XIIIe s. Car en tex leus tient ses escoles Et chante à ses disciples messes Li diex d'amors et la deesse
, la Rose, 13731. Venus dieuesse d'amur
, Marie de France, Gugemer.
XIVe s. Ivorine est clamée la dieuesse gentis
, Baud. de Seb. XI, 522.
XVe s. Elle semble mieulx que femme Deesse? Elle n'a per [égale]
, Orléans, Bal. 9. Quant madame et ma deesse?
, Deschamps, Poésies ms. f° 100, dans LACURNE. Ma deesse estes que j'aour Et veil amer
, ib. f° 198.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
DÉESSE. - HIST. Ajoutez?: XIIe s. Gie sé très bien que la deesse M'aïdera, gie n'en dot rien
, Benoit de Sainte-Maure, Roman de Troie, V. 3902. Puis dit?: Paris, à moi entent?; Treis deesses vienent à tei, Por lo jugement, d'un otrei
, Benoit de Sainte-Maure, ib. V. 3860.
Encyclopédie, 1re édition
DÉESSE, s. f. (Myth.) fausse divinité du sexe féminin. Voyez Dieu.
Les anciens avoient presque autant de déesses que de dieux : telles étoit Junon, Diane, Proserpine, Vénus, Thétis, la Victoire, la Fortune, &c. Voyez Fortune.
Ils ne s'étoient pas contentés de se faire des dieux femmes, ou d'admettre les deux sexes parmi les dieux ; ils en avoient aussi d'hermaphrodites : ainsi Minerve, selon quelques savans, étoit homme & femme, appellée Lunus & Luna. Mithra chez les Perses, étoit dieu & déesse ; & le sexe de Vénus & de Vulcain, étoit aussi douteux. De-là vient que dans leurs invocations ils disoient : si vous êtes dieu, si vous êtes déesse, comme Aulugelle nous l'apprend. Voyez Hermaphrodite.
C'étoit le privilége des déesses d'être représentées toutes nues sur les médailles : l'imagination demeuroit dans le respect en les voyant. Dictionnaire de Trévoux & Chambers.
Les déesses ne dédaignoient pas de s'unir quelquefois avec des mortels. Thétis épousa Pelée, & Vénus aima Anchise, &c. Mais c'étoit une croyance commune, que les hommes honorés des faveurs des déesses ne vivoient pas long-tems ; & si Anchise paroît avoir été excepté de ce malheur, il en fut, dit-on, redevable à sa discrétion. (G)
Déesses-meres, (Litt. Antiq. Insc. Myth. Hist.) divinités communes à plusieurs peuples, mais particulierement honorées dans les Gaules & dans la Germanie, & présidant principalement à la campagne & aux fruits de la terre. C'est le sentiment de M. l'abbé Banier, qu'il a étayé de tant de preuves dans le VI. volume des mémoires de l'académie des Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refuser.
Les surnoms que les déesses-meres portent dans les inscriptions, semblent être ceux des lieux où elles étoient honorées : ainsi les inscriptions sur lesquelles on lit matribus Gallaicis, marquoient les déesses-meres de la Galice ; ainsi les Rumanées sont celles qui étoient adorées à Rhumaneim dans le pays de Juliers, &c.
Leur culte n'étoit pas totalement borné aux choses champêtres, puisqu'on les invoquoit non-seulement pour la santé & la prospérité des empereurs & de leur famille, mais aussi pour les particuliers.
Les déesses-meres étoient souvent confondues, & avoient un même culte que les Suleves, les Commodeves, les Junons, les Matrones, les Sylvatiques, & semblables divinités champêtres. On le justifie par un grand nombre d'inscriptions qu'ont recueillies Spon, Gruter, Reynesius, & autres antiquaires.
Il n'est pas vraissemblable que les déesses-meres tirent leur origine des Gaules ou des Germains, comme plusieurs savans le prétendent, encore moins que leur culte ne remonte qu'au tems de Septime Sévere. On a plusieurs inscriptions qui prouvent que ces déesses étoient connues en Espagne & en Angleterre ; & il est probable que les uns & les autres avoient reçu le culte de ces déesses, soit des Romains, soit des autres peuples d'Italie, qui de leur côté le devoient aux Grecs, tandis que ceux-ci le tenoient des Egyptiens & des Phéniciens par les colonies qui étoient venues s'établir dans leurs pays. Voilà la premiere origine des déesses-meres, & de leur culte : en effet il paroît par un passage de Plutarque, que les Crétois honoroient d'un culte particulier, même dès les premiers tems, les déesses-meres, & personne n'ignore que les Crétois étoient une colonie phénicienne.
C'est donc de la Phénicie que la connoissance des déesses-meres s'est répandue dans le reste du monde. Si l'on suit les routes des fables & de l'idolatrie, on les trouvera partir des peuples d'Orient qui en se dispersant altérerent la pureté du culte qu'ils avoient reçu de leurs peres. D'abord ils rendirent leurs hommages à ce qui parut le plus parfait & le plus utile, au Soleil, & aux astres ; de leur adoration, on vint à celle des élémens, & finalement de toute la nature. On crut l'univers trop grand pour être gouverné par une seule divinité ; on en partagea les fonctions entre plusieurs. Il y en eut qui présiderent au ciel, d'autres aux enfers, d'autres à la terre ; la mer, les fleuves, la terre, les montagnes, les bois, les campagnes, tout eut ses divinités. On n'en demeura pas là : chaque homme, chaque femme, eurent leurs propres divinités, dont le nombre, dit Pline, excédoit finalement celui de la race humaine. Les divinités des hommes s'appelloient les Génies, celles des femmes les Junons.
Ainsi se répandit la tradition parmi presque tous les peuples de la terre, que le monde étoit rempli de génies ; opinion, qui après avoir tant de fois changé de forme, a donné lieu à l'introduction des fées, aux antres des fées, & s'est enfin métamorphosée en cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des dieux, que les anciens nommoient Dusii & Pilosi, les Gnomes, les Sylphes, &c. Voyez Genie, &c.
Il n'est guere douteux que c'est du nombre de ces divinités, en particulier des Junons & des Génies, que sortoient les déesses-meres, puisqu'elles n'étoient que les génies des lieux où elles étoient honorées, soit dans les villes, soit dans les campagnes, comme le prouvent toutes les inscriptions qui nous en restent.
On leur rendoit sans doute le même culte qu'aux divinités champêtres ; les fleurs & les fruits étoient la matiere des sacrifices qu'on offroit en leur honneur ; le miel & le lait entroient aussi dans les offrandes qu'on leur faisoit.
Les Gaulois en particulier qui avoient un grand respect pour les femmes, érigeoient aux déesses-meres des chapelles nommées cancelli, & y portoient leurs offrandes avec de petites bougies ; ensuite après avoir prononcé quelques paroles mystérieuses sur du pain ou sur quelques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux ou dans un arbre, croyant par-là garantir leurs troupeaux de la contagion & de la mort même. Ils joignoient à cette pratique plusieurs autres superstitions, dont on peut voir le détail dans les capitulaires de nos rois, & dans les anciens rituels qui les défendent. Seroit-ce de-là que vient la superstition singuliere pour certaines images dans les villes & dans les campagnes ? Seroit-ce encore de-là que vient parmi les villageois la persuasion des enchantemens & du sort sur leurs troupeaux, qui subsiste toûjours dans plusieurs pays ? C'est un spectacle bien frappant pour un homme qui pense, que celui de la chaîne perpétuelle & non interrompue des mêmes préjugés, des mêmes craintes, & des mêmes pratiques superstitieuses. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.
Wiktionnaire
Nom commun - français
déesse \de.?s\ féminin (pour un homme, on dit : dieu)
-
(Religion) Divinité de sexe féminin.
- Elle ne croyait pas à Aphrodite, mais elle aimait qu'on lui comparât la déesse, et elle allait quelquefois au temple, pour lui donner, comme à une amie, des boîtes de parfums et des voiles bleus. ? (Pierre Louÿs, Aphrodite, Mercure de France, Paris, 1896)
- Mars, identifié avec le dieu grec Arès, l'a été aussi avec le dieu gaulois Toutatis; Minerve, confondue avec la déesse grecque Athéna, l'a été aussi aussi avec la déesse gauloise Belisama, etc. ? (Henri d'Arbois de Jubainville, Les druides et les dieux celtiques à forme d'animaux, Paris : chez H. Champion, 1906, p. 66)
-
(Par hyperbole) Femme qui est d'une beauté majestueuse.
- Me voici à genoux devant vous, fascinante déesse, le torse nu et la tête inclinée, pareil au prisonnier que l'on veut humilier en le portant aux pieds de son vainqueur [?]. ? (Marika Moreski, Ces dames en bottines, Éditions Dominique Leroy, 1971, p. 40)
- Une grande nostalgie s'empare de lui quand il se remémore son corps de déesse aux fines attaches, sa peau ambrée qui sentait bon les parfums envoûtants de l'Orient et son art consommé pour faire l'amour. ? (Yannick Surun, Les caravanes de Zanzibar, L'Harmattan, 1999, page 180)
-
(Argot) Cocaïne.
- Le problème c'est que dans ses une poche ils ont trouvé cinq grammes de déesse, de la meilleure, pure, blanche, pas encore coupée, et je te jure, mec, c'est pas moi qui l'y avait mise. ? (Luis Sepúlveda, Rolandbar, dans le recueil Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, 1997. - Traduit de l'espagnol (Chili) par François Gaudry, 1997, p.59)
- (Mélioratif) (Automobile) La Citroën DS, par homophonie de l'acronyme.
Trésor de la Langue Française informatisé
DÉESSE, subst. fém.
Déesse au Scrabble
Le mot déesse vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot deesse - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot déesse au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
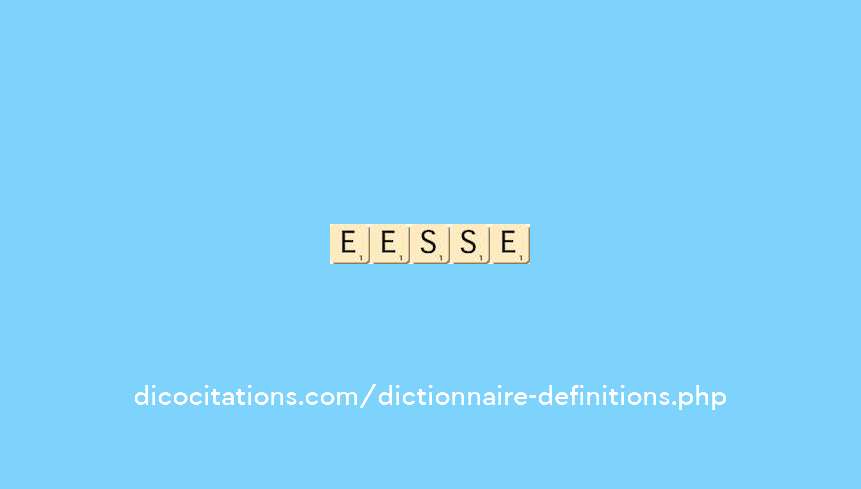
Les mots proches de Déesse
Déesse Deerlijk déesse déessesMots du jour
-
voyantes excédent appartenu furieux déprimée procurent quasi-jungienne utilement materont opposerait
Les citations avec le mot Déesse
- Ne vois-tu pas quelle déesse est Aphrodite ? Elle sème la vie, elle donne l'amour à qui nous devons tous sur terre la naissance.Auteur : Euripide - Source : Hippolyte (428 av. J.-C.), 449-450
- Il rêvait, une fois par semaine, peut-être bien, que tout cela n'avait été qu'un rêve, et qu'à présent il se réveillait pour découvrir que la poursuite de V. n'était après tout qu'une recherche purement intellectuelle, une aventure de l'esprit, selon la tradition du Rameau d'or ou de la Déesse blanche. Auteur : Thomas Pynchon - Source : V. (1963)
- Et l'histoire est là, déesse raisonnable, statue figée au milieu de la place des Fêtes, avec pour tribut, une fois l'an, des gerbes séchées de pivoines, et en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux. Auteur : Eric Vuillard - Source : L'ordre du jour
- La douce vapeur du sommeil ne coule pas plus doucement dans les yeux appesantis et dans tous les membres fatigués d'un homme abattu que les paroles flatteuses de la déesse s'insinuaient pour enchanter le coeur de Mentor.Auteur : François de Pons de Salignac de La Mothe-Fénelon, dit Fénelon - Source : Les Aventures de Télémaque (1699), VII
- Pour les anciens grecs, les Dieux et les déesses habitaient un lieu enchanteur au-dessus des nuages : l'Olympe. En se penchant, ils pouvaient observer le monde des humains, dont le destin, contrairement au leur, était de mourir un jour.Auteur : Yvan Pommaux - Source : Orphée et la morsure du serpent (2009)
- Même un homme pleinement comblé en mariage ne peut raisonnablement contempler cette déesse sans regrets éternels.Auteur : Lionel Davoust - Source : La Volonté du Dragon (2010)
- La présence est une puissante déesse.Auteur : Johann Wolfgang Goethe - Source : Maximes et réflexions
- Les gens du village pensaient que les actrices de cinéma étaient toutes des déesses descendues parmi les mortels...Auteur : Mo Yan - Source : Le grand chambard (2013)
- Celui qui veut entretenir en soi le désir de continuer à vivre et la croyance en quelque chose de plus délicieux que les choses habituelles doit se promener, car les rues, les avenues, sont pleines de déesses.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, La Prisonnière (1923)
- De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du coeur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie.Auteur : Khalil Gibran - Source : L'oeil du prophète (1991)
- Chante la colère, déesse, du fils de Pélée, Achille, colère funeste et qui causa mille douleurs aux Achéens !Auteur : Homère - Source : L'Iliade, I, 1
- Après quelques sacrifices faits, il vest la chappe de pourpre de la deesse Proserpine.Auteur : Jacques Amyot - Source : Dion, 70
- Un vieux mot réédité ce soir, mais vraiment drôle, un mot sur la Vénus de Milo, dénommée maintenant la déesse de l'Agriculture, l'agriculture manquant de bras.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Journal, février 1890
- Etre aussi rare qu'une déesse sur terre.Auteur : Hérondas - Source : Mimes, I, 9
- Vénus, une belle et bonne dame, était la déesse de l'amour; Junon, une terrible mégère, la déesse du mariage, et toujours elles furent ennemies mortelles.Auteur : Jonathan Swift - Source : Pensées sur divers sujets moraux et divertissants
- Mnémosyne! s'écria-t-il, déesse de la mémoire, mère des chastes muses, inspire ton fidèle et fervent adorateur!Auteur : Jules Verne - Source : Les Enfants du capitaine Grant (1866-1868)
- Par sa démarche, elle révèle une véritable déesse.Auteur : Virgile - Source : L'Enéide, I, 405
- La chance n'est pas, comme le disaient les anciens à propos de la fortune, une déesse aveugle. Elle accorde volontiers à l'optimiste les faveurs refusées au pessimiste.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Psychologie des temps nouveaux (1920)
- Vénus, belle et accueillante, était la déesse de l'amour. Junon, terrible mégère, celle du mariage. Elles ont toujours été ennemies jurées.Auteur : Jonathan Swift - Source : Sans référence
- L'enfant à qui ses parents n'ont pas souri n'est digne ni de la table d'un dieu, ni du lit d'une déesse.Auteur : Virgile - Source : Les Bucoliques, IV, 60
- Ce que sont pour le libertin les cuisses ouvertes, ce qu'est un vol d'oiseaux migrateurs pour l'ornithologue, ce qu'est la tenaille pour l'ajusteur, voilà ce qu'était pour le jeune Stencil la lettre V. Il rêvait, une fois par semaine, peut-être bien, que tout cela n'avait été qu'un rêve, et qu'à présent il se réveillait pour découvrir que la poursuite de V. n'était après tout qu'une recherche purement intellectuelle, une aventure de l'esprit, selon la tradition du Rameau d'or ou de la Déesse blanche. Auteur : Thomas Pynchon - Source : V. (1963)
- O noblesse! ô beauté simple et vraie! déesse dont le culte signifie raison et sagesse, toi dont le temple est une leçon éternelle de conscience et de sincérité, j'arrive tard au seuil de tes mystères.Auteur : Ernest Renan - Source : Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), II, Prière sur l'Acropole
- Un poète a dit : L'enfant à qui n'a point souri sa mère n'est digne ni de la table des dieux ni du lit des déesses.Auteur : Anatole France - Source : Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881)
- Diane: Déesse de la chasse-teté.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Une déesse rayonnante guidait dans ces nouveaux avatars l'évolution rapide des humains.Auteur : Gérard de Nerval - Source : La Bohème galante (1852)
Les citations du Littré sur Déesse
- En achevant ces mots, la déesse guerrière.... Rend aux trois champions leur intrépiditéAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. III
- Ô déesse de la santé, Fille de la sobriété, Et mère des plaisirs du sageAuteur : Voltaire - Source : Lett. en vers et en prose, 81
- Cheveux-de-Venus, d'autant que ceste herbe embellit les cheveux ; et parce que les anciens peignoient leur deesse Venus avec belle chevelure, ce mot de Venus y est ajoustéAuteur : O. DE SERRES - Source : 611
- Anténor, le premier, sort des bras du sommeil, Et vient au rendez-vous attendre le soleil ; La déesse des bois n'est point si matinaleAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Adonis.
- En un lieu que devait la déesse bizarre [la Fortune] Fréquenter sur tout autre ; et ce lieu c'est la courAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VII, 12
- La déesse, en entrant, qui voit la nappe mise, Admire un si bel ordreAuteur : BOILEAU - Source : Lutrin, I
- Cette jeune deesse, aussi fiere que belle, Erroit sans passion ainsi qu'il luy plaisoit, Et bien qu'innocemment mille playes faisoitAuteur : DESPORTES - Source : Élégies, II, 5, advanture premiere.
- Voudrais-je, de la terre inutile fardeau, Trop avare du sang reçu d'une déesse, Attendre chez mon père une obscure vieillesse ?Auteur : Jean Racine - Source : Iph. I, 2
- La déesse en entrant, qui voit la nappe mise, Admire un si bel ordre, et reconnaît l'ÉgliseAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. I
- Retirez-vous, trésors ; fuyez : et toi, déesse, Mère du bon esprit, compagne du repos, Ô médiocrité, reviens vite !Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VII, 6
- Les gens qu'avait envoyés Vénus pour se saisir d'elle [Psyché], ayant rendu à leur reine un fort mauvais compte de leur recherche, cette déesse ne trouva point d'autre expédient que de faire trompeter sa rivaleAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Psyché, II, p. 146
- Déesse, venge-toi : nos causes sont pareillesAuteur : Jean Racine - Source : Phèdre, III, 2
- Là je resonge sans cesse L'heureux soir que ma deesse....Auteur : DU BELLAY - Source : VII, 20, recto
- Avec quelle furie, avec quelle vitesse Détruis-tu ton ouvrage, inconstante déesse !Auteur : ROTR. - Source : Bélis. V, 4
- La grotte de la déesse était sur le penchant d'une collineAuteur : FÉN. - Source : Tél. I
- Baise moy donc, mon coeur [m'amie], car j'aime mieux Ton seul baiser, que si quelque deesse...Auteur : RONS. - Source : 109
- Lequel [cheval] ne peut estre monté ny dressé que par Cesar, qui dedia son image aprez sa mort à la deesse VenusAuteur : MONT. - Source : I, 360
- La méchante déesse Iris, Ayant donc cette forme pris, Se mit piteusement à dire Ces mots qui ne sont pas pour rireAuteur : Paul Scarron - Source : Virg. V
- Est-il vrai qu'on a vu des déesses livides Dans nos sombres forêts cacher leurs pas perfides ?Auteur : DUCIS - Source : Macbeth, II, 3
- Il suivit l'espace de quatre lieues le char de sa déesseAuteur : Voltaire - Source : Crocheteur.
- La Parque et ses ciseaux Avec peine y mordaient [sur le sanglier] ; la déesse infernale Reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fataleAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VIII, 27
- En achevant ces mots, la déesse guerrière.... Rend aux trois champions leur intrépiditéAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. III
- La déesse Discorde ayant brouillé les dieux, Et fait un grand procès là-haut pour une pomme, On la fit déloger des cieux ; Chez l'animal qu'on appelle homme, On la reçut à bras ouvertsAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VI, 20
- Mégaclès leur persuada [aux réfugiés du temple de Minerve] de venir se présenter devant les juges en tenant un fil attaché par un des bouts à la statue de la déesse, afin de ne point perdre leur franchiseAuteur : FÉN. - Source : Solon.
- Prends ton luth, cher Orphée, et montre à la déesse Combien ce doux espoir charme notre tristesseAuteur : Corneille - Source : Toison d'or, I, 5
Les mots débutant par Dee Les mots débutant par De
Une suggestion ou précision pour la définition de Déesse ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h14
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur déesse
Poèmes déesse
Proverbes déesse
La définition du mot Déesse est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Déesse sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Déesse présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
