Définition de « x »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot x de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur x pour aider à enrichir la compréhension du mot X et répondre à la question quelle est la définition de x ?
Une définition simple : (lettre|x|X|iks) x (m) (inv)
Définitions de « x »
Trésor de la Langue Française informatisé
X, x, lettre
La vingt-quatrième lettre de l'alphabet; un exemplaire de cette lettre.X, x, lettre
La vingt-quatrième lettre de l'alphabet; un exemplaire de cette lettre.Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
x \p?.ti.t?iks\ masculin
- (Colorimétrie) Coordonnée colorimétrique calculée par X / (X + Y + Z) de CIE XYZ. Note : On dit petit x pour le distinguer de X.
Nom commun 1 - français
x \iks\ masculin
- Variante orthographique de X. Indique l'anonymat.
-
(En apposition) (Généralement italique) Quelconque. Note : Sert à désigner un objet que l'on présente comme particulier, mais sans le nommer, indiquant par là que l'objet particulier changera selon le contexte.
- La rédaction [publicitaire] est toujours tributaire d'un client qui a quelque chose à dire à quelqu'un par un média x. ? (Luc Panneton, Marcher entre les mots, Lingatech éditeur, Montréal, 2016, page 26)
Littré
-
1Lettre consonne qui est la vingt-troisième de l'alphabet.
Jambes en X, se dit des genoux tournés en dedans et se touchant.
- 2X, dans les chiffres romains, vaut 10?; XI, 11?; XII, 12?; XIII, 13?; XIIII ou XIV, 14, etc. XX?; 20?; XXX, 30?; XXXX ou XL, 40, etc. Surmonté d'un trait, dans cette forme X? il vaut 10000?; couché, il se prenait pour 1000.
- 3Dans le comput ecclésiastique, marque le dimanche.
- 4Sur les monnaies de France, indique qu'elles ont été frappées à Amiens, selon l'Encyclopédie, à Aix selon le dictionnaire de Trévoux.
-
5En marge des anciens manuscrits, X est une note critique qui indique une expression inusitée ou une figure trop hardie.
Il sert aussi quelquefois à noter les endroits remarquables.
-
6X ou x s'emploie d'ordinaire, en algèbre, pour désigner l'inconnue ou une des inconnues.
Il se dit quelquefois figurément, dans le langage philosophique, d'une chose que l'on cherche.
Familièrement, les x, l'algèbre, les mathématiques. Fort en x, fort en mathématiques.
Des xx redoublés admirant la puissance, Il croit que Varignon est seul utile en France
, Voltaire, Ép. 50.Nom donné familièrement aux élèves de l'école polytechnique.
- 7Un x ou un ixe, chez les tapissiers, est un petit tabouret dont les pieds croisés offrent la figure de cette lettre.
- 8Poinçon d'acier au bout duquel se trouve gravé un x, pour frapper ou imprimer cette lettre.
- 9X, espèce de phalène.
REMARQUE
1. X a tantôt la prononciation de ks, comme dans extrême?; tantôt celle de gz, comme dans exercice?; tantôt celle de k, comme dans exception. Au reste la prononciation en est marquée en particulier. à chaque mot de ce dictionnaire
2. Dans quelques noms de lieux, x se prononce comme s?: Auxerre, Bruxelles, dites ô-sê-r', Bru-sè-l'.
3. En certains mots, il sonne z?: deuxième, sixième, etc.
4. À la fin des mots où il n'est pas muet, il se prononce comme ks?: préfix, sphinx, etc.
5. Dans la plupart des mots x final est muet et ne sert qu'à rendre plus grave le son de la voyelle?: paix, choix, généreux.
6. Cet x final se lie et prend le son de z?: Baux à longues années, bô-z à? Un choix heureux, choi-z heureux?; une paix inattendue, pê-z inattendue.
7. Dans certains mots, x final sert à marquer le pluriel?: choux, oiseaux, etc. Il remplace aussi quelquefois l's radicale finale, comme dans jaloux. Dumarsais, ?uv. t. IV, p. 101, suppose que cela vient des maîtres d'écriture, qui ont préféré l'x à l's, l'x offrant à la main la liberté de faire ces figures inutiles qu'ils appellent traits. Cet usage est bien plus ancien que les maîtres d'écriture auxquels Dumarsais fait allusion?; il appartient au moyen âge, dont l'orthographe variable substitua souvent l'x à l's finale.
Encyclopédie, 1re édition
, s. f. (Gram.) c'est la vingt-troisieme
lettre, & la dix-huitieme consonne de l'alphabet
françois. Nous la nommons ixe,
& c'est ce nom qui est féminin ;
mais cette dénomination ne sauroit
convenir à l'épellation ;
& pour désigner ce caractere,
relativement à sa destination
originelle, il faut l'appeller xe, nom masculin.
Nous tenons cette lettre des Latins, qui en avoient pris l'idée dans l'alphabet grec, pour représenter les deux consonnes fortes C S, ou les deux foibles G Z. C'étoit donc l'abréviation de deux consonnes réunies, ou une consonne double : X duplicem, loco C & S, vel G & S, posteà à græcis inventam, assumpsimus, dit Priscien, (lib. I.) c'est pourquoi Quintilien, (I. iv.) observe qu'on auroit pu se passer de ce caractere ; X litterâ carere potuimus, si non quæsissemus : & nous apprenons de Victorin (Art. gram. I.) que les anciens Latins écrivoient séparément chacune des deux consonnes réunies sous ce seul caractère ; latini voces quæ in X litteram incidunt, si in declinatione earum apparebat G, scribebant G & S, ut conjugs legs. Nigidius in libris suis X litterâ non est usus, antiquitatem sequens.
J'ai dit que les Latins avoient pris l'idée de leur X dans l'alphabet grec ; non qu'ils y ayent pris le caractere qui y avoit la même valeur, savoir ? ou ?, mais parce qu'ils ont emprunté le X, qui y valoit K H, ou ??, pour signifier leur C S ou G Z.
Cette lettre a dans notre ortographe différentes valeurs ; & pour les déterminer je la considérerai au commencement, au milieu, & à la fin des mots.
I. Elle ne se trouve au commencement que d'un très-petit nombre de noms propres, empruntés des langues étrangeres, & il faut l'y prononcer avec sa valeur primitive C S, excepté quelques-uns, devenus plus communs & adoucis par l'usage ; comme Xavier, que l'on prononce Gzavier ; Xénophon, que l'on prononce quelquefois Sénophon ; Ximénez, qui se prononce Siménez ou Chiménez.
II. Si la lettre X est au milieu du mot, elle y a différentes valeurs, selon ses diverses positions.
1°. Elle tient lieu de C S entre deux voyelles, lorsque la premiere n'est pas un e initial ; comme axe, maxime, Alexandre, Mexique, sexe, flexible, vexation, fixer, Ixion, oxicrat, paradoxe, luxe, luxation, fluxion, &c.
On en exceptoit autrefois les mots Bruxelles, Flexelles, Uxelles, qui ne font plus exception, parce qu'on les écrit conformément à la prononciation, Brusselles, Flesselles, Usselles ; mais il faut encore excepter aujourd'hui sixain, sixieme, deuxieme, dixain, dixaine, dixainier, dixieme, où X se prononce comme Z ; & soixante, soixantaine, soixantieme, que l'on prononce soissante, soissantaine, soissantieme.
2°. Elle tient encore lieu de C S, lorsqu'elle a après elle un C guttural, suivi d'une des trois voyelles a, o, u, ou d'une consonne, ou lorsqu'elle est suivie de toute autre consonne, excepté H ; comme excavation, excommunié, excuse, exclusion, excrément, exfolier, expédient, mixtion, exploit, extrait.
3°. Elle tient lieu de G Z, lorsqu'étant entredeux voyelles, la premiere est un e initial ; & dans ce cas la lettre h qui précéderoit l'une des deux voyelles est réputée nulle : comme dans examen, héxametre, exécution, exhérédation, exil, exhiber, exorde, exhorter, exultation, exhumer.
4°. Elle tient lieu de C guttural, quand elle est suivie d'un C sifflant, à cause de la voyelle suivante e ou i ; comme excès, exciter, qui se prononcent eccès, ecciter.
III. Lorsque la lettre X est à la fin des mots, elle y a, selon l'occurence, différentes valeurs.
1°. Elle vaut autant que C S à la fin des noms propres, Palafox, Pollux, Styx ; des noms appellatifs, borax, index, larynx, lynx, sphinx ; & des deux adjectifs perplex, préfix.
2°. Lorsque les deux adjectifs numéraux six, dix, ne sont point suivis du nom de l'espece nombrée, on y prononce x comme un sifflement fort ; j'en ai dix, prenez-en six.
3°. Deux, six, dix, étant suivis du nom de l'espece nombrée, commençant par une voyelle, ou par une h muette, ou bien dix n'étant qu'une partie élémentaire d'un mot numéral composé & se trouvant suivi d'une autre partie de même nature, on prononce X comme un sifflement foible, ou Z : deux hommes, six aunes, dix ans, dix-huit, dix-neuf, dix-neuvieme.
4°. A la fin de tout autre mot X ne se prononce pas, ou se prononce comme Z. Voici les occasions où l'on prononce X à la fin des mots, le mot suivant commençant par une voyelle, ou par une h muette ; 1°. Après aux, comme aux amis, aux hommes. 2°. A la fin d'un nom suivi de son adjectif, quand ce nom n'a pas x au singulier ; chevaux alertes, cheveux épars, travaux inutiles, feux ardens, v?ux indiscrets. 3°. A la fin d'un adjectif suivi du nom avec lequel il s'accorde ; heureux amant, faux accords, affreux état, séditieux insulaires. 4°. Après les verbes veux & peux ; comme je veux y aller, tu peux écrire, je peux attendre, tu en veux une.
X dans la numération romaine, valoit 10 ; & avec
un trait horisontal X valoit 10000. ![]() valoit seulement
1000. I avant X en soustrait une unité, &
IX=9 : au contraire XI=11, XII=12, XIII=13, XIV=14, XV=15, &c. X avant L ou
avant C, indique qu'il faut déduire 10 de 50 ou de
100 ; ainsi XL=40, XC=90.
valoit seulement
1000. I avant X en soustrait une unité, &
IX=9 : au contraire XI=11, XII=12, XIII=13, XIV=14, XV=15, &c. X avant L ou
avant C, indique qu'il faut déduire 10 de 50 ou de
100 ; ainsi XL=40, XC=90.
La monnoie frappée à Amiens est marquée X. (B. E. R. M.)
X, (Médail. Monnoie. Littérat.) on voit souvent les lettres greques ? & ?, jointes ainsi ? sur les anciennes médailles. Nous trouvons la premiere lettre, c'est-à-dire un X, sur de grandes monnoies de cuivre, où cette marque paroît avoir été mise pour des raisons de police civile.
Quelques antiquaires ont pris cette marque pour une date, & d'autres pour la lettre initiale d'un nom propre ; mais ces deux conjectures ne sont appuyées d'aucune raison solide. M. Ward suppose bien mieux que cette lettre est une abbréviation du mot grec ?????, qui veut dire monnoie, & qu'on a gravé cette marque sur ces pieces pour indiquer leur cours comme monnoie ; ce moyen a paru d'autant plus propre, que ces sortes de monnoies n'ont aucune empreinte de tête de roi, comme l'ont nos monnoies d'or & d'argent, mais on y voit un Jupiter avec une aigle perchée sur un foudre au revers.
Ce caractere ? fut ensuite transporté, par Constantin, sur ses monnoies & ses drapeaux à un tout autre dessein ; il en fit usage pour désigner en abregé le mot ??????? ; en quoi il fut suivi non-seulement par quelques-uns de ses successeurs, mais par des particuliers qui firent graver dévotement la même marque ? sur leurs lampes & autres meubles. Le même usage eut lieu pour les vases consacrés dans les églises.
Dans la suite, la marque ? vint à être employée dans les manuscrits, simplement pour notes critiques, servant à coter des endroits remarquables ; & alors cette marque fut mise pour les deux lettres initiales du mot grec ????????, utile ; c'est ce que nous apprenons d'lsidore Orig. l. I. c. xx. Voyez les Philos. Trans. n°. 474. §. 1. (Le chevalier .)
X x x, (Ecriture.) du côté de leur figure, les deux premieres sont composées dans leurs premieres parties de la 1, 8, 7, 6, 5, parties d'O, & un plain boutonné en forme de point. Dans leurs secondes, c'est un C entier.
A l'égard de la troisieme x, la premiere partie est un e renversé, la seconde est un e pur ; celles-ci se forment en un seul tems, du mouvement mixte des doigts & du poignet ; celles-là en deux tems, du même mouvement. Voyez le vol. des Pl. de l'Ecriture, & leur explic.
x, (Econom. rustiq.) l'x du moulin est une piece de fer, en forme d'x, qui a un trou quarré au milieu pour recevoir la tête du petit fer. Sur cette piece est posée la meule de dessus, & l'x est entaillée de toute son épaisseur dans la meule de dessus. Voyez nos Pl. de moulin, (Econom. rustiq.)
Étymologie de « x »
Lat. x?; grec, ?, lettre double composée de ? et de ?.
- (Inconnue) De l'arabe chay (« chose »)[1] via l'espagnol xay (x se prononce \?\ en espagnol).
- Cette lettre, inexistante en latin, a été inventée par les scribes du Moyen Âge comme abréviation de la combinaison ? us ?.
x au Scrabble
Le mot x vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot x - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot x au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
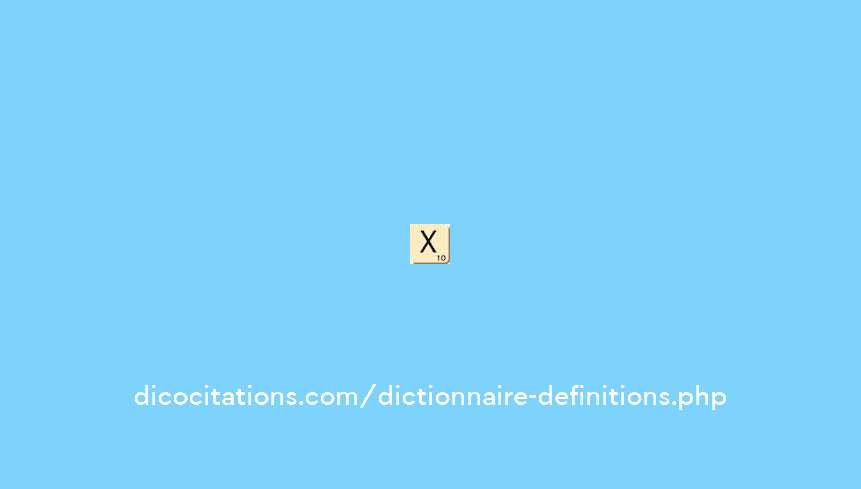
Les rimes de « x »
On recherche une rime en KS .
Les rimes de x peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ks
Rimes de taxent Rimes de Gallaix Rimes de cache-sexe Rimes de annexes Rimes de pacs Rimes de nasopharynx Rimes de Jamioulx Rimes de axent Rimes de hétérodoxes Rimes de rex Rimes de rixes Rimes de équinoxe Rimes de télex Rimes de demi-luxe Rimes de lux Rimes de paradoxes Rimes de fixe Rimes de orthodoxe Rimes de unisexes Rimes de réflexes Rimes de parallaxe Rimes de fox Rimes de Signeulx Rimes de x Rimes de relaxes Rimes de thorax Rimes de cortex Rimes de détaxe Rimes de tex Rimes de juke-box Rimes de pharynx Rimes de trax Rimes de néocortex Rimes de préfixe Rimes de perplexe Rimes de inox Rimes de Kemexhe Rimes de juke-boxes Rimes de boxe Rimes de orthodoxes Rimes de oryx Rimes de larynx Rimes de bombyx Rimes de vexe Rimes de fluxe Rimes de taxe Rimes de opoponax Rimes de ibex Rimes de onyx Rimes de orthodoxeMots du jour
taxent Gallaix cache-sexe annexes pacs nasopharynx Jamioulx axent hétérodoxes rex rixes équinoxe télex demi-luxe lux paradoxes fixe orthodoxe unisexes réflexes parallaxe fox Signeulx x relaxes thorax cortex détaxe tex juke-box pharynx trax néocortex préfixe perplexe inox Kemexhe juke-boxes boxe orthodoxes oryx larynx bombyx vexe fluxe taxe opoponax ibex onyx orthodoxe
Les citations sur « x »
- S'il souhaitait de s'élever et s'il le répétait sans cesse, il avait l'horreur des servitudes bureaucratiques et n'eût pas considéré comme une élévation de travailler à heures fixes, derrière des portes closes, même au prix d'un traitement princier.Auteur : Georges Duhamel - Source : Chronique des Pasquier (1933-1945)
- Ce nuage, c'est comme si la plus belle femme du monde vous avait donné rendez-vous dans un endroit connu de vous seul, résumait l'un d'eux, et qu'elle avait oublié de vous communiquer la date.Auteur : Fabrice Colin - Source : La Vie extraordinaire des gens ordinaires (2010)
- Il n'est pas séant par exemple d'y retirer ses jambes, il faut les étendre et il est à propos de se coucher tantôt sur un côté, tantôt sur un autre; car il n'est pas honnête de dormir étant couché sur le ventre.Auteur : Jacqueline Pascal - Source : Règlement des enfans
- Plus un sceptre s'étend, plus il pèse aux mains qui le portent; ainsi la longueur d'un bâton ajoute au poids suspendu à son extrémité.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- On la croyait indéchiffrable, quand une curieuse, aux mains de laquelle le livre était venu, s'avisa de regarder dans un miroir la page maculée. Elle lut très nettement dans la glace: «Je t'envoie mon coeur dans un baiser».Auteur : Anatole France - Source : La Vie littéraire (1888)
- Pour que les gens tombent amoureux de vous, il n'y a pas trente-six méthodes: il faut faire semblant de s'en foutre complètement. Stratagème infaillible.Auteur : Frédéric Beigbeder - Source : L'Egoïste Romantique (2005)
- Le barbare estant homme cault et malicieux, parlant tout doulx, le reconfortoit.Auteur : Jacques Amyot - Source : Crassus, 42
- Le jeune oiseau se laisse tirer deux ou trois fois, mais c'est en vain qu'on tend un filet ou qu'on tire l'arc devant ceux qui ont déjà des plumes.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, Le Purgatoire (1316), XXXI
- De mon style, Monsieur? Si par malheur j'en avais un, je m'efforcerais de l'oublier quand je fais une comédie, ne connaissant rien d'insipide au théâtre comme ces fades camaïeux où tout est bleu, où tout est rose, où tout est l'auteur, quel qu'il soit.Auteur : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais - Source : Le Mariage de Figaro (1784), préface
- L'Etat, c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde.Auteur : Frédéric Bastiat - Source : Harmonies économiques (1850)
- La liberté générale bannira du monde entier les absurdes oppressions qui accablent les hommes et fera renaître une fraternité universelle, sans laquelle tous les avantages publics et individuels sont si douteux et si précaires.Auteur : Mirabeau - Source : Collection
- La chance existe. Sans cela, comment expliquerait-on la réussite des autres.Auteur : Marcel Achard - Source : Sans référence
- Je pense que pour vivre, il faut s'y prendre très jeune, parce qu'après on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeaux.Auteur : Romain Gary - Source : La vie devant soi
- Les élans du coeur m'étaient devenus tout à fait désagréables, je préférais ceux du corps tout simplement.Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Voyage au bout de la nuit (1932)
- A Bruxelles, on juge une empoisonneuse qui n'a pas envoyé moins de douze personnes dans l'au-delà.Auteur : Julien Green - Source : Journal, 1938
- Le langage le plus énergique est celui où le signe a tout dit avant qu'on parle. Ainsi l'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Essai sur l'origine des langues (1781)
- Quand de nouveaux chagrins nous ont fait faire quelques pas dans la bonne voie, il n'est pas permis de se plaindre. C'est avoir placé à fonds perdu, mais la rente reste.Auteur : Sophie Swetchine - Source : Airelles
- Le désespoir n'existe pas dans le monde ! Du tout !Auteur : Nahman de Bratslav - Source : Likouté Moharane
- En consultant un catalogue ..., j'ai découvert que la limande-salope a les yeux à gauche, tandis que la limande-franche les a à droite, ça m'a fait éclater de rire.Auteur : Bernard Comment - Source : Un poisson hors de l'eau (2004)
- Il commençait de me faire connaître des dieux que j'ai, pour mon allégement et ma joie, confessés dans la suite des jours.Auteur : Georges Duhamel - Source : Chronique des Pasquier (1933-1945)
- Son teint albumineux était plus blanchâtre que de coutume.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- Les meilleurs tueurs sont ceux qui sont capables d'amour, car ils connaissent les forces de la vie.Auteur : Alfred Angelo Attanasio - Source : Radix (1983)
- Maintenant je suis grand et j'ai acquis de l'expérience
Moi aussi j'ai mes dictons bourrés de vérité
C'est dans les vieux pots que la soupe est la plus dégueulasse
Et c'est en forgeant qu'on devient vachement fatigué
C'est parfois les petits lits qui font les grandes maîtresses
Et les p'tits oiseaux qui entretiennent les saletés
Frappe toujours un homme à terre avant qu'il se redresse
Il te remerciera, pour vivre heureux vivons couchés.Auteur : Pierre Perret - Source : Les proverbes (1970) - Personne n'entend ceux qui disent vouloir être seuls. La volonté de solitude, c'est forcément une pulsion morbide.Auteur : David Foenkinos - Source : La Délicatesse (2009)
- C'est merveilleux
Quand on est tous les deux
Le bonheur nous surveille
C'est merveilleux
Quand on est amoureux.Auteur : Édith Piaf - Source : C'est merveilleux
Les mots proches de « x »
Xénélasie Xénodoque Xiphias Xiphoïde Xyloculture Xylofer XylographiqueLes mots débutant par x Les mots débutant par x
x Xaffévillers Xaintrailles Xaintray Xambes Xammes Xamontarupt Xanrey Xanton-Chassenon Xaronval xavier xavier xénogenèse xénogreffe xénon xénophilie xénophobe xénophobe xénophobes xénophobes xénophobie xérès Xermaménil xérographie xérographique Xertigny Xeuilley Xhendelesse Xhendremael Xhoris xiang xième xiphidion xiphoïde Xirocourt Xivray-et-Marvoisin Xivry-Circourt Xocourt Xonrupt-Longemer Xonville Xouaxange Xousse Xures xylène xylographie xylophone xylophones xylophoniste
Les synonymes de « x»
Les synonymes de x :- 1. porno
2. obscène
3. vulgaire
4. indécent
5. impudique
6. pornographie
7. pornographique
8. grossier
synonymes de x
Fréquence et usage du mot x dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « x » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot x dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de X ?
Citations x Citation sur x Poèmes x Proverbes x Rime avec x Définition de x
Définition de x présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot x sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot x notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 1 lettres.
