Définition de « ongle »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot ongle de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur ongle pour aider à enrichir la compréhension du mot Ongle et répondre à la question quelle est la définition de ongle ?
Une définition simple : (fr-rég|??gl) ongle (m)
Expression : (fig) (fam) Rogner les ongles à quelqu’un, les lui rogner de bien près : Lui retrancher de ses profits ou de son pouvoir. (fig) (fam) Avoir bec et ongles : Être pourvu des moyens de se défendre et savoir en user. (fig) Se ronger les ongles : (ucf|montrer) une grande impatience. (fig) (fam) Avoir de l’esprit jusqu’au bout des ongles : Avoir beaucoup d’esprit, faire paraître son esprit jusque dans les plus petites choses. (fig) (fam) Payer rubis sur l’ongle : (ucf|payer) très exactement.
Définitions de « ongle »
Trésor de la Langue Française informatisé
ONGLE, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
ongle \Prononciation ?\ masculin ou féminin (l'usage hésite)
- Variante de ungle.
Nom commun - français
ongle \???l\ masculin
-
(Anatomie) Lame dure, cornée, translucide, qui revêt le dessus du bout des doigts et des orteils.
- Alors, je commençai à torturer le colporteur. Je lui arrachai, un par un, tous les ongles des mains et tous les ongles des pieds... ? (Octave Mirbeau, La Pipe de cidre, 1886, Le colporteur)
- Jim se curait les ongles à l'aide d'une allumette. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
- Cette fois, je fermai les poings à m'enfoncer les ongles dans la paume. J'étais décidé à ne plus remuer les doigts. ? (Henri Alleg, La Question, 1957)
- Je ne me coupais pas les ongles depuis longtemps ; c'était encore un moyen de défense que la nécessité m'avait inspiré, et mes cinq doigts ainsi armés étaient entrés profondément dans la peau de ce misérable. ? (François Auguste Biard, Deux années au Brésil, 1862)
- Pour bien marquer leur condition et leur exemption de tout travail, [les femmes des riches et des mandarins] portent les ongles d'une longueur démesurée, enveloppés dans des étuis d'or ou d'argent, quelques-uns ornés de grelots. ? (Émile Bard, Les Chinois chez eux, Paris : A. Colin et Cie, 1899)
- Nora Blume fixait ses ongles, absorbée. Elle les comparait à ceux parsemés de brillants de Madame Hermani. ? (Claudia Quadri, Joue, Nora Blume, traduit de l'italien (Suisse) par Danielle Benzonelli, Éditions Plaisir de Lire, 2018, chap. 6)
-
Griffe de certains animaux, serre des oiseaux de proie.
- Les ongles des tigres, des ours.
- Les ongles crochus et rétractiles du lion, du chat.
- Les ongles d'un aigle, d'un vautour.
- (Par extension) Sabot des solipèdes, des ruminants.
- (Ophtalmologie) Pellicule qui commence en forme d'ongle ou de croissant vers l'angle interne de l'?il et qui s'étend peu à peu jusque sur la prunelle.
Littré
-
1Lame dure, cornée, demi-transparente, qui revêt l'extrémité dorsale des doigts et des orteils.
Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt Qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit??
Molière, Mis. II, 1.Il y a plusieurs endroits de la terre où l'on se laisse croître les ongles, pour marquer que l'on ne travaille point
, Montesquieu, Esp. XIX, 9.Les ongles sont plus petits dans l'homme que dans tous les autres animaux?; s'ils excédaient beaucoup les extrémités des doigts, ils nuiraient à l'usage de la main
, Buffon, Hist. natur. hom. ?uv. t. IV, p. 320.Les habitants de Taïti laissent toute leur longueur aux ongles, excepté à celui du doigt du milieu de la main droite
, Bougainville, Voy. t. II, p. 77, dans POUGENS.Ces Russes ajoutèrent qu'ils s'étonnaient surtout de notre sécurité à l'approche de leur puissant hiver?: dans quinze jours, s'écriaient-ils, vos ongles tomberont, vos armes s'échapperont de vos mains engourdies et à demi mortes
, Ségur, Hist. de Nap. VIII, 10.Il n'est crû que par les cheveux et par les ongles, se dit d'un nain.
Terme de manége. Ongles du poing de la bride, les ongles de la main gauche.
Populairement. Ongles de velours, ongles sales et mal soignés.
Fig. et par plaisanterie. Avoir des ongles en deuil, en demi-deuil, les avoir noirs de saleté.
Fig. Rogner les ongles à quelqu'un, les lui rogner de bien près, lui diminuer son pouvoir, ses profits.
Des princes qui avaient assez de courage pour rogner les ongles aux Samuels et aux Grégoires
, Voltaire, Dial. XXIV, 5.Couper les ongles, enlever la partie libre qui croît constamment?; et fig. ôter à quelqu'un ce qui fait sa force, son talent, etc.
C'est bien assez de me couper les ongles moi-même de bien près, sans qu'un censeur vienne encore me les couper jusqu'au sang
, D'Alembert, Lett. à Voltaire, 17 janv. 1765.Songez donc que Bertrand a les ongles coupés
, D'Alembert, ib. 26 févr. 1774.Fig. Avoir de l'esprit jusqu'au bout des ongles, en avoir beaucoup.
Être quelque chose jusqu'aux ongles, l'être tout à fait.
Mme de Mauconseil, qui est d'Argenson jusque sous les ongles
, Mme de Chateauroux, Correspond. p. 254, dans POUGENS.Ils ne veulent pas qu'on les traite comme des ouvriers, et ils sont ouvriers jusqu'aux ongles
, Vauvenargues, Nouv. max. 68.Il a bien rongé ses ongles, se dit d'un homme qui a beaucoup travaillé à un ouvrage d'esprit.
J'ai fait cent tours sous mon portique, Rongé mes ongles bien et beau, Pour en style macaronique Tirer encor de mon cerveau Quelque vieux rébus pathétique
, Chaulieu, Rép. à la duch. du Maine.Ronger ses ongles, manger ses ongles, mordre ses ongles, se dit aussi de celui qui est en proie à l'impatience, au chagrin.
Elle pleure, et ses ongles ronge
, Scarron, Virg. IV.Avoir du sang aux ongles, sous les ongles, au bout des ongles, avoir du c?ur.
Si nos ennemis avaient du sang aux ongles
, Sévigné, 5 août 1676.Fig. Avoir bec et ongle, savoir bien se défendre en toutes manières.
Rubis sur l'ongle, voy. RUBIS.
Fig. Savoir une chose sur l'ongle, la savoir couramment, très bien.
-
2Griffes de plusieurs animaux.
Un enfant? De qui par pitié j'ai dérobé les jours Aux ongles des lions, aux griffes des vautours
, Corneille, ?dipe, V, 4.Tout cet orgueil [du coq vainqueur] périt sous l'ongle du vautour
, La Fontaine, Fabl. VII, 13.Eux venus, le lion par ses ongles compta
, La Fontaine, ib. I, 6.Le monstre des forêts [un lion], furieux de sa blessure, imprimait déjà ses ongles sanglants dans le flanc du monarque
, Voltaire, Princ. de Babyl. 1.Tel ce terrible oiseau qui porte le tonnerre, Par ses ongles tranchants enlève de la terre Le cygne au blanc plumage ou le lièvre peureux
, Delille, Én. IX.Fig.
Nous voulons bien [nous protestants] ressembler à des brebis, nous contenter de bêler comme elles, et nous couvrir de leur peau, pendant que nous serons faibles?; mais quand les dents et les ongles nous seront venus comme à de jeunes lions?
, Bossuet, 5e avert. 14.À l'ongle on connaît le lion, c'est-à-dire on reconnaît aux moindres traits un homme d'un grand talent, d'un grand caractère.
C'est l'ongle du lion, se dit d'un trait qui décèle un grand talent, un grand caractère.
-
3 Par extension, sabot des solipèdes ou des ruminants. Chute de l'ongle.
On dit que les nymphes le nourrissaient [Épiménide], et qu'il gardait dans l'ongle d'un b?uf la manne qu'elles lui apportaient
, Fénelon, Épimén.Et ma lyre aux fibres d'acier A passé sur ces âmes viles, Comme sur le pavé des villes L'ongle résonnant du coursier
, Hugo, Odes, II, 10. - 4 Terme de zoologie. Dent recourbée qui termine les pattes des insectes.
- 5Se dit de divers opercules des coquilles.
-
6 Par analogie. Instrument crochu de fer.
J'ai vu couler leur sang sous les ongles de fer
, Rotrou, St Genest, III, 2.Ces voiles où sont-elles, Qu'armaient les infidèles, Et qui prêtaient leurs ailes à l'ongle des brûlots??
Hugo, Orient. 5. -
7 Terme de chirurgie. Ongle, traduction française du mot grec onyx, variété du ptérygion en forme d'ongle.
Sorte d'hypopyon consistant en un abcès, qui a l'aspect d'un croissant, entre l'iris et la cornée.
Terme de fauconnerie. Maladie qui survient à l'?il des oiseaux par l'effet d'un chaperon trop serré ou de quelque rhume.
REMARQUE
Le genre d'ongle a été longtemps incertain?; au XVIIe siècle, Chifflet, Gramm. p. 250, remarque qu'il vaut mieux le faire masculin. Cependant plusieurs le faisaient féminin?: Elle [l'alouette] sent son ongle maline [de l'autour]
, La Fontaine, Fabl. VI, 15. Aujourd'hui il est masculin.
HISTORIQUE
XIe s. Al ungle de petit dei
, Lois de Guill. 13.
XIIe s. Des-ci as ongles sont armé sans faillance
, Ronc. p. 134. Entre ses ongles [le faucon] me saisit maintenant
, ib. p. 164. Bernier l'oï, tout a le sens changié?; De poor tranble dès qu'en l'ongle del pié
, Raoul de C. 114.
XIIIe s. À ses ongles [elle] s'estoit un peu esgratinée
, Berte, LXXXII. Li enherbemens [empoisonnement] ne fu mie à mort?; mais li ongle li cheïrent des piés et des mains
, Chr. de Rains, p. 49. S'en tes ongles a point de noir, Ne l'i laisse pas remanoir
, la Rose, 2178.
XIVe s. Il advient souvent aux chiens une maladie es yeux qu'on appelle ongle
, Modus, f° XLIV. Il appartient principalement au juge garder et tenir à l ungle et au point touts lez drois
, Oresme, Eth. 162.
XVe s. Voudroit vos ongles vous avoir coppées jusques au sang, et reployé la corne de vostre povoir en confusion basse
, Chastelain, Chr. des d. de Bourg. II, 25. Vouloit toutefois maintenir le sien, et le tenir aux ongles
, Chastelain, Élog. de Charles le Hardi. Son aïeul [de ta femme], son frere et son oncle Et son pere doiz tu à l'ongle Honourer, amer, conjouir
, Deschamps, Miroir de mariage, p. 38. On me dira que je chasse bien contre ongle?; car je ne quiers que à monstrer exemple de magnanimité qui est vertu contendant à honneur, et je monstre exemple de trahison très deshonneste et de très frauduleuse deception
, Hist. de la Toison d'or, t. I, f° 41, dans LACURNE.
XVIe s. Le cheval de Cesar avoit l'ongle couppée en forme de doigts
, Montaigne, I, 36. Je me travaillois d'entrouvrir mon pourpoinct à belles ongles
, Montaigne, II, 56. J'ay pu me mesler des charges publicques, sans me despartir de moy, de la largeur d'une ongle
, Montaigne, IV, 152. Il fit faire un beau lit de marbre poli à l'ongle [c'est-à-dire parfaitement, en latin ad unguem]
, Yver, p. 547. Ce que vous faites, s'appelle proprement se mettre entre l'ongle et la chair [mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce]
, Carloix, II, 7. Il sort promptement pour destourner la beste à vingt ongles [une femme], la faisant sortir par une petite porte
, Carloix, VI, 5. Arracher un ongle entrant en la chair
, Paré, Introd. 2. Pterygion?: ungle, c'est une excroissance de chair fibreuse, laquelle petit à petit couvre la conjonctive, venant d'un angle de l'?il?: et pour ce est dit comme ongle
, Paré, XV, 5. Le cheval a l'ongle forte
, Paré, Anim. 1. Il a les ongles fort pointus
, Paré, Monstr. app. 1. Le premier, comme vous savez et moi aussi, a un peu les ongles bien pales pour une charge où il ne faut rien craindre, et estre tousjours au peril
, Sully, Mém. t. III, p. 211, dans LACURNE. C'est belle bataille des chiens et des chats, chascun a des ongles
, Cotgrave ?
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
ONGLE. Ajoutez?: Fig. Nous ne sommes pas renversés d'un seul effort?; nous avons quelque coup d'ongle, et d'une heure à l'autre perdons quelque chose de notre vigueur
, Malherbe, Lexique, éd. L. Lalanne.
REMARQUE
Ajoutez?:
2. Dans les plus anciens exemples rapportés à l'historique, on ne voit pas de quel genre ongle était. Ici le genre est déterminé et il est féminin?: XIIe s. Il [les chameaux] n'ont mie l'ungle fendue
, li Dialoge Gregoire lo pape, 1876, p. 353.
Encyclopédie, 1re édition
ONGLE, s. m. (Botan.) on appelle ongle ou onglet, en Botanique, une espece de tache, différente en couleur du reste des pétales de certaines fleurs. On observe cette sorte de tache à la naissance des feuilles de rose, de la fleur des pavots, & de plusieurs autres. (D. J.)
Ongle, (Anat.) les ongles sont ces corps, pour la plûpart, transparens, qui se trouvent aux extrémités des doigts tant des mains que des piés ; ils sont convexes en-dehors, concaves en-dedans, d'une figure ovale, & d'une consistence assez ferme. Ils semblent être en géneral de la même substance que les cornes.
Malpighi, Boerhaave, Heister & plusieurs autres célebres auteurs, prétendent avec beaucoup de vraissemblance, que les ongles sont formé par les mamelons de la peau ; ces mamelons couchés longitudinalement à l'extrémité des doigts, s'alongent parallelement, s'unissent ensemble, & s'endurcissent avec des vaisseaux cutanés qui se soudent ; & l'épiderme se joignant à ces mamelons vers la racine de l'ongle, leur sert comme de gaine. De tout cela résulte un amas de fibres déliées, & fortement collées ensemble, qui viennent de toute la partie de la peau qu'elles touchent, & qui forment plusieurs couches appliquées étroitement les unes sur les autres. Ces couches n'ont pas la même longueur, & sont arrangées par degré de telle façon, que les extérieures sont les plus longues, & les intérieures les plus courtes. Enfin elles se séparent aisément par la macération : mais pour mieux développer encore la formation & la structure des ongles, nous allons emprunter les lumieres de M. Winslow.
La substance des ongles, dit-il, est comme cornée & composée de plusieurs plans ou couches longitudinales soudées ensemble. Ces couches aboutissent à l'extrémité de chaque doigt. Elles sont presque d'une égale épaisseur ; mais elles sont différentes en longueur. Le plus externe de ces plans est le plus long, & les plans intérieurs diminuent par degré jusqu'au plan le plus interne, qui est le plus court de tous ; de sorte que l'ongle augmente par degré en épaisseur depuis son union avec l'épiderme, où il est le plus mince, jusqu'au bout du doigt, où il est le plus épais. Les extrémités graduées, ou racines de toutes les fibres, dont ces plans sont composés, sont creuses, pour recevoir autant de mamelons très menus & fort obliques qui y sont enchâssés. Ces mamelons sont une continuation de la vraie peau, qui étant parvenue jusqu'à la racine de l'ongle, forme une repli semi-lunaire, dans lequel la racine de l'ongle se niche.
Après ce repli semi-lunaire, la peau se continue sous toute la surface interne de l'ongle, & les mamelons s'y insinuent comme on vient de le dire. Le repli de la peau est accompagné de l'épiderme jusqu'à la racine de l'ongle extérieurement, & il est très-adhérent à cette racine.
On distingue communément dans l'ongle trois parties ; savoir, la racine, le corps, & l'extrémité. La racine est blanche & en forme de croissant. Elle est cachée entierement, ou pour la plus grande partie, sous le repli semi-lunaire dont nous venons de parler. Le croissant de l'ongle & le repli de la peau sont à contre-sens l'un de l'autre. Le corps de l'ongle est latéralement vouté : il est transparent, & de la couleur de la peau mamelonnée. L'extrémité ou le bout de l'ongle n'est attaché à rien, & croît toujours à mesure que l'on le coupe.
Les Anatomistes qui attribuent l'origine des ongles aux mamelons de la peau, expliquent par ce moyen plusieurs phénomenes au sujet des ongles. Ainsi, comme les mamelons sont encore tendres à la racine de l'ongle, de-là vient qu'il est si sensible à cet endroit ; & comme plus l'extrémité des mamelons s'éloigne de la racine, plus cette extrémité se durcit, cela fait qu'on peut couper le bout des ongles sans causer un sentiment de douleur.
Comme ces mamelons & ces vaisseaux soudés qui forment l'ongle viennent de la peau par étages, tant à la racine qu'à la partie inférieure, c'est pour cela que les ongles sont plus épais, plus durs, & plus forts en s'avançant vers l'extrémité ; à cause que naissans de toute la partie de la peau qu'ils touchent, les mamelons augmentent en nombre de plus en plus, & vont se réunir au bout des ongles. C'est aussi par le moyen de ces mamelons que les ongles sont fortement attachés à la peau qui est au-dessous. Cependant, on peut aisément les en séparer dans les cadavres par le moyen de l'eau chaude.
Quant à la nourriture & à l'accroissement des ongles, on l'explique en disant que, comme les autres mamelons de la peau ou des vaisseaux qui leur portent la nourriture, les mamelons des ongles en ont aussi de semblables à leur commencement. De ces mamelons, qui sont les racines, il sort des fibres qui s'alongent, se collent ensemble & se durcissent ; & de cette maniere les ongles se nourrissent & croissent couche sur couche en naissant de toute la partie de la peau qu'ils touchent, comme il a été expliqué ci-dessus.
Les ongles, pendant la vie, croissent toujours ; c'est pourquoi on les rogne à mesure qu'ils surpassent les extrémités des doigts. Les Romains se les faisoient couper par des mains artistes ; les nègres de Guinée les laissent croître comme un ornement, & comme ayant été faits par la nature pour prendre la poudre d'or.
C'est une erreur populaire en Europe, d'imaginer que les ongles croissent après la mort. Il est facile de se convaincre de la fausseté de cette opinion, pour peu qu'on entende l'économie animale : mais ce qui a donné lieu à cette erreur, c'est qu'après la mort les extrémités des doigts se dessechent & se retirent, ce qui fait paroître les ongles plus longs que durant la vie ; sans compter que les malades laissent ordinairement croître leurs ongles sans les couper, & qu'ainsi ils les ont souvent fort longs quand ils viennent à mourir après une maladie qui a duré quelque tems.
Quelquefois on apperçoit une tache à la racine de l'ongle, & l'on remarque qu'elle s'en éloigne à mesure que l'ongle croît, & qu'on la coupe : cela arrive ainsi, parce que la couche qui contient la tache étant poussée vers l'extrémité par le suc nourricier qu'elle reçoit, la tache doit l'être pareillement. La même chose arriveroit si la tache se rencontroit ailleurs qu'à la racine.
Quand un ongle est tombé, à l'occasion de quelqu'accident, on observe que le nouvel ongle se forme de toute la superficie de la peau, à cause que les petites fibres qui viennent des mammelons, & qui se collent ensemble, s'accroissent toutes en même tems.
La grande douleur que l'on ressent quand il y a quelque corps solide enfoncé entre l'ongle & la peau, ou quand on arrache les ongles avec violence ; cette douleur, dis-je, arrive à cause que leur racine est tendre & adhérente aux mamelons de la peau, qui sont proprement les organes du toucher & du sentiment ; de sorte que la séparation des ongles ne peut pas se faire sans blesser ces mamelons, & par conséquent, sans occasionner de très-vives douleurs.
Au reste, comme on l'observe, quand les mamelons sont anéantis quelque part, la peau perd son propre sentiment en cet endroit ; on peut aussi conjecturer que lorsqu'ils sont anéantis à l'endroit des ongles, de nouveaux ongles ont de la peine à se produire.
Les usages des ongles sont principalement les suivans : 1°. ils servent de défense aux bouts des doigts & des orteils, qui, sans leur secours, se blesseroient aisément contre les corps durs. 2°. Ils les affermissent, & empêchent qu'en pressant ou en maniant des choses dures, les bouts des doigts & des orteils ne se renversent contre la convexité de la main ou du pié ; car dans les doigts, c'est du côté de la paume de la main, & dans les orteils, c'est du côté de la plante du pié que se font les plus fréquentes & les plus fortes impressions quand on manie quelque chose, ou quand on marche : c'est pourquoi l'on peut dire, que non-seulement les ongles tiennent lieu de boucliers, mais qu'ils servent sur-tout comme d'arc-boutans. 3°. Ils donnent aux doigts de la main la facilité de prendre & de pincer les corps qui échaperoient aisément par leur petitesse. Les autres usages sont assez connus. Nous parlerons dans la suite des ongles des animaux. Mais nous invitons le lecteur à lire les remarques particulieres de M. du Verney sur ceux de l'homme dans le journal des savans du 23 Mai 1689.
Il arrive quelquefois que l'ongle du gros orteil croît dans la chair par sa partie latérale, ce qui cause de fort grandes douleurs, & la chair croît sur l'ongle. C'est en vain que l'on tâche de consumer cette chair par des cathérétiques, si préalablement on ne coupe l'ongle avec beaucoup de dextérité ; après quoi l'on tire avec une pincette le morceau d'ongle, & on l'enleve le plus doucement qu'il est possible ; ce qui pourtant ne peut se faire sans causer une vive douleur.
Pour prévenir la récidive, quelques-uns conseillent, le mal étant gueri, de ratisser l'ongle par le milieu avec un morceau de verre, une fois tous les mois, jusqu'à ce que l'ongle soit tellement émincé, qu'il céde sous le doigt. Quoiqu'on ne fasse pas ordinairement grand cas de cette blessure, il y a cependant des auteurs qui rapportent qu'elle n'a pas laissé, arrivant sur-tout à des sujets d'une mauvaise constitution, d'occasionner des fâcheux accidens, & même la mort à quelques personnes.
La nature exerce ses jeux sur les ongles, comme sur les autres parties du corps humain. Rouhaut a envoyé en 1719 à l'ac. des Sciences une relation & un dessein des ongles monstrueux d'une pauvre femme de Piémont. On jugera de leur grandeur par celle du plus grand de tous, qui étoit l'ongle du gros doigt du pié gauche. Il avoit depuis sa racine jusqu'à son extrémité quatre pouces & demi. On y voyoit que les lames qui composent l'ongle sont placées les unes sur les autres, comme les tuiles d'un toit, avec cette différence, qu'au lieu que les tuiles de dessous avancent plus que celles de dessus, les lames supérieures avançoient plus que les inférieures. Ce grand ongle, & quelques-autres, avoient des inégalités dans leur épaisseur, & quelquefois des recourbemens, qui devoient venir ou de la pression du soulier, ou de celle de quelques doigts du pié sur d'autres. Ce qui donna occasion à ces ongles de faire du bruit, & d'attirer la curiosité de M. de Rouhaut ; c'est que cette femme s'étant cru possédée, & s'étant fait exorciser, elle s'imagina, & publia que le diable s'étoit retiré dans les ongles de ses piés, & les avoit fait croître si excessivement en moins de rien.
On lit dans la même histoire de l'acad. des Scienc. année 1727, l'observation d'un enfant qui avoit les cinq doigts de chaque main parfaitement joints en un seul corps, faisant le même volume & la même figure que des doigts séparés à l'ordinaire qui se tiendroient joints, & ces doigts unis étoient couverts d'un seul ongle, dont la grandeur étoit, à-peu-près, celle des cinq.
Il est tems de dire un mot des ongles des bêtes, qui sont quelquefois coniques, quelquefois caves, & qui servent aux uns de souliers, d'armes aux autres ; mais rien n'est plus curieux que l'artifice qui se trouve dans les pattes des lions, des ours, des tigres, & des chats, où les ongles longs & pointus se cachent si proprement dans leurs pattes, qu'ils n'en touchent point la terre, & qu'ils marchent sans les user & les émousser, ne les faisant sortir que quand ils s'en veulent servir pour frapper & pour déchirer.
La structure & la méchanique de ces ongles est, en quelque façon, pareille à celle qui fait le mouvement des écailles des moules : car de même qu'elles ont un ligament, qui, ayant naturellement ressort, les fait ouvrir, quand le muscle qui est en-dedans ne tire point ; les pattes des lions ont aussi un ligament à chaque doigt, qui, étant tendu comme un ressort, tire le dernier auquel l'ongle est attaché, & le fait plier en dessus, ensorte que l'ongle est caché dans les entre-deux du bout des doigts, & ne sort de dehors pour agriffer, que lorsqu'un muscle, qui sert d'antagoniste au ligament, tire cet os, & le fait retourner en-dessous avec l'ongle ; il faut néanmoins supposer que les muscles extenseurs des doigts, servent aussi à tenir cet ongle redressé, & que ce ligament est pour fortifier son action.
Les anciens, qui n'ont point remarqué cette structure, ont dit que les lions avoient des étuis, dans lesquels ils serroient leurs ongles pour les conserver ; il est bien vrai qu'à chaque bout des orteils des lions, il y a une peau dans laquelle les ongles sont en quelque façon cachés, lorsque le ligament à ressort les retire ; mais ce n'est point cet étui qui les conserve ; car les chats, qui n'ont point ces étuis, & qui ont tout le reste de la structure des pattes du lion, conservent fort bien leurs ongles, sur lesquels il ne marchent point, si ce n'est quand ils en ont besoin pour s'empêcher de glisser. De plus, ces étuis couvrent tout l'ongle excepté la pointe, qui est la seule partie qui a besoin d'être conservée. (D. J.)
Ongle, (Chimie.) espece de matiere osseuse fort analogue à la corne. Voyez Substances animales.
Ongle, terme de Chirurgie, employé pour exprimer deux maladies des yeux fort différentes ; l'une connue sous le nom latin unguis, dont nous allons parler dans cet article ; & l'autre que nous décrirons au mot Onyx.
L'ongle est une maladie de l'?il, qui consiste en une excroissance plate qui s'étend sur la conjonctive ; elle commence ordinairement au grand angle, & va par degrés jusqu'à la cornée transparente qu'elle couvre enfin tout-à-fait. Les Grecs l'ont nommée pterygium, qui signifie petite aîle ; & les Latins pannus ou panniculus, & unguis, parce que cette excroissance est à-peu-près de la grandeur & de la figure d'un ongle de la main.
Les anciens ont reconnu trois especes d'ongles : un membraneux, parce qu'il ressemble à une membrane charnue ; le second adipeux, parce qu'il est plus blanchâtre que le precédent, & qu'il semble être de la graisse congelée. Ils ont nommé le troisieme variqueux, parce qu'il paroît tissu de beaucoup d'arteres, & de veines assez grosses ; c'est celui qu'on appelle proprement pannus. Il est le plus fâcheux de tous, parce qu'il est susceptible d'inflammation, de douleur, & d'ulcération.
Le prognostic de l'ongle n'est point équivoque : si l'on ne le guérit pas, il prive celui qui en est attaqué de l'usage de la vue. Il faut donc nécessairement employer les secours qui conviennent pour le détruire.
La cure de l'ongle est différente, suivant son état : s'il est médiocre & récent, on peut, selon Maître-Jan, l'atténuer & le dessécher par les collyres secs, avec le vitriol blanc, le sucre candi, l'os de seche, l'iris de Florence, la poudre de tuthie, &c. On y ajoute du verre ou du crystal subtilement pulvérisé : chaque particule de cette substance conserve des ongles tranchans qu'on apperçoit au microscope, & qui servent à excorier la superficie de l'ongle. Ces scarifications imperceptibles procurent l'écoulement de l'humidité qui abreuve cette membrane contre nature, & elles y attirent une legere suppuration. L'auteur assure s'en être servi plusieurs fois sans aucun inconvénient, & avec beaucoup de succès.
Si par ces remedes ou autres semblables, on n'a pu parvenir à dessécher & détruire l'ongle, il faut faire l'opération.
On prépare d'abord une aiguille un peu longue & ronde ; on la détrempe en la faisant rougir à la flamme d'une chandelle, & on la courbe suivant qu'on le juge à propos ; on en émousse ensuite la pointe sur une pierre à aiguiser, afin qu'elle ne pique point, & qu'elle se glisse plus aisément entre l'ongle & la conjonctive, sans blesser cette membrane.
Pour faire l'opération, on enfile cette aiguille d'un fil de soie retors : l'opérateur assis fait asseoir le malade par terre, & lui fait renverser & appuyer sa tête sur ses genoux ; ou le chirurgien peut rester debout & faire asseoir le malade dans un fauteuil dont le dosier puisse se renverser. Un aide tient une paupiere ouverte, & le chirurgien l'autre ; celui-ci passe son aiguille par-dessous l'ongle, vers son milieu, ensorte qu'il le comprenne entierement. Voyez Planche XXII. figure 4 (a). Lorsque le fil est passé, & que l'aiguille est ôtée, le chirurgien prend avec le pouce & le doigt index de chaque main, & le plus près de l'?il qu'il peut, une extrémité du fil, qui doit être simple, & le fait glisser comme en sciant par-dessous l'ongle, vers sa racine du côté du grand ongle ; il le ramene ensuite de la même maniere vers la cornée transparente. Si l'ongle est trop adhérent, & que le fil ne puisse pas passer, on tient les deux extrémités du fil d'une main, & en soulevant un peu l'ongle par son milieu, on le détache en le disséquant avec une lancette armée, c'est-à-dire affermie sur sa chasse par le moyen d'une bandelette de linge qui ne laisse que la pointe découverte : on détache toutes les adhérences, ayant soin de ne point intéresser le globe de l'?il.
Lorsque l'ongle est bien séparé, on le lie avec le fil vers son milieu, Planche XXII. fig. 4 (b) & avec la lancette ou de petits ciseaux bien tranchans, on coupe l'ongle par ses extrémités. Il faut bien prendre garde d'entamer la caroncule lacrymale en détruisant l'attache de l'ongle, parce qu'il pourroit en résulter un larmoyement involontaire.
Après l'opération, on lave l'?il, on y souffle de la poudre de tuthie & de sucre candi ; on met dessus une compresse trempée dans un collyre rafraîchissant. On panse ensuite l'?il avec les remedes proposés pour les ulceres superficiels de l'?il, & on les continue jusqu'à la fin de la cure. Voyez l'article Argema.
Maître-Jan ayant extirpé un ongle de la maniere susdite, fut obligé pour arrêter le sang, de se servir d'une poudre faite avec parties égales de gomme arabique & de bol, & une sixieme partie de colcothar. Le même auteur ayant eu occasion de faire l'opération d'un ongle dont les vaisseaux étoient gros, le lia près du grand angle, & se contenta de couper l'autre extrémité. La ligature tomba cinq ou six jours après, & par ce moyen il ne fut point incommodé de l'écoulement du sang. J'ai fait plusieurs fois cette opération avec succès. (Y)
Ongle entré dans la chair, c'est une maladie qui occasionne des douleurs très-vives, & qui fait venir une excroissance fongueuse dans le coin de l'ongle. C'est ordinairement celui du gros orteil à qui cela arrive, parce que les chaussures trop étroites enfoncent la chair sur la partie tranchante de l'ongle. Quand le mal commence, on peut en prévenir les suites en se faisant chausser plus au large, & en raclant avec un verre la surface de l'ongle. Quand le mal a fait des progrès, il faut détruire la chair fongueuse avec la poudre d'alun calciné, & couper avec de petites tenailles incisives la portion de l'ongle qui entre dans la chair, pour en faire ensuite l'extraction. Voici comment Fabrice d'Aquapendente traitoit cette maladie : il écartoit avec une petite spatule la chair de l'ongle, & il dilatoit cet endroit avec de la charpie seche, fourrée entre la chair & l'ongle. Cela fait, il coupoit l'ongle en long près de l'endroit où il est adhérent à la chair, & il l'arrachoit sans violence ; il procédoit ainsi plusieurs jours de suite, dilatant, coupant, & arrachant, jusqu'à ce que toute la partie de l'ongle qui entroit dans la chair fût enlevée. On a vu quelquefois les plus violens accidens être les symptomes de ce mal ; tels que fievre considérable, mouvemens convulsifs, & le délire : les saignées, les calmans, & même les narcotiques, deviennent nécessaires ; mais on calme bien plus promptement & plus efficacement, en ôtant la cause de la douleur par une opération très-douloureuse à la vérité, mais qui n'est que momentanée, & qui assure une guérison prochaine, & la cessation subite des vives douleurs. Le pansement exige à peine l'application d'une compresse trempée dans l'eau vulnéraire, à-moins qu'il n'y ait des chairs à détruire ; mais elles s'affaissent bien-tôt d'elles mêmes, & cedent à l'application des remedes spiritueux & dessicatifs. (Y)
Ongle, (Littérature.) les Romains tenoient leurs ongles fort propres, & avoient grand soin de les couper. Horace, dans la lettre septieme du premier livre de ses épîtres, fait mention d'un Vulteius, crieur public de son métier, lequel après avoir été rasé chez un barbier, coupoit tranquilement ses ongles :
Conspexit, ut aiunt,
Adrasum quemdam, vacuâ tonsoris in umbrâ
Cutello proprios purgantem leniter ungues.
Et dans la premiere épître du même livre : « vous me grondez, parce que je n'ai pas les ongles bien faits » :
Et prave sectum stomacharis ob unguem.
Le même dit dans son ode sixieme du premier livre, qu'il chante les combats des vierges qui coupent leurs ongles, pour ne pas blesser leurs amans, en les repoussant :
Nos prælia virginum
Sectis in juvenes unguibus acrium
Cantamus.
Ongle du pié du cheval, (Maréchallerie.) est la même chose que la corne du pié.
Ongles du poing de la bride, c'est la différente situation des ongles de la main gauche du cavalier, qui donne au cheval la facilité de faire les changemens de main, & de former son partir & son arrêt ; parce que le mouvement de la bride suit la position des ongles. Pour laisser échapper un cheval de la main, il faut tourner les ongles en-bas. Pour le changer à droite, il faut les tourner en-haut, portant la main à droite. Pour les changer à gauche, il faut les tourner en bas & à gauche ; & pour l'arrêter, il faut les tourner en-haut & lever la main.
Étymologie de « ongle »
Picard, ongue?; prov. ongla, ungla?; esp. uña?; port. unha?; ital. unghia, ugna?; du lat. ungula, diminutif de unguis, le même que le grec ?????; persan, nâkhèn?; sanscr. nakha?; russe, nógot?; all. Nagel?; angl. nail?; le latin paraît avoir comme le grec ?-???, subi la prosthèse d'une voyelle.
- (XIIe siècle) Du moyen français ongle, l'ancien français ongle (« serre, griffe, ongle »), ungle, du latin ?ng?la (« serre, griffe, sabot, ongle »), dérivé du latin unguis, qui a disparu relativement tôt étant donné qu'il n'a donné aucun dérivé direct dans les langues romanes.
- Jusqu'au XVIe, le genre grammatical du mot est féminin, comme son étymon latin.
ongle au Scrabble
Le mot ongle vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot ongle - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ongle au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
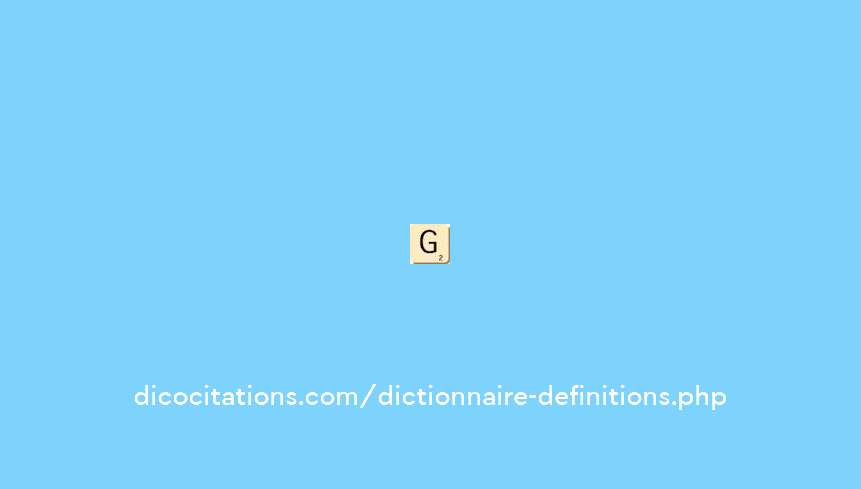
Les rimes de « ongle »
On recherche une rime en GL .
Les rimes de ongle peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en gl
Rimes de tringle Rimes de rectangle Rimes de jongles Rimes de sangle Rimes de règlent Rimes de règle Rimes de aveugles Rimes de règle Rimes de tringle Rimes de single Rimes de dérèglent Rimes de étrangle Rimes de aveuglent Rimes de angle Rimes de beuglent Rimes de rectangles Rimes de remugles Rimes de coupe-ongles Rimes de étrangles Rimes de angles Rimes de rectangles Rimes de ciglent Rimes de rectangle Rimes de seigles Rimes de sangles Rimes de grand-angle Rimes de ongle Rimes de remugle Rimes de jungles Rimes de bugle Rimes de bugles Rimes de cingle Rimes de jungle Rimes de épingle Rimes de bigles Rimes de jonglent Rimes de dérègle Rimes de shingle Rimes de ongles Rimes de espiègles Rimes de triangles Rimes de aveugle Rimes de bigles Rimes de tringles Rimes de sanglent Rimes de seigle Rimes de cinglent Rimes de règles Rimes de single Rimes de épinglentMots du jour
tringle rectangle jongles sangle règlent règle aveugles règle tringle single dérèglent étrangle aveuglent angle beuglent rectangles remugles coupe-ongles étrangles angles rectangles ciglent rectangle seigles sangles grand-angle ongle remugle jungles bugle bugles cingle jungle épingle bigles jonglent dérègle shingle ongles espiègles triangles aveugle bigles tringles sanglent seigle cinglent règles single épinglent
Les citations sur « ongle »
- Je sirote mon vin, quel qu'il soit, vieux, nouveau :
Je fais rubis sur l'ongle, et n'y mets jamais d'eau.Auteur : Jean-François Regnard - Source : Les Folies amoureuses (1704), II, 2 - Il est plus facile à un jongleur de jongler avec des objets lourds qu'avec des objets légers. Au véritable écrivain aussi.Auteur : Gilbert Cesbron - Source : Libérez Barabbas (1957)
- Le fait est qu'il la connaissait pour point commode, maîtresse femme jusqu'au bout des ongles.Auteur : Georges Courteline - Source : Boubouroche (1893)
- Les aigles et les lions en marchant resserrent leurs ongles au dedans, de peur qu'ilz n'en usent et emoussent les pointes.Auteur : Jacques Amyot - Source : De la curiosité, 19
- Aujourd'hui, journée sans tabac demain journée y'a plus d'ongles sur les doigts. Auteur : Les Nuls - Source : Le JTN - le Journal Télévisé Nul
- Ses souvenirs le fouaillaient, plus encore que ce vent glacé qui lui tailladait le visage et lui donnait l'onglée.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- Un écrivain peut finir par devenir un simple jongleur de mots plus ou moins adroit. Il peut en arriver à oublier l'essentiel: cette source qui coule au fond de nous et qui est le véritable lieu de rencontre des êtres.Auteur : Janine Boissard - Source : L'Esprit de famille, Claire et le bonheur (1981)
- C'est bien assez de me couper les ongles moi-même de bien près, sans qu'un censeur vienne encore me les couper jusqu'au sang.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 17 janvier 1765
- Avoir dents et ongles pour se défendre.Auteur : Lucien de Samosate - Source : Dialogue des morts, XI, 4
- Montouroy prit d'abord les pieds et sa langue habile et souple en fouillait les doigts, en caressait les ongles, provoquait chez Dodue des tressaillements, de petits cris, des rires.Auteur : Georges Grassal, dit Hugues Rebell - Source : Les Nuits chaudes du cap Français
- Pauvre Créon ! Avec mes ongles cassés et pleins de terre et les bleus que tes gardes m'ont faits aux bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine.Auteur : Jean Anouilh - Source : Antigone (1942)
- Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
L'Angoise, ce minuit, soutient, lampadophore,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore.Auteur : Stéphane Mallarmé - Source : Poésies (1898), Plusieurs Sonnets, IV - On peut peindre tout un visage (avec des traits) dans un espace qui n'est pas plus large qu'un ongle. Pour le décrire avec des phrases il faudrait une page entière et encore on ne parviendrait pas à en donner une idée exacte.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 1, 28 janvier 1804
- Tout malin jongle avec le silence et les paroles. Auteur : Proverbes congolais - Source : Proverbe
- Songez donc que Bertrand a les ongles coupés.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 26 février 1774
- A l'âge de dix neuf ans, je ne voulais pas accepter l'éventualité que le meurtre d'un homme pût être traité, dans la société qui était la mienne, avec la même indifférence qu'un accroc d'un ongle qu'on aurait coupé au doigt de quelqu'un.Auteur : James Lee Burke - Source : Dans la brume électrique avec les morts confédérés (1994)
- Maintenant quand Gianni jonglait, il prenait Nello sur ses épaules, et cette superposition de deux jongleurs n'en faisant qu'un, amenait dans le voltigement des boules, des jeux bizarres et inattendus.Auteur : Edmond de Goncourt - Source : Les Frères Zemganno (1879)
- Tibby hocha la tête. Une fois de plus, Bailey lui donnait une leçon. Pour elle, Angela se résumait à ses ongles monstrueux, elle n'avait jamais été plus loin.Auteur : Ann Brashares - Source : Quatre filles et un jean, 1. Quatre filles et un jean (2002)
- Qui donc avait affirmé sans preuves et sans appel que l'unité était 1? On l'avait oublié. L'unité était peut-être 2, et cela secrètement, en marge de vingt siècles de triomphales jongleries à travers les mathématiques supérieures.Auteur : Jacques Sternberg - Source : La banlieue
- Il y a telle femme qui s'est rendue malheureuse pour la vie, qui s'est perdue et déshonorée pour un amant qu'elle a cessé d'aimer parce qu'il a mal ôté sa poudre, ou mal coupé un de ses ongles, ou mis son bas à l'envers.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Les voix mouraient une à une le long du poème inachevé ; déjà, les enfants expirants plantaient leurs ongles dans les cuisses d'Ernie, en un suprême recours, et déjà l'étreinte de Golda se faisait plus molle, ses baisers s'estompaient, quand s'accrochant farouche au cou de l'aimé elle exhala en un souffle discordant :
– Je ne te reverrai donc plus jamais ? Plus jamais ?Auteur : André Schwarz-Bart - Source : Le Dernier des Justes (1959) - Une bande de femmes furieuses rencontrèrent Danton dans la rue... Quoiqu'il sentît tout autour de lui les ongles, il se retourna brusquement. Il monta sur une borne, et, pour les consoler, il commença par les injurier dans leur langue.Auteur : Jules Michelet - Source : Histoire de la Révolution française (1847-1853)
- La jalousie est une chose terrible, qui déchire les coeurs avec ses ongles de fer.Auteur : Arsène Housset, dit Arsène Houssaye - Source : L'Amour comme il est (1858)
- La censure à l'haleine immonde, aux ongles noirs,
Cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs,
Vile, et mâchant toujours dans sa gueule souillée,
O muse ! quelque pan de ta robe étoilée !Auteur : Victor Hugo - Source : Les Chants du crépuscule (1835), A Alphonse Rabbe - Pauvre Créon ! Avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait aux bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine !Auteur : Jean Anouilh - Source : Antigone (1942), Antigone
Les mots proches de « ongle »
Ongle Onglée Onglier Onglon OnguentLes mots débutant par ong Les mots débutant par on
ongle onglée onglée ongles Ongles onglet onglets Onglières onglon onguent onguents ongulé ongulé ongulés ongulés
Les synonymes de « ongle»
Les synonymes de ongle :- 1. ergot
2. griffe
3. serre
4. éperon
5. sabot
6. corne
7. jardin
- 1. ongulé
synonymes de ongle
Fréquence et usage du mot ongle dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « ongle » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot ongle dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Ongle ?
Citations ongle Citation sur ongle Poèmes ongle Proverbes ongle Rime avec ongle Définition de ongle
Définition de ongle présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot ongle sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot ongle notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.
