Définition de « ontologie »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot ontologie de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur ontologie pour aider à enrichir la compréhension du mot Ontologie et répondre à la question quelle est la définition de ontologie ?
Une définition simple : (fr-rég|??.t?.l?.?i) ontologie (f)
Définitions de « ontologie »
Trésor de la Langue Française informatisé
ONTOLOGIE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
ontologie \??.t?.l?.?i\ féminin
-
(Philosophie) Partie de la philosophie qui a pour objet l'être en tant qu'être, qui étudie les propriétés générales de l'être.
- On considère que le philosophe grec présocratique Parménide est le père de l'ontologie.
- Les subtilités de l'ontologie ont fait tout au plus des sceptiques ; c'est à la connaissance de la nature qu'il était réservé de faire de vrais déistes. ? (Denis Diderot, Pensées philosophiques, Texte établi par J. Assézat, Garnier, 1875-77)
- [?] c'est la philosophie empiriste anglaise qui ruine définitivement l'ontologie d'Aristote à laquelle la dogmatique chrétienne est intimement inféodée. ? (Louis Rougier, Histoire d'une faillite philosophique : la Scolastique, 1925, édition 1966)
-
(Informatique) Ensemble structuré de concepts, eux-mêmes organisés dans un graphe dont les relations peuvent être des relations sémantiques ou des relations de composition et d'héritage (au sens objet).
- Le projet OpenCyc est une tentative d'écrire une ontologie générique, regroupant un grand nombre de concepts communs.
- (Médecine) Étude de la genèse des entités médicales : maladies, signes cliniques, syndromes cliniques, symptômes, lésions, etc.
-
(Biologie) Étude des êtres vivants.
- Pour moi, l'ontologie est la science des êtres naturels. ? (Pierre Flourens, Ontologie naturelle, Garnier frères, 1864, page 5 ? lire en ligne)
- Il s'agit là de normer principalement le vocabulaire et la structure des phrases utilisées afin d'être clair et compréhensif pour tous, et notamment permettre les comparaisons ! L'outil permettant de répondre à ce besoin est une ontologie botanique. ? (Marc Teychene et Hélène Ruscassie, Nouveau Projet sur Tela Botanica : une ontologie botanique en français, Tela botanica, 28 juin 2006 ? lire en ligne)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. didactique. Science de l'être en tant qu'être. L'ontologie est une des parties de la métaphysique.
Littré
-
1Théorie de l'être, science de l'être?; c'est en général le synonyme de métaphysique.
Il sera bien dans l'ordre de la marche d'esprit qui va naturellement des concrets aux abstraits et des moins abstraits aux plus abstraits, de finir par l'ontologie ou la science de l'être
, Bonnet, ?uv. mêl. t. XVIII, p. 179, dans POUGENS.Toutes les ontologies, toutes les psychologies ne sont-elles pas des rêves??
Voltaire, Lett. L. C. 1768, Sur les qualités occultes.L'examen de ces propriétés forme cette branche de la philosophie dont toutes les autres empruntent en partie leurs principes?: on la nomme l'ontologie ou science de l'être, ou métaphysique générale
, D'Alembert, Disc. prélim. Encycl. ?uv. t. I, p. 239, dans POUGENS.Traité sur l'ontologie. L'Ontologie de Wolf.
- 2Dans la médecine, la doctrine qui, opposée à la doctrine physiologique, ne rattache pas les phénomènes pathologiques aux phénomènes réguliers de la vie.
Encyclopédie, 1re édition
ONTOLOGIE, s. f. (Logiq. & Métaphys.) c'est la science de l'être considéré entant qu'être. Elle fournit des principes à toutes les autres parties de la Philosophie, & même à toutes les Sciences.
Les scholastiques souverainement passionnés pour leur jargon, n'avoient garde de laisser en friche le terroir le plus propre à la production des termes nouveaux & obscurs : aussi élevoient-ils jusqu'aux nues leur philosophia prima. Dès que la doctrine de Descartes eut pris le dessus, l'ontologie scholastique tomba dans le mépris, & devint l'objet de la risée publique. Le nouveau philosophe posant pour principe fondamental qu'on ne devoit admettre aucun terme auquel ne répondît une notion claire ou qui ne fût résoluble par sa définition en idées simples & claires, cet arrêt, émané du bon sens, proscrivit tous les termes ontologiques alors usités. Effectivement les définitions destinées à les expliquer, étoient pour l'ordinaires plus obscures que les termes mêmes ; & les regles ou canons des scholastiques étoient si équivoques, qu'on ne pouvoit en tirer aucun usage. On n'envisagea donc plus l'ontologie que comme un dictionnaire philosophique barbare, dans lequel on expliquoit des termes dont nous pouvions fort bien nous passer ; & ce qui acheva de la décrier, c'est que Descartes détruisit sans édifier, & qu'il décida même que les termes ontologiques n'avoient pas besoin de définition, & que ceux qui signifioient quelque chose étoient suffisamment intelligibles par eux mêmes. Sans doute la difficulté de donner des définitions précises des idées simples & primitives, fut ce qui engagea Descartes à couper ainsi le n?ud.
L'ontologie, qui n'étoit autrefois qu'une science de mots, prit une toute autre face entre les mains des philosophes modernes, ou, pour mieux dire, de M. Volf ; car le cours de cette science qu'il a publié, est le premier & jusqu'à-présent l'unique où elle soit proposée d'une maniere vraiment philosophique. Ce grand homme méditant sur les moyens de faire un système de philosophie certain & utile au genre humain, se mit à rechercher la raison de l'évidence des démonstrations d'Euclide ; & il découvrit bien-tôt qu'elle dépendoit des notions ontologiques. Car les premiers principes qu'Euclide emploie sont ou des définitions nominales qui n'ont par elles-mêmes aucune évidence, ou des axiomes dont la plûpart sont des propositions ontologiques.
De cette découverte M. Volf conclut que toute la certitude des Mathématiques procede de l'ontologie ; passant ensuite aux théoremes de la Philosophie, & s'efforçant de démontrer la convenance des attributs avec leurs sujets, conformément à leurs légitimes déterminations, pour remonter par des démonstrations réitérées jusqu'aux principes indémontrables, il s'apperçut pareillement que toutes les especes de vérités étoient dans le même cas que les Mathématiques, c'est-à-dire qu'elles tenoient aux notions ontologiques. Il résulte manifestement de-là que la Philosophie, & encore moins ce qu'on appelle les facultés supérieures, ne peuvent être traitées d'une maniere certaine & utile, qu'après avoir assujetti l'ontologie aux regles de la méthode scientifique. C'est l'important service que M. Volf s'est proposé. de rendre aux Sciences, & qu'il leur a rendu réellement dans l'ouvrage publié en 1729 sous ce titre : Philosophia prima sive ontologia, methodo scientificâ pertractata, quâ omnis cognitionis humanæ principia continentur ; réimprimé plus correct en 1736 in-4°, à Francfort & Léïpsick. Il donne les notions distinctes, tant de l'être en général, que des attributs qui lui conviennnent, soit qu'on le considére simplement comme être, soit que l'on envisage les êtres sous certaines relations. Ces notions servent ensuite à former des propositions déterminées, les seules qui soient utiles au raisonnement & à construire les démonstrations, dans lesquelles on ne doit jamais faire entrer que des principes antérieurement prouvés. On ne doit pas s'étonner de trouver dans un pareil ouvrage les définitions des choses que les idées confuses nous représentent assez clairement pour les distinguer les unes des autres, & les preuves des vérités sur lesquelles on n'a pas coutume d'en exiger. Le but de l'auteur demandoit ces détails : il ne lui suffisoit pas de donner une énumération des attributs absolus & respectifs de l'être, il falloit encore rendre raison de leur convenance à l'être, & convaincre à priori, qu'on est en droit de les lui attribuer toutes les fois que les déterminations supposées par l'attribut se rencontrent. Tant que les propositions ne sont éclaircies que par les exemples que l'expérience fournit, on n'en sauroit inférer leur universalité, qui ne devient évidente que par la connoissance des déterminations du sujet. Quiconque sait quelle est la force de la méthode scientifique, pour entrainer notre consentement, ne se plaindra jamais du soin scrupuleux qu'un auteur apporte à démontrer tout ce qu'il avance.
On peut définir l'ontologie naturelle par l'assemblage des notions confuses acquises par l'usage ordinaire des facultés de notre ame, & qui répondent aux termes abstraits dont nous nous servons pour exprimer nos jugemens généraux sur l'être. Telle est en effet la nature de notre ame, qu'elle ne sauroit détacher de l'idée d'un être tout ce qu'elle apperçoit dans cet être, & qu'elle apperçoit les choses universelles dans les singulieres, en se souvenant d'avoir observé dans d'autres êtres ce qu'elle remarque dans ceux qui sont l'objet actuel de son attention. C'est ainsi, par exemple, que se forment en nous les idées confuses de plus grand, de moindre & d'égal, par la comparaison des grandeurs ou hauteurs des objets corporels. Il s'agit de ramener ces concepts vagues à des idées distinctes, & de déterminer les propositions qui en doivent résulter : c'est ce que fait l'ontologie artificielle, & elle est par conséquent l'explication distincte de l'ontologie naturelle.
Étymologie de « ontologie »
??, ?????, l'être, et ?????, doctrine.
- (XVIIe siècle) Emprunté du latin scientifique ontologia, lui-même composé à l'aide d'onto-, tiré du grec ancien ?? (ôn, ontos) « étant, ce qui est » et de -logia, tiré du grec ancien ????? (logos) « discours, traité ». Johann Clauberg est le premier à utiliser ontologia dans une formule latine, dans ses Elementa Philosophiae sive Ontosophia, Groningen, 1647, page 3. Dans le Lexicon Philosophicum de Rudolf Goclenius l'Ancien, une formulation grecque (????????? et philosophia de ente) apparaît dès 1613. Sur ce point, voir Ernst Vollrath, «Die Gliederung der Metaphysik in eine Metaphysica generalis und eine Metaphysica specialis», in Zeitschrift für philosophische Forschung, Band XVI, Verlag Anton Hain KG., Meisenheim/Glan, 1962, en particulier page 265 sq.[1]
ontologie au Scrabble
Le mot ontologie vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot ontologie - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ontologie au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
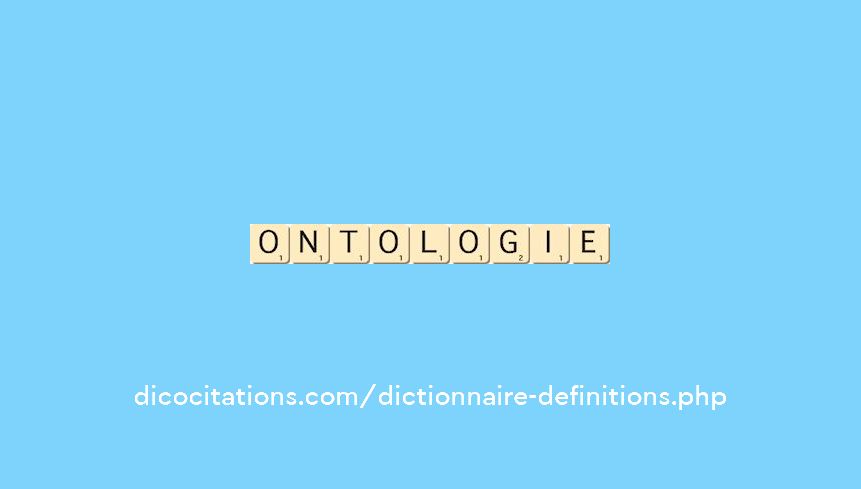
Les rimes de « ontologie »
On recherche une rime en ZI .
Les rimes de ontologie peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Zi
Rimes de hyperesthésie Rimes de hypocrisies Rimes de allergie Rimes de nazies Rimes de bouzy Rimes de technologie Rimes de Tunisie Rimes de idéologie Rimes de neurologie Rimes de pharmacognosie Rimes de océanologie Rimes de bougie Rimes de cramoisi Rimes de astrologie Rimes de réagis Rimes de magnésie Rimes de détruisis Rimes de entomologie Rimes de rassasie Rimes de pataugis Rimes de hémorragies Rimes de pédagogie Rimes de vagi Rimes de technologies Rimes de géologie Rimes de posologie Rimes de plagies Rimes de phraséologies Rimes de zanzi Rimes de dessaisis Rimes de anesthésies Rimes de rougît Rimes de ichtyologie Rimes de gabegie Rimes de mugit Rimes de resurgies Rimes de achondroplasie Rimes de paronomasie Rimes de sosies Rimes de choisi Rimes de neurochirurgie Rimes de néonazie Rimes de hémorragie Rimes de nazie Rimes de saisies Rimes de bourgeoisie Rimes de herpétologie Rimes de frénésie Rimes de instruisit Rimes de ressurgitMots du jour
hyperesthésie hypocrisies allergie nazies bouzy technologie Tunisie idéologie neurologie pharmacognosie océanologie bougie cramoisi astrologie réagis magnésie détruisis entomologie rassasie pataugis hémorragies pédagogie vagi technologies géologie posologie plagies phraséologies zanzi dessaisis anesthésies rougît ichtyologie gabegie mugit resurgies achondroplasie paronomasie sosies choisi neurochirurgie néonazie hémorragie nazie saisies bourgeoisie herpétologie frénésie instruisit ressurgit
Les citations sur « ontologie »
- Pour Aristote, il existe assurément une déontologie; il y a des choses qu'il «faut» faire, il ne faut les faire que parce qu'elles sont requises pour atteindre une certaine fin.Auteur : Etienne Gilson - Source : L'Esprit de la philosophie médiévale (1932)
- On ne serra point étonné de ne pas trouvé dans ce dictionnaire les mots abstraction, aperception, intuition, syndérèse, modalité, ontologie, identité, monade, etc., car nous n'avons pas à nous occuper de la science purement métaphysique, comme l'ont fait récemment quelques professeurs éminents de l'Université. Tout ici doit être clair et à la portée de la majorité des lecteurs pour lesquels j'écris. Auteur : Hippolyte Roux-Ferrand - Source : Dictionnaire raisonné de philosophie morale (1883)
- L'examen de ces propriétés forme cette branche de la philosophie dont toutes les autres empruntent en partie leurs principes: on la nomme l'ontologie ou science de l'être, ou métaphysique générale.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Discours préliminaire à l'Encyclopédie (1751)
- La mathesis s'est regroupée constituant une apophantique et une ontologie.Auteur : Michel Foucault - Source : Les Mots et les Choses (1966)
- Ceux qui font appliquer la loi doivent respecter la loi. Je n’accepterai jamais que la violence gratuite de quelques-uns entache le professionnalisme de femmes et d’hommes qui, au quotidien, assurent notre protection avec courage. Le respect des valeurs de la République et la déontologie doivent être au cœur de l’engagement de toutes nos forces de l’ordre.Auteur : Emmanuel Macron - Source : Emmanuel Macron, vendredi 27 novembre 2020, sur Facebook.
- On ne se trompait pas en 1943 sur le sens d'un livre comme L'Etre et le néant par Jean-Paul Sartre, c'était une ontologie de la liberté. Et aussi [...] l'importance qu'ont eu pour moi les Réflexions sur la question juive après la guerre. Ça a été un livre à tous égards libérateur.Auteur : Claude Lanzmann - Source : Claude Lanzmann dans "A voix nue" le 28/12/2005 sur France Culture
- Le génie de Cuvier a développé ces vues et en a tiré une science nouvelle, la paléontologie, qui reconstruit un animal entier d'après un fragment de son squelette.Auteur : Claude Bernard - Source : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865)
Les mots proches de « ontologie »
Ontogénie OntologieLes mots débutant par ont Les mots débutant par on
ont ont Ontex onto ontologie ontologique ontologiquement
Les synonymes de « ontologie»
Les synonymes de ontologie :- 1. métaphysique
2. philosophie
synonymes de ontologie
Fréquence et usage du mot ontologie dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « ontologie » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot ontologie dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Ontologie ?
Citations ontologie Citation sur ontologie Poèmes ontologie Proverbes ontologie Rime avec ontologie Définition de ontologie
Définition de ontologie présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot ontologie sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot ontologie notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 9 lettres.
