La définition de Soeur du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Soeur
Nature : s. f.
Prononciation : seur
Etymologie : Bourg. soeu ; provenç. sor, seror ; espagn. sor ; portug. sor, sorore ; ital. sorore ; du lat. sororem ; comparez l'allem. Schwester ; angl. sister ; goth. swista ; sanscrit, svasri. Dans l'ancien français, suer (prononcez soeur) est le nominatif, du lat. sóror, avec l'accent sur so ; seror est le régime, de sorórem avec l'accent sur ró ; contre l'habitude, c'est le nominatif, et non le régime, qui est resté dans la langue moderne.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de soeur de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec soeur pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Soeur ?
La définition de Soeur
Fille née du même père et de la même mère qu'une autre personne, ou née de l'un des deux seulement.
Toutes les définitions de « soeur »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Celle qui est née du même père et de la même mère qu'une autre personne, ou seulement de l'un des deux. Sœur aînée. Sœur cadette. Elles sont sœurs. Le frère et la sœur. Sœurs jumelles. Elle est ma sœur. Elle a pour lui l'affection d'une sœur, une affection de sœur. En termes de Jurisprudence, Sœur germaine, Celle qui est née de même père et de même mère qu'une autre personne. Sœur consanguine, Celle qui n'est sœur que du côté paternel. Sœur utérine, Celle qui n'est sœur que du côté maternel. Fam., Demi-sœur, Celle qui n'est sœur que du côté paternel ou du côté maternel. Sœur naturelle, Celle qui est née de même père ou de même mère, mais hors du mariage. Sœur de lait, La fille de la nourrice par rapport au nourrisson que celle-ci a nourri du même lait; il se dit aussi de ce nourrisson, si c'est une fille, par rapport à l'enfant de la nourrice. Elles sont sœurs de lait. C'est la sœur de lait du prince. Belle-sœur. Voyez ce mot à son rang alphabétique. Fig., La poésie et la peinture sont sœurs, Elles ont ensemble beaucoup de rapports; elles se ressemblent en beaucoup de points. Poétiquement, Les neuf Sœurs, Les Muses.
SŒUR est le Titre donné aux religieuses soit en leur parlant, soit en parlant d'elles, dans la plupart des ordres ou dans les communautés. Sœur de charité. Sœur garde-malade. Sœurs missionnaires. Petites sœurs des pauvres. Sœur Marie de l'Incarnation. La sœur Thérèse. Sœur converse, Religieuse employée aux travaux domestiques du monastère. Sœur écoute, Sœur tourière. Voyez ÉCOUTE, TOURIÈRE.
Littré
-
1Fille née du même père et de la même mère qu'une autre personne, ou née de l'un des deux seulement.
Les habitants de ce pays-là lui demandant [à Isaac] qui était Rébecca, il leur répondit?: c'est ma s?ur
, Sacy, Bible, Genèse, XXVI, 7.Jamais s?urs ne furent unies par des liens ni si doux ni si puissants
, Bossuet, Anne de Gonz.La princesse Palatine s'ôta tout pour soulager une s?ur qui ne l'aimait pas
, Bossuet, ib.Elle vous plaint, vous voit avec des yeux de s?ur
, Racine, Iph. II, 1.Fig. Être s?ur, avoir en commun quelque chose.
Nous nous voyons s?urs d'infortune
, Molière, Psyché, I, 1.S?ur de père et de mère, ou s?ur germaine, celle qui est née de même père et de même mère qu'une autre personne.
S?ur de père ou s?ur consanguine, celle qui n'est s?ur que du côté paternel.
S?ur de mère ou s?ur utérine, celle qui n'est s?ur que du côté maternel.
Les expressions s?ur germaine, s?ur consanguine et s?ur utérine ne s'emploient guère qu'en jurisprudence.
Demi-s?ur, celle qui n'est s?ur que du côté paternel ou du côté maternel.
S?ur naturelle ou s?ur bâtarde, celle qui est née de même père ou de même mère, mais hors du mariage.
Belle-s?ur, voy. ce mot à son rang alphabétique.
S?ur de lait, fille qui a eu la même nourrice qu'une autre personne.
J'ai l'honneur d'être le fils du père nourricier de madame de? (il me nomma la femme du ministre)?; ainsi elle est ma s?ur de lait, rien que cela
, Marivaux, Marianne, 6e part.Se dit des animaux. Ma chienne est la s?ur de la vôtre.
-
2 Poétiquement. Les neuf S?urs, les Muses.
Dieu ne fit la sagesse Pour les cerveaux qui hantent les noeuf S?urs
, La Fontaine, Clochette.Quelle verve indiscrète Sans l'aveu des neuf S?urs vous a rendu poëte??
Boileau, Sat. IX.Les s?urs filandières, les Parques (voy. FILANDIÈRE).
-
3Nom qui fut longtemps donné aux chrétiennes par tous les membres de la chrétienté.
S?ur en Jésus-Christ, se dit des femmes chrétiennes par rapport au Père qui est au ciel.
- 4Titre que les rois de la chrétienté donnent aux reines en leur écrivant.
-
5Il se dit, dans le langage élevé, de filles, de femmes qui vivent ensemble, sans être unies par les liens du sang.
Que vous semble, mes s?urs, de l'état où nous sommes??
Racine, Esth. II, 9.Nom que les religieuses qui ne sont point en charge ou qui n'ont point atteint un certain âge, prennent dans les actes publics, se donnent entre elles, et qu'on leur donne en leur parlant ou en parlant d'elles. La s?ur Thérèse. S?ur Marie de l'Incarnation.
Vous m'étonnez de Pauline?; ah?! ma fille, gardez-la auprès de vous?; ne croyez point qu'un couvent puisse redresser une éducation ni sur le sujet de la religion que nos s?urs ne savent guère, ni sur les autres choses
, Sévigné, 510.S?ur colette ou collette, religieuse de l'ordre de Sainte-Claire.
Fig. et familièrement. Faire la s?ur collette, faire la sucrée, avoir des manières, un langage affecté.
Nous rîmes fort de ses manières passées?; nous les tournâmes en ridicule?; elle n'a point le style des s?urs colettes?; elle parle fort sincèrement et fort agréablement de son état
, Sévigné, 183.S?urs laies, et, plus ordinairement, s?urs converses, les religieuses qui ne sont pas du ch?ur, qui ne sont employées qu'aux ?uvres serviles du monastère.
S?ur écoute, religieuse désignée pour accompagner une autre religieuse ou une pensionnaire qui va au parloir.
-
6Nom donné à certaines filles qui vivent en communauté sans être religieuses.
Je vois que votre mal de gorge est opiniâtre?; mais je vous avertis qu'il est rare qu'un médecin guérisse ses malades à cent lieues, et qu'une s?ur de la Charité fait plus de bien de près qu'Esculape de loin
, Voltaire, Lett. Damilaville, 18 mai 1765.Je ne vois plus ces s?urs dont les soins délicats Apaisaient la souffrance, ou charmaient le trépas
, Delille, Pit. II.S?urs grises, nom qu'on a donné quelquefois aux s?urs hospitalières du tiers ordre de Saint-François.
La s?ur grise court administrer l'indigent dans sa chaumière
, Chateaubriand, Génie, IV, III, 6.S?urs du pot, filles qui vivent en communauté et qui soignent les malades.
Fig.
Mme la duchesse d'Aiguillon, la s?ur du pot des philosophes
, Voltaire, Lett. Thiriot, 27 févr. 1755. -
7 Fig. Il se dit de choses assez liées ensemble pour qu'on les assimile à des s?urs.
Socrate? n'aura pas voulu s'échapper de la prison contre l'autorité de ces lois [d'Athènes], de peur de tomber après cette vie entre les mains des lois éternelles, lorsqu'elles prendront la défense des lois civiles, leurs s?urs?; car c'est ainsi qu'il parlait
, Bossuet, 5e avert. 23.Oui, la sagesse aimable est s?ur de la santé, Elle seule connaît le secret qu'on ignore D'assurer l'immortalité
, Bernis, Épît. 12. -
8 Fig. Il se dit de choses (du genre féminin) qui se répètent.
Cette nuit eut des s?urs et même en très bon nombre
, La Fontaine, Petit chien.Comme Charès, capitaine des Athéniens, après un grand avantage? écrivit au peuple d'Athènes qu'il avait remporté une victoire qu'on pouvait appeler la s?ur germaine de celle de Marathon
, Dacier, Plutarque, Aratus.Un démon qui m'inspire Veut qu'encore une utile et dernière satire Se vienne en nombre pair joindre à ses onze s?urs
, Boileau, Sat. XI. -
9
Le bouillon des deux s?urs, un lavement
, Saumaize, Dict. des Préc. t. II, p. 51.Dans le Berry, tomber sur ses deux s?urs, tomber sur son séant.
HISTORIQUE
XIIe s. Se puis veïr ma gente sorur Alde?
, Ch. de Rol. CXXVIII.
XIIIe s. A l'entrée de quaresme? se croisa li quens Bauduins de Flandre et de Haynaut, à Bruges, et la comtesse Marie sa feme, qui suer estoit au conte Thiebaut de Champaigne
, Villehardouin, VI. De là s'en ala-il vers le roi Phelipe d'Alemaigne qui sa serour avoit à fame
, Villehardouin, XLII. [Simon a dit à sa femme?:] Bele suer, où est Berte, pour sainte charité??
Berte, CXXV. Li baron li disent que Henris li quens de Champagne, qui moult estoit larges, avoit une fille biele et gente, qui avoit non Aelis, et estoit suer germaine l'arcevesque Guillaume-blance-main
, Chr. de Rains, p. 9. Tombiele et ses deux sereurs
, Bibl. des chart. 2e série, t. 3, p. 423. L'aventure des dameiseles qui esteient serur gemeles
, Marie de France, Frêne.
XIVe s. Se nous ou notre hoir marions l'une de nos seurs
, Du Cange, auxilium.
XVe s. De ce messire Edouard de Guerles ne demoura nuls enfans?; mais de serour germaine? avoit des enfans
, Froissart, II, III, 92.
XVIe s. Thibaut, qui ouyt ces mots, estimant qu'on parloit de sa femme, qui puet-estre aimoit l'amble comme estant de nos s?urs [femme galante]
, Moyen de parvenir, p. 127, dans LACURNE.
Wiktionnaire
Nom commun - français
s?ur \s??\ féminin (pour un homme, on dit : frère)
-
Personne du sexe féminin, ayant le même père et la même mère que la personne considérée. Si un seul des parents est commun, c'est une demi-s?ur.
- Elle désire une s?ur, une grande, une petite, peu importe, elle désire parler avec Sa S?ur, jouer avec elle, se disputer avec elle, dormir dans la même chambre qu'elle, faire les bazarettes le soir au lieu de dormir, [?]. ? (Claudine Galea, Les choses comme elles sont, Éditions Verticales (Gallimard), 2018)
-
Membre féminin d'une fraternité.
- La femme d'un frère mort sans enfants, si elle est reçue s?ur , jouit de l'usufruit entier des biens du défunt, à l'exception des bagues et joyaux, qui doivent être remis à l'association. ? (Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs & politiques des chambres françaises imprimé par ordre du Sénat et de la Chambre des députés, Première série (1787 à 1799), tome 22, Librairie administrative de Paul Dupont, 1885, page 393)
-
(En particulier) (Religion) Membre féminin d'une fraternité religieuse qui a prononcé des v?ux.
- Dès huit heures du matin, il arrivait à l'hôpital dans un coupé déverni que traînait une émouvante rossinante et il commençait, à la mode d'autrefois, l'appel de ses élèves sur un beau carton ad hoc peint en couleur par la s?ur de charité de la salle des hommes attachée elle-même au service depuis vingt-cinq ans. ? (Léon Daudet, Souvenirs littéraires ? Devant la douleur, Grasset, 1915, réédition Le Livre de Poche, page 136)
- Je quitte le lieutenant licencié et regagne le couvent, où la s?ur converse m'annonce qu'un ami est venu me demander. ? (Jean Giraudoux, Retour d'Alsace - Août 1914, 1916)
- C'est infect, Saint-Lazare. Les s?urs vous traitent plus bas qu'tout. Elles vous insultent [?]. ? (Francis Carco, Images cachées, Éditions Albin Michel, Paris, 1928)
- Moins l'habit et la cornette, c'est une s?ur de la charité qui pose des ventouses, des cataplasmes, applique des sinapismes, masse les rhumatisants, ensevelit les morts. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
-
Réplique issue d'un original, d'importance égale ou moindre, parfois supérieure. Utilisé seulement pour les noms féminins.
- M. Ferdinand Poise a écrit, sur cette jolie scénette en deux actes, une partition fine, élégante et distinguée, la s?ur des Surprises de l'amour et de l'Amour médecin dont elle retrouvera sans doute le succès. ? (L'Artiste, vol. 2, Paris : Aux bureaux de L'Artiste, 1884, page 317)
- La multiplication des bureaucraties fait ressembler l'Europe capitaliste à sa s?ur soviétisée. ? (Emmanuel Todd, Le Fou et le Prolétaire, 1979, réédition revue et augmentée, Paris : Le Livre de Poche, 1980, page 167)
- L'Italie reste encore pour la France, la patrie de la Rome antique, et je dirais volontiers, malgré l'anachronisme de la formule à cette date, une s?ur latine ? (Joseph Reinach, La France et l'Italie devant l'Histoire, 1893)
-
(Figuré) Élément (féminin) d'un ensemble.
- (Par apposition) ? En remontant jusqu'au XIXe siècle, époque de la formation de la « nation » française, je démontrerai que la France est, quintessentiellement, un pays de l'Europe du Nord-Ouest, et que sa nation-s?ur, si elle en a une, est l'Allemagne plutôt que l'Italie. ? (Emmanuel Todd, Le Fou et le Prolétaire, 1979, réédition revue et augmentée, Paris : Le Livre de Poche, 1980, page 34)
Adjectif - français
s?ur \s??\
- Qualifie des choses similaires, souvent avec la même origine. ? Note d'usage : Utilisé seulement pour les noms féminins.
- Le français, l'italien et l'espagnol sont des langues s?urs.
- Les deux sont des villes s?urs.
Trésor de la Langue Française informatisé
S?UR, subst. fém.
Soeur au Scrabble
Le mot soeur vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot soeur - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot soeur au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
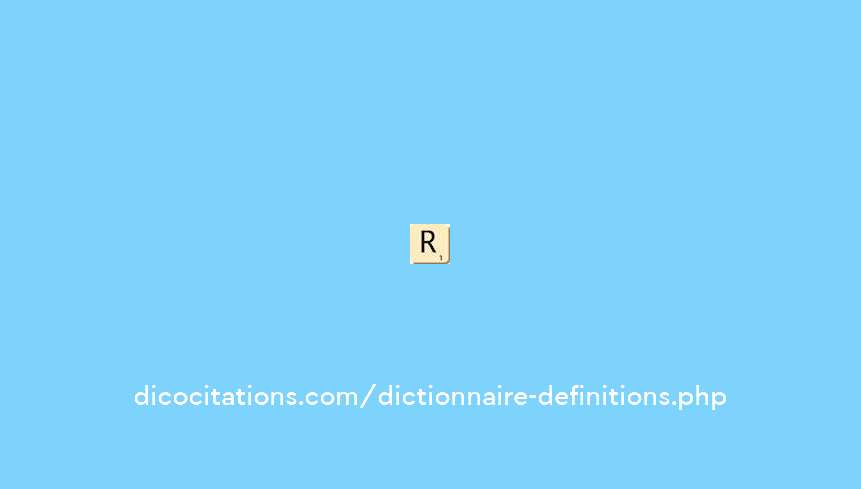
Les mots proches de Soeur
Soeur Soeurette soeur soeurette soeursMots du jour
Chandelier, ère Gouttière Votation Inconstance Explorer Crêpe Congrès Amatir Chirurgien Franchir
Les citations avec le mot Soeur
- Ta soeur est tellement grosse que, lorsqu'elle saute de joie, elle descend d'un étage!Auteur : Jacques Essebag, dit Arthur - Source : Sans référence
- - À côté de qui préférez-vous être placée ?
- Une bonne soeur ou une mémé tricot, si possible.
- Hmm, fit la fille en scrutant la liste de passagers. Les bonnes soeurs, les mémés et les hommes intelligents et pas dragueurs sont déjà tous pris. Il reste le techno-pédant, l’avocat, l’ivrogne pleurnichard ou le bébé qui passe son temps à vomir.Auteur : Jasper Fforde - Source : Délivrez-moi ! (2005) - Ne sait-on pas que toutes les passions sont soeurs qu'une seule suffit pour en exciter mille, et que les combattre l'une par l'autre n'est qu'un moyen de rendre le coeur plus sensible à toutes?Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Lettre à d'Alembert
- Qu'est-ce qui me vaut, ô petite soeur ? Venez donc faire un joli bout d'horizontale avec votre malenky droug sur ce lit.Auteur : Anthony Burgess - Source : L'Orange mécanique (1964)
- Tous les hommes sont frères, et comme tels, savent trop de choses sur leur compte réciproque. Mais si nous sommes tous frères, toutes les femmes ne sont pas nos soeurs !Auteur : Joseph Conrad - Source : Gaspar Ruiz (1906)
- Il nous faut obéir, ma soeur, à nos parents: Un père a sur nos voeux une entière puissance.Auteur : Molière - Source : Sans référence
- Qui est-ce qui a créé le Jockey Club, le Racing, l'Unesco, les éditions Gallimard, les Compagnons de la chanson, le Club français du livre, le Grand Orient de France, les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, la CGT et l'Aéropostale? - Un groupe d'êtres humains.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- Ah ! la grande amour, ça vient, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et qui mieux est, on ne sait pas pour qui. Du moins à ce qu'il paraît. Alors ce ne sont plus que clairs de lune, gondoles, ivresses éthérées, âmes soeurs et fleurs bleues.Auteur : Raymond Queneau - Source : Pierrot mon ami (1942)
- J'ignorais la douceur féminine. Ma mère
Ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de soeur
Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'oeil moqueur.
Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie
Grâce à vous une robe a passé dans ma vie.Auteur : Edmond Rostand - Source : Cyrano de Bergerac (1897) - Il n'y a pas que ta voiture qui fasse du cent, il y a aussi ta soeur!Auteur : Lionel Chrzanowski - Source : Petit dictionnaire à mourir de rire de Philippe Héraclès et Lionel Chrzanowski
- Ils jeterent en prison sa soeur et sa femme, qui estoit grosse, et feit la pauvre dame une piteuse gesine.Auteur : Jacques Amyot - Source : Dion, 72
- La perte est la soeur du gain.Auteur : Proverbes turcs - Source : Proverbe
- Un jour qu'on allait jouer aux barres, Melle Nelly Kossichef, la soeur cadette de Marie, assignait à chacun le camp où il se trouverait.Auteur : Marcel Proust - Source : Jean Santeuil (1896-1904)
- La sororisation, c’est l’action de sororiser, sororiser c’est rendre soeurs. C’est créer, par la qualité des liens, une relation qui amène à l’état de communauté féministe. Une communauté soudée, animée par la même volonté de déjouer les stratégies paternalistes et la violence sexiste ordinaire, terreau fertile aux viols et aux uxoricides. Auteur : Chloé Delaume - Source : Mes bien chères soeurs (2019)
- La haine était ma soeur, ma compagne, ma came, et la colère mon meilleur carburant. Du sucre dans ma bouche amère.Auteur : Emmanuelle Richard - Source : Désintégration (2019)
- Vous êtes voluptueuse et timide! vous avez des joues qui appellent le baiser d'une soeur, et des lèvres qui réclament le baiser d'un amant!Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862)
- La poésie et le dessin sont frère et soeur, comme tu le sais, de même que les mots et les couleurs.Auteur : Orhan Pamuk - Source : Mon nom est Rouge (2002)
- Il vous a fallu de l'argent. Où en prendre ? Vous avez saigné vos soeurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs soeurs.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Père Goriot (1835)
- Un peu gêné tout de même de marier si vite avec sa belle-soeur, il redouble de soins sur la tombe de sa femme. - C'est la mieux entretenue du cimetière.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- La plupart des individus, vous pouvez les oublier en une seconde, comme ça, d'un simple claquement de doigts. Mais d'autres vous marquent. Ils vous hantent et il faut du temps pour se débarrasser de leur souvenir. E puis parfois, ont tombe sur « la » personne. Ce que l'on appelle l'âme soeur. Homme ou femme, peu importe. Et cette personne-là, on ne l'oublie jamaisAuteur : Patrick Bauwen - Source : Les fantômes d'Eden (2014)
- Si tu veux, ô ma soeur, comprendre les étoiles
Commence par baisser les yeux sur nos douleurs.
De là tu verras Dieu. Le Ciel n'ôte ses voiles
Que pour les yeux voilés de pleurs.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Tables tournantes de Jersey - Avec mes soeurs, j'ai grandi dans une sorte de cocon, décoré de soutiens-gorge, de tendresse et de chapelets de mots.Auteur : Nicolas Delesalle - Source : Un parfum d'herbe coupée (2013)
- Sur le couple. Des espèces de frère et soeur légalement et mollement incestueux, entre le frigidaire et la télé.Auteur : Paul Guth - Source : Lettres à votre fils qui en a ras le bol (1976)
- La nature, soeur jumelle
D'Eve et d'Adam et du jour,
Nous aime, nous berce et mêle
Son mystère à notre amour.Auteur : Victor Hugo - Source : Après l'hiver - Été : être pour quelques jours
le contemporain des roses ;
respirer ce qui flotte autour
de leurs âmes écloses.
Faire de chacune qui se meurt
une confidente,
et survivre à cette soeur
en d'autres roses absente.Auteur : Rainer Maria Rilke - Source : Été : être pour quelques jours
Les citations du Littré sur Soeur
- Quel carnage de toutes parts ! On égorge à la fois les enfants, les vieillards, Et la soeur et le frère, Et la fille et la mèreAuteur : Jean Racine - Source : Esth. I, 5
- Ma soeur, qui peut causer votre sombre tristesse ? Le silence des bois sert à l'entretenirAuteur : QUIN. - Source : Amad. II, 2
- Par ses solicitations deceptives, il emmena folier par le païs Hubinette, soeur de l'exposantAuteur : DU CANGE - Source : follis.
- Certes, ma soeur, le conte est fait avec adresseAuteur : Corneille - Source : Pomp. I, 3
- Comme vous refusez d'épouser ma soeur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire [proposition de duel]Auteur : Molière - Source : Mar. forcé, 16
- Que vous semble, mes soeurs, de l'état où nous sommes ?Auteur : Jean Racine - Source : Esth. II, 9
- La soeur de Philomèle, attentive à sa proie, Malgré le bestion happoit mouches dans l'airAuteur : Jean de La Fontaine - Source : ib. X, 7
- La princesse Marie, pleine alors de l'esprit du monde, croyait, selon la coutume des grandes maisons, que ses jeunes soeurs devaient être sacrifiées à ses grands desseinsAuteur : BOSSUET - Source : ib.
- Je n'ai point l'heureux don de ces esprits faciles Pour qui les doctes soeurs, caressantes, dociles, Ouvrent tous leurs trésorsAuteur : J. B. ROUSS. - Source : Ode au comte du Luc.
- Les vertus devraient être soeurs, Ainsi que les vices sont frèresAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VIII, 25
- On entrevoit en quoi Diderot tenait d'elle [sa soeur] et en quoi il en différait : elle était la branche restée rude et sauvageonne, lui le rameau greffé, cultivé et adouci, épanouiAuteur : SAINTE-BEUVE - Source : dans le Dict. de DOCHEZ.
- Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, Ma soeur, que de tousser et de cracher comme elleAuteur : Molière - Source : F. sav I, 1
- Voilà comment sur le mestier humain Non les trois soeurs, mais amour de sa main Tist et retist la toile de ma vieAuteur : DU BELLAY - Source : II, 31 recto.
- Vous aurez une obédience de moi pour aller avec madame votre soeurAuteur : BOSSUET - Source : Lett. abb. 260
- Va, du lit de ma soeur l'usurpatrice infâme [Frédégonde]....Auteur : LEMERC. - Source : Frédég. et Brunehaut, I, 2
- Ce beau nom d'héritière 'a de telles douceurs, Qu'il devient souverain à consoler des soeurs [qui ont perdu un frère]Auteur : Corneille - Source : Mél. IV, 10
- Ah ! que je crains, mes soeurs, les funestes nuages Qui de ce prince obscurcissent les yeux ! Comme il est aveuglé du culte de ses dieux !Auteur : Jean Racine - Source : Esth. II, 9
- Mes inhumaines soeurs sont d'autant plus cruelles, Qu'elles le sont par piétéAuteur : LAMOTTE - Source : Odes, t. I, p. 500, dans POUGENS
- Ah ! ma soeur ! si sur vous je puis avoir créditAuteur : Molière - Source : le Dép. II, 3
- Elle est soeur de Mme d'Olcy, que vous avez certainement rencontrée dans le mondeAuteur : GENLIS - Source : Adèle et Théodore, t. I, p. 53, dans POUGENS
- Pour vous, ma chère soeur, sage et pieuse fille, Gloire du sang d'Oedipe, honneur de sa familleAuteur : ROTR. - Source : Antig. II, 2
- Mandant à vostre soeur, par ung roi d'armes, aultrement le herault Valois, si....Auteur : CARLOIX - Source : VIII, 32
- Les officières se tiendront un peu de temps dans l'assemblée, afin que les soeurs aient le temps de leur parlerAuteur : PORT-ROYAL - Source : Constitutions, p. 51, dans RICHELET
- Vous et vos soeurs les vertueuses, Vous vous retranchez sur l'espritAuteur : DANCOURT - Source : Céphale et Procris, prologue.
- Néron : La soeur vous touche ici beaucoup moins que le frère ; Et pour Britannicus...., -J, unie : Il a su me toucher, Seigneur ; et je n'ai point prétendu m'en cacherAuteur : Jean Racine - Source : Brit. II, 3
Les mots débutant par Soe Les mots débutant par So
Une suggestion ou précision pour la définition de Soeur ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 12h51

- Sacrifice - Sacrilege - Sage - Sagesse - Sagesse_populaire - Saint_Valentin - Salete - Sante - Santé - Sante - Satisfaction - Satyre - Savant - Savoir - Savoir_vivre - Scandale - Scepticisme - Science - Scrupule - Sculpture - Secret - Secte - Seigneur - Sein - Semblable - Sens - Sensibilite - Sentiment - Separation - Séparation - Serenite - Sérénité - Sérieux - Service - Servitude - Seul - Seule - Sexe - Sexologie - Sexualite - Silence - Simplicite - Sincère - Sincerite - Sincérité - Singe - Snob - Sobre - Sociabilite - Societe - Sociologie - Sodomie - Soi_même - Soleil - Solitude - Solution - Sommeil - Sondage - Songe - Sot - Sottise - Soucis - Souffrance - Souffrir - Soulage - Soupçon - Sourire - Souvenir - Specialiste - Spectacle - Sport - Stabilite - Star - Statistiques - Stimulation - Stress - Style - Subjonctif - Succes - Suggestion - Suicide - Superflu - Superiorite - Supermarche - Superstition - Supplice - Survie - Suspicion - Systeme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur soeur
Poèmes soeur
Proverbes soeur
La définition du mot Soeur est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Soeur sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Soeur présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
