La définition de Pneumatique du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Pneumatique
Nature : s. f.
Prononciation : pneu-ma-ti-k'
Etymologie : Voy. .
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de pneumatique de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec pneumatique pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Pneumatique ?
La définition de Pneumatique
Science qui a pour objet les propriétés physiques de l'air et des autres gaz permanents.
Toutes les définitions de « pneumatique »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. T. de Physique. Qui est relatif à l'air. Il s'emploie particulièrement dans cette expression : Machine pneumatique, Machine avec laquelle on aspire l'air d'un récipient pour y faire le vide. Le récipient d'une machine pneumatique. Canon pneumatique, Canon où l'air comprimé sert de force propulsive. Tube pneumatique, Tube où l'on fait le vide par le moyen de machines pneumatiques et dont on se sert pour envoyer les dépêches. Carte pneumatique, Carte qui est transmise par des tubes pneumatiques. Substantivement, Un pneumatique. Expédier un pneumatique. Bandage pneumatique, Tube de caoutchouc, gonflé d'air ou d'un gaz comprimé, et qui est fixé à la jante d'une roue pour amortir les chocs. Substantivement, Un pneumatique. Gonfler un pneumatique. On dit par abréviation PNEU.
Littré
- Qui est relatif à l'air.
Terme de botanique. Vaisseaux pneumatiques, cavités pleines d'air, qui se forment au milieu du tissu des plantes par l'effet de la rupture du tissu cellulaire.
Machine ou pompe pneumatique, machine avec laquelle on pompe l'air d'un récipient.
Otto Guericke, bourgmestre de la ville [Magdebourg], fameux par ses expériences du vide et par l'invention de la machine pneumatique
, Fontenelle, Homberg.Une machine pneumatique, quelque parfaite qu'elle puisse être, ne peut jamais produire un vide parfait
, Brisson, Traité de physique, t. II, p. 110.Fig.
Je ne pouvais m'accoutumer aux grands airs du maréchal de Villeroy?; je trouvais qu'il pompait l'air de partout où il était, et qu'il en faisait une machine pneumatique
, Saint-Simon, 114, 255.Briquet pneumatique, petit cylindre de métal ou de verre, dans lequel on allume de l'amadou en y comprimant l'air subitement.
Chimie pneumatique, nom donné autrefois à la chimie de Lavoisier, par opposition à celle de Stahl fondée sur la théorie du phlogistique, parce que la première était surtout fondée sur le rôle du gaz oxygène de l'air, et des gaz qui venaient d'être découverts.
Cuve pneumatique, voy. PNEUMATOCHIMIQUE.
Dans les orgues, levier pneumatique, mécanisme destiné à procurer un toucher uniforme.
Encyclopédie, 1re édition
PNEUMATIQUE, s. f. (Physiq.) que l'on appelle aussi Pneumatologie, & c'est proprement la science qui s'occupe des esprits & des substances spirituelles. Voyez Esprit.
Ce mot est formé du grec ??????, spiritas, souffle ou air ; c'est pourquoi de la différente acception de ce mot, pris comme une substance incorporelle pour signifier l'air, il en naît deux sortes de science pneumatique.
Mais on se sert plus communément du mot pneumatique pour signifier la science des propriétés de l'air, & les lois que suit ce fluide dans sa condensation, sa raréfaction, sa gravitation, &c. Voyez Air.
Quelques écrivains regardent la pneumatique comme une branche des méchaniques, à cause que l'on y considere le mouvement de l'air & ses effets. Il faut avouer que cette science est tout-à-fait semblable à l'hydrostatique, l'une considérant l'air de la même maniere précisément que l'autre considere l'eau. Voyez Méchanique & Hydrostatique.
Wolt, au lieu du mot pneumatique, se sert du mot aérométrie, ou airométrie, qui signifie l'air. Voyez Aérometrie.
On trouve la doctrine & les lois des pneumatiques aux articles Air, Atmosphere, Pompe, Syphon, Raréfaction, &c.
Pneumatique, machine, (Physique.) autrement appellée machine à pomper l'air, ou machine de Boyle, ou machine du vuide, est une machine par laquelle on vuide, ou du-moins on rarefie considérablement l'air contenu dans un vase.
La machine pneumatique fut inventée vers l'année 1654 par Otto de Guericke, consul de Magdebourg, qui la mit le premier en usage. L'archevêque de Mayence ayant vû cette machine & ses effets à Ratisbonne, où l'inventeur l'avoit portée, engagea Otto de Guericke à venir chez lui, & à faire apporter sa machine en son palais de Wurtzbourg ; c'est-là que le savant pere Schott, jésuite, qui professoit les Mathématiques dans cette université, & plusieurs autres savans, la virent pour la premiere fois.
Le bruit de ces premieres expériences se répandit aussi-tôt par les grandes correspondances que le pere Schott entretenoit avec tous les savans de l'Europe : mais sur-tout l'an 1657, quand il publia son livre, intitulé : mechanica-hydraulico-pneumatica, auquel, comme dans un appendix, il a ajouté un détail circonstancié des expériences de Magdebourg (c'est ainsi qu'on les appelloit). En 1664, il publia sa technica curiosa, dans laquelle on trouve les expériences nouvelles qu'on avoit faites depuis l'impression de son premier ouvrage. Enfin, Otto de Guericke se détermina à donner lui-même un recueil complet de ses expériences, dans un livre qu'il intitula : experimenta nova magdeburgica de vacuo spatio.
La machine pneumatique a été si généralement connue sous le nom de machine de Boyle, ou vuide de Boyle, que cela a fait croire à bien des gens qu'on en devoit l'invention à ce philosophe : il y a eu certainement grande part, tant pour l'avoir beaucoup perfectionnée, que pour l'avoir appliquée le premier à des expériences curieuses & utiles.
Quant à l'invention de l'instrument, il avoue ingénument qu'il n'en a pas la gloire, dans une lettre écrite deux ans après la publication du livre du pere Schott.
Il paroît par cette lettre que la premiere machine dont s'est servi M. Boyle, est de l'invention de M. Hook ; elle est certainement beaucoup plus parfaite que celle que le pere Schott a décrite dans sa mechanica hydraulico-pneumatica. Cependant elle avoit encore plusieurs défauts, & n'étoit pas à-beaucoup-près aussi commode qu'on auroit pû le desirer, particulierement en ce que l'on ne pouvoit se servir que d'un seul récipient qui, étant toujours fixé à la machine, devoit être par conséquent très-grand pour servir commodément à toute sorte d'expériences : or cette grande capacité du récipient faisoit qu'il falloit un tems considérable pour le vuider, & c'étoit un inconvénient qu'on ne pouvoit aisément éviter dans beaucoup d'expériences qui demandoient une prompte évacuation ; c'est ce qui engagea M. Boyle, après qu'il eut fait ses premieres expériences, & qu'il les eut publiées dans un ouvrage, intitulé : experimenta physico-mechanica de vis aëris elasticâ & ejus affectibus, &c. à chercher à corriger cette machine. On peut voir la description de cette seconde machine pneumatique dans la premiere continuation de ses expériences physico-méchaniques ; elle n'a comme la premiere qu'un seul corps de pompe, mais il est appliqué de façon qu'il plonge dans l'eau de tous côtes, ce qui empêche le retour de l'air ; les récipients qui sont de différentes figures & grandeurs, posent sur une platine de fer sur laquelle ils sont fixés par le moyen d'un ciment mou, ainsi on en peut changer autant de fois qu'il est nécessaire. Il paroît qu'il n'avoit pas encore pensé à cet expédient si simple, de les fixer à la platine par le moyen d'un cuir mouillé.
Les expériences rapportées dans la seconde continuation, ont été faites avec une machine différente des deux premieres, elle est de l'invention de M. Papin, qui a beaucoup aidé M. Boyle dans toutes ses recherches ; cette troisieme machine est beaucoup plus parfaite que la précédente, son avantage consiste principalement en ces deux points. Premierement, au lieu que la derniere machine n'avoit qu'un seul corps de pompe & qu'un seul piston, celle-ci en a deux aussi-bien que deux corps de pompes ; ces deux pistons qui se haussent & baissent alternativement, font une évacuation d'air continuelle & non-interrompue, effet qu'on ne pouvoit espérer avec un seul piston : car dans les autres on ne sauroit se dispenser d'interrompre l'évacuation de l'air, tandis qu'on remonte le piston vers le fond de la seringue ; mais outre cet avantage de faire l'opération dans la moitié du tems qu'il faudroit employer si l'on n'avoit qu'un seul piston, la peine est aussi considérablement diminuée. Le grand inconvénient qu'on reprochoit aux machines à un seul corps de pompe, étoit la grande résistance que fait l'air extérieur sur le piston quand on l'abaisse, résistance qui augmente à mesure que le récipient se vuide ; car l'équilibre de l'air intérieur avec l'extérieur diminue toujours de plus en plus, desorte que si le corps de pompe est d'un diametre un peu considérable, la force d'un homme suffit à-peine pour abaisser tant-soit-peu le piston : or cette résistance de l'air s'évanouit entierement en employant deux pistons, ils sont ajustés de façon que quand l'un monte l'autre descend ; par conséquent la pression de l'air extérieur empêche autant l'un de monter, qu'elle aide l'autre à descendre ; ainsi ces deux forces se détruisent mutuellement par des effets contraires.
Un autre avantage de cette nouvelle machine, ce sont les valvules : dans les deux autres, quand le piston étoit remonté tout au haut, on étoit obligé de tourner le robinet pour laisser passer l'air du récipient dans le corps de pompe, & de le fermer quand on vouloit l'en faire sortir, d'ôter la cheville pour le laisser passer, & de répéter cette man?uvre à chaque coup de pompe ; or les valvules de la derniere machine suppléent à ce bouchon & au robinet, & sont infiniment plus commodes. Voyez les leçons de Phys. expér. de M. Cottes, treizieme leçon, d'où ceci a été tiré, ainsi que l'explication suivante.
Explication des parties de la machine pneumatique. La figure 16. pneum. représente la machine pneumatique de M. Hauksbée, qui n'est autre chose que la derniere de M. Boyle dont on vient de parler. AA, deux corps de pompe d'un pié de haut, & de deux pouces de diametre. BB, manches des pistons, qui sont deux especes de crics capables de recevoir la lanterne de la manivelle. C, la manivelle ; la lanterne est enfermée dans la boîte. DDDD, le tuyau qui conduit l'air du récipient au corps de pompe. E, le récipient. EF, boîte de fer blanc garnie de cuirs huilés, au-travers desquels passe une verge de fer, pour mouvoir ou suspendre différens corps dans le récipient. GGG, la jauge mercurielle, qui est un tuyau de verre ouvert par ses deux extrémités, dont l'une passe au-travers de la platine & communique avec le récipient, & l'autre est plongée dans une cuvette qui contient du mercure. H, la cuvette ; sur la surface du mercure qu'elle contient, nage un morceau de liege percé d'un trou à son centre ; on y a inséré une regle de buis verticale, divisée en pouces, lignes & quarts de lignes, ensorte que le mercure haussant & baissant dans la jauge, le liege & la regle baisse ou hausse en même tems. IIII, les supports & la table.
Depuis les additions & les corrections que M. Hauksbée a faites à la machine pneumatique de Guericke & de Boyle, cette même machine a encore reçu divers changemens. On trouve à la fin des essais de Physique de M. Musschenbroenck, la description de deux machines pneumatiques, l'une double, l'autre simple, c'est-à-dire, dont l'une a deux corps de pompe & l'autre n'en a qu'un. Ces deux machines ont été inventées ou plutôt perfectionnées par le célebre M. Gravesande, professeur de Mathématiques à Leyde, mort depuis peu d'années. La pompe dont on se sert communément en Allemagne, se trouve décrite dans les élémens de Physique de M. Techmeier, professeur à Iene.
La machine pneumatique dont on se sert aujourd'hui le plus communément en France, consiste dans un tuyau ou corps de pompe vertical, auquel est adapté un piston terminé par un étrier dans lequel on met le pié pour faire descendre le piston ; on releve le piston par le moyen d'une espece de levier recourbé en-haut, lequel est attaché à l'extrémité du piston & terminé par un manche ; le cylindre ou corps de pompe communique par un tuyau avec le récipient ; ce tuyau est traversé en son milieu par un robinet percé d'un trou d'outre en outre, & outre cela traversé d'une rainure qui est environ à quatre-vingt-dix degrés du trou dont le robinet est percé. Lorsqu'on veut rarefier l'air du récipient, on tourne d'abord le robinet de maniere que le trou qui y est pratiqué réponde à l'ouverture du cylindre, & que par conséquent l'air du cylindre communique avec l'air du récipient, sans communiquer avec l'air extérieur ; on tire ensuite le piston en-bas, & par ce moyen on dilate l'air contenu dans le récipient & dans le cylindre, en lui faisant occuper un plus grand espace. Ensuite on tourne le robinet de maniere que la rainure réponde à l'ouverture du cylindre, par-là il arrive que l'air du cylindre a communication avec l'air extérieur. On pousse ensuite le piston en en-haut & on chasse dehors l'air qui étoit contenu dans la cavité du cylindre ; on retourne ensuite le robinet de maniere que son trou réponde à la cavité du cylindre, on abaisse le piston une seconde fois ; & il est clair que par cette opération on ôte continuellement du récipient une certaine portion d'air, laquelle se répand dans la cavité du cylindre quand on abaisse le piston, pour être ensuite jetté dehors quand le piston le releve ; par conséquent on rarefie continuellement l'air du récipient ; le récipient pose sur une platine, & cette platine est couverte d'un cuir mouillé auquel le récipient s'attache fortement quand on a commencé à pomper l'air ; de maniere que l'air extérieur ne sauroit rentrer dans le récipient, parce qu'il ne peut trouver aucun espace entre le récipient & le cuir mouillé auquel le récipient s'attache très-exactement. Ce cuir mouillé tient lieu du mastic qu'on seroit obligé de mettre à l'extrémité inférieure du récipient pour l'attacher à la platine, & pour boucher tous les petits interstices par lesquels l'air pourroit rentrer. Il ne sera peut-être pas inutile d'ajouter ici une figure de cette machine pneumatique simple : quoique la description que nous venons d'en donner soit fort facile à entendre, & que cette machine soit aujourd'hui extrèmement connue, on la voit représentée avec toutes ses parties ; Planche pneumatique, fig. 16. n°. 2. Voyez la description plus détaillée de la machine pneumatique, tant double que simple, & de ses parties, dans les mémoires de l'académie des Sciences de 1740.
Nous dirons seulement, pour faciliter l'intelligence du reste de cet article, que cette machine pneumatique est composée de cinq parties principales, savoir, 1°. d'un corps de pompe de cuivre A : 2°. d'un piston dont le manche est terminé en forme d'étrier B, pour être abaissé avec le pié, & garni d'une branche montante avec une poignée C, pour être relevé avec la main : 3°. d'un robinet dont on avoit la clé en D : 4°. d'une platine couverte d'un cuir mouillé, sur lequel on pose le récipient ou la cloche de verre E : 5°. d'un pié FG, avec deux tablettes HH, qui peuvent se hausser & se baisser à volonté.
Il paroît d'abord probable qu'à chaque coup de pompe, il doit toujours sortir une égale quantité d'air, & par conséquent, qu'après un certain nombre de coups de pompe, le récipient peut être entierement évacué ; mais si nous faisons attention, nous trouverons qu'il en arrive bien différemment. Pour le prouver, nous allons d'abord démontrer le théorème suivant, d'après M. Cottes, que nous ne ferons qu'abreger.
La quantité d'air qu'on fait sortir du récipient à chaque coup de pompe, est à la quantité que contenoit le récipient avant le coup, comme la capacité de la pompe dans laquelle l'air passe en sortant du récipient, est à la somme des capacités du corps de la pompe & du récipient.
Pour voir la vérité de ce principe, il faut observer, qu'en élevant le piston, & l'éloignant du fond de la pompe, il doit se faire un vuide dans ce nouvel espace ; mais ce vuide est prévenu par l'air qui s'y transporte du récipient ; cet air fait effort de tous côtés pour se répandre ; or il arrive de-là qu'il passe dans la partie vuide du corps de pompe que le piston vient d'abandonner, & il doit continuer ainsi à passer jusqu'à ce qu'il soit de même densité dans la pompe & dans le récipient ; ainsi l'air qui immédiatement avant le coup de pompe, étoit renfermé seulement dans le récipient & toutes ses dépendances, est à présent uniformément distribué dans le récipient & le corps de la pompe : d'où il est clair que la quantité d'air contenue dans la pompe, est à celle que contiennent la pompe & le récipient tout ensemble, comme la capacité de la pompe est à celle de la pompe & du récipient tout ensemble ; mais l'air que contient la pompe, est celui-là même qui sort du récipient à chaque coup, & l'air contenu dans la pompe & le récipient cout ensemble, est celui que contenoit le récipient immédiatement avant le coup : donc la vérité de notre regle est évidente.
Nous allons démontrer à présent que la quantité d'air qui reste dans le récipient après chaque coup de pompe, diminue en progression géométrique. En effet, puisque la quantité d'air du récipient diminue à chaque coup de pompe, en raison de la capacité du récipient, à celle du même récipient & de la pompe jointes ensemble ; chaque reste est donc toujours moindre que le reste précédent dans la même raison donnée ; d'où il est clair qu'ils sont tous dans une progression géométrique décroissante.
Si les restes décroissent en progression géométrique, il est certain qu'à force de pomper, on pourra les rendre aussi petits qu'on voudra, c'est-à-dire, qu'on pourra approcher autant qu'on voudra, du vuide parfait ; mais on voit en même tems qu'on ne pourra tout évacuer.
Outre les effets & les phénomènes de la machine pneumatique, dont on a parlé aux articles Vuide, Air, &c. on peut y en ajouter quelques autres : par exemple, la flamme d'une chandelle mise dans le vuide s'éteint en une minute, quoiqu'elle y subsiste quelquefois pendant deux ; mais la meche continue d'y être en feu, & même il en sort une fumée qui monte en-haut. Du charbon allumé s'éteint totalement dans l'espace d'environ cinq minutes, quoiqu'en plein air il ne s'éteigne qu'après une demi-heure ; cette extinction se fait par degrés, en commençant par le haut & par les côtés extérieurs. L'absence de l'air n'affecte point le fer rougi au feu ; & néanmoins le soufre ou la poudre à canon ne prennent point flamme dans le vuide, ils ne font que s'y fondre. Une meche, après avoir paru long-tems totalement éteinte dans le vuide, se ranime lorsqu'on la remet à l'air. Si l'on bat le fusil dans le vuide, on y produit des étincelles aussi abondamment qu'en plein air : ces étincelles saillent dans toutes les directions, en-dessus, en dessous, &c. comme dans l'air : l'aimant & les aiguilles aimantées ont les mêmes propriétés dans le vuide que dans l'air. Après qu'un flambeau est éteint dans un récipient épuisé d'air, la fumée descend par degrés au fond, où elle forme un corps noirâtre, en laissant la partie supérieure claire & transparente ; & si l'on incline le vase, tantôt d'un côté & tantôt d'un autre, la surface de la fumée se tient horisontalement semblable aux autres fluides. Le syphon ne coule point dans le vuide. L'eau s'y gêle. Dans un récipient épuisé d'air on peut produire de la chaleur par le frottement. Le camphre ne prend point feu dans le vuide. Quoique quelques grains d'un monceau de poudre s'allument dans le vuide par le moyen d'un miroir ardent, ils ne communiquent point le feu aux grains qui leur sont contigus. Les vers luisans perdent leur lumiere à mesure que l'air s'épuise, & à la fin ils s'obscurcissent totalement, mais ils recouvrent sur le champ tout leur éclat, quand on les remet à l'air. Le phosphore que l'on fait avec de l'urine ne cesse pas d'être lumineux dans le vuide ; on remarque aussi que l'esprit de nitre de Glauber mêlé avec de l'huile de carvi, s'enflamme dans le vuide, & met en pieces la fiole où il a été renfermé. Les viperes & les grenouilles s'enflent beaucoup dans le vuide ; mais elles y vivent une heure & demi ou deux heures, & quoiqu'alors elles paroissent tout-à-fait mortes, quand on les remet à l'air pendant quelques heures, elles se raniment. Les limaçons y vivent dix heures ; les lésards, deux ou trois jours ; les sangsues, cinq ou six jours ; les huitres vivront dans le vuide pendant vingt-quatre heures sans aucun accident. Le c?ur d'une anguille détaché de son corps continue de battre dans le vuide avec plus d'agilité que dans l'air, & cela pendant près d'une heure. Le sang chaud, le lait, le fiel éprouvent dans le vuide une effervescence & une ébullition considérable. On peut parvenir à faire vivre une souris ou d'autres animaux dans un air rarefié, plus long-tems qu'ils ne vivroit naturellement, si l'on sait bien ménager les degrés de rarefaction. Si on enferme un animal sous un récipient dont on ne pompe l'air qu'en partie, il y vit à la vérité plus long-tems que si on pompoit l'air entierement, mais il ne laisse pourtant pas d'y mourir. Les oiseaux ont à cet égard quelque avantage sur les animaux terrestres ; car ils peuvent mieux supporter un air rarefié, étant accoutumés de s'élever à une hauteur souvent très-considérable, où ils rencontrent un air beaucoup moins épais que celui que nous respirons. On a cependant observé que si on pompe les de l'air d'un récipient, ils ne peuvent plus vivre dans l'air qui reste, parce que cet air se trouve trop subtil. On voit par-là que les oiseaux ne peuvent s'élever que jusqu'à une certaine hauteur ; car s'ils voloient trop haut, ils ne respireroient qu'avec peine, comme l'ont expérimenté plusieurs voyageurs qui ont monté de fort hautes montagnes ; par exemple, le pic de Ténériffe.
Lorsqu'on veut priver les poissons d'air, on les met dans un grand verre plein d'eau qu'on place sous le récipient ; au moment qu'on pompe l'air, les poissons viennent flotter sur l'eau, & ne peuvent redescendre qu'avec beaucoup de peine, parce qu'ils ont au-dedans de leurs corps une vessie pleine d'air qui venant à se dilater, les gonfle & les rend plus légers ; aussitôt qu'on fait rentrer l'air dans le verre, ils s'enfoncent, comme d'eux-mêmes ; mais, si on continue à pomper, la vessie pleine d'air se creve souvent dans leurs corps. Il y a diverses sortes de poissons qui vivent assez long-tems dans le vuide, comme les anguilles ; d'autres qui y meurent assez vite. Les insectes peuvent aussi vivre assez long-tems sans air ; quelques-uns meurent, d'autres semblent ressusciter, lorsqu'on a fait rentrer l'air ; mais ils paroissent toujours fort languissans dans le vuide.
L'air peut y conserver sa pression ordinaire, après être devenu incapable de servir à la respiration. Les ?ufs des vers à soie éclorront dans le vuide, &c.
Lorsqu'on a tiré le piston de la machine, en bas, l'air extérieur qui le presse par son poids, & qui a plus de force que l'air du dedans de la machine, fait remonter le piston de lui-même, & souvent même on a besoin de modérer la vitesse avec laquelle le piston est repoussé en haut.
Il faut avoir soin de mettre sur la platine un récipient convexe, & propre par conséquent par sa figure à résister à la pression de l'air extérieur ; car si on y met un récipient dont la surface soit applatie, comme une bouteille plate, elle se brise en mille morceaux.
Le son ne sauroit se répandre dans le vuide ; car si on suspend dans le récipient une petite cloche, le son de cette cloche devient plus foible à mesure qu'on pompe l'air, & à la fin il devient si foible qu'on ne l'entend plus du tout.
Dès qu'on a commencé à donner quelques coups de piston, il paroit dans le récipient une vapeur plus ou moins épaisse qui obscurcit l'intérieur du vase, & qui après quelques petits mouvemens en forme de circonvolutions, se précipite vers la partie inférieure. Plusieurs physiciens l'ont attribué à l'humidité des cuirs dont on couvre la platine pour aider l'application exacte du récipient, sans examiner en détail pourquoi les particules d'eau seroient détachées & déterminées à se mouvoir de haut en bas à l'occasion d'un air rarefié au-dessus ; mais ces philosophes se seroient bientôt détrompés, s'ils avoient remarqué qu'un récipient posé sur une platine & latté avec de la cire ou du mastic, fait voir la même vapeur qu'on a coutume d'appercevoir dans un récipient posé sur un cuir mouille. M. Mariotte est le premier qui ait expliqué ce phénomène d'une maniere plus satisfaisante ; selon lui la vapeur qui obscurcit le récipient, vient des petites parties aqueuses ou héterogènes, répandues dans l'air, & qui ne pouvant plus être soutenues par l'air, dès qu'il commence à être rarefié à un certain point, sont obligés de retomber & de s'attacher aux parois du récipient. Voyez son traité du mouvement des eaux, seconde partie, premier discours, pog. 364, de l'édition de Leyde 1717. Voyez aussi les mémoires de l'académie de 1740, pag. 243. On peut voir aussi le détail d'un grand nombre d'autres expériences faites avec la machine pneumatique dans l'essai de physique de M. Musschenbroeck, tout à la fin. Nous nous sommes contentés de rapporter ici, d'après ces habiles physiciens, les plus simples & les plus communes qui se font avec la machine dont il s'agit.
Wiktionnaire
Nom commun - français
pneumatique \pnø.ma.tik\ masculin
-
Tube de caoutchouc, gonflé d'air ou d'un gaz comprimé, et qui est fixé à la jante d'une roue pour amortir les chocs, inventé en 1888.
- Sans me presser je mets mes souliers et gonfle mes pneumatiques. ? (Jules Renard, Journal, 1897)
- Brevet de quinze ans, 30 septembre 1913; Destriez (J.) & Duthilleul (E.), représentés par Smits, rue Colbrant, n" 23, à Lille (Nord). ? Tube à air increvable et inéclatable remplaçant la chambre à air des pneumatiques pour automobiles. ? (Bulletin des lois : Partie supplémentaire , 2e partie : Ordonnances, 1er et 2e section, Paris : Imprimerie nationale, 1915, page 1297)
- La roue en bois avec cerclage en fer, utilisée notamment en Afrique du Nord, en Égypte et à Madagascar, équipait autrefois tous les chariots avant l'emploi des pneumatiques. ? (Mémento de l'agronome, France : CIRAD-GRET/Ministère des affaires étrangères, 2002, page 754)
- Tube rigide où l'on fait le vide par le moyen de machines pneumatiques et dont on se servait pour envoyer les dépêches, et aujourd'hui pour faire circuler de la monnaie.
- 9 décembre 42 ? C'est étonnant l'habitude que nous avons tous de procéder par pneumatiques ! On n'a pas le courage d'attendre plus de deux heures qu'une lettre soit reçue et lue ! Je me demande si les autres jeunesses étaient comme cela ? Il est évident que pour nous, tout se passe par lettre. ? (Benoîte et Flora Groult, Journal à quatre mains, Denoël, 1962, page 250)
-
(Par extension) Sorte d'obus qui circule dans ce tube.
- Expédier un pneumatique. (Voir aussi pneu).
-
(Par extension) (Désuet) Dépêche envoyée par ce moyen.
- C'était un garçon de bureau qui lui apportait un pneumatique que Bellegarde s'empressa de décacheter. ? (Arthur Bernède, Belphégor, 1927)
Adjectif - français
pneumatique \pnø.ma.tik\ masculin et féminin identiques
-
(Physique) Relatif à l'air.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
-
(Technique) Qui utilise de l'air sous pression ou sous dépression.
- Les dépoussiéreurs pneumatiques offrent l'inconvénient de dépoussiérer moins efficacement que les tamis vibrants, ? [?] ? et de consommer une quantité importante d'air, c'est à dire de force motrice. ? (Ch. Berthelot, Épuration, séchage, agglomération et broyage du charbon, Paris : chez Dunod, 1938, page 42)
- Pour les épandeurs centrifuges à 2 disques et les épandeurs pneumatiques il est préférable, lorsque cela est possible, de vérifier le débit des 2 côtés. ? (Comment régler son épandeur d'engrais ou de produits organiques ?, ARVALIS, 2004)
-
(Spécialement) Qualifie le système de transport de petites masses, sur de courtes distances, par des tubes sous pression d'air.
- À la vue de la carte pneumatique, la crainte du fantôme de son mari s'est évanouie chez Hélène. ? (Jules Supervielle, Le Voleur d'enfants, 1926, p. 40)
- Tube pneumatique.
Trésor de la Langue Française informatisé
PNEUMATIQUE, adj. et subst.
Pneumatique au Scrabble
Le mot pneumatique vaut 21 points au Scrabble.
Informations sur le mot pneumatique - 11 lettres, 6 voyelles, 5 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot pneumatique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
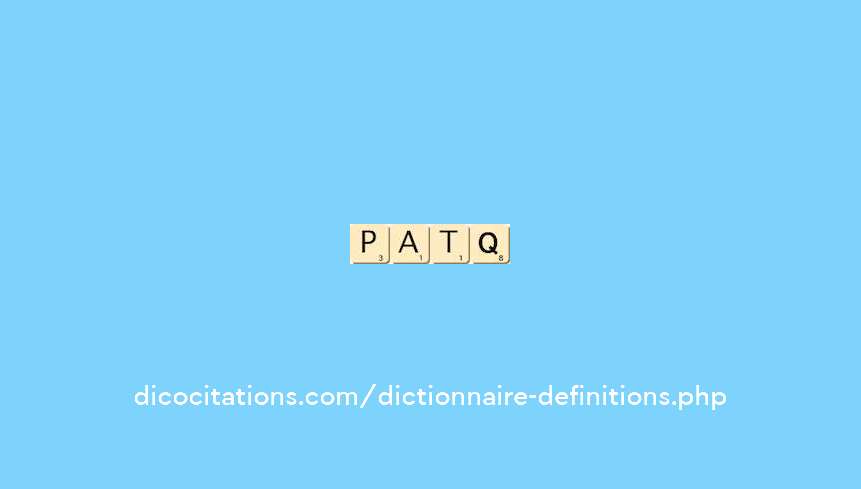
Les mots proches de Pneumatique
Pneumatique Pneumatocèle Pneumatologie Pneumonanthe pneu pneumatique pneumatique pneumatiques pneumatiques pneumatophore pneumo pneumoconiose pneumocoque pneumocoques pneumocystose pneumologue pneumonectomie pneumonie pneumonies pneumonique pneumopathie pneumos pneumothorax pneus pneus-neigeMots du jour
-
extra-lucides exécutions déjanterais éminence fantôme insurgeât localisation contrarient rivoir surgeonnent
Les citations avec le mot Pneumatique
- La quantité considérée dans l'air, sa pesanteur, son mouvement, sa condensation, raréfaction, etc. donne la pneumatique.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Sans référence
- La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques, à bandages antidérapants.Auteur : Maurice Leblanc - Source : L'Aiguille creuse (1908)
Les citations du Littré sur Pneumatique
- La quantité considérée dans l'air, sa pesanteur, son mouvement, sa condensation, raréfaction, etc. donne la pneumatiqueAuteur : D'ALEMB. - Source : Explic. syst. conn. hum. Oeuv. t. I, p. 340, dans POUGENS.
Les mots débutant par Pne Les mots débutant par Pn
Une suggestion ou précision pour la définition de Pneumatique ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 04h40
- Paix - Papa - Paradis - Paradoxe - Paraître - Pardon - Pardonner - Parent - Paresse - Parler - Parole - Parole chanson - Partage - Partir - Pas - Passé - Passé - Passion - Passoire - Patience - Patient - Patrie - Patriotisme - Pauvre - Pauvrete - Pauvreté - Payer - Pays - Paysan - Péché - Peche - Pédagogie - Pédanterie - Peine - Peinture - Pensée - Pensées - Penser - Perception - Père - Père noel - Père fils - Amour Papa - Enfants Père - Amour Père - Aime Père - Aime Papa - Père coeur - Père enfant - Père Mère - Père Fille - Père Fils - Fête des Pères - Bonne fête des pères - Perfection - Perfidie - Permanence - Perséverance - Personnage - Personnalité - Personne - Persuader - Pessimisme - Peuple - Peur - Philosophie - Phrases - Physiologie - Physique - Piano - Piege - Piston - Pitie - Pitié - Plagiat - Plaindre - Plaire - Plaisir - Plannification - Pleonasme - Pleur - Pleurer - Poésie - Poesie - Poète - Poete - Pognon - Police - Politesse - Politicien - Politique - Ponctualite - Populaire - Popularité - Pornographie - Porte - Posologie - Posséder - Postérité - Pouvoir - Prédiction - Préférence - Préjugé - Prendre - Présent - Président - Pret - Prétention - Prévoir - Prier - Principes - Prison - Privilege - Prix - Probabilite - Probleme - Producteur - Profit - Progres - Proletariat - Promenade - Promesse - Promettre - Prononciation - Proposer - Propriété - Prose - Prostituée - Prouver - Proverbe - Prudence - Psychanalyse - Psychologie - Psychose - Publicité - Pucelage - Pudeur - Punition - Pureté
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur pneumatique
Poèmes pneumatique
Proverbes pneumatique
La définition du mot Pneumatique est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Pneumatique sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Pneumatique présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

