Définition de « abbaye »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot abbaye de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur abbaye pour aider à enrichir la compréhension du mot Abbaye et répondre à la question quelle est la définition de abbaye ?
Une définition simple : (fr-rég|a.be.i) abbaye (f)
Expression : abbaye en règle abbaye en commende pour un moine l’abbaye ne faut pas abbaye des s’offre-à-tous abbaye ruffiante
Approchant : abbatial, abbé, abbesse
Définitions de « abbaye »
Trésor de la Langue Française informatisé
ABBAYE, subst. fém.
RELIG. Monastère placé sous la direction d'un abbé ou d'une abesse.Wiktionnaire
Nom commun - français
abbaye \a.be.i\ féminin
-
(Christianisme) Monastère d'hommes, qui a pour supérieur un abbé, ou de femmes, qui a pour supérieure une abbesse.
- Ah ! c'est une riche abbaye ; on y fait bonne chère, et ils boivent les meilleurs vins, ces bons pères de Jorvaulx. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- Les abbayes et les monastères, étaient à cette époque, « cavernes de voleurs, lieux de dissolution » ; les abus devenaient tellement criants, les désordres prenaient des proportions si inquiétantes, qu'à tout prix il fallait y mettre un terme [?]. ? (Gustave Fraipont, Les Vosges, 1923)
- Pessan, le siège d'une antique abbaye, a une superficie de 2 588 hectares où végètent encore 430 habitants. ? (Ludovic Naudeau, La France se regarde : le Problème de la natalité, Librairie Hachette, Paris, 1931)
-
(Histoire) Bénéfice attaché au titre d'abbé.
- Le roi lui donna une abbaye.
- Il avait, il possédait jusqu'à trois abbayes.
-
(Par métonymie) (Architecture) Les bâtiments du monastère.
- Avant les découvertes des plates-tombes de l'abbaye Notre-Dame-du-V?u, des fouilles de céramiques tombales importantes ont eu lieu au prieuré Saint-Martin de Deux-Jumeaux. ? (Éric Brine, Le Prieuré de Deux-Jumeaux, in Arts funéraires et décors de la vie, Normandie XIIe-XVIe siècle, CRAHM, 2003, page 32)
- [?] le Père Dimier attirait l'attention sur le nom de la commune de Bouconville-Vauclerc, sur le territoire de laquelle se trouve l'abbaye cistercienne de Vauclair. Il émettait le v?u de voir rectifier l'orthographe du nom de la commune conformément à l'étymologie du nom de l'abbaye [?]. ? (Cîteaux, commentarii cistercienses, volume 24, 1973, page 73)
-
(Suisse) (Vaud)(Neuchâtel) Société de tir?[1], et par extension fête organisée par une société de tir.
- C'est comme une de ces après-midi de dimanche où il y a fête, fête et danse, une de ces abbayes d'ici qui ont lieu une fois par an. ? (Charles Ferdinand Ramuz, Présence de la mort, Georg, Genève 1922, chapitre 25)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Monastère d'hommes, qui a pour supérieur un abbé, ou de femmes, qui a pour supérieure une abbesse. Abbaye royale, ou de fondation royale. Abbaye sécularisée. Abbaye de Saint-Benoît, de l'ordre de Cîteaux. Il s'est dit du Bénéfice attaché au titre d'abbé. Le roi lui donna une abbaye. Il avait, il possédait jusqu'à trois abbayes. Abbaye en règle, Celle à laquelle on ne peut nommer qu'un religieux. Abbaye en commende, Celle à laquelle on pouvait nommer un ecclésiastique séculier.
ABBAYE se dit encore des Bâtiments du monastère. Une abbaye bien bâtie. Une abbaye qui tombe en ruines. Prov. et fig., Pour un moine l'abbaye ne faut pas, Quand plusieurs personnes sont convenues de se réunir, et qu'une d'elles manque à la réunion, on ne laisse pas de faire ce qui avait été résolu.
Littré
- 1Monastère d'hommes ou de filles. Une abbaye fort riche.
- 2Le bénéfice attaché au titre d'abbé. Il avait jusqu'à trois abbayes.
-
3Les bâtiments du monastère. L'abbaye de Saint-Germain brûla en 1793.
Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince?; Allez, venez, courez?; demeurez en province?; Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement?; Les gens en parleront, n'en doutez nullement
, La Fontaine, Fab. III, 1.Abbaye en règle, celle à laquelle on ne peut nommer qu'un religieux. Abbaye en commande, celle à laquelle on peut nommer un ecclésiastique séculier.
Prov. Pour un moine l'abbaye ne faut pas, c.-à-d. pour un qui fait défaut, une partie ne manque pas, un projet ne s'en exécute pas moins.
HISTORIQUE
XIe s. Se ceo fust u evesqué u abbeie?
, L. de Guill. 1.
XIIe s. Se delivrast al regne nul liu [lieu] cum eveschiez, Priorez, abeies, u nuls arceveschiez, Li reis en saisireit les rentes et les fiés
, Th. le Mart. 61. Deu [elle] servira dedens une abaïe
, Ronc. 148. A la riche abaie du baron St-Maart [Médard]
, Sax. 29. Vous estes de l'abaïe As [aux, des] s'offre à tous (vous êtes de celles qui s'offrent à tous)?; Si ne vous nommerai
, Romanc. 89.
XIIIe s. St-Estienne, une abaie qui estoit à trois lieues de Constantinoble
, Villehardouin, 61. Et avant en devroit porter heritage uns cousins en tiers degré ou en quart, de lignage du pere au religieus, que ses fix qui isteroit [sortirait] de l'abbeie pour avoir heritage
, Beaumanoir, LVI, 2. Et puis [il] se rendit moine dedens une abeie
, Berte, 2.
XVe s. Car amour, en son abbaye Se tenoit chef de son couvent Ou [au] temps qu'ay congneu en ma vie
, Orléans, Ball. 52.
Encyclopédie, 1re édition
ABBAYE, s. f. Monastere ou Maison Religieuse, gouvernée par un Supérieur, qui prend le titre d'Abbé ou d'Abbesse. Voyez Abbé, &c.
Les Abbayes different des Prieurés, en ce qu'elles sont sous la direction d'un Abbé ; au lien que les Prieurés sont sous la direction d'un Prieur : mais l'Abbé & le Prieur (nous entendons l'Abbé Conventuel) sont au fond la même chose, & ne different que de nom. Voyez Prieur.
Fauchet observe que dans le commencement de la Monarchie Françoise, les Ducs & les Comtes s'appelloient Abbés, & les Duchés & Comtés, Abbayes. Plusieurs personnes de la premiere distinction, sans être en aucune sorte engagées dans l'état Monastique, prenoient la même qualité. Il y a même quelques Rois de France qui sont traités d'Abbés dans l'Histoire. Philippe I. Louis VII. & ensuite les Ducs d'Orléans, prirent le titre d'Abbés du Monastere de S. Agnan. Les Ducs d'Aquitaine sont appellés Abbés du Monastere de S. Hilaire de Poitiers, & les Comtes d'Anjou, de celui de S. Aubin, &c. Mais c'est qu'ils possédoient en effet ces Abbayes, quoique laïques. Voyez Abbé.
Abbaye se prend aussi pour le bénéfice même, & le revenu dont joüit l'Abbé.
Le tiers des meilleurs Bénéfices d'Angleterre étoit anciennement, par la concession des Papes, approprié aux Abbayes & autres Maisons Religieuses : mais sous Henri VIII. ils furent abolis, & devinrent des Fiefs séculiers. 190 de ces Bénéfices abolis, rapportoient annuellement entre 200 l. & 35000 l. ce qui en prenant le milieu, se monte à 2853000 l. par an.
Les Abbayes de France sont toutes à la nomination du Roi, à l'exception d'un petit nombre ; savoir, parmi les Abbayes d'Hommes, celles qui sont Chefs d'Ordre, comme Cluny, Cîteaux avec ses quatre Filles, &c. & quelques autres de l'Ordre de Saint-Benoît, & de celui des Prémontrés : & parmi les Abbayes de Filles, celles de Sainte-Claire, où les Religieuses, en vertu de leur Regle, élisent leur Abbesse tous les trois ans. On peut joindre à ces dernieres, celles de l'Ordre de Saint Augustin, qui ont conservé l'usage d'élire leur Abbesse à vie, comme les Chanoinesses de S. Cernin à Toulouse.
C'est en vertu du Concordat entre Léon X. & François I. que les Rois de France ont la nomination aux Abbayes de leur Royaume. (H)
Étymologie de « abbaye »
Provenç. et espagn. abadia?; ital. abbadia?; de abbatia, de abbas (voy. ABBÉ).
- (1175) Du moyen français abbaye, abbaïe, de l'ancien français abeïe, abaie, abbeie, abadie, du latin abbatia[1].
abbaye au Scrabble
Le mot abbaye vaut 19 points au Scrabble.
Informations sur le mot abbaye - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot abbaye au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
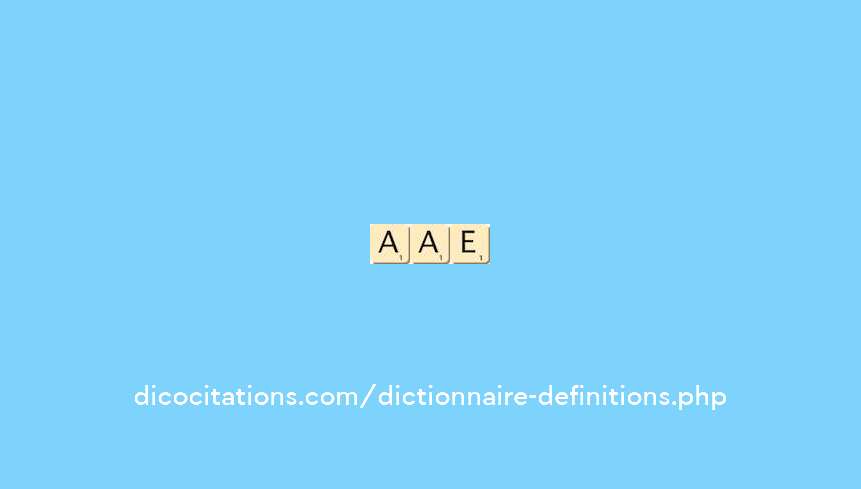
Les rimes de « abbaye »
On recherche une rime en EI .
Les rimes de abbaye peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ei
Rimes de abbayes Rimes de désobéis Rimes de arrière-pays Rimes de obéis Rimes de pays Rimes de abbaye Rimes de agnus dei Rimes de obéie Rimes de agnus-dei Rimes de obéit Rimes de désobéit Rimes de obéi Rimes de désobéiMots du jour
abbayes désobéis arrière-pays obéis pays abbaye agnus dei obéie agnus-dei obéit désobéit obéi désobéi
Les citations sur « abbaye »
- Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince; - Allez, venez, courez; demeurez en province; - Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement; - Les gens en parleront, n'en doutez nullement.Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fables (1668 à 1694), Livre troisième, I, le Meunier, son Fils, et l'Ane
- Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont de certains principes, les commandements de Dieu ont été mis en abrégé sur le frontispice de l'abbaye de Thélème: fais ce que tu voudras.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Abbaye de Monte-à-regret: Echafaud (Vidocq). - Double allusion. - Comme une abbaye, l'échafaud vous sépare de ce bas monde, et c'est à regret qu'on en monte les marches.Auteur : Etienne Lorédan Larchey - Source : Les Excentricités du langage (1865)
- Il s'est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n'étaient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye voeu de pauvreté.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696)
- Autrefois la guillotine s'appelait l'abbaye de monte-à-regret, mais depuis qu'on la dresse sur la place de la Roquette et qu'afin qu'elle soit d'aplomb elle s'appuie sur cinq dalles placées au milieu du pavage, on la nomme «l'abbaye de cinq pierres».Auteur : Maxime Du Camp - Source : Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle (1869-1875)
- En Indochine, les dirigeants de Vientiane ont revu leurs prévisions de croissance à Laos...
Dans le même temps, dans les abbayes, les crédits ont été revus à l'abbesse!Auteur : Marc Hillman - Source : Mots en Mêlée (2011) - Au détour du chemin creux, une porte de bois, dans un châssis de pierres, qu'une croix de fer surmonte: c'est l'entrée de l'abbaye.Auteur : André Suarès - Source : Trois Hommes: Pascal, Ibsen, Dostoïevski (1913)
- On dit qu'il a permission d'aller se promener dans ses abbayes; on aurait dû l'envoyer promener quatre ans plutôt.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 18 octobre 1760
- Les murs qui jadis étaient des abbayes ne sont plus que des cavernes, et les coules ne sont que des sacs pleins de mauvaise farine.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, Le Paradis (1321), XXII
- Même abbaye, même habit.Auteur : Proverbes allemands - Source : Proverbe
- Le chien veut mal à celui à qui il abbaye.Auteur : Jacques Amyot - Source : Cimon, 33
- Honte, répondit Jalousie, j'ai grand'peur d'être trahie, car Débauche est devenue très puissante. Elle règne partout. Même en abbaye et en cloître, Chasteté n'est plus en sûreté.Auteur : Guillaume de Lorris - Source : Le Roman de la Rose
- Je n'étudie point, pour ma part. En notre abbaye, nous n'étudions jamais, de peur des oreillons.Auteur : François Rabelais - Source : Gargantua (1542), 39
- L'abbaye est bien pauvre quand les moines vont aux glands.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- L'abbaye de Port-Royal des champs, ce berceau de la première philosophie et de la bonne littérature.Auteur : Charles Pinot Duclos - Source : Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la régence et le règne de Louis XV (1791)
- Zénon : Par-delà ce village, d'autres villages, par-delà cette abbaye, d'autres abbayes, par-delà cette forteresse, d'autres forteresses. Et dans chacun de ces châteaux d'idées, de ces masures d'opinions superposés aux masures de bois et aux châteaux de pierre, la vie emmure les fous et ouvre un pertuis aux sages.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Alexis ou le Traité du vain combat (1929)
- Le coeur de Simon migre maintenant, il est en fuite sur les orbes, sur les rails, sur les routes, déplacé dans ce caisson dont la paroi plastique, légèrement grumeleuse, brille dans les faisceaux de lumière électrique, convoyé avec une attention inouïe, comme on convoyait autrefois les coeurs des princes, comme on convoyait leurs entrailles et leur squelette, la dépouille divisée pour être répartie, inhumée en basilique, en cathédrale, en abbaye, afin de garantir un droit à son lignage, des prières à son salut, un avenir à sa mémoire –on percevait le bruit des sabots depuis le creux des chemins, sur la terre battue des villages et le pavé des cités, leur frappe lente et souveraine, puis on distinguait les flammes des torches (…) mais l'obscurité ne permettait jamais de voir cet homme, ni le reliquaire posé sur un coussin de taffetas noir, et encore moins le coeur à l'intérieur, le membrum principalissimum, le roi du corps, puisque placé au centre de la poitrine comme le souverain en son royaume, comme le soleil dans le cosmos, ce coeur niché dans une gaze brochée d'or, ce coeur que l'on pleurait.Auteur : Maylis de Kerangal - Source : Réparer les vivants (2013)
Les mots proches de « abbaye »
Abbatial, ale Abbatiat Abbaye Abbé AbbesseLes mots débutant par abb Les mots débutant par ab
Abbans-Dessous Abbans-Dessus Abbaretz abbatial abbatiale abbatiale abbatiales abbaye Abbaye-sous-Plancy abbayes abbé Abbécourt Abbecourt Abbenans abbés abbesse abbesses Abbeville Abbeville Abbeville Abbéville-la-Rivière Abbéville-la-Rivière Abbéville-lès-Conflans Abbeville-Saint-Lucien Abbévillers
Les synonymes de « abbaye»
Les synonymes de abbaye :- 1. monastère
2. cloître
3. couvent
4. ermitage
5. prieuré
6. chalet
7. doyenné
synonymes de abbaye
Fréquence et usage du mot abbaye dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « abbaye » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot abbaye dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Abbaye ?
Citations abbaye Citation sur abbaye Poèmes abbaye Proverbes abbaye Rime avec abbaye Définition de abbaye
Définition de abbaye présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot abbaye sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot abbaye notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
