La définition de Cidre du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Cidre
Nature : s. m.
Prononciation : si-dr'
Etymologie : Berry, citre ; picard, cite ; espagn. sidra ; anc. espagn sizra ; ital. sidro, cidro ; du latin sicera, venant d'un mot hébreu qui signifie une espèce de boisson enivrante.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de cidre de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec cidre pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Cidre ?
La définition de Cidre
Boisson faite avec du jus de pommes. Cidre doux. Cidre piquant. Le cidre enivre. On dit que du cidre est tué, quand, ayant été exposé, en vidange, à l'action de l'air, il a pris une teinte noirâtre et perdu de son goût.
Toutes les définitions de « cidre »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Boisson faite avec du jus de pommes pressurées. Gros cidre. Petit cidre. Cidre doux. Cidre piquant. Cidre mousseux.
Littré
- Boisson faite avec du jus de pommes. Cidre doux. Cidre piquant. Le cidre enivre. On dit que du cidre est tué, quand, ayant été exposé, en vidange, à l'action de l'air, il a pris une teinte noirâtre et perdu de son goût.
Cidre à deux trains, cidre fait avec des pommes d'espèces mêlées.
HISTORIQUE
XIIIe s. Sicera, id est, sidre
, Du Cange, sicera.
XVe s. De nous se rit le François, Mais vrayement, quoi qu'il en die, Le sildre de Normandie Vault bien son vin quelquesfois
, Basselin, Vau de Vire, 15.
XVIe s. Nos reitres receurent aussi argent, qu'ils trouverent beaucoup meilleur que les citres de Normandie
, Lanoue, 604. Ils se servent plus du sidre ou pommé, et du peré que de la biere, par tout où ces boissons sont en usage, l'on appelle pommé le jus de pomme, et poiré celui de poire?: particulierement en la haulte Normandie, es environs de Paris, en la Brie, et en certains endroits de la Picardie, sidre, toute liqueur procedante des pommes et des poires, meslée ou distincte. Mais en la basse Normandie, comme en Costentin, Bessin, païs de Caux, et autres, esquels ce bruvage est le mieux cogneu, aussi à Rouen, par le sidre est seulement entendu le jus procedant des pommes, demeurant le nom de poiré particulier à celui des poires
, De Serres, 245-246.
Encyclopédie, 1re édition
* CIDRE, s. m. (?conom. rust.) boisson que l'on tire de la pomme. Elle est très-ancienne ; les Hébreux l'appelloient sichar, que S. Jérôme traduit par sicera, d'où nous avons fait cidre. Les nations postérieures l'ont connu ; les Grecs & les Romains ont fait du vin de pomme. Parmi nous il est très-commun, sur-tout dans les provinces où l'on manque de celui du raisin.
La Normandie est pour le cidre, ce que sont la Bourgogne & la Champagne pour le vin ; & de même que le vin n'est pas également bon dans tous les cantons de ces provinces, tous les cantons de la Normandie ne donnent pas du cidre de la même qualité. Il s'en fait en abondance, & d'excellent, surtout dans le pays d'Auge & le Bessin, ou les environs d'Isigny. Le fruit à couteau n'y vaut rien. Le cidre se tire de pommes rustiques de plusieurs especes, dont il faut bien connoître les sucs, afin de les combiner convenablement, & de corriger les uns par les autres. On éleve des pepinieres de pommiers de cette espece de pommes, on les greffe en fente, on les plante en quinconce, ou on en dresse des allées. Il y a peut-être plus de trente sortes de pommes à cidre, qu'on cueille en différens tems à mesure qu'elles paroissent mûres ; & elles mûrissent plus ou moins promptement, selon que les années sont plus ou moins avancées. On les distribue en trois classes différentes, dont on fait la récolte successivement. On donne le nom de pommes tendres aux deux premieres classes, & celui de pommes dures à la troisieme. En effet les pommes de la troisieme classe sont dures, & mûrissent tard & difficilement. Une regle générale pour la récolte, c'est de choisir un tems sec, pendant lequel les pommes soient essuyées de toute humidité.
Ce jour-là est ordinairement vers la fin de Septembre ou le commencement d'Octobre ; on se transporte vers les arbres ; & comme il y auroit trop d'ouvrage à cueillir les fruits à la main, on les abat, soit à coups de gaules, soit en secouant les arbres : on les ramasse, on les porte sur le grenier ; on les y met en tas suivant leur classe : là ils s'échauffent, ils suent, & ils achevent de se mûrir.
S'il y a un point de maturité à choisir pour la récolte des pommes, il y en a un autre qui n'est pas moins important à connoître pour les piler : on laisse passer aux pommes qu'on appelle tendres, de beaucoup le tems de la plus grande maturité, avant que de les piler pour les cidrer ; les pommes dures au contraire se pilent vertes. On juge du progrès de la maturité des pommes entassées dans les greniers, par l'accroissement de l'odeur qu'elles exhalent : quand cette odeur a pris un degré de force que la seule expérience apprend à connoître, il est tems de faire le cidre, & de porter le fruit à la pile.
Voici la construction de la pile : imaginez une auge circulaire de pieces de bois rapportées à deux meules de bois semblables à celles d'un moulin à blé, mais différemment posées ; celles du moulin à blé sont horisontales, celles de la pile à cidre sont verticales dans leur auge : elles sont appliquées contre une piece de bois verticale, mobile sur elle-même, & placée au centre de l'espace circulaire de l'auge ; un long essieu les traverse ; cet essieu est assemblé avec l'axe vertical ; son autre extrémité s'étend au-delà de l'auge ; on y attele un cheval ; ce cheval tire l'essieu en marchant autour de l'auge, & fait mouvoir en même tems les meules dans l'auge, où les pommes dont on l'a remplie sont écrasées. Lorsqu'on les juge convenablement écrasées, c'est-à-dire assez pour en pouvoir tirer tout le jus, on les prend avec une pelle de bois, & on les jette dans une grande cuve voisine. On écrase autant de pommes qu'il en faut pour faire un marc.
Les meules de bois sont meilleures que celles de pierre. Il faut que l'auge soit bien close, & que les pieces en soient bien assemblées, pour que rien ne se perde. Ceux qui n'ont pas de grandes piles à meules tournantes, se servent de pilons & de massues, dont ils pilent le fruit à force de bras.
Alors on travaille à asseoir le marc sur l'émoi du pressoir. Le pressoir est composé d'un gros sommier de bois qui s'appelle la brebis, de vingt-quatre à vingt-huit piés de longueur, posé horisontalement sur le terrein, & d'un arbre appellé le mouton, de pareille figure, & élevé parallélement sur la brebis : le mouton est soûtenu au bout le moins gros par une forte vis de bois, dont l'autre extrémité se rend pareillement au bout le moins gros de la brebis. Au milieu de la longueur de ces deux arbres il y a deux jumelles, & à leur gros bout deux autres jumelles : ce sont quatre pieces de bois plates, arrêtées fixement par le bout d'en-bas à la brebis, & par en-haut à des traverses qui les tiennent solidement unies, & les empêchent de s'écarter. Le mouton hausse & baisse entre les quatre jumelles, & toûjours à-plomb sur la brebis. On a une traverse que l'on met à la main sous le mouton dans les ceux jumelles du côté de la vis, où on les a disposées à la recevoir & à la soûtenir : à l'aide de cette traverse on fait hausser & baisser en bascule le gros bout du mouton. Pour les jumelles de derriere on a des morceaux de bois qu'on appelle clés ; ces clés servent soit à supporter, soit à faire presser le mouton.
On établit entre les quatre jumelles sur la brebis un fort plancher de bois, qu'on appelle le chassis d'émoi ; ce plancher a un rebord de quatre pieces de bois qu'on nomme roseaux d'émoi ; ce rebord contient le jus de la pomme ; il ne peut s'écouler que par un endroit qu'on appelle le beron, d'où il tombe dans une petite cuve.
On éleve perpendiculairement sur l'émoi le marc des pommes, par lits de trois ou quatre pouces d'épaisseur, séparés par des couches de longue paille ou par des toiles de crin, jusqu'à la hauteur de quatre à cinq piés. Le marc ainsi disposé a la forme d'une pyramide tronquée & quarrée.
Quand le marc est mis en motte de cette forme, il y a au-dessous du mouton un plancher qui lui est attaché, qui est de la grandeur de celui qui porte le marc, & qu'on nomme le hec : par le moyen de la vis qui est au bout de la brebis & du mouton, on fait descendre le mouton ; le hec est fortement appliqué sur le marc, & la pression en fait sortir le jus.
On laisse quelque tems la motte affaissée sous le hec avant que de le relever : quand le jus n'en coule plus guere, on desserre le pressoir, on taille la motte quarrément avec le couteau à pressoir, qui est un grand fer recourbé & emmanché de bois, on charge les recoupes sur la motte, & l'on continue à pressurer, recoupant & chargeant jusqu'à ce que le marc soit épuisé.
Au bas de la vis du pressoir il y a un bâti de bois placé horisontalement sur la brebis, & embrassant la vis ; ce bâti est une espece de roue dont les bras sont des leviers ; il y a des chevilles sur la gente de cette roue ; on prend ces chevilles à la main, on tourne la vis ; le mouton descend d'autant plus, & presse le marc d'autant plus fortement.
A mesure que la petite cuve qui est sous le beron de l'émoi se remplit, on prend le cidre & on l'entonne. L'entonnoir est garni d'un tamis de crin qui arrête les parties grossieres de marc qui se sont mêlées au cidre. On ne remplit pas exactement les tonneaux, on y laisse la hauteur de quatre pouces de vuide ; on les descend dans la cave, où on les laisse ouverts, car la fermentation du cidre est violente : là le cidre fermente & se clarifie ; une partie de la lie est précipitée au fond, une autre est portée à la surface ; celle-ci s'appelle le chapeau.
Si l'on veut avoir du cidre fort, on le laisse reposer sur sa lie, & couvert de son chapeau : si on le veut doux, agréable, & délicat, il faut le tirer au clair lorsqu'il commence à grater doucement le palais ; ce cidre s'appelle cidre paré. Pour lui conserver sa qualité, on lui ajoûte un sixieme de cidre doux au sortir de l'émoi ; cette addition excite une seconde fermentation legere, qui précipite au fond du tonneau un peu de lie, & porte à la surface de la liqueur un leger chapeau.
Quand on a tiré le jus du marc qui est sur l'émoi, on enleve le marc, & on le remet à la pile avec une quantité suffisante d'eau ; on broye le marc avec l'eau, & l'on reporte le tout à un pressoir où il rend le petit cidre, qui est la boisson ordinaire du menu peuple. Le premier suc s'appelle le gros cidre.
Le petit cidre est d'autant meilleur que le marc a été moins pressuré. Il paye ordinairement les frais de la cueillette. Le marc de quatre gros muids de cidre donne deux muids de petit cidre. Il y a donc du profit à avoir à soi un pressoir, parce que le marc reste au propriétaire du pressoir, avec le prix qu'on fait par motte quand on pressure chez les autres. Quand le marc est tout-à-fait sec, il sert encore d'engrais aux cochons & aux arbres, ou on le brûle.
Quand le cidre a séjourné assez long-tems dans les futailles pour y prendre le goût agréable qu'on lui veut, on le colle comme le vin, & on le met en bouteilles.
Le bon cidre doit être clair, ambré, agréable au goût & à l'odorat, & piquant. Il y en a qui se garde jusqu'à quatre ans. Les cidres legers ne passent gueres la premiere année.
Il faut communément trente-six boisseaux ou six mines de pommes, pour faire un muid de cent-soixante-huit pots de cidre. On dit que les meilleurs cidres sont sujets à la cappe, ou à une espece de croûte qui se forme à leur surface, & qui venant à se briser quand le tonneau est à la barre, met tout le reste du cidre en lie. Cette croûte ne se brisant que quand le tonneau est à la barre, il y a de l'apparence qu'il faut attribuer cet accident à l'extrème fragilité de la cappe, & à la diminution de la surface horisontale du tonneau : à mesure que le tonneau se vuide, la surface horisontale de la liqueur augmente, depuis la bonde jusqu'à la barre ; depuis la barre jusqu'au fond, cette surface diminue en même proportion qu'elle avoit augmenté. Qu'arrive-t-il ? c'est que, passé la barre, la cappe appuie contre les parois du tonneau, & resteroit suspendue en l'air sans toucher à la surface du cidre qui seroit plus basse qu'elle, si elle en avoit la force ; mais comme elle est foible, elle se brise, ses fragmens tombent au fond, se dissolvent, & troublent tout le reste du cidre. Il me semble que des vaisseaux quarrés ou des tonneaux placés debout remédieroient à cet inconvénient ; la cappe descendroit avec la liqueur par un espace toûjours égal, & toûjours soûtenue par-tout, sans qu'on pût appercevoir aucune occasion de rupture.
On fait avec les poires rustiques le cidre poiré, comme avec les pommes rustiques le cidre pommé. Voyez Poiré.
On tire encore des cormes un cidre qu'on appelle cormé. Voyez Corme.
On tire du cidre pommé une eau-de-vie dont on ne fait pas grand cas ; & l'on peut en tirer un aigre, comme on fait un aigre de vin.
Le cidre passe en général pour pectoral, apéritif, humectant, & rafraîchissant. L'excès en est très nuisible. On prétend que, quand on n'y est pas fait de jeunesse, il donne des coliques, qu'il attaque le genre nerveux, & qu'on ne guérit de ces incommodités qu'en quittant cette boisson, & en changeant de climat.
Wiktionnaire
Nom commun - français
cidre \sid?\ masculin
-
Boisson faite par fermentation alcoolique de jus de pommes pressurées.
- Alors il chercha l'oubli tour à tour dans le cidre normand, le poiré manceau, l'hydromel gaulois, le cognac français, le genièvre hollandais, le gin anglais, le wiskey écossais, le kirsch germain. ? (Charles Deulin, Cambrinus)
- L'hydromel était antérieur au cidre, dont on ne fit emploi qu'assez tard en Gaule alors que la bière y était répandue depuis longtemps ; [?]. ? (François-Xavier Masson, Annales ardennaises, ou Histoire des lieux qui forment le département des Ardennes et des contrées voisines, Mézières : imprimerie Lelaurin, 1861, page 54)
- On fait du cidre dans quelques cantons des arrondissements de Rethel et de Vouziers ; la production annuelle, pour tout le département, est à peu près de 50.000 hectolitres, [?]. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 136)
- Le cidre aigrelet de la ferme arrosait ces mets peu recherchés, et j'ajoutais à cette liqueur débilitante quelques verres du vin qui se vendait dans l'île sous le nom pompeux de Bordeaux. ? (Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, L'Archipel de Chausey, souvenirs d'un Naturaliste, Revue des Deux Mondes, tome 30, 1842)
- Il leur suffisait de tremper le bout des doigts dans une pipe de cidre ou une cuvée de vin pour changer cidre et vin en bouse liquide ; [?]. ? (Octave Mirbeau, Rabalan)
- Au XVIe siècle encore, chez nos voisins la bière était la boisson du peuple et des domestiques « comme moins chère et plus commune » (Traité du Sidre, par Paulmier, 1573), et le cidre la boisson de luxe réservée aux maîtres. Nous avons vu qu'il en était tout différemment dans le Bas-Maine, à cette époque où le vin était appelé « Monsieur », et le cidre « Gilles du Pommain, breuvage de maczons ». ? (A. Angot, Le cidre, son introduction dans le pays de Laval, 1889.)
- Hélas ! en même temps que la richesse, l'habitude de la distillation du cidre à domicile s'est répandue ! ? (Ludovic Naudeau, La France se regarde : le Problème de la natalité, Librairie Hachette, Paris, 1931)
Trésor de la Langue Française informatisé
CIDRE, subst. masc.
Cidre au Scrabble
Le mot cidre vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot cidre - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot cidre au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
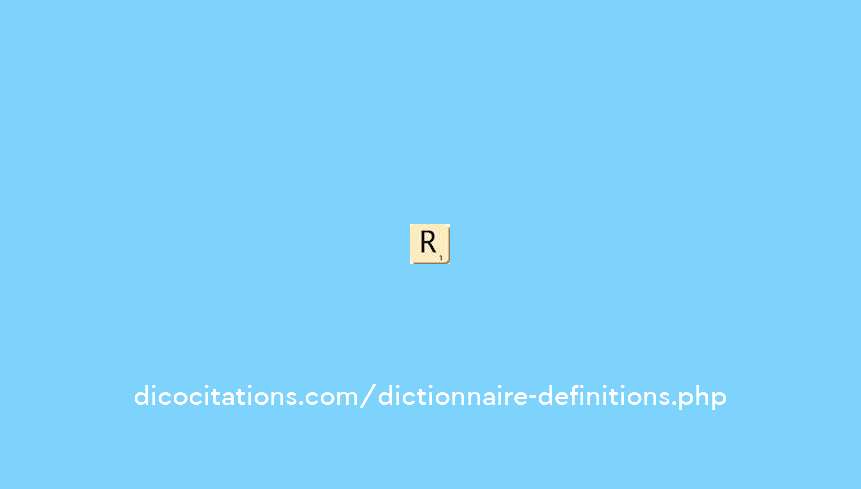
Les mots proches de Cidre
Cid Cidre Cideville cidre cidrerieMots du jour
Nourricerie Délassé, ée Aigrir Parvulissime Poêlonnée Grésiller Treillon Mérite Index Bateleur, euse
Les citations avec le mot Cidre
- En février, s'il tonne, - Point de cidre en la tonne.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- L'orgue de Barbarie est à la figue du même nom ce que la trompette bouchée est au cidre.Auteur : Pierre Dac - Source : L'Os à moelle
- Octobre n'est jamais passé, - Sans qu'il y ait cidre brassé.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Cidre: Gâte les dents.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- La nature est prévoyante: elle fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre.Auteur : Henry Monnier - Source : Mémoires de M. Joseph Prudhomme
- Je suis semblable à un alcoolique profond, invétéré, atavique, qui n'aurait jamais connu d'autre boisson qu'un petit cidre doux et baptisé, et auquel on ferait boire tout à coup, sans limite, un tord-boyaux à 70°.Auteur : Michel Tournier - Source : Le Roi des Aulnes (1980)
- Beau temps à Sainte-Eulalie - Pommes et cidre à la folie.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- C’est des pommes pour faire un petit cidre qui n’a pas non plus grande prétention mais que j’aime bien.Auteur : Jacques Chirac - Source : France 2, 9 janvier 1995
- Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, - Pommes et cidre à la folie.Auteur : Dictons - Source : 12 février
- Cidre: Ferment du jus de pomme, à ne pas confondre avec le serment du Jeu de PaumeAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
Les citations du Littré sur Cidre
- Noyons nostre soulcy En ce doux dagorie [espèce de cidre]Auteur : BASSELIN - Source : XLII
- Ores que sommes allaigres Et en santé, Dieu mercy, Laissons là ces cidres maigres ; Je treuve bon cestuy-ciAuteur : BASSELIN - Source : XLVI
- Tu es. bon cidre orangié, Tout songié, Un bon meuble en un mesnaigeAuteur : BASSELIN - Source : XXIX
- Lorsqu'on perce chez mon voisin Un tonneau de bon cidre plein....Auteur : BASSELIN - Source : XXXIII
- Il y a des pommes qui rendent le cidre clairet comme vin françois : entre lesquelles celle appellée en Cotentin escarlate le fait rougeAuteur : O. DE SERRES - Source : 247
- Aux accouchées laissons Ces douceresses boissons ; Ce bon cidre caressonsAuteur : J. LE HOUX - Source : 11
- La ferme des menues-boires, comme cidre, poiré, biere et cervoises, Lett. patent. nov. 1559. Puisque vous avez et tenez du menu [de la petite monnaie], je vous prie de me bailler le change d'un escuAuteur : BOUCHET - Source : Serées, liv. III, p. 54, dans LACURNE
- Bon cidre oste le soussy D'un procès qui me tempesteAuteur : BASSEL. - Source : XXVII
- Cervoise, ou bochet, ou biere, ou cidre, ou peré, ou telles manieres de bruvaigesAuteur : DU CANGE - Source : ib.
- Pour ce que icelui prestre estoit moult chargié de vin ou de cidre en besgoiant....Auteur : DU CANGE - Source : balbuzare.
- Ô quintessence de pommier [le cidre] ! Se toujours j'en buvoy de telle !Auteur : BASSELIN - Source : XI
- J'en vueil avoir le coeur net ; Versez donc dans ce godet ! Sur ce cidre d'excellence J'en vai faire experienceAuteur : BASSELIN - Source : VII
- Le cidre ne vaut plus Qu'un carolusAuteur : BASSELIN - Source : XXXIX.
- Il n'a point de regret Au cidre qu'il nous donne ; En eust-il une tonne, Il l'abandonneroitAuteur : BASSELIN - Source : 42
- Permettez-nous De n'espaigner ce pommé [cidre] Si bien aiméAuteur : BASSEL. - Source : XXXIX.
Les mots débutant par Cid Les mots débutant par Ci
Une suggestion ou précision pour la définition de Cidre ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 07h57
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur cidre
Poèmes cidre
Proverbes cidre
La définition du mot Cidre est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Cidre sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Cidre présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
