La définition de D du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
D
Nature : s. m.
Prononciation : dé, et, dans l'épellation moderne, de
Etymologie : D de l'alphabet latin, qui est le delta de l'alphabet grec, lequel, à son tour, est le daleth de l'alphabet phénicien. (daleth, porte).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de d de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec d pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de D ?
La définition de D
La quatrième lettre de l'alphabet et la troisième des consonnes. Le d appartient aux consonnes nommées dentales.
La prononciation a changé ; voy. ces mots.
Toutes les définitions de « d »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La quatrième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. On la nomme Dé. Un D majuscule. Un petit d. Le D est une des consonnes qu'on appelle dentales. Il est muet à la fin d'un mot, sauf à la fin de certains noms d'origine étrangère : David, Port-Saïd; et de quelques locutions latines : Ad patres, ad hoc. En liaison, il se prononce T. Grand homme. Pied-à-terre.
Littré
- La quatrième lettre de l'alphabet et la troisième des consonnes. Le d appartient aux consonnes nommées dentales.
Dans la plupart des livres que l'on imprime aujourd'hui [XVIIe siècle], on ôte le d de tous les mots où il ne doit point se faire sentir?; ainsi, comme on trouve écrit avenir, avis, ajourner, ajuger, ajuster, on ne saurait point se tromper à la prononciation de ces mots?; plusieurs font encore sentir le d dans adversité, mais tout le monde prononce aversaire
, Vaugelas, Rem. notes Th. Corn. t. II, p. 746, dans POUGENS. La prononciation a changé?; voy. ces mots.À la fin des mots et après une nasale, il est ordinairement muet?: grand, il rend?; et s'il sonne sur la voyelle suivante, il sonne comme un t?: grand homme, prononcez granit homme.
Dans la musique, D ou D-la-ré (pour ré-fa-la-ré) indique le ton de ré. D écrit au-dessus de la portée signifie doux (dolce). Quelquefois, en tête d'une partie, il marque que c'est celle du dessus.
En chiffres romains, D signifie 500, et, quand il est surmonté d'un trait, 5000.
D, Sur les anciennes monnaies de France, indique qu'elles ont été frappées à Lyon.
D M P après une signature signifie docteur en médecine de la faculté de Paris.
D est l'abréviation de don, titre donné aux seigneurs italiens et espagnols?: D. Pedro. Il est aussi l'abréviation de dom, titre donné aux moines bénédictins?: D. Rainard.
N. D. signifie Notre-Dame, la vierge Marie.
D. O. M. est dans les inscriptions, l'abréviation de Deo optimo maximo [à Dieu très bon, très grand].
Dans l'ancien alphabet chimique, D indiquait le sulfate de fer.
HISTORIQUE
XIIIe s. D [D signifie ici Dieu] jeta ceux de l'aigre feu Qui touz tems fussent en enfer?; D fu en fust, D fu en fer?; D eut au C [croix] angoisse et soif, Senefiance de l'A B C
, Jubinal, t. II, p. 276.
Encyclopédie, 1re édition
* D, s. m. (Ecriture.) la quatrieme lettre de notre alphabet. La partie intérieure du D italique se forme de l'O italique entier ; & sa partie supérieure ou sa queue des septieme & huitieme parties du même O. Le d coulé & le d rond n'ont pas une autre formation ; il faut seulement le rapporter à l'o coulé & à l'o rond. Ces trois sortes de d demandent de la part de la main un mouvement mixte des doigts & du poignet, pour la description de leur portion inférieure ; les doigts agissent seuls dans la description de la queue ou de leur partie supérieure.
D, (Gramm. &c.) Il nous importe peu de savoir d'où nous vient la figure de cette lettre ; il doit nous suffire d'en bien connoître la valeur & l'usage. Cependant nous pouvons remarquer en passant que les Grammairiens observent que le D majeur des Latins, & par conséquent le nôtre, vient du ? delta des Grecs arrondi de deux côtés, & que notre d mineur vient aussi de ? delta mineur. Le nom que les maîtres habiles donnent aujourd'hui à cette lettre, selon la remarque de la grammaire générale de P. R. ce nom, dis-je, est de plûtôt que dé, ce qui facilite la syllabisation aux enfans. Voyez la grammaire raisonnée de P. R. chap. vj. Cette pratique a été adoptée par tous les bons maîtres modernes.
Le d est souvent une lettre euphonique : par exemple, on dit prosum, profui, &c. sans interposer aucune lettre entre pro & sum ; mais quand ce verbe commence par une voyelle on ajoûte le d après pro. Ainsi on dit, pro-d-es, pro-d-ero, pro-d-esse : c'est le méchanisme des organes de la parole qui fait ajoûter ces lettres euphoniques, sans quoi il y auroit un bâillement ou hiatus, à cause de la rencontre de la voyelle qui finit le mot avec celle qui commence le mot suivant. De-là vient que l'on trouve dans les auteurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-ergà, c'est-à-dire erga me. C'est ce qui fait croire à Muret que dans ce vers d'Horace,
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Horace avoit écrit, tibid iluxisse, d'où on a fait dans la suite diluxisse.
Le d & le t se forment dans la bouche par un mouvement à-peu-près semblable de la langue vers les dents : le d est la foible du t, & le t la forte du d ; ce qui fait que ces lettres se trouvent souvent l'une pour l'autre, & que lorsqu'un mot finit par un d, si le suivant commence par une voyelle, le d se change en t, parce qu'on appuie pour le joindre au mot suivant ; ainsi on prononce gran-t-homme, le froi-t-est rude, ren-t-il, de fon-t-en comble, quoiqu'on écrive grand homme, le froid est rude, rend-il, de fond en comble.
Mais si le mot qui suit le d est féminin, alors le d étant suivi du mouvement foible qui forme l'e muet, & qui est le signe du genre féminin, il arrive que le d est prononcé dans le tems même que l'e muet va se perdre dans la voyelle qui le suit ; ainsi on dit, grand'ardeur, gran-d'ame, &c.
C'est en conséquence du rapport qu'il y a entre le d & le t, que l'on trouve souvent dans les anciens & dans les inscriptions, quit pour quid, at pour ad, set pour sed, haut pour haud, adque pour atque, &c.
Nos peres prononçoient advis, advocat, addition, &c. ainsi ils écrivoient avec raison advis, advocat, addition, &c. Nous prononçons aujourd'hui avis, avocat, adition ; nous aurions donc tort d'écrire ces mots avec un d. Quand la raison de la loi cesse, disent les jurisconsultes, la loi cesse aussi : cessante ratione legis, cessat lex.
D numéral. Le D en chiffre romain signifie cinq cents. Pour entendre cette destination du D, il faut observer que le M étant la premiere lettre du mot mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour signifier par abréviation le nombre de mille. Or ils avoient une espece de M qu'ils faisoient ainsi CI?, en joignant la pointe inférieure de chaque C à la tête de l'I. En Hollande communément les Imprimeurs marquent mille ainsi CI?, & cinq cents par I?, qui est la moitié de CI?. Nos Imprimeurs ont trouvé plus commode de prendre tout d'un coup un D qui est le C rapproché de l'I. Mais quelle que puisse être l'origine de cette pratique, qu'importe, dit un auteur, pourvû que votre calcul soit exact & juste ? non multum resert, modo recte & juste numeres. Martinius.
D abréviation. Le D mis seul, quand on parle de seigneurs Espagnols ou de certains religieux, signifie don ou dom.
Le dictionnaire de Trévoux observe que ces deux lettres N. D. signifient Notre-Dame.
On trouve souvent à la tête des inscriptions & des épîtres dédicatoires ces trois lettres D. V. C. elles signifient dicat, vovet, consecrat.
Le D sur nos pieces de monnoie est la marque de la ville de Lyon. (F)
D, (Antiquaire.) Hist. anc. Dans les inscriptions & les médailles antiques signifie divus ; joint à la lettre M, comme DM, il exprime diis manibus, mais seulement dans les épitaphes romaines : en d'autres occasions, c'est deo magno ou diis magnis ; & joint à N, il signifie dominus noster, nom que les Romains donnerent à leurs empereurs, & sur-tout aux derniers.
Cette lettre a encore beaucoup d'autres sens dans les inscriptions latines. Alde Manuce en rapporte une cinquantaine, quand elle est seule, autant quand elle doublée, & plus de trente quand elle est triplée sans parler de beaucoup d'autres qu'elle reçoit, lorsque dans les anciens monumens elle est accompagnée de quelques autres lettres. Voyez l'ouvrage de ce savant littérateur italien ; ouvrage nécessaire à ceux qui veulent étudier avec fruit l'Histoire & les Antiquités. Son titre est, de veterum notarum explanatione quæ in antiquis monumentis occurrunt, Aldi Manutii Pauli F. commentarius : in-8° Venetiis, 1566 ; il est ordinairement accompagné du traité du même auteur, orthographiæ ratio in-8°. Venetiis, 1566. (a)
D, (Musique.) D-la-ré, D-sol-ré, ou simplement D. Caractere ou terme de Musique qui indique la note que nous appellons ré. Voyez Gamme. (S)
D, (Comm.) cette lettre est employée dans les journaux ou registres des marchands banquiers & teneurs de livres, pour abréger certains termes qu'il faudroit répéter trop souvent. Ainsi d° se met pour dito ou dit ; den. pour denier ou gros. Souvent on ne met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tournois & dit. Dal. ou Dre pour daldre, duc. ou Dd pour ducat. V. Abréviation. Dict. du Com. & Chamb. (G)
Wiktionnaire
Nom commun - français
d \de\ masculin
-
(Jeux) Dé, en particulier dans le domaine du jeu de rôle.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Trésor de la Langue Française informatisé
D, d, lettre
D, d, lettre
D au Scrabble
Le mot d vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot d - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot d au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
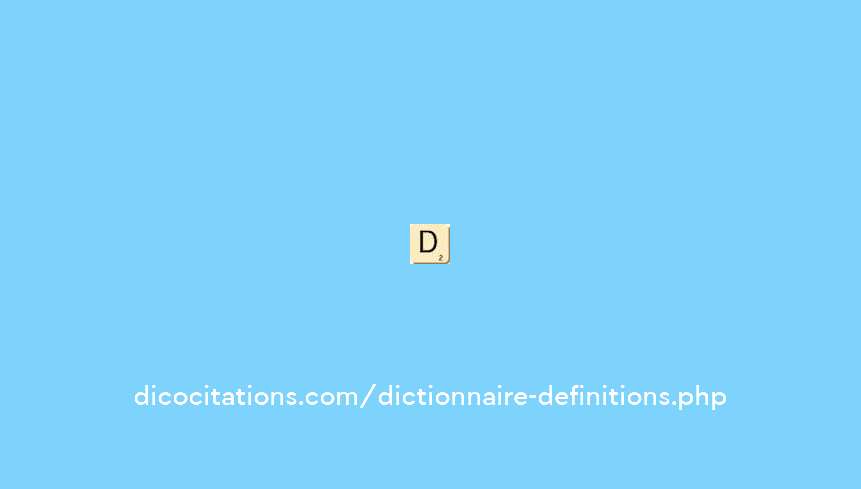
Les mots proches de D
D Da Dactyle Dactyliographie Dactylologie Dada Dadais Dague Daguer Daguet Dahlia Daï-co Daigner Dail Daille Daim Daïmiat Daintiers Daïri ou daïro Dais Dallage Dalle Dalleur Dalmatique Dam Damas Damasquin Damasquiné, ée Damasquiner Dame Dame Dame-jeanne Damer Dameret Damiéniste Damier Damnable Damnablement Damnation Damné, ée Damnement Damner Damoclès Damoiseau Damoiselle Dandin Dandinant, ante Dandiner Dandy Danger d d d d' d' d'abord d'autres d'autres d'emblée d'emblée D'Huison-Longueville D'Huison-Longueville d'ores et déjà D?uil-sur-le-Mignon da da dab daba dabe Dabo dabs dabuche dabuches dace daces daces dache Dachstein dacique dacron dactyle dactyles dactylo dactylographe dactylographes dactylographie dactylographié dactylographié dactylographiée dactylographiée dactylographiées dactylographiées dactylographier dactylographiés dactyloptères dactylos dactyloscopie dada dadais dadaïsmeMots du jour
-
évaluer réembarque constituez merde orientez parité ensommeillée triomphions conduction bicentenaire
Les citations avec le mot D
- Pendant près de trois quarts d'heure, on est tous restés là, à feinter. C'est Larpin, un des poulets, qui a téléphoné le premier, sans quitter la salle des yeux.Auteur : Albert Simonin - Source : Touchez pas au grisbi (1953)
- Il y a une chose plus triste à perdre que la vie, c'est la raison de vivre, - Plus triste que de perdre ses biens, c'est de perdre son espérance, - Plus amère que d'être déçu, et c'est d'être exaucé.Auteur : Paul Claudel - Source : L'Otage (1914)
- Les cons ont un souci d'universalité, ils ne connaissent pas les frontières...Auteur : Hugo Buan - Source : L'oeil du singe
- Les femmes sont séduites par les hommes effroyables, parce que les hommes effroyables se présentent masqués comme au bal. Ils arrivent avec des mandolines et des costumes de fête.Auteur : Yasmina Reza - Source : Heureux les heureux (2013)
- Il ne faut pas oublier que nos sens sont fortement sollicités pendant cette période, avec les vitrines des magasins, les décorations dans les rues, la publicité… Notre subconscient est bombardé de stimuli. Pour une personne qui n'aiment pas Noël parce qu'elle sait qu'elle sera seule, qu'elle a vécu une séparation ou un deuil ou qu'elle est sans ressources, ces stimuli sont une source permanente de conflit entre l'injonction sociétale d'être gai et sa situation réelle. Et puis, Noël ramène à la surface toutes les joies mais aussi toutes les ombres de l'enfance.Auteur : Bernard Minier - Source : N'éteins pas la lumière (2014)
- Peu de maximes sont vraies à tous égards.Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- Le premier de tous les empires est celui qu'on a sur ses désirs.Auteur : Jacques Bénigne Bossuet - Source : Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte (1709), IV, 2
- Le mauvais âge. L'âge où les enfants deviennent soi-disant des adultes. L'âge où ils sont en vérité le plus vulnérables, s'embarquant dans n'importe quel voyage.Auteur : Jean-Christophe Grangé - Source : Miserere (2008)
- Et avoient l'authorité souveraine de commander alternativement l'un après l'autre, Aratus et luy.Auteur : Jacques Amyot - Source : Aratus, 38
- Dès qu'un homme se met à me parler «femmes», au pluriel, sur un ton de complicité masculine entre connaisseurs de viande sur pied, je ressens à son égard une montée de haine presque raciste.Auteur : Romain Gary - Source : Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable (1975)
- Celuy qui a esté attainct au vif et deschiré d'une remonstrance, si on le laisse ainsi tout brusque, enflé et esmeu de cholere, il est puis après difficile à remettre.Auteur : Jacques Amyot - Source : Comment discerner le flatteur de l'ami, 63
- La chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier.Auteur : Vladimir Poutine - Source : Avril 2005, discours à la nation
- L'observateur des hommes et de la vie qui n'aboutit pas au comique est un observateur bien incomplet.Auteur : Paul Léautaud - Source : Le théâtre de Maurice Boissard (1926)
- La beauté est la conjugaison du hasard et du malheur.Auteur : Umar Timol - Source : Les Affreurismes (2005)
- Le loufiat qui m'a servi et m'a tout l'air d'appartenir à la jaquette flottante s'extasie devant une photo de magazine représentant le plus bel athlète in the world.Auteur : Frédéric Dard - Source : San-Antonio, Au suivant de ces messieurs (1957)
- L'herbe givrée mouillait ses souliers; il entendait sous ses pas clapoter la vase.Auteur : François Mauriac - Source : Le Mal (1955)
- J'ai tout un nettoyage et un réglage à faire du côté du carburateur. Je regarderai les bougies. L'allumage aussi est à régler.Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Les Hommes de bonne volonté (1932-1946)
- Prendre l'ordre à mourir d'une main ennemie, - C'est mourir, pour un roi, beaucoup plus d'une fois.Auteur : Pierre Corneille - Source : Médée (1635)
- N'essayez jamais d'être ce que vous n'êtes pas.Auteur : Serge Bonnet - Source : Les Ermites (1980)
- Toujours l'oreille est le chemin du coeur.Auteur : Voltaire - Source : La Pucelle d'Orléans (1762), Chant XXI
- Une vertu n'est qu'un vice qui s'élève au lieu de s'abaisser; et une qualité n'est qu'un défaut qui sait se rendre utile.Auteur : Maurice Maeterlinck - Source : Le Double Jardin
- L'Histoire dit les événements, la sociologie décrit les processus, la statistique fournit les chiffres, mais c'est la littérature qui les fait toucher du doigt, là où ils prennent corps et sang dans l'existence des hommes.Auteur : Claudio Magris - Source : Utopie et désenchantement
- Choisir sa vie, c'est décider à l'avance et volontairement ce qui vous empêchera de dormir.Auteur : Gilbert Cesbron - Source : Libérez Barabbas (1957)
- Dans les rues de Winchester, les collégiens sortent en veste rouge, coiffés d'un chapeau de paille, genre canotier.Auteur : Julien Green - Source : Journal, 22 mai 1976
- Je ne sentais ni le froid ni l'hiver ni le chaud de l'été. J'avais mes saisons à moi, mon noir soleil, mes fruits empoisonnés, mûrissant à des treilles secrètes.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Electre ou la Chute des masques (1954), I, 4, Electre
Les citations du Littré sur D
- Quand on considère de plus près l'histoire de ce grand royaume [l'Angleterre]Auteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Encore aujourd'hui, dans tous les prônes qu'ils [les prédécesseurs de Bossuet] ont dressés, on met au rang des excommuniés ceux qui s'absentent de la messe paroissiale durant trois dimanches consécutifs, sans excuse légitimeAuteur : BOSSUET - Source : Ordonn. synodale, 1691
- Des intérêts étrangers et ruineux pour leur patrie élèveront-ils leur âme avilie et corrompue ?Auteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. V, 34
- Poursuivie par les ennemis implacables qui avaient eu l'audace de lui faire son procèsAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Angl.
- Il faisoit couvrir des hommes de peau d'ours et de sangliers, et puis lascher des levriers d'attache sur eulx, qui les deschiroient en piecesAuteur : AMYOT - Source : Pélop. 53
- Non, Muret, non, ce n'est pas du jour d'huy Que l'archerot qui cause nostre ennuy Cause l'erreur qui retrompe les hommesAuteur : RONS. - Source : 118
- Il lui échappa même [au premier président] que d'Antin avait bien recordé le roi, il brossa à travers la compagnie et disparutAuteur : SAINT-SIMON - Source : 377, 97
- Et cependant ilz ne vouloient bouger de leurs maisons à se baigner, estuver, banquetter et faire grand chereAuteur : AMYOT - Source : Pyrrh. 33
- Enfin l'impression fut reprise et marcha rondementAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Confess. XI
- S'il n'eût laissé des marques et vestiges de son humanité dans cette démonomanieAuteur : G. NAUDÉ - Source : Apologie, p. 127
- Chercher tant d'éclaircissements et aller à tant de conseilsAuteur : BOURD. - Source : Carême, II, Parf. observat. de la loi, 204
- Si la seigneurie est une principauté, le seigneur sous-concède des fiefs à des gentilshommes...Auteur : BÉCHARD - Source : Journ. offic. 29 sept. 1877, p. 6554, 3e col.
- Je presse le loquet d'un doigt lourd et rapideAuteur : LAMART. - Source : Jocel. Prol. 28
- L'avocat lui respondit, que à desjeuner il trouveroit assez, mais qu'il eust un desfrayeurAuteur : MARG. - Source : Nouv LII
- Newton prouva que le mouvement de rotation de la terre a dû l'aplatir à ses pôlesAuteur : LAPLACE - Source : Exp. V, 5
- Et passames de là à tout vint chevaliers, dont il estoit li disiesme et je disiesmeAuteur : JOINV. - Source : 208
- Favas emporta la Reole par le chasteau avec des eschelles de plus de soixante pieds de haut faites de plusieurs pieces, les emboitures n'aians jamais esté pratiquées auparavant son inventionAuteur : D'AUB. - Source : Hist. III, 25
- Salomon pour hosties pacifiques égorgea et immola au Seigneur vingt-deux mille boeufs, et vingt mille brebisAuteur : SACI - Source : ib. Rois, III, VIII, 63
- Les Grecs prenaient d'autres libertés qui nous sont rigoureusement interdites ; par exemple, de répéter souvent dans la même page des épithètes, des moitiés de vers, des vers même tout entiersAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Langues.
- L'en se dort le soir là où l'en ne scet se l'en se trouvera ou fons de la merAuteur : JOINV. - Source : 210
- Je ne suis pas en belle humeur : les affaires de Flandres prennent un mauvais tourAuteur : MAINTENON - Source : Lett. au duc de Noailles, 15 août 1711
- On va achever et consommer la démonstrationAuteur : Blaise Pascal - Source : Géom.
- Vous ne voudrez jamais, abusant de mon âge...Auteur : Voltaire - Source : Brut. II, 4
- C'est là tout le corps de la chrestienté ; le demourant sont isles, comme Angletterre, Escosse, Dannemarc et Suede, qui sont comme peninsulesAuteur : LANOUE - Source : 389
- Jupiter même, à la prière de Minerve, avait ordonné à Mercure.... de....Auteur : FÉN. - Source : Tél. XVIII
Les mots débutant par D Les mots débutant par D
Une suggestion ou précision pour la définition de D ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 16h33
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur d
Poèmes d
Proverbes d
La définition du mot D est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot D sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification D présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
