Définition de « hiatus »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot hiatus de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur hiatus pour aider à enrichir la compréhension du mot Hiatus et répondre à la question quelle est la définition de hiatus ?
Une définition simple : hiatus (m)
Définitions de « hiatus »
Trésor de la Langue Française informatisé
HIATUS, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
hiatus (h aspiré) ou (h muet)\ja.tys\ masculin invariable
-
(Linguistique) Succession immédiate de deux voyelles qui appartiennent à des syllabes différentes du même mot (héroïque), ou à la frontière de deux mots (Nous sommes à Avignon).
- Il faut continuer, il est vrai, par : « J'ai z'un coquin de frère? », ou risquer un hiatus terrible ; mais pourquoi aussi la langue a-t-elle repoussé ce z si commode, si liant, si séduisant [?] ? ? (Gérard de Nerval, « Les Filles du feu », in Chansons et légendes du Valois, 1854)
- Il faut bien se garder de confondre diphtongue et voyelles en hiatus. Deux phonèmes vocaliques peuvent se suivre dans un mot sans former pour autant une diphtongue si, n'appartenant pas à la même syllabe, ils n'ont aucune chance d'entrer dans la même tenue. ? (Gaston Zink, Phonétique historique du français, Presses universitaires de France)
- L'hiatus d'un mot à un autre a été interdit dans notre poésie par Malherbe.
- En français, l'hiatus n'effraye qu'en vers, encore est-il constant dans le corps même des mots. Quoi qu'il en soit, en prose il ne nous fait pas peur. ? (Louis de Beaufront, Commentaire sur la grammaire de la Langue Internationale « Esperanto », 1900)
- Les livrets de Scribe, comme celui de La Juive, sont souvent d'une paresse honteuse ; je me demande comment les chanteurs ont accepté d'avoir des hiatus aussi grossiers à prononcer. ? (Charles Dantzig, Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, Grasset, 2009, page 450)
-
(concret) Ouverture.
-
M. Dufour communique l'observation d'un cas remarquable de triplopie monoculaire, qu'il eut l'occasion d'analyser et de traiter dans la clinique du professeur de Græfe.
Un jeune homme reçoit, à l'âge de 12 ans, un coup de poing sur l'?il gauche. À partir de cet instant il voit triple de cet ?il, et cet état persiste sans changement jusqu'au moment de l'observation où le sujet est âgé de 20 ans. Cornée plus grande qu'à l'ordinaire, pupille et cristallin de dimensions normales, mais décentrés en dedans. L'iris est tout strié de fentes de direction radiaire, et l'une de ces fentes, cédant sans doute à l'action traumatique, s'est élargie, forme un hiatus séparé de la pupille par le sphincter, allant jusqu'à l'insertion de l'iris, et laissant passer la lumière au travers du bord du cristallin et au travers de la zonule de Zinn, en dehors de ce bord. ? (« Société vaudoise de médecine : Séance du 4 novembre 1869 », in Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande, troisième année, Librairie Rouge et Dubois, Éditeurs, Lausanne, 1869) - Après une assez longue station sur le seuil, nous entendîmes, à l'intérieur de la maison, des bruits de pas, des grincements de verrou et des tours de clef de bon augure ; un battant s'entre-bâilla avec précaution : dans l'hiatus se modelait une bonne vieille petite tête ridée et grisonnante, sculptée en casse-noisette de Nuremberg, et dont la lueur d'une lampe tenue haut faisait ressortir par de vives lumières et de fortes ombres la laideur fantastiquement bizarre. ? (Théophile Gautier, Ce qu'on peut voir en six jours, 1858, réédition Nicolas Chadun, pages 128-129)
-
M. Dufour communique l'observation d'un cas remarquable de triplopie monoculaire, qu'il eut l'occasion d'analyser et de traiter dans la clinique du professeur de Græfe.
-
(abstrait) Écart, manque de continuité entre deux notions, principes, idées...
- Entre l'intention qui nous anime et celle que nos gestes laissent supposer, il y a toujours un hiatus que rien ne peut combler. ? (Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, éd. PUF, 2003 (ISBN 2-13-053793-6), p. 60)
- Le hiatus est de plus en plus grand entre les concepts concluant que le monde va mal et les réalisations pratiques pour qu'il aille mieux. ? (Olivier Le Naire , Pierre Rabhi semeur d'espoir, éd. Actes Sud, 2013 (ISBN 978-2-330-02357-7), p. 60)
- Elles constituent une évolution, pas une révolution, un hiatus entre objectifs et outils. ? (René Souchon, cité dans Réforme de la PAC : l'enjeu d'une régionalisation, Localtis.info)
- Hiatus entre la théorie et les faits. ? (Le petit Larousse)
- D'où j'étais assis, je ne détectais pas de hiatus dans le récit d'Asa. ? (Glen Cook, Le Château noir, 1984)
-
(Spécialement) Espace de temps séparant deux événements.
- L'auteur de Pourquoi Boulogne fait son grand retour sur la scène littéraire, après un hiatus qui aura duré près de huit ans. ? (Impact Campus, Université Laval, vol. 6 n° 3, décembre 2021, p. 66)
- Couvrant la période 1271-1306, les cinq livres des Mémoires de Nijô forment deux série de tableaux séparées par un hiatus de plusieurs années. ? (Dame Nij?, Splendeurs et misères d'une favorite, traduit par Alain Rocher, édition Picquier, 2004, introduction, page 10)
- Le 27 février sera diffusé sur la [chaîne] Fox le quatorzième épisode de la saison 8 de Dr House, dernier épisode avant un hiatus de quelques semaines et la reprise de la diffusion en avril. ? (Dr House, saison 8, épisode 14 : trois vidéos en VOST, house-fr.com)
- La littérature « musicologique » (au sens large) abonde en ouvrages sur la musique dite « classique », comme sur celle qualifiée de « populaire » ? la « haute musique » et le « prêt-à-l'écoute ». Mais entre les deux, il y a hiatus. ? (Herman Sabbe, La Musique et l'Occident : démocratie et capitalisme (post-)industriel : incidences sur l'investissement esthétique et économique en musique, Éditions Mardaga, Sprimont, 1998, page 5)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Terme emprunté du latin. Ouverture de la bouche produite par la rencontre, par la succession immédiate de deux voyelles sonores. Il désigne particulièrement la Rencontre de deux voyelles dont l'une finit un mot et dont l'autre commence le mot suivant. Les hiatus font souvent un mauvais effet dans la prose. Cet hiatus blesse l'oreille. L'hiatus d'un mot à un autre a été interdit dans notre poésie par Malherbe.
Littré
- 1 Terme de versification grecque et latine. Rencontre de voyelles. Quand deux voyelles se rencontraient dans un vers, l'une à la fin d'un mot, l'autre au commencement du mot suivant, la première ne comptait pas dans la mesure du vers?; c'était la règle chez les Romains, et elle était beaucoup plus étroite que chez les Grecs?; mais, quand les poëtes avaient besoin, pour la mesure du vers, de compter cette dernière syllabe, on disait qu'ils faisaient un hiatus.
-
2Dans la langue française, son produit par la rencontre, sans élision possible, de deux voyelles dont l'une finit un mot, et l'autre commence le mot suivant. Il y a des hiatus choquants, il y en a d'agréables.
Notre poésie même me paraît ridicule sur ce point?; on rejette?: j'ai vu mon père immolé à mes yeux?; et on admet?: j'ai vu ma mère immolée à mes yeux, quoique l'hiatus du second vers soit beaucoup plus ridicule
, D'Alembert, Lett. à Voltaire, 11 mars 1770.Ne devrait-on pas dire que c'est une puérilité, et souvent un défaut contraire à la simplicité et à la naïveté du style, que le soin minutieux d'éviter les hiatus dans la prose comme le pratique l'abbé de la Bletterie??
D'Alembert, ib.Vous serez bien aises de savoir que j'arrivai ici hier (voilà un affreux hiatus dont je vous demande pardon)
, Courier, Lett. I, 305.Demi-hiatus, rencontre de deux voyelles dissimulée par une élision?; par exemple, la joie éclate en ses yeux.
-
3 Fig. Lacune dans un ouvrage.
Endroit d'une pièce de théâtre où la scène reste vide.
Interruption dans une généalogie.
- 4Nom donné par les anatomistes à quelques ouvertures.
REMARQUE
Dans la Comédie des Académiciens, I, 2, Saint-Évremond fait dire à Godeau, à propos de ses vers?: Manqué-je en quelque endroit à garder la césure?? Y peut-on remarquer une seule hiature?? dans l'édition revue par l'auteur?; la première, celle de 1650, donne rature au lieu de hiature.
SYNONYME
HIATUS, BÂILLEMENT. Hiatus signifie, en latin, bâillement. Dumarsais a donc eu raison de dire que ces deux mots étaient synonymes. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui hiatus est plus en usage que bâillement.
Encyclopédie, 1re édition
HIATUS, s. m. (Gramm.) ce mot purement latin a été adopté dans notre langue sans aucun changement, pour signifier l'espece de cacophonie qui résulte de l'ouverture continuée de la bouche, dans l'émission consécutive de plusieurs sons qui ne sont distingués l'un de l'autre par aucune articulation. M. du Marsais paroît avoir regardé comme exactement synonymes les deux mots hiatus & bâillement ; mais je suis persuadé qu'ils sont dans le cas de tous les autres synonymes, & qu'avec l'idée commune de l'émission consécutive de plusieurs sons non articulés, ils désignent des idées accessoires différentes qui caractérisent chacun d'eux en particulier. Je crois donc que bâillement exprime particulierement l'état de la bouche pendant l'émission de ces sons consécutifs, & que le nom hiatus exprime, comme je l'ai déjà dit, la cacophonie qui en résulte : en sorte que l'on peut dire que l'hiatus est l'effet du bâillement. Le bâillement est pénible pour celui qui parle ; l'hiatus est desagréable pour celui qui écoute : la théorie de l'un appartient à l'Anatomie, celle de l'autre est du ressort de la Grammaire. C'est donc de l'hiatus qu'il faut entendre ce que M. du Marsais a écrit sur le bâillement. Voyez Baillement. Qu'il me soit permis d'y ajoûter quelques réflexions.
« Quoique l'élision se pratiquât rigoureusement dans la versification des Latins, dit M. Harduin, secrétaire perpétuel de la société littéraire d'Arras (Remarques diverses sur la prononciation, page 106. à la note.) : & quoique les François qui n'élident ordinairement que l'e féminin, se soient fait pour les autres voyelles une regle équivalente à l'élision latine, en proscrivant dans leur poésie la rencontre d'une voyelle finale avec une voyelle initiale ; je ne sai s'il n'est pas entré un peu de prévention dans l'établissement de ces regles, qui donne lieu à une contradiction assez bisarre. Car l'hiatus, qu'on trouve si choquant entre deux mots, devroit également déplaire à l'oreille dans le milieu d'un mot : il devroit paroître aussi rude de prononcer meo sans élision, que me odit. On ne voit pas néanmoins que les poëtes latins aient rejetté au tant qu'ils le pouvoient les mots où se rencontroient ces hiatus ; leurs vers en sont remplis, & les nôtres n'en sont pas plus exempts. Non-seulement nos poëtes usent librement de ces sortes de mots, quand la mesure ou le sens du vers paroît les y obliger ; mais lors même qu'il s'agit de nommer arbitrairement un personnage de leur invention, ils ne font aucun scrupule de lui créer ou de lui appliquer un nom dans lequel il se trouve un hiatus ; & je ne crois pas qu'on leur ait jamais reproché d'avoir mis en ?uvre les noms de Cléon, Chloé, Arsinoé, Zaïde, Zaïre, Laonice, Léandre, &c. Il semble même que loin d'éviter les hiatus dans le corps d'un mot, les poëtes françois aient cherché à les multiplier, quand ils ont séparé en deux syllabes quantité de voyelles qui font diphtongue dans la conversation. De tuer ils ont fait tu-er, & ont allongé de même la prononciation de ruine, violence, pieux, étudier, passion, diadème, jouer, avouer, &c. On ne juge cependant pas que cela rende les vers moins coulans ; on n'y fait aucune attention ; & on ne s'apperçoit pas non plus que souvent l'élision de l'e féminin n'empêche point la rencontre de deux voyelles, comme quand on dit, année entiere, plaie effroyable, joie extréme, vûe agréable, vûe égarée, bleue & blanche, boue épaisse ».
Ces observations de M. Harduin sont le fruit d'une attention raisonnée & d'une grande sagacité ; mais elles me paroissent susceptibles de quelques remarques.
1°. Il est certain que la loi générale qui condamne l'hiatus comme vicieux entre deux mots, a un autre fondement que la prévention. La continuité du bâillement qu'exige l'hiatus, met l'organe de la parole dans une contrainte réelle, & fatigue les poûmons de celui qui parle, parce qu'il est obligé de fournir de suite & sans interruption une plus grande quantité d'air : au lieu que quand des articulations interrompent la succession des sons, elles procurent nécessairement aux poûmons de petits repos qui facilitent l'opération de cet organe : car la plûpart des articulations ne donnent l'explosion aux sons qu'elles modifient, qu'en interceptant l'air qui en est la matiere. Voyez h. Cette interception doit donc diminuer le travail de l'expiration, puisqu'elle en suspend le cours, & qu'elle doit même occasionner vers les poûmons un reflux d'air proportionné à la force qui en arrête l'émission.
D'autre part, c'est un principe indiqué & confirmé par l'expérience, que l'embarras de celui qui parle affecte desagréablement celui qui écoute : tout le monde l'a éprouvé en entendant parler quelque personne enrouée ou begue, ou un orateur dont la mémoire est chancelante ou infidelle. C'est donc essentiellement & indépendamment de toute prévention que l'hiatus est vicieux ; & il l'est également dans sa cause & dans ses effets.
2°. Si les Latins pratiquoient rigoureusement l'élision d'une voyelle finale devant une voyelle initiale, quoiqu'ils n'agissent pas de même à l'égard de deux voyelles consécutives au milieu d'un mot ; si nous-mêmes, ainsi que bien d'autres peuples, avons en cela imité les Latins, c'est que nous avons tous suivi l'impression de la nature : car il n'y a que ses décisions qui puissent amener les hommes à l'unanimité.
Ne semble-t-il pas en effet que le bâillement doit être moins pénible, & conséquemment l'hiatus moins desagreable au milieu du mot qu'à la fin, parce que les poûmons n'ont pas fait encore une si grande dépense d'air ? D'ailleurs l'effet du bâillement étant de soûtenir la voix, l'oreille doit s'offenser plûtôt de l'entendre se soûtenir quand le mot est fini, que quand il dure encore ; parce qu'il y a analogie entre soûtenir & continuer, & qu'il y a contradiction entre soûtenir & finir.
Il faut pourtant avouer que cette contradiction a paru assez peu offensante aux Grecs, puisque le nombre des voyelles non élidées dans leurs vers est peut-être plus grand que celui des voyelles élidées : c'est une objection qui doit venir tout naturellement à quiconque a lu les poëtes grecs. Mais il faut prendre garde en premier lieu à ne pas juger des Grecs par les Latins, chez qui la lettre h étoit toûjours muette quant à l'élision qu'elle n'empêchoit jamais ; au lieu que l'esprit rude avoit chez les Grecs le même effet que notre h aspirée ; & l'on ne peut pas dire qu'il y ait alors hiatus faute d'élision, comme dans ce vers du premier livre de l'Iliade :
??? ????· ? ?? ??? ??????????? ?? ??? ??????.
Cette premiere observation diminue de beaucoup le nombre apparent des voyelles non élidées. Une seconde que j'y ajoûterai peut encore réduire à moins les témoignages que l'on pourroit alléguer en faveur de l'hiatus : c'est que quand les Grecs n'élidoient pas, les finales, quoique longues de leur nature, & même les diphthongues, devenoient ordinairement breves ; ce qui servoit à diminuer ou à corriger le vice de l'hiatus : & les poëtes latins ont quelquefois imité les Grecs en ce point :
Credimus ? An qui amant ipsi sibi somnia fingunt ?
Implerunt montes ; flerunt Rhodop??? rupes. idem.
Que reste-t-il donc à conclure de ce qui n'est pas encore justifié par ces observations ? que ce sont des licences autorisées par l'usage en faveur de la difficulté, ou suggérées par le goût pour donner au vers une mollesse relative au sens qu'il exprime, ou même échappées au poëte par inadvertance ou par nécessité ; mais que comme licences ce sont encore des témoignages rendus en faveur de la loi qui proscrit l'hiatus.
3°. Quoique les Latins n'élidassent pas au milieu du mot, l'usage de leur langue avoit cependant égard au vice de l'hiatus ; & s'ils ne supprimoient pas tout-à-fait la premiere des deux voyelles, ils en supprimoient du-moins une partie en la faisant breve. C'est-là la véritable cause de cette regle de quantité énoncée par Despautere en un vers latin :
Vocalis brevis antè aliam manet usque Latinis.
& par la Méthode latine de Port-Royal, en deux vers françois :
Il faut abréger la voyelle,
Quand une autre suit après elle.
Ce principe n'est pas propre à la langue latine : inspiré par la nature, & amené nécessairement par le méchanisme de l'organe, il est universel & il influe sur la prononciation dans toutes les langues. Les Grecs y étoient assujettis comme les Latins ; & quoique nous n'ayons pas des regles de quantité aussi fixes & aussi marquées que ces deux peuples, c'en est cependant une que tout le monde peut vérifier, que nous prononçons breve toute voyelle suivie d'une autre voyelle dans le même mot : l?er, n?er, pr?eur, cr?ant.
On trouve néanmoins dans le Traité de la Prosodie françoise par M. l'abbé d'Olivet (page 73 sur la terminaison ée), une regle de quantité contradictoire à celle-ci : c'est « que tous les mots qui finissent par un e muet, immédiatement précédé d'une voyelle, ont leur pénultieme longue comme aim?e, je l?e, jo?e, je lo?e, je n?e, &c. » La langue italienne a une pratique assez semblable ; & en outre toute diphthongue à la fin d'un vers, se divise en deux syllabes dont la pénultieme est longue & la derniere breve. Peut-être n'y a-t-il pas une langue qui ne pût fortifier cette objection par quelques usages particuliers & par des exemples : les mots grecs ??????, ?????, &c. les mots latins di?i, f?unt, &c. en sont des preuves.
Mais qu'on y prenne garde : dans tous les cas que l'on vient de voir, toutes les langues ont pensé à diminuer le vice de l'hiatus ; la premiere des deux voyelles est longue à la vérité, mais la seconde est breve ; ce qui produit à-peu-près le même effet que quand la premiere est breve & la seconde longue. Si quelquefois on s'écarte de cette regle, c'est le moins qu'il est possible ; & c'est pour concilier avec elle une autre loi de l'harmonie encore plus inviolable, qui demande que de deux voyelles consécutives la premiere soit fortifiée, si la seconde est muette ou très-breve, ou que la premiere soit foible, si la seconde est le point où se trouve le soûtien de la voix.
4°. C'est encore au même méchanisme & à l'intention d'éviter ou de diminuer le vice de l'hiatus, qu'il faut rapporter l'origine des diphthongues ; elles ne sont point dans la nature primitive de la parole ; il n'y a de naturel que les sons simples. Mais dans plusieurs occasions, le hasard ou les lois de la formation ayant introduit deux sons consécutifs sans articulation intermédiaire, on a naturellement prononcé bref l'un de ces deux sons, & communément le premier, pour éviter le desagrément d'un hiatus trop marqué, & l'incommodité d'un bâillement trop soûtenu. Lorsque le son prépositif s'est trouvé propre à se prêter à une rapidité assez grande sans être totalement supprimé, les deux sons se sont prononcés d'un seul coup de voix : c'est la diphthongue. C'est pour cela que toute diphthongue réelle est longue, dans quelque langue que ce soit, parce que le son double réunit dans sa durée les deux tems des sons élémentaires dont il est résulté : & que quand les besoins de la versification ont porté les poëtes à décomposer une diphthongue pour en prononcer séparément les deux parties élémentaires (Voyez Diérese), ils ont toûjours fait bref le son prépositif. Si par une licence contraire ils ont voulu se débarrasser d'une syllabe incommode, en n'en faisant qu'une de deux sons consécutifs que l'usage de la langue n'avoit pas réunis en une diphthongue (Voy. Synecphonèse & Synérèse), cette syllabe factice a toûjours été longue, comme les diphthongues usuelles.
5°. Quoiqu'il soit vrai en général que l'hiatus est un vice réel dans la parole, sur-tout entre deux mots qui se suivent ; loin cependant d'y déplaire toûjours, il y produit quelquefois un bon effet, comme il arrive aux dissonnances de plaire dans la Musique, & aux ombres dans un tableau, lorsqu'elles y sont placées avec intelligence. Par exemple, lorsque Racine (Athalie, act. I. sc. j.) met dans la bouche du grand-prêtre Joad ce discours si majestueux & si digne de sa matiere :
Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait aussi des méchans arrêter les complots.
est-il bien certain que l'hiatus qui est à l'hémistiche du premier vers, y soit une faute ? M. l'abbé d'Olivet (Prosod. franç. page 47.) se contente de l'excuser par la raison du repos qui interrompt la continuité des deux sons & le bâillement : mais je serois fort tenté de croire que cet hiatus est ici une véritable beauté ; il y fait image, en mettant, pour ainsi dire, un frein à la rapidité de la prononciation, comme le Tout-puissant met un frein à la fureur des flots. Je ne prétends pas dire que le poëte ait eu explicitement cette intention : mais il est certain que le fondement des beautés qu'on admire avec enthousiasme dans le procumbit humi bos, n'a pas plus de solidité ; peut-être même en a-t-il moins.
6°. Quoique je n'aye pas expliqué toutes les inconséquences apparentes de la loi qui condamne l'hiatus & qui en laisse pourtant subsister un grand nombre dans toutes les langues, j'ai cru néanmoins pouvoir joindre mes remarques à celles de M. Harduin : peut-être que la combinaison des unes avec les autres pourra servir quelque jour à les concilier & à faire disparoître les prétendues contradictions du système de prononciation dont il s'agit ici. En général, on doit se défier beaucoup des exceptions à une loi qui paroît universelle & fondée en nature : souvent on ne la croit violée, que parce que l'on n'en connoît pas les motifs, les causes, les relations, les degrés de subordination à d'autres lois plus générales ou plus essentielles. Eh, sans sortir des matieres grammaticales, combien de regles contradictoires & d'exceptions aujourd'hui ridicules, qui remplissent les anciens livres élémentaires & plusieurs des modernes, & qu'une analyse exacte & approfondie ramene sans embarras à un petit nombre de principes également solides, lumineux & féconds ! (B. E. R. M.)
Étymologie de « hiatus »
- Du latin hi?tus.
Lat. hiatus, de hiare, être béant, parce que la bouche s'ouvre dans l'hiatus.
hiatus au Scrabble
Le mot hiatus vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot hiatus - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot hiatus au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
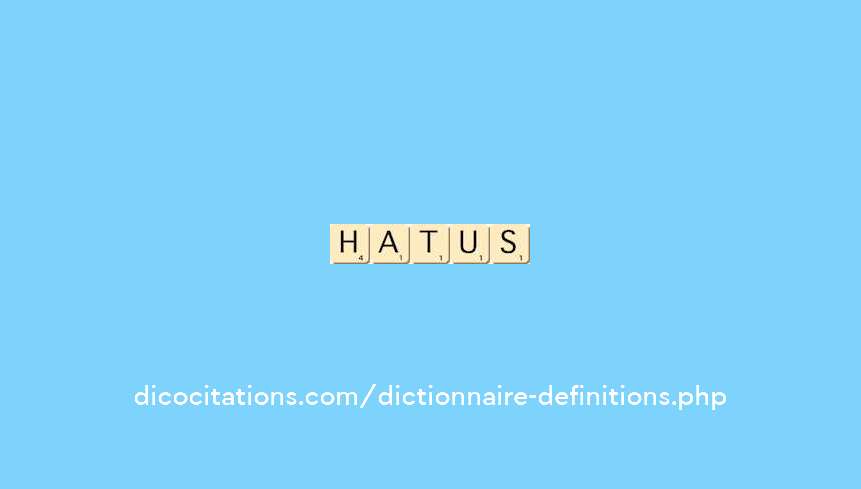
Les rimes de « hiatus »
On recherche une rime en YS .
Les rimes de hiatus peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ys
Rimes de eusse Rimes de olibrius Rimes de puces Rimes de famulus Rimes de infarctus Rimes de nucléus Rimes de fusse Rimes de dabuches Rimes de processus Rimes de bûches Rimes de germano-russe Rimes de urus Rimes de naevus Rimes de cunnilingus Rimes de plus Rimes de crésus Rimes de stradivarius Rimes de crataegus Rimes de embûches Rimes de trucmuche Rimes de épluches Rimes de consensus Rimes de solidus Rimes de quitus Rimes de collapsus Rimes de mucus Rimes de plexus Rimes de cruches Rimes de mortibus Rimes de dabuche Rimes de eusses Rimes de susse Rimes de peluche Rimes de gamahuche Rimes de hibiscus Rimes de trismus Rimes de dusse Rimes de foetus Rimes de iléus Rimes de crocus Rimes de microbus Rimes de crusse Rimes de cactus Rimes de fusse Rimes de diplodocus Rimes de bus Rimes de oculus Rimes de paluches Rimes de laïus Rimes de campusMots du jour
eusse olibrius puces famulus infarctus nucléus fusse dabuches processus bûches germano-russe urus naevus cunnilingus plus crésus stradivarius crataegus embûches trucmuche épluches consensus solidus quitus collapsus mucus plexus cruches mortibus dabuche eusses susse peluche gamahuche hibiscus trismus dusse foetus iléus crocus microbus crusse cactus fusse diplodocus bus oculus paluches laïus campus
Les citations sur « hiatus »
- Le dimanche n'est pas un jour normal, physiologique, c'est un hiatus, une solution de continuité dans la trame des jours suivants.Auteur : Georges Duhamel - Source : Chronique des Pasquier (1933-1945)
- Avec un peu d'oreille de la part de l'écrivain, les hiatus ne seront ni fréquents ni choquants dans sa prose.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Mélanges littéraires
- Hiatus: Ne pas le tolérer.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Ne devrait-on pas dire que c'est une puérilité, et souvent un défaut contraire à la simplicité et à la naïveté du style, que le soin minutieux d'éviter les hiatus dans la prose comme le pratique l'abbé de la Bletterie?Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 11 mars 1770
- Notre poésie même me paraît ridicule sur ce point; on rejette: j'ai vu mon père immolé à mes yeux; et on admet: j'ai vu ma mère immolée à mes yeux, quoique l'hiatus du second vers soit beaucoup plus ridicule.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 11 mars 1770
Les mots proches de « hiatus »
HiatusLes mots débutant par hia Les mots débutant par hi
hiatale hiatus
Les synonymes de « hiatus»
Les synonymes de hiatus :- 1. cacophonie
2. espace
3. interruption
4. arrêt
5. coupure
6. discontinuité
7. cessation
8. pause
9. suspension
10. halte
11. entracte
12. rupture
13. relâche
14. vacance
15. chômage
16. interstice
17. intervalle
18. fente
19. méat
20. jour
synonymes de hiatus
Fréquence et usage du mot hiatus dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « hiatus » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot hiatus dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Hiatus ?
Citations hiatus Citation sur hiatus Poèmes hiatus Proverbes hiatus Rime avec hiatus Définition de hiatus
Définition de hiatus présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot hiatus sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot hiatus notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
