La définition de Lyrique du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Lyrique
Nature : adj.
Prononciation : li-ri-k'
Etymologie : Lat. lyricus, de lyra, lyre.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de lyrique de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec lyrique pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Lyrique ?
La définition de Lyrique
Chez les anciens, poésie lyrique, poésie qui se chantait sur la lyre. Les vers lyriques étaient ceux qu'on chantait ou qu'on était supposé chanter ; ceux, par exemple, des odes et des dithyrambes.
Toutes les définitions de « lyrique »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui se chante sur la lyre. Il s'applique aux poésies destinées à être mises en musique et chantées. Il se dit également d'un Genre de poésie qui a gardé, en souvenir de sa destination primitive, un caractère particulier marqué par l'abondance des images, le mouvement du style et la variété du rythme. Poésie lyrique. Poème lyrique. Genre lyrique. Vers lyriques. Il se dit, par analogie, des Ouvrages en vers qui sont faits pour être chantés ou propres à être mis en musique, tels que les cantates, les chansons, les opéras. Tragédie, drame, comédie lyrique. Un chef-d'œuvre lyrique. Il se dit, par extension, des Odes, quoiqu'on ne les chante pas. Ronsard dans ses premières Odes a imité la poésie lyrique grecque. Poète, auteur lyrique, Celui qui compose des odes ou des poésies propres à être mises en musique. Théâtre lyrique, Théâtre sur lequel on représente des ouvrages mis en musique. Artiste lyrique, Celui ou celle qui chante de tels ouvrages.
LYRIQUE s'emploie aussi comme nom masculin et signifie Auteur lyrique. Les lyriques grecs. Les lyriques français.
Littré
-
1Chez les anciens, poésie lyrique, poésie qui se chantait sur la lyre. Les vers lyriques étaient ceux qu'on chantait ou qu'on était supposé chanter?; ceux, par exemple, des odes et des dithyrambes.
Les Grecs eux-mêmes ont reconnu que la plus ancienne et la meilleure espèce de poésie était la lyrique, c'est-à-dire les hymnes et les odes, pour louer la divinité
, Fleury, M?urs des Israél. titre XV, 2e part. p. 189, dans POUGENS.Poëtes lyriques, et, substantivement, les lyriques, ceux qui composaient dans ce genre de poésie. Pindare, Horace sont des lyriques.
-
2Aujourd'hui, il se dit des vers qui entrent dans les odes et les dithyrambes. Les poëmes lyriques de Malherbe, de Rousseau.
Appliqué aux pièces de théâtre, lyrique signifie propre à être chanté, à être mis en musique. Tragédie lyrique, opéra sérieux?; comédie lyrique, opéra du genre gai.
Célèbre par ses belles poésies lyriques et par la douceur qu'il [Quinault] opposa aux satires très injustes de Boileau
, Voltaire, Louis XIV, Écriv.Théâtre lyrique, théâtre sur lequel on représente des ouvrages mis en musique. Les théâtres lyriques sont à Paris les Italiens, l'Opéra, l'Opéra-Comique et le Théâtre lyrique.
-
3 Particulièrement. Lyrique se dit de pièces disposées par stances qui, sans être destinées à être chantées, ont un mouvement et un transport plus vif que le reste de la poésie.
Qui appartient à la poésie lyrique de ce genre.
Il faut que des hauteurs du sublime Hélicon Le premier trait que lance un poëte lyrique, Soit une flèche d'Apollon
, E. Lebrun, le Vengeur.Montés au même char, comme un couple homérique, Nous tiendrons, pour lutter dans l'arène lyrique, Toi la lance, moi les coursiers
, Hugo, Odes, à Lamartine.Par ironie.
Dans mon lyrique essor je marche à pas comptés
, Chénier M. J. les Nouveaux saints. -
4 S. m. Un lyrique, poëte lyrique, celui qui s'est illustré par des odes, des dithyrambes et autres poésies lyriques. Malherbe, Lamartine, V. Hugo sont nos premiers lyriques.
Le lyrique, le genre, le talent lyrique.
Racine me paraît incomparable dans le lyrique?: une diction précise et serrée?; de la douceur, mais avec de l'énergie?; des figures variées?; de riches et nobles images?; une mesure libre qui pourtant ne marche pas au hasard
, D'Olivet, Rem. Racine, § 62.
HISTORIQUE
XVIe s. Les vieux lyriques si heureusement ressuscitez
, Ronsard, Épître au lecteur, Odes.
Encyclopédie, 1re édition
LYRIQUE, (Littér.) chose que l'on chantoit ou qu'on jouoit sur la lyre, la cithare ou la harpe des anciens.
Lyrique se dit plus particulierement des anciennes odes ou stances qui répondent à nos airs ou chansons. C'est pour cela qu'on a appellé les odes poésies lyriques, parce que quand on les chantoit, la lyre accompagnoit la voix. Voyez Ode.
Les anciens étoient grands admirateurs des vers lyriques, & ils donnoient ce nom, selon M. Barnés, à tous les vers qu'on pouvoit chanter sur la lyre. Voyez Vers.
On emploia d'abord la poësie lyrique à célébrer les louanges des dieux & des héros. Musa dedit fidibus divos puerosque deorum, dit Horace ; mais ensuite on l'introduisit pour chanter les plaisirs de la table, & ceux de l'amour : & juvenum curas & libra vina referre, dit encore le même auteur.
Ce seroit une erreur de croire avec les Grecs qu'Anacréon en ait été le premier auteur, puisqu'il paroît par l'écriture que plus de mille ans avant ce poëte, les Hébreux étoient en possession de chanter des cantiques au son des harpes, de cymbales & d'autres instrumens. Quelques auteurs ont voulu exclure de la poésie lyrique les sujets héroïques, M. Barnés a montré contre eux que le genre lyrique est susceptible de toute l'élévation & la sublimité que ces sujets exigent. Ce qu'il confirme par des exemples d'Alcée, de Stésichore & d'Horace, & enfin par un essai de sa façon qu'il a mis à la tête de son ouvrage sous le titre d'Ode triomphale au duc de Marlboroug. Il finit par l'histoire de la poésie lyrique, & par celle des anciens auteurs qui y ont excellé.
Le caractere de la poésie lyrique est la noblesse & la douceur ; la noblesse, pour les sujets héroïques ; la douceur, pour les sujets badins ou galans ; car elle embrasse ces deux genres, comme on peut voir au mot Ode.
Si la majesté doit dominer dans les vers héroïques ; la simplicité, dans les pastorales ; la tendresse, dans l'élégie ; le gracieux & le piquant, dans la satyre ; la plaisanterie, dans le comique ; le pathétique, dans la tragédie ; la pointe, dans l'épigramme : dans le lyrique, le poëte doit principalement s'appliquer à étonner l'esprit par le sublime des choses ou par celui des sentimens, ou à le flatter par la douceur & la variété des images, par l'harmonie des vers, par des descriptions & d'autres figures fleuries, ou vives & véhémentes, selon l'exigence des sujets. Voyez Ode.
La poésie lyrique a de tout tems été faite pour être chantée, & telle est celle de nos opéras, mais superieurement à toute autre, celle de Quinault, qui semble avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui l'ont précédé ou suivi. Par conséquent la poésie lyrique & la musique doivent avoir entre elles un rapport intime, & fondé dans les choses mêmes qu'elles ont l'une & l'autre à exprimer. Si cela est, la musique étant une expression des sentimens du c?ur par les sons inarticulés, la poésie musicale ou lyrique est l'expression des sentimens par les sons articulés, ou ce qui est la même chose par les mots.
M. de la Mothe a donné un discours sur l'ode, ou la poésie lyrique, ou parmi plusieurs réflexions ingénieuses, il y a peu de principes vrais sur la chaleur ou l'enthousiasme qui doit être comme l'ame de la poésie lyrique. Voyez Enthousiasme & Ode.
Wiktionnaire
Nom commun - français
lyrique \li.?ik\ masculin
-
Auteur lyrique.
- C'est là, c'est dans l'île de Lesbos que les premiers lyriques ont chanté leurs premiers vers dans une langue européenne. ? (Pierre Louÿs, Lesbos aujourd'hui, 1901, dans Archipel, 1932)
Adjectif - français
lyrique \li.?ik\ masculin et féminin identiques
- Qui se chante sur la lyre. ? Note : Il s'applique aux poésies destinées à être mises en musique et chantées.
- Qualifie un genre de poésie qui a gardé, en souvenir de sa destination primitive, un caractère particulier marqué par l'abondance des images, le mouvement du style et la variété du rythme.
- Poème lyrique.
- Genre lyrique.
-
(Par analogie) Qualifie les ouvrages en vers qui sont faits pour être chantés ou propres à être mis en musique, tels que les cantates, les chansons, les opéras.
- [?]; flétrissez aussi le charlatanisme de ces pseudo-virtuoses qui ont obtenu des succès apocryphes à New-York ou en Californie, et qui, [?], viennent défigurer sur nos grandes scènes lyriques des partitions dont elles ridiculisent la majesté par les exagérations de leur style exotique. ? (Stéphen de La Madelaine, Études pratiques de style vocal, tome 1, 1868, page 18)
-
(Figuré) (Par analogie) D'un style faisant poétique, enjôleur.
- J'ai alors eu un élan un peu lyrique : il faut résister. ? (Antoine Robitaille, « Des remparts contre la peur », dans Le journal de Montréal, 3 novembre 2020)
- L'entrée de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) apparaît comme un legs potentiel pour la postérité. Le 9 mars 2000, il se fait lyrique lors d'un discours prononcé à l'université Johns-Hopkins de Baltimore (Maryland). ? (Marie Charrel et Gilles Paris, Quand l'Occident croyait à la convergence de la Chine, Le Monde. Mis en ligne le 10 décembre 2021)
Trésor de la Langue Française informatisé
LYRIQUE, adj. et subst.
Lyrique au Scrabble
Le mot lyrique vaut 23 points au Scrabble.
Informations sur le mot lyrique - 7 lettres, 3 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot lyrique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
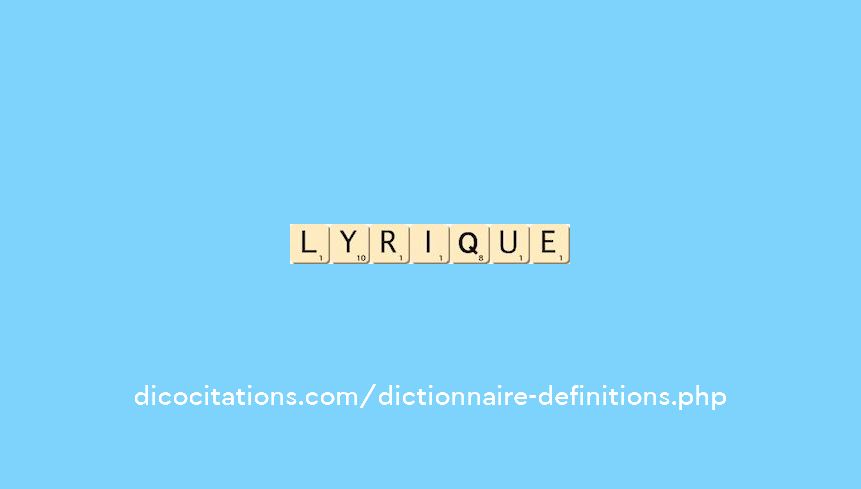
Les mots proches de Lyrique
Lyre Lyré, ée Lyricomique Lyrique lyre lyres lyrique lyriques lyriser lyrismeMots du jour
Fixé, ée Relégation Universellement Hamathéen, enne Atterrissement Hivernal, ale Signifiance Courrière Subversion Tadorne
Les citations avec le mot Lyrique
- Dans une grande ville, pour peu qu'on regarde aux fenêtres, on se sent entraîné vers la poésie épique; dans un village, au contraire, on ne composera que des idylles ou des poésies lyriques.Auteur : Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul - Source : Pensées extraites de tous les ouvrages de Johann Paul Friedrich Richter dit Jean-Paul
- Tout poète lyrique, en vertu de sa nature, opère fatalement un retour vers l'Eden perdu. Tout, hommes, paysages, palais, dans le monde lyrique, est pour ainsi dire apothéose.Auteur : Charles Baudelaire - Source : L'Art romantique (1852), XXII, 7
- Quand dans mes films la charge lyrique de l'inspiration, qui est toujours un acte d'amour, me permet de faire se dessiner un sourire sur un visage en pleurs, de tendre la main à celui qui est sur le point de glisser dans la perdition, de montrer son chemin à celui qui s'est égaré, d'offrir un idéal à celui qui n'a rêvé que de phantasmes, quand j'arrive à dépouiller de leurs mensonges les aventures de la vie, alors j'ai l'impression de n'avoir trahi personne, de m'être fait du bien à moi, avant même d'en avoir fait aux autres.Auteur : Federico Fellini - Source : Fellini, Propos, Ed. Buchet/Chastel, 1980
- Mais il suffit d'aimer à la folie et d'entendre gargouiller ses intestins pour que l'unité de l'âme et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt.Auteur : Milan Kundera - Source : L'insoutenable légèreté de l'être (1984)
- Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme…
En variant le ton, – par exemple, tenez :
Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez,
Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! »
Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »
Descriptif : « C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap !
Que dis-je, c’est un cap ? … C’est une péninsule ! »
Curieux : « De quoi sert cette oblongue capsule ?
D’écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? »
Gracieux : « Aimez-vous à ce point les oiseaux
Que paternellement vous vous préoccupâtes
De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? »
Truculent : « Ça, monsieur, lorsque vous pétunez,
La vapeur du tabac vous sort-elle du nez
Sans qu’un voisin ne crie au feu de cheminée ? »
Prévenant : « Gardez-vous, votre tête entraînée
Par ce poids, de tomber en avant sur le sol ! »
Tendre : « Faites-lui faire un petit parasol
De peur que sa couleur au soleil ne se fane ! »
Pédant : « L’animal seul, monsieur, qu’Aristophane
Appelle Hippocampéléphantocamélos
Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d’os ! »
Cavalier : « Quoi, l’ami, ce croc est à la mode ?
Pour pendre son chapeau, c’est vraiment très commode ! »
Emphatique : « Aucun vent ne peut, nez magistral,
T’enrhumer tout entier, excepté le mistral ! »
Dramatique : « C’est la Mer Rouge quand il saigne ! »
Admiratif : « Pour un parfumeur, quelle enseigne ! »
Lyrique : « Est-ce une conque, êtes-vous un triton ? »
Naïf : « Ce monument, quand le visite-t-on ? »
Respectueux : « Souffrez, monsieur, qu’on vous salue,
C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue ! »
Campagnard : « Hé, ardé ! C’est-y un nez ? Nanain !
C’est queuqu’navet géant ou ben queuqu’melon nain ! »
Militaire : « Pointez contre cavalerie ! »
Pratique : « Voulez-vous le mettre en loterie ?
Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! »
Enfin parodiant Pyrame en un sanglot :
« Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître
A détruit l’harmonie ! Il en rougit, le traître ! »
– Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et d’esprit
Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres,
Vous n’en eûtes jamais un atome, et de lettres
Vous n’avez que les trois qui forment le mot : sot !
Eussiez-vous eu, d’ailleurs, l’invention qu’il faut
Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries,
me servir toutes ces folles plaisanteries,
Que vous n’en eussiez pas articulé le quart
De la moitié du commencement d’une, car
Je me les sers moi-même, avec assez de verve,
Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve.Auteur : Edmond Rostand - Source : Cyrano de Bergerac (1897), I, 4, Cyrano - Un jour je m'attendais moi-même
Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes
Et d'un lyrique pas s'avançaient ceux que j'aime
Parmi lesquels je n'étais pas.Auteur : Guillaume Apollinaire - Source : Alcools (1913) - L'éloge funèbre constitue un genre difficile, impliquant un savant dosage entre le souvenir familier, la détresse authentique, les banalités de circonstance et l'envolée lyrique.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Bouvard de A à Z (2014)
- Mieux vaut paraître insensible que larmoyant, mieux vaut sembler sans grâce que pathétique, logique que lyrique !Auteur : Stefan Zweig - Source : Trois poètes de leur vie : Stendhal, Casanova, Tolstoï (1928)
- L'écrivain dispose d'un immense pouvoir lyrique, celui de braquer son projecteur sur une douzaine de vies dont il ne resterait rien s'il n'était pas là pour raconter. Des vies dont on se demande: Vont-elles bouleverser les foules? Auteur : Jean Rouaud - Source : Interview Jean Rouaud, Lire par Catherine Argand, 1 décembre 1996
- Enfants: Affecter pour eux une tendresse lyrique, quand il y a du monde.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Et ce qui me fait souffrir, ce n'est pas tant la mort d'un amour que celle d'un être vraiment vivant que nous avions créé l'un et l'autre, que peut-être moi j'avais créé seule… Cet être était une union de vous et de moi, tels que nous nous voulions l'un et l'autre. C'était vous comme j'avais besoin que vous fussiez ; non pas un admirateur de ma personne comme vous avez prétendu, mais un homme qui m'aimait ; qui, à cause de cet amour, trouvait de l'intérêt à tout ce qui venait de moi ; devant lui, je pouvais avoir tous mes défauts et toutes mes qualités ; je pouvais me laisser aller au désordre… ce désordre lyrique et inattendu où tous les instincts se livrent en paroles et en cris pour ensuite permettre aux sûres directions de l'âme de retrouver la route et de continuer. Et j'imaginais qu'aucun de ces abandons ne troublait votre amour et votre confiance.Auteur : Marcelle Sauvageot - Source : Laissez-moi
- Dans la complète solitude où je vécus, je pus chauffer à blanc ma ferveur, et me maintenir dans cet état de transport lyrique hors duquel j'estimais malséant d'écrire.Auteur : André Gide - Source : Si le grain ne meurt (1926)
- Elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire ...Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857)
- Lorsque les poètes lyriques parviennent à la postérité, ils ont perdu leur gros bagage en route. Ils arrivent équipés à la légère, quelques pièces en main. Cette même postérité, dont la mémoire est surchargée d'ailleurs, ne retient d'eux que les choses courtes, mais achevées et surtout senties. Auteur : Louise Ackermann - Source : Pensées d'une solitaire (1903)
- Il n'y a pas d'amitié, dit la voix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de poésie épique, il n'y a pas de poésie lyrique qui ne soient un gargouillement ou un gazouillement d'égoïstes, une trille de tricheurs, un bouillonnement de traîtres, une ébullescence d'arrivistes. une roulade de pédales.Auteur : Roberto Bolano - Source : 2666 (2004)
- Je ne sais ce qui arrivera des vers sans rime; mais je ne désespère pas que, s'ils s'établissent jamais, l'usage ne commence par nos vers lyriques, par ceux qui sont faits pour être chantés.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Sans référence
- On peut voir, dans les oeuvres de Fontenelle, une lettre curieuse de ce philosophe sur cet opéra de Bellérophon, qui n'était pas de cet inimitable poète lyrique (Quinault) et qui était presque digne d'en être.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, La Motte
- J'avais toujours cru que le mariage, tout comme l'opéra et les épinards, n'était pas ma tasse de thé. J'ai changé d'avis à propos de l'opéra quand j'avais neuf ans. Mon père m'a emmenée à la première de Madame Butterfly à Brescia en 1904. Après le spectacle, pendant que papa faisait la cuisine, Puccini m'a régalée avec des histoires drôles et a signé mon carnet d'autographes ; c'est comme ça que je suis devenue une fervente adepte de l'art lyrique. De la même façon, il a fallu que je tombe amoureuse de Landen pour reconsidérer ma vision du mariage. J'ai trouvé ça passionnant et exaltant : deux êtres, ensemble, n'en formant qu'un. J'étais à ma juste place... heureuse, satisfaite, épanouie.
Et les épinards ? Ma foi, j'attends toujours.Auteur : Jasper Fforde - Source : Délivrez-moi ! (2005)
- Emphatique : « Aucun vent ne peut, nez magistral,
T’enrhumer tout entier, excepté le mistral ! »
Dramatique : « C’est la Mer Rouge quand il saigne ! »
Admiratif : « Pour un parfumeur, quelle enseigne ! »
Lyrique : « Est-ce une conque, êtes-vous un triton ? »
Naïf : « Ce monument, quand le visite-t-on ? »
Respectueux : « Souffrez, monsieur, qu’on vous salue,
C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue ! »
Campagnard : « Hé, ardé ! C’est-y un nez ? Nanain !
C’est queuqu’navet géant ou ben queuqu’melon nain ! »
Militaire : « Pointez contre cavalerie ! »
Pratique : « Voulez-vous le mettre en loterie ?
Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! »
Enfin parodiant Pyrame en un sanglot :
« Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître
A détruit l’harmonie ! Il en rougit, le traître ! »
Auteur : Edmond Rostand - Source : Cyrano de Bergerac (1897), I, 4, Cyrano - Tous les discours les plus convaincus et les plus lyriques sur les valeurs de la France, sur son histoire et sa mémoire qu'il faudrait transmettre aux jeunes gens venus d'ailleurs, ne sont que du vent pour qui ne se préoccupe pas d'abord de restaurer la mémoire vivante de la France à travers ses paysans, ses artisans et ses petites entreprises. Auteur : Natacha Polony - Source : Nous sommes la France (2015)
- Les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont épiques, les temps modernes sont dramatiques.Auteur : Victor Hugo - Source : Cromwell (1827), Préface
- Le gars qui se croit capable de tout faire et qui rate tout ce qu’il fait, mais qui est content et qui s’en vante. Et il s’attaque à tous les genres dans le domaine artistique, que ce soit spirituel, que ce soit dramatique, que ce soit lyrique, avec une inconscience d’amateur. C’était ça mon personnage.Auteur : Bourvil - Source : Anthologie « Bourvil - 1955-1962 », réalisé par Jean-Baptiste Mersiol
- La volupté est une comédie sérieuse qui réserve parfois des surprises idylliques, j'allais écrire lyriques. L'amour, un drame dont l'enjeu est l'infini et qui oscille longtemps entre un compromis avec la raison et une folie mortelle.Auteur : Marcel Jouhandeau - Source : Jeux de miroirs (1965-1966)
- Aussi bien le vaste fourre-tout lyrique de la Légende des Siècles n'a pas fini de livrer ses secrets et d'étonner ses prospecteurs.Auteur : Emile Henriot - Source : Romanesques et romantiques (1930)
- Cestuy Thales avoit bruit d'estre poete lyrique, et prenoit le tiltre de cest art là.Auteur : Jacques Amyot - Source : Lycurgus, 4
Les citations du Littré sur Lyrique
- Ce qui ne laisse pas d'être une énigme pour nous, et ce qui nous semble une négligence inexprimable dans un poëte aussi attentif et aussi habile qu'Horace à donner à ses vers lyriques tous les charmes de l'harmonie, c'est de voir, même dans les odes qu'il a divisées en quatrains, le sens enjamber à tout moment d'une strophe à l'autre sans qu'il ait cru devoir se donner aucun soin de les couper par des reposAuteur : MARMONTEL - Source : Élém. litt. Oeuvres, t. X, p. 184, dans POUGENS
- Je ne sais ce qui arrivera des vers sans rime ; mais je ne désespère pas que, s'ils s'établissent jamais, l'usage ne commence par nos vers lyriques, par ceux qui sont faits pour être chantésAuteur : D'ALEMB. - Source : Oeuv. t. IV, p. 112
- La poésie lyrique.... recueillie dans ses thrènesAuteur : A. BOUCHÉ-LECLERCQ - Source : Rev. politique et litt. 20 mars 1875
- Cicero disoit que, quand il vivroit la vie de deux hommes, il ne prendroit pas le loisir d'estudier les poëtes lyriques ; et je treuve ces ergotistes [en philosophie] plus tristement encores inutilesAuteur : MONT. - Source : I, 179
- Ces défauts du langage ultra-lyrique de LycophronAuteur : VILLEMAIN - Source : Génie de Pindare, XIII
- Ce drame lyrique de Quinault fut comme tout ce qui sortait alors de sa plume, tendre, ingénieux, facileAuteur : Voltaire - Source : Comment. Corneille, Andromède, préf.
- Les Grecs eux-mêmes ont reconnu que la plus ancienne et la meilleure espèce de poésie était la lyrique, c'est-à-dire les hymnes et les odes, pour louer la divinitéAuteur : FLEURY - Source : Moeurs des Israél. titre XV, 2e part. p. 189, dans POUGENS.
- Montés au même char, comme un couple homérique, Nous tiendrons pour lutter dans l'arène lyrique, Toi la lance, moi les coursiersAuteur : Victor Hugo - Source : à Lamartine.
- Mais le sévère satirique [Boileau] Embrassait, encore en grondant, Cet aimable et tendre lyrique [Quinault], Qui lui pardonnait en riantAuteur : Voltaire - Source : Temple du goût.
- Je ne veux pourtant entonner Les alarmes de sons lyriques, Et moins encor refredonner Les chants des poëtes antiquesAuteur : JACQUES TAHUREAU - Source : Poésies, p. 92, dans LACURNE
- On peut voir, dans les oeuvres de Fontenelle, une lettre curieuse de ce philosophe sur cet opéra de Bellérophon, qui n'était pas de cet inimitable poète lyrique [Quinault] et qui était presque digne d'en êtreAuteur : D'ALEMB. - Source : Éloges, Lamotte.
- Cestuy Thalès avoit bruit d'estre poëte lyrique, et prenoit le tiltre de cest art làAuteur : AMYOT - Source : Lyc. 4
- Telle est la prophétie de Joad dans l'Athalie de l'illustre Racine, le plus beau morceau de poésie lyrique qui soit sorti de la main des hommes et auquel il ne manque, pour être une ode parfaite, que la rondeur des périodes dans la contexture des versAuteur : MARMONT. - Source : Élém. litt. Oeuvres, t. IX, p. 24, dans POUGENS
- L'auteur a compris sous la dénomination générale d'ïambes toute satire d'un sentiment amer et d'un mouvement lyrique ; cependant ce titre n'appartient réellement qu'aux vers satiriques composés à l'instar de ceux d'André Chénier ; le mètre employé par ce grand poëte n'est pas précisément l'ïambe des anciens, mais quelque chose qui en rappelle l'allure franche et rapide : c'est le vers de douze syllabes, suivi d'un vers de huit, avec croisement de rimes ; cette combinaison n'était pas inconnue à la poésie française, l'élégie s'en était souvent servie, mais en forme de stances ; c'est ainsi que Gilbert a exhalé ses dernières plaintesAuteur : BARBIER - Source : Iambes.
- Dans les costumes, la direction du Théâtre-Lyrique a eu le bon goût de rechercher plutôt l'exactitude que le saute-à-l'oeilAuteur : A. AUBERT - Source : le Soleil, 17 nov. 1876
- Pour soutenir ces superfétations lyriques, on ne manque pas de soutenir le spectacle par des ballets pantomimesAuteur : LA HARPE - Source : Corresp. t. v, p. 98
- Embrasé du feu lyrique, J'osai, jusque dans les cieux, Suivre l'aigle audacieux En son essor pindariqueAuteur : MILLEV. - Source : Élég. liv. I
- Jadis la pompe lyrique et musicale avait été, dans Athènes délivrée, l'inspirante apothéose des exploits héroïquesAuteur : VILLEMAIN - Source : Génie de Pindare, XVII
- La poésie lyrique..., vivement rhythmée dans ses hyporchèmesAuteur : A. BOUCHÉ-LECLERCQ - Source : Rev. polit. et littér. 20 mars 1875
- Le fameux septuor du Roi Théodore [opéra de Paisiello] fut un pas immense dans l'art de jeter de l'intérêt sur les scènes lyriques à personnages nombreuxAuteur : FÉTIS - Source : la Musique, XI, 18
- La poésie lyrique... grave dans ses nomes, ses péans, ses hymnesAuteur : BOUCHÉ-LECLERCQ - Source : Rev. politique et littér. 20 mars 1875
- Kyrielle ou palinode est quand le vers final du premier couplet se repete à la fin des autres couplets, comme en la ballade ; et est bien seant aux chans lyriques et odes, dont se dit palinodesAuteur : BOISSIÈRE - Source : Poétique, p. 258, dans LACURNE
- Les vieux lyriques si heureusement ressuscitezAuteur : RONS. - Source : Épître au lecteur, Odes.
- Cestuy Thales avoit bruit d'estre poete lyrique, et prenoit le tiltre de cest art làAuteur : AMYOT - Source : Lyc. 4
Les mots débutant par Lyr Les mots débutant par Ly
Une suggestion ou précision pour la définition de Lyrique ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 23h17

- Lache - Lacheté - Lâcheté - Laideur - Langage - Langue - Lapsus - Larme - Leçon - Lecture - Lettre - Liaison - Liberalite - Liberte - Liberté - Limitation - Linguistique - Lire - Littérature - Litterature - Livre - Logement - Logiciel - Logique - Loi - Loisirs - Louange - Loyauté - Lucidite - Lumiere - Lune - Lunettes - Luxe - Luxure
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur lyrique
Poèmes lyrique
Proverbes lyrique
La définition du mot Lyrique est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Lyrique sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Lyrique présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
