La définition de Once du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Once
Nature : s. f.
Prononciation : on-s'
Etymologie : Picard, onche ; provenç. onsa ; cat. unsa ; espagn. onza ; ital. oncia ; du lat. uncia, mot sicilien.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de once de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec once pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Once ?
La définition de Once
Ancien poids qui était d'abord la douzième partie de la livre romaine ; il était restée la douzième partie de la livre de Lyon et du midi de la France ; il était la seizième partie de la livre de Paris. Une demi-once. Une once et demie.
Toutes les définitions de « once »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Ancien poids qui était la douzième partie de la livre romaine. En France, il formait la Huitième partie du marc, ou la seizième partie de la livre de Paris. Fig. et fam., N'avoir pas une once de jugement, une once de sens commun, une once de bon sens, N'en avoir point du tout. Fig., Ne pas peser une once, N'être d'aucun poids. Cette objection n'a pas pesé une once.
Littré
-
1Ancien poids qui était d'abord la douzième partie de la livre romaine?; il était restée la douzième partie de la livre de Lyon et du midi de la France?; il était la seizième partie de la livre de Paris. Une demi-once. Une once et demie.
M. de Réaumur avait prouvé que l'once d'or pouvait fournir un fil qui égalait en longueur quatre cent quarante-quatre lieues
, Bonnet, Consid. corps organ. t. V, p. 205, dans POUGENS.Les orfévres divisaient l'once en vingt esterlins, chaque esterlin en deux mailles, chaque maille en deux félins, et chaque félin en sept grains et un cinquième.
On appelle perles à l'once, des semences de perles ou des perles fort menues, qui s'achètent au poids, les autres s'appellent perles de compte.
-
2 Familièrement. Once se dit pour petite quantité.
Tant et tant fut? Dit d'oraisons, qu'on vit du purgatoire L'âme sortir, légère et n'ayant pas Once de chair
, La Fontaine, Fér.Vous avez surtout un homme pâle et livide, qui n'a pas sur soi dix onces de chair
, La Bruyère, XII.Fig. Il n'a pas une once de sens commun, d'esprit, de jugement, il en est complétement dénué.
Il n'a pas seulement une once de raison
, Baron, École des pères, III, 6.Ne pas peser une once, être très léger, et aussi avoir un grand contentement qui fait qu'on semble léger.
[Dans un tableau] l'ange qui s'élance des pieds de la Religion? est d'une légèreté, d'une grâce, d'une élégance incroyables?; il a les ailes déployées, il vole, il ne pèse pas une once
, Diderot, Salon de 1767, t. IX, p. 55, éd. 1821.Comme j'étais content?! je ne pesais pas une once
, Théod. Leclercq, Proverb. t. I, p. 153, dans POUGENS. -
3Nom de plusieurs valeurs monétaires.
Sétoc commença par redemander cinq cents onces d'argent à un Hébreu, auquel il les avait prêtées en présence de deux témoins
, Voltaire, Zadig, 10.Once d'or, monnaie courante en plusieurs pays, valant 85 fr. en Espagne, où on l'appelle aussi quadruple, 13 fr. à Naples, 86 fr. au Mexique, 92 fr. à la Havane, etc.
Clément IV ne donna l'investiture à Charles d'Anjou qu'à condition qu'il payerait 3000 onces d'or au saint-siége
, Voltaire, M?urs, 61. -
4Dans l'ancienne Rome, la douzième partie d'une chose.
Aujourd'hui, à Rome, une certaine partie du pouce d'eau des fontainiers.
Six expériences que j'ai faites avec M. Vici, directeur des eaux de Rome, et desquelles j'ai conclu que l'once d'eau de Trevi donnait un produit de 41, 16 mètres cubes, en vingt-quatre heures
, Prony, Institut. Mém. scienc. 1817, t. II, p. 414.Rapport du pouce de fontainier avec l'once d'eau romaine
, ID. ib. p. 413.
HISTORIQUE
XIIe s. E li fers de sa [de Goliath] lance [pesait] treis cenz unces
, Rois, p. 203.
XIIIe s. Nus [nul] du mestier devant dit ne puet ne ne doit batre ne faire batre argent que en chascune bateure de xxv onces d'argent n'ait x estellins d'or au mains [moins]
, Liv. des mét. 75.
XVe s. Et si ne vault pas mieux une once L'autre?: deux folz sont sans cervelle
, Patelin.
XVIe s. Pour estre dite leyau [légale], la ditte playe doit avoir de longueur et incision une once de poulce, qui est la cinquieme partie du pan de cane
, Coust. génér. t. II, p. 694.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. ONCE. Ajoutez?: - REM. D'après l'Annuaire du Bureau des longitudes, l'once d'Espagne ou quadruple a valu 83 fr. 93 c. de 1772 à 1786?; mais, depuis 1786, elle ne vaut plus que 81 fr. 50 c.Encyclopédie, 1re édition
ONCE, (Hist. nat.) les Portugais ont appellé onca, once, le tigre connu sous le nom de tigre d'Amérique & le tigre noir.
Les parties de cet animal dont on se sert, sont la graisse & les griffes ; sa graisse est résolutive, & on l'applique aux articulations, lorsqu'il y a luxation & distention ; on monte sa griffe en or & en argent, & on la porte comme une amulette contre l'épilepsie & les convulsions. Dale d'après Schroder.
Once, s. f. (Commerce.) petit poids qui fait la huitieme partie du marc, ou la seizieme partie d'une livre de Paris. Dans d'autres endroits, la livre n'a que douze onces, & dans d'autres elle a plus de seize onces.
Ce mot vient du latin uncia, qui en général chez les Romains étoit la douzieme partie d'une chose qu'on prenoit pour un tout, & qu'on appelloit as. Dans les mesures géométriques, par exemple, uncia signifioit la douzieme partie d'un pié, c'est-à-dire un pouce. Voyez As & Pouce.
L'once du poids de marc ou l'once de Paris se divise en huit gros ou drachmes, le gros en trois deniers ou scrupules, le denier ou scrupule en vingt-quatre grains, le poids de chaque grain est celui d'environ un grain de froment. L'once entiere est composée de 576 grains, une demi-once est de quatre gros, & le quart-d'once de deux gros. Voyez Gros, Drachme, Denier, Scrupule, Grain.
Parmi les monnoyeurs & les orfevres, l'once se divise en 20 estelins, l'estelin en 2 mailles, la maille en 2 felins, le felin en 7 grains & un 5e de grain. Voyez Estelin, Maille, Felin.
L'once qui fait partie de la livre composée seulement de 12 onces, se divise en 20 deniers, l'anglois porte peny veights, & chaque denier en 24 grains.
Toutes les marchandises précieuses, comme l'or, l'argent, la soie, se vendent à l'once. On appelle perles à l'once celles qui sont si petites, qu'elles ne peuvent être comptées aisément, ni vendues autrement qu'au poids, & qu'on nomme communément semence de perles. On appelle cotons d'once certains cotons filés qu'on apporte de Damas, & qui sont d'une espece & d'une qualité supérieure aux autres cotons. Voyez Cotons. Diction. de comm. & Diction. de Chambers.
Once, (Monnoie.) c'est une monnoie imaginaire ou de compte, dont on se sert en Sicile, particulierement à Messine & à Palerme, pour évaluer les changes, & pour tenir les écritures & livres de commerce. L'once vaut 30 tarins ou 60 carlins, ou 600 grains. Le tarin vaut 20 grains, & le grain 6 piccolis.
Once de terre, est une phrase que l'on trouve souvent dans les anciennes chartes des rois d'Angleterre : mais il est difficile de déterminer la quantité de terre signifiée par ce terme. Tout ce que nous en savons de positif, c'est que l'on entendoit par là une grande quantité ou étendue de terrein, comme pouroient faire douze modii ; & quelques-uns conjecturent que chaque modius pouvoit faire cent piés en quarré.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - ancien français
once \Prononciation ?\ masculin
-
Once (mammifère).
- [?] qui sont pommelé de noires taches, autressi comme l'once ? (Brunetto Latini, Li livres dou Tresor, édition de P. Chabaille, 1863)
Nom commun 1 - ancien français
once \Prononciation ?\ féminin
-
Once (poids).
- D'or y avoit bien plus d'une once ? (Roman d'Eneas, ms. 60 français de la BnF, f. 169v., dernier vers du feuillet)
Nom commun 1 - français
once \??s\ féminin
-
(Métrologie) Unité de mesure de la masse (système impérial britannique avoirdupois), qui vaut 28,3495231 grammes pour l'once commune ? voir ounce. Ses symboles sont oz et ?. L'once troy (troy ounce) équivaut pour sa part à 31,1034768 grammes.
- Cependant n'accède pas tout de suite à leur demande ; car la qualité reconnue de ce peuple maudit est de commencer par exiger des livres et de finir par accepter des onces. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- Renaud leva ses bras maigres que les gants de six onces garnissaient comme deux paquets de pansement et sourit. ? (Francis Carco, Messieurs les vrais de vrai, Les Éditions de France, Paris, 1927)
- (Métrologie) Ancien poids qui valait la douzième partie de la livre romaine.
-
(Métrologie) (Histoire) Ancienne unité de mesure du poids en France, qui valait 30,59 grammes. Elle formait la huitième partie du marc, ou la seizième partie de la livre de Paris. Parfois encore utilisée pour peser l'or par exemple.
- Il est bon de savoir que l'once de la livre du poids de médecine est égale à celle du poids de marchand. ? (L'agronome ou dictionnaire portatif du cultivateur, Rouen, 1787)
- Tu sais bien que je prends du tabac, une once par jour. ? (Eugène Labiche, L'Article 960 ou la Donation, scène 7, 1839)
-
Petite quantité de quelque chose.
- Il n'a pas une once d'intelligence.
- Dans son regard, il y avait une incroyable détermination militaire, pas une once de peur. ? (Thomas Gunzig, Manuel de survie à l'usage des incapables, Gallimard, 2013, page 147)
-
(Numismatique) Ancienne monnaie d'or ayant eu cours en Espagne et en Amérique latine.
- Les brigands l'arrêtent auprès de la Carolina, et, après lui avoir pris toutes les onces qu'il avait dans sa bourse, sans compter les bagues, chaînes, souvenirs amoureux qu'un homme aussi répandu ne pouvait manquer d'avoir, le chef des voleurs lui fit remarquer poliment que le linge de sa bande, obligée qu'elle était d'éviter les endroits habités, avait grand besoin de blanchissage. ? (Prosper Mérimée, Lettres d'Espagne, 1832, réédiition Éditions Complexe, 1989, page 87)
Nom commun 2 - français
once \??s\ féminin
-
(Zoologie) Grand félin (Uncia uncia) vivant dans les régions froides et montagneuses du nord de l'Asie.
- ? Elle vient du Tchad, me dit son maître. Elle pourrait venir aussi de l'Asie. C'est une once, sans doute. Elle s'appelle Bâ-Tou, ce qui veut dire « le chat », et elle a vingt mois. ? (Colette, Bâ-Tou, dans La maison de Claudine, Hachette, 1922, collection Livre de Poche, 1960, page 130)
- Ce travail, publié dans la revue Science Advances du mois de juillet, présente la séquence complète de deux espèces du genre Panthera, le jaguar et le léopard. Puis, les chercheurs ont comparé ces génomes à ceux, déjà disponibles, de trois autres espèces vivantes de Panthera, le lion, le tigre et l'once, ou léopard des neiges. ? (Benjamin Prud'homme, Nicolas Gompel, Quand le jagupard brasse la définition de l'espèce sur LeMonde.fr, Le Monde. Mis en ligne le 11 octobre 2017, consulté le 19 octobre 2017)
- (Zoologie) Lynx ou loup-cervier.
-
(Zoologie) Bête féroce, de toute espèce.
- On entend une langue bruyante et fortement aspirée, on aperçoit de longues dents éblouissantes de blancheur, comme celles des chacals et des onces. ? (François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811)
- François Ier fait quelquefois coucher un lion ou une once au pied de son lit. ? (Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, Zoos : histoire des jardins zoologiques en occident (XVIe-XXe), La Découverte, Paris, 1998, page 21)
- [...] les murs étaient cachés sous des panneaux de pelleteries disposés en échiquiers d'un riche travail où les peaux de l'once et de l'ours blanc alternaient avec régularité. ? (Julien Gracq, Au château d'Argol, éd. José Corti, 1938, p. 31)
Trésor de la Langue Française informatisé
ONCE1, subst. fém.
ONCE2, subst. fém.
ZOOL. Grand félin d'Asie centrale, dont la robe gris clair tachetée de noir ressemble à celle de la panthère. Synon. panthère* des neiges.L'once, le léopard et le tigre, s'élevant comme la taupe, jettent par dessus eux en monticules la terre émiettée (Chateaubr.,Paradis perdu,1836, p.115).Des panneaux de pelleteries disposés en échiquiers d'un riche travail où les peaux de l'once et de l'ours blanc alternaient avec régularité (Gracq,Argol,1938, p.31).Once au Scrabble
Le mot once vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot once - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot once au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
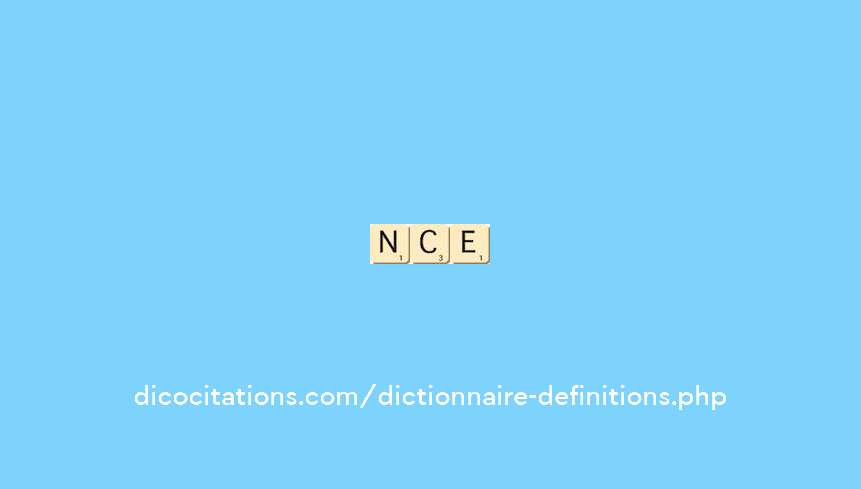
Les mots proches de Once
Onc ou onques Once Once Onciaire Oncial, ale Oncle Onction Onctueux, euse Onctuosité onc once onces Oncieu oncle oncles oncologie oncologique oncologue oncologues Oncourt onction onctions onctueuse onctueusement onctueuses onctueux onctuosité Oncy-sur-École Oncy-sur-ÉcoleMots du jour
In petto Constitution Turcisme Incandescence Tutoyeur, euse Électeur Discret, ète Trousse Rejauger Jais
Les citations avec le mot Once
- De tels êtres ou de si grands pouvoirs il est concevable qu'il y ait une survivance... survivance d'un temps extrêmement reculé où... la conscience se manifesta, peut-être, sous des formes et figures en retrait depuis longtemps avant la marée de l'humanité en marche...formes dont seules la poésie et la légende ont saisi un souvenir fugace et qu'elles ont appelées dieux, monstres, êtres mythiques de toutes sortes et espèces...Auteur : Howard Phillips Lovecraft - Source : L'Appel de Cthulhu (1926)
- il scruta son visage : elle avait vieilli. Ses yeux disparaissaient, enfoncés dans les rides qui les mangeaient, rivière jamais rassasiée. Le vert si dur, si beau de ce regard avalé par le temps se transformait en gris, un gris de terre, un gris de jument, un gris qui ternissait tout, amplifiait les petites peurs, les angoisses sans importance. Auteur : Cécile Coulon - Source : Une bête au paradis (2019)
- Ce que l'Ecriture annonce touchant les peines corporelles des âmes des damnés, à savoir qu'elles seront tourmentées par le feu de l'enfer, doit être entendu littéralement.Auteur : Saint Thomas d'Aquin - Source : Compendium de théologique (1265-1267), CLXXIX
- Chacun porte en soi sa conception du monde dont il ne peut se défaire si aisément.Auteur : Henri Poincaré - Source : La Science et l'hypothèse (1908)
- Tu sembles une note adorable ajoutée
Au concert qu'ici-bas l'âme écoute enchantée.Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859) - Sincère a ceci de commun avec modeste, dès qu'on le prononce, on ne l'est plus.Auteur : Jean-Michel Ribes - Source : Les mots que j'aime et quelques autres... (2013)
- La tragédie c'est l'avènement de l'inconcevable dans chaque existence.Auteur : Dominique de Roux - Source : Immédiatement (1972)
- D'autre côté - n'est pas science, toute connaissance dont les éléments conceptuels ne sont pas faits ad hoc, mais pris dans le langage ordinaire.Auteur : Paul Valéry - Source : Cahiers
- Plantons des arbres et les racines de notre avenir s'enfonceront dans le sol et une canopée de l'espoir s'élèvera vers le ciel.Auteur : Wangari Muta Maathai - Source : Celle qui plante les arbres (2007)
- Mine anti-personnelle : arme abominable que ses concepteurs travaillent d'arrache-pied à améliorerAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Il n'y a rien à célébrer, rien à condamner, rien à dénoncer, mais il y a beaucoup de choses dérisoires tout est dérisoire quand on songe à la mort.Auteur : Thomas Bernhard - Source : Mes prix littéraires (2010)
- Faut-il toujours des mots pour nommer les sentiments? Faut-il énoncer les choses pour qu'elles existent?Auteur : Delphine de Vigan - Source : Les Jolis Garçons (2005)
- Les secrets ont leur rhétorique fallacieuse. Un secret n’est pas un mensonge par omission – conception trop facile et rassurante. Il est un négatif photographique, une réalité en creux ayant sa propre existence et qui le jour où elle est mise à jour peut tout dévaster, là où, révélée à temps, elle aurait sans doute blessé, mais de ces blessures dont on guérit. Sa force destructrice réside dans la dissimulation, plus que dans le contenu dissimulé. C’est ce qu’avaient refusé de comprendre mes grands-parents. Auteur : Valentin Musso - Source : Les cendres froides (2011)
- Renoncez une fois pour toutes à vos grandiloquentes conceptions de l'humanité: la vie humaine et toute l'histoire du Monde ne sont rien d'autre qu'un rêve qu'un Etre moqueur fait à nos dépens.Auteur : Hanns Heinz Ewers - Source : C.3.3, dans L'araignée
- Demain! est à la fois le mot favori de la prudence et de la paresse; mais, presque toujours, celle-là s'applaudit, et celle-ci se repent de l'avoir prononcé.Auteur : Félix Guillaume Marie Bogaerts - Source : Pensées et Maximes
- La pluie s'annonce à des signes très sûrs : le vent d'ouest, net et frais, les mouettes qui refluent très loin à l'intérieur des terres et se posent comme des balles de coton sur les champs labourés, les hirondelles, l'été, qui rasent les toits des maisons, tournoient, attentives et muettes, dans les jardins, les feuillages qui s'agitent et bruissent au vent, les petites feuilles rondes des trembles affolées, les hommes qui lèvent le nez vers un ciel pommelé, les femmes qui ramassent le linge à brassée (incomparables draps séchés au vent de la mer - cet air homéopathique d'iode et de sel entre les fibres), abandonnant sur le fil les épingles multicolores comme des oiseaux de volière, les enfants qui jouent dans le sable et que les mamans rappellent, les chats à leur toilette qui passent la patte derrière l'oreille, et trois petits coups d'ongle sur le verre bombé du baromètre : l'aiguille qui s'effondre. Auteur : Jean Rouaud - Source : Les champs d'honneur (1990)
- Nous nommons vrai un concept qui concorde avec le système général de tous nos concepts, vraie une perception qui ne contredit pas le système de nos perceptions; la vérité est cohérence.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Du sentiment tragique de la vie (1913)
- Ce qui a changé ma vie, mon écriture, ça a été le passage d'une conception du monde à une autre totalement différente. C'était lorsque je suis passé de la physique classique à la physique quantique.Auteur : Armand Gatti - Source : En février 2010, dans l'émission Hors-champs
- Oignons bien habillés - Annoncent fortes gelées.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Prononcer vingt-cinq aphorismes par jour et ajouter à chacun d'eux: «Tout est là.»Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 27 janvier 1894
- Une once de vanité gâte un quintal de mérite.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Les «comment» m'intéressent assez pour que je renonce sans regret à la vaine recherche des «pourquoi».Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Sans référence
- Une once de bon esprit vaut mieux qu'une livre de science.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Ce temps de régénération intellectuelle et de transformation sociale viendra, nous en sommes sûrs. Déjà des présages certains l'annoncent. Quand la Science saura, la Religion pourra, et L'Homme agira avec une énergie nouvelle.Auteur : Philippe Frédéric Edouard Schuré - Source : Les grands initiés
- La plus grande erreur est de penser que les prétendus gens simples sont en mesure de sauver quelqu'un. Au comble de la détresse, on va les voir et on les prie formellement de vous sauver et ils vous enfoncent encore davantage dans le désespoir. Auteur : Thomas Bernhard - Source : Le naufragé (1983)
Les citations du Littré sur Once
- Un lionceau qui rugit en voyant sa proieAuteur : SACI - Source : Bible, Machab. I, III, 4
- Pour renoncer au monde et à ses pompesAuteur : MASS. - Source : Prof. rel. 3
- Je renonce à tout ce qui a été, qui est, qui sera libreAuteur : LA BRUY. - Source : XII
- Une armoire pratiquée dans l'enfoncement d'un murAuteur : MARIV. - Source : Marianne, part. I, t. I, p. 6, dans POUGENS
- Ces cours décrétèrent le nonce lui-même d'ajournement personnel et ensuite de prise de corpsAuteur : ANQUET. - Source : Ligue, III, p. 178
- Les sommités de chanvre, les sommités de roncesAuteur : PARÉ - Source : XVI, 35
- Avouons plutôt que par le moyen de cette périphrase, mélodieusement répandue dans le discours, d'une diction toute simple il a fait une espèce de concert et d'harmonieAuteur : BOILEAU - Source : Longin, Subl. ch. 24
- Digne de prononcer les oracles de la justiceAuteur : BOSSUET - Source : ib.
- Le président du sénat [en Égypte] portait un collier d'or et de pierres précieuses, d'où pendait une figure sans yeux qu'on appelait la vérité.... il l'appliquait au parti qui devait gagner sa cause, et c'était la forme de prononcer les sentencesAuteur : BOSSUET - Source : Hist. III, 3
- Pour moi Palès encore a des asiles verts, Les Amours des baisers, les Muses des concerts ; Je ne veux pas mourir encoreAuteur : A. CHÉN. - Source : la Jeune captive.
- Si un homme voulait se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur, il devait lui dénoncer qu'il abandonnait son fief ; après quoi, il l'appelait devant son seigneur suzerain, et offrait les gages de batailleAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXVIII, 27
- La pupille des oiseaux de nuit reste toujours ronde en se rétrécissant concentriquement, au lieu que celle des chats devient perpendiculairement étroite et longueAuteur : BUFF. - Source : Ois. t. II, p. 118
- Le fils d'Ulysse s'enfonce dans ces ténèbres horriblesAuteur : FÉNEL. - Source : ib. XVIII
- Cascuns entent le prononcement des arbitres diversementAuteur : BEAUMAN. - Source : XXXIX, 7
- Le prince conceda à la roine Baugency pour la commodité du traité, avec premesse qu'il lui seroit restitué si on ne pouvoit convenir [s'entendre]Auteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 141
- Dans cette confusion on ne pouvait se mouvoir de concert ; les ordres ne venaient jamais à tempsAuteur : BOSSUET - Source : Hist. III, 5
- Tantôt il donnait des remèdes qui faisaient suer, et il montrait, par le succès des sueurs, combien la transpiration, diminuée ou facilitée, déconcerte ou rétablit toute la machine du corpsAuteur : FÉN. - Source : Tél. XVII
- Tous de concert nous conspirerons à le soutenir, à le perfectionner, à le consommerAuteur : BOURD. - Source : Carême, I, Cendres, 51
- À Grenoble où le blé dépassait déjà 4 fr. le quartal [de 27 livres], la crainte des poursuites annoncées contre les enarrheurs a fait faire quelques ventes précipitées à un cours inférieurAuteur : BOISLISLE - Source : Corr. contrôl. gén. des fin. p. 338, 1693
- Quelques années avant sa mort, il avait renoncé à la société, qui n'était plus que fatigante pour luiAuteur : CONDORCET - Source : Daniel Bernoulli.
- Il faut se presser de travailler le suc de la betterave à mesure qu'on l'extrait ; si on le laisse reposer plusieurs heures, surtout quand il n'est pas concentré, il éprouve des altérations qui dénaturent le sucreAuteur : CHAPTAL - Source : Instit. Mém. Acad. des scienc. t. I, p. 369
- L'once diffère de la panthère, en ce qu'il est bien plus petit, qu'il a la queue beaucoup plus longue, le poil plus long aussi et d'une couleur grise ou blanchâtreAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. III, p. 266
- Ils tâchent d'intéresser les voyageurs par le concert ambulant de leur famille erranteAuteur : STAËL - Source : Allem. I, ch. 2, Moeurs.
- Chacun trouve ses voies semées de ronces et d'épinesAuteur : MASS. - Source : Avent, Afflict.
- Mais bientôt en ce lieu par des mots concertés Érichtho [magicienne] fait briller des rayons enchantésAuteur : BRÉBEUF - Source : Pharsale, VI
Les mots débutant par Onc Les mots débutant par On
Une suggestion ou précision pour la définition de Once ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h23

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur once
Poèmes once
Proverbes once
La définition du mot Once est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Once sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Once présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
