La définition de Neigé, ée, du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Neigé, ée,
Nature : adj.
Prononciation : nè-jé, jée
Etymologie : Wallon, nivaie ; namur. nive ; Hainaut, nive ; bourg. noge ; provenç. nicx, neu, nieu ; cat. neu ; esp. nieve ; port. et ital. neve ; du lat. nix, nivem, anc. lat. ninguis, dans Lucrèce ; grec, il neige. Comparez le goth. snaivs, l'anc. h. all. sneo, l'all. Schnee, l'angl. snow, l'anc. irl. sneachta. Les formes germaniques et celtiques annoncent qu'en latin et en grec une s initiale est tombée ; tout cela conduit au sanscrit snih, être humide. Le français a deux formes : neif, noif, qui vient de nix, nivem, et neige, qui vient de nivea, pris substantivement. Quant au wallon nivaie, il vient de nivalia.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de neigé, ée, de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec neigé, ée, pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Neigé, ée, ?
La définition de Neigé, ée,
Couvert de neige.
Toutes les définitions de « neigé, ée, »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Eau congelée qui tombe sur la terre, en flocons blancs et légers. De gros flocons de neige. Ce temps couvert nous amènera, nous apportera de la neige. Il tombe de la neige. De la neige fondue. De la neige durcie. La campagne est couverte de neige. Les premières neiges. Neiges éternelles. Il s'est perdu dans les neiges. Un torrent formé par la fonte des neiges. Se lancer des boules de neige. Fig., Blanc comme neige, Parfaitement innocent. Il sortit de cette affaire blanc comme neige. Prov. et fig., Cela fait la boule de neige se dit des Séditions qui croissent progressivement, des Sommes qui grossissent par l'accumulation des intérêts, etc. En termes de Cuisine, Œufs à la neige, Blancs d'œufs battus de manière qu'ils forment une mousse semblable à de la neige, et qu'on fait cuire dans du lait bouillant. En termes de Botanique, Boule de neige, Espèce de viorne dont les fleurs blanches sont rassemblées en boules.
Littré
-
1Eau congelée qui tombe de l'atmosphère en flocons légers, d'un blanc éclatant.
Une belle plaine de neige d'environ quatre-vingts lieues de tour forme notre horizon
, Voltaire, Lett. d'Argental, 4 janv. 1767.Les petits flocons qui en proviennent [des gouttes d'eau atmosphériques], se réunissant plusieurs ensemble, et ne se touchant que par quelques points de leur surface, ne composent que des flocons très légers?; c'est là ce que nous appelons neige
, Brisson, Traité de phys. t. II, p. 151, dans POUGENS.Aux flancs des monts altiers, à leurs cimes glacées, L'hiver a suspendu les neiges entassées
, Saint-Lambert, Saisons, IV.Rien n'est plus triste que la neige en Italie
, Staël, Corinne, XIX, 6.L'armée marche enveloppée de vapeurs froides?; ces vapeurs s'épaississent?: bientôt c'est un nuage immense qui s'abaisse et fond sur elle en gros flocons de neige
, Ségur, Hist. de Nap. IX, 11.Là ils gémissent en vain?; bientôt la neige les couvre?; de légères éminences les font reconnaître?; voilà leur sépulture
, Ségur, ib.De la neige les flocons sont les papillons de la saison
, A. de Soland, Proverbes et dictons rimés de l'Anjou, p. 2.Quand la neige à minuit, lente, silencieuse, Tombe aux toits endormis
, Sainte-Beuve, Poésies, à David.Après ma mort, une avalanche De son linceul me couvrira, Et sur mon corps la neige blanche, Tombeau d'argent, s'élèvera
, Th. Gautier, le Chasseur.Neiges perpétuelles, celles qui ne fondent jamais.
Pour moi, j'arrivai dans des déserts affreux?; on y voit des sables brûlants au milieu des plaines, des neiges qui ne fondent jamais et qui font un hiver perpétuel sur le sommet des montagnes
, Fénelon, Tél. II.Devenir blanc comme neige, pâlir extrêmement.
Fig. Blanc comme neige, parfaitement innocent.
Penautier sortira [de l'affaire des poisons] un peu plus blanc que de la neige
, Sévigné, 22 juill. 1676.Je ne fais non plus de cas de cela que des neiges d'antan, c'est-à-dire je n'en fais aucun cas.
Cela grossit comme une boule de neige, c'est une pelote de neige qui grossit, cela fait la pelote, la boule de neige, se dit de tout ce qui s'augmente par la durée et l'accumulation.
Pour empêcher ce tumulte qui peut, comme une boule de neige, s'accroître merveilleusement
, Patin, Nouv. lett. t. II, p. 377, dans POUGENS.C'est la scène du Dépit amoureux, quand on ne le demande [le congé] que par le désespoir de n'être pas bien avec la princesse?; et puis il se fait une pelote de neige?: le congé accordé est une douleur qui confirme la première
, Sévigné, Jour de Noël, 1671.Par exagération et par plaisanterie. Tout ce qui est froid au moral.
Ninon l'a quitté [Ch. de Sévigné]? elle n'en parle pas avec beaucoup d'estime?: c'est une âme de bouillie, dit-elle, c'est un corps de papier mouillé, c'est un c?ur de citrouille fricassé dans de la neige
, Sévigné, 44.Vous avez lu la Nouvelle Héloïse?; eh bien?! ma parole d'honneur, c'est de la neige fondue à côté de mon style de ce temps-là
, Ch. de Bernard, la Femme de 40 ans, § IV. -
2Neige, saison des neiges.
Les Ostiaks comptent par neiges et non par la marche apparente du soleil
, Voltaire, Russie, I, 1.À la prochaine lune des fleurs, il y aura sept fois dix neiges, et trois neiges de plus, que ma mère me mit au monde
, Chateaubriand, Atala, le Récit, les Chasseurs. -
3 Fig. Toute chose blanche comparée à la neige.
Il faut qu'avril jaloux brûle de ses gelées Le beau pommier, trop fier de ses fleurs étoilées, Neige odorante du printemps
, Hugo, Orient. 33.Neige, barbe blanche.
En vain une neige glacée D'Homère ombrageait le menton
, Lamartine, Médit. II, 26.Il a de la neige sur la tête, se dit d'un vieillard dont les cheveux ont blanchi.
-
4Glace de fruits faite avec du sucre et le jus de certains fruits.
La neige avec art préparée Aiguise nos sens émoussés?; On dirait que ces fruits glacés Sortent des jardins de Borée
, Bernis, Quatre saisons, Été. - 5?ufs à la neige, plat sucré composé de blancs d'?ufs battus en neige ferme et jetés quelques minutes dans du lait bouillant. Avec le reste du lait, les jaunes d'?ufs, quelques aromates, on fait une crème qui se sert autour des blancs en neige.
- 6Dentelle de peu de valeur.
- 7 Terme d'ancienne chimie. Neige d'antimoine, oxyde d'antimoine blanc sublimé.
-
8
Neige rouge, hydrophyte de la famille des phycées qui, en certaines circonstances, se développe en grande quantité sur la neige?: c'est le protococcus nivalis, appelé aussi terre rouge de la neige
, Legoarant ?Quand j'examinais de près cette neige rouge, je voyais que la couleur dépendait d'une poudre fine mêlée avec elle, et qui pénétrait jusqu'à deux ou trois pouces de profondeur, mais pas plus avant
, Saussure, Voy. Alpes, t. III, p. 45, dans POUGENS. -
9Familièrement et fig. De neige, sans valeur, digne de mépris.
Voyez le beau héros de neige, Pour avoir un tel privilége
, Scarron, Virg. VI.Tiens, tiens, sans y chercher tant de façons, voilà Ton beau galant de neige, avec ta nonpareille
, Molière, Dépit, IV, 4.Ah?! le beau médecin de neige avec ses remèdes
, Destouches, Tambour noct. I, 6.
PROVERBES
Des neiges et un bon hiver mettent bien des biens à couvert.
La neige qui tombe engraisse la terre.
Neige au blé est tel bénéfice Comme au vieillard la bonne pelisse.
On ne voit cygne noir ni nulle neige noire.
Il en faut autant qu'il faut de pelotes de neige à chauffer un four, se dit d'une chose qui ne sert aucunement à ce qu'on veut faire.
HISTORIQUE
XIe s. Autresi blanche come neif sur gelée
, Ch. de Rol. CCXI.
XIIe s. Gorge blanche plus que n'est nois ne lis
, Couci, p. 125.
XIIIe s. Gesir as chans sour la gielée et sor la noif, sans loge et sans pavillon
, H. de Valenciennes, XXVII. Li autres principaus [vent] qui vient de la tramontane done nues et froidure, et qui li est encoste, vers couchant, donne noif et grelle
, Latini, Trés. p. 122.
XIVe s. Et de nege cheï tant et si longuement, Que l'endemain au jour, ains prime vraiement, Fu de nege cinq piez et plus?
, Guesclin. 19584.
XVe s. Un gresil et une noige va commencer si fort que merveilles fut
, Froissart, II, II, 41. Neige et gresil sont en terre bouté?; On oit chanter chascun parmi la rue
, Deschamps, Saison de guerre. Dictes moy où n'en quel pays Est Flora la belle romaine? Mais où sont les neiges d'antan??
, Villon, Ball. des dames du temps jadis.
XVIe s. Un seul trait de ses yeux, tous mes sens enchantant, Ne suffisoit que trop pour me forcer à croire Que la neige estoit noire
, Desportes, Diverses amours, Plainte. Laissans rouler sans nul empeschement ceste petite pelote de neige, en peu de temps elle se fit grosse comme une maison
, Lanoue, 697.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
NEIGE. Ajoutez?:Arbre de neige, plusieurs arbrisseaux à fleurs blanches nombreuses, tels que le viburnum opulus,Baillon, Dict. de botan. p. 257.
Encyclopédie, 1re édition
NEIGE, s. f. (Physique.) eau congelée, qui dans certaines constitutions de l'atmosphere, tombe des nuées sur la terre sous la forme d'une multitude de flocons séparés les uns des autres pendant leur chûte, & qui sont tous d'une extrème blancheur. Un flocon de neige n'est qu'un amas de très-petits glaçons pour la plûpart de figure oblongue, de filamens d'eau congelée, rameux, assemblés en différentes manieres, & formant quelquefois autour d'un centre des especes d'étoiles à six pointes. Voyez Glace & Congélation.
Descartes & d'autres philosophes modernes en assez grand nombre, qui n'ont guere pensé que d'après lui, ont cru que les nuées étoient composées de particules de neige & de glace. Il devoit donc, selon eux, tomber de la neige toutes les fois que les parcelles condensées d'une nuë se précipitoient vers la terre & arrivoient à sa superficie, avant que d'être entierement fondues. On est aujourd'hui détrompé de cette fausse opinion. Les nuées sont des brouillards élevés dans l'atmosphère, c'est-à dire, des amas de vapeurs & d'exhalaisons assez grossieres pour troubler la transparence de l'air, où elles sont suspendues à diverses hauteurs plus ou moins considérables. Nous parlerons dans un autre article des principales causes qui, forçant les vapeurs aqueuses de se réunir, les convertissent en petites gouttes de pluie. Ces gouttes venant à tomber, il arrive souvent que la froideur de l'air qu'elles traversent est assez considérable pour les geler : elles se changent alors en autant de petits glaçons. D'autres gouttes qui les suivent se joignant à elles, se gelent aussi ; & de cette maniere, il se forme une multitude de flocons, qui ne peuvent être que fort rares & fort légers ; l'union des petits glaçons qui les composent, étant toûjours très-imparfaite. Voyez Pluie.
On voit qu'il est absolument nécessaire pour la formation de la neige, que la congélation saisisse les particules d'eau répandues dans l'air, avant qu'elles se soient réunies en grosses gouttes. Si les gouttes de pluie, lorsqu'elles perdent leur liquidité, sont déja d'une certaine grosseur : si elles ont, par exemple, deux ou trois lignes de diametre, elles se changent en grêle & non en neige : nous l'avons remarqué ailleurs. La grêle, dont le tissu est nécessairement compacte & serré, est parfaitement semblable à la glace ordinaire. La neige au contraire est de même nature que la gelée blanche : rien ne distingue essentiellement ces deux sortes de congélations : l'une se forme dans l'air ; l'autre sur la surface des corps terrestres : voilà leur principale différence. Voyez Grêle, Gelée blanche, & Givre.
La figure des flocons de neige est susceptible d'un grand nombre de variétés ; elle est réguliere ou irréguliere. Ces flocons ne sont quelquefois que comme de petites aiguilles. Quelquefois ce sont de petites étoiles héxagonales, qui finissent en pointes fort aiguës, & qui forment ensemble des angles de 60 degrés, après que trois aiguilles sont tombées les unes sur les autres, & se sont congelées. Il arrive aussi que le milieu du corps de l'étoile est plus épais, & se termine en pointes aiguës. Quelques-unes de ces étoiles ont un globule à leur centre ou aux extrémités de leurs rayons, ou en même tems au centre & à l'extrémité des rayons. D'autres ont à leur centre une autre étoile pleine ou vuide. M. Musschenbrock a vu tomber des flocons sous la forme de fleurs à six pétales. Dans une autre occasion il a observé des étoiles hexagonales, composées de rayons fort minces, d'où partoient un grand nombre de petites branches ; de sorte qu'ils imitoient assez bien les branches d'un arbre. Deux autres sortes d'étoiles que M. Cassini observa dans la neige en 1692, ne different de celles de M. Musschenbroek, qu'en ce qu'au lieu de simples branches, qui se fourchent en plusieurs autres, ce sont comme des rameaux garnis de leurs feuilles. Erasme Bartholin assure qu'il a vu dans la neige des étoiles pentagonales, & même il ajoute que quelques-uns en ont vu d'octangulaires. Voyez nos Planches de Physique.
Cette neige réguliere ne tombe pas souvent ; les flocons sont ordinairement de figure irréguliere, & de grandeur inégale. Ce qui est bien digne de remarque, c'est que les différentes especes de flocons réguliers, dont on vient de parler, ne sont presque jamais confondues dans la même neige ; il n'en tombe que d'une espece à-la-fois, soit en différens jours, soit à différentes heures d'un même jour.
Dans toutes les figures de flocons de neige qui ont été décrites, on apperçoit malgré la diversité qui y regne, quelque chose d'assez constant, de longs filamens d'eau glacée, quelquefois entierement séparés les uns des autres, mais d'ordinaire assemblés sous différens angles, principalement sous des angles de 60 degrés. C'est ce qu'on remarque dans toutes les autres congélations ; & ce qui paroît dépendre de la figure, quelle qu'elle soit, des parties intégrantes de l'eau, & de la maniere dont la force de cohésion agit sur ces particules pour leur faire prendre un certain arrangement déterminé. La congélation a beaucoup de rapport avec la crystallisation. Or les sels n'affectent-ils pas de même dans leurs crystallisations différentes figures ? Enfin le degré du froid, sa lenteur ou son accroissement rapide, la direction & la violence du vent, le lieu de l'atmosphère où se forme la neige, la différente nature des exhalaisons qui se mêlent avec les molécules d'eau converties en petits glaçons, tout cela peut contribuer à faire tomber dans un certain tems de la neige réguliere, & une espece de cette neige plutôt qu'une autre. Nous n'en dirons pas davantage sur les causes de la diversité dont il s'agit. C'est assez d'appercevoir la liaison des phénomenes, & de faire envisager en gros & confusément dans les opérations de la nature, les agens & le méchanisme qu'elle a pu employer.
La neige est beaucoup plus rare & plus légere que la glace ordinaire. Le volume de celle ci ne surpasse que d'un dixieme ou d'un neuvieme tout au-plus celui de l'eau dont elle est formée ; au lieu que la neige qui vient de tomber a dix ou douze fois plus de volume que l'eau qu'elle fournit étant fondue. Quelquefois même cette rareté est beaucoup plus grande ; car M. Musschenbrock ayant mesuré à Utrecht de la neige qui étoit en forme d'étoiles, elle se trouva vingt-quatre fois plus rare que l'eau.
L'évaporation de la neige est très-considérable : lorsqu'il n'en est tombé qu'un ou deux pouces, on la voit disparoître en moins de deux jours de dessus la terre par un vent sec & au plus fort de la gelée ; il est aisé de comprendre qu'étant composée d'un grand nombre de particules de glace assez désunies, elle doit présenter une infinité de surfaces à la cause de l'évaporation.
D'un autre côté, elle ne sauroit faire le même effort que la glace pour se dilater ; elle ne rompt point les vaisseaux qui la contiennent ; elle cede à la compression, & l'on peut aisément la réduire à un volume presque égal à celui de la glace ordinaire. Les pelotes qu'on en forme en la pressant fortement avec les mains, sont d'une très-grande dureté ; c'est que les parties qui les composent étant plus rapprochées, & se touchant par un plus grand nombre de points, adherent plus fortement entr'elles ; ajoutons que la chaleur de la main fondant la neige en partie, l'eau qui se répand dans tout le composé en lie mieux les différentes portions, & augmente leur adhésion mutuelle : tout cela est assez connu.
La neige ne sauroit être fortement comprimée sans perdre au moins en partie son opacité & sa blancheur ; c'est qu'elle n'est blanche & opaque que dans sa totalité. Chacun des petits glaçons qui la composent, lorsqu'on l'examine de près, est transparent ; mais les intervalles peu réguliers que laissent entr'eux ces petits glaçons, donnant lieu à une multitude de réflexions des rayons de lumiere, le tout doit être opaque & blanc. Ce que nous avons dit à l'article Gelée blanche, du verre le plus transparent, qui est blanc lorsqu'on le réduit en poudre, trouve ici son application.
Comme la neige réfléchit la lumiere avec force, il n'est pas surprenant, lorsque tout en est couvert, que ceux qui ont la vue foible n'en puissent pas supporter l'éclat. Il n'est même personne qui se promenant long-tems dans la neige pendant le jour, n'en devienne comme aveugle. Xenophon rapporte que l'armée de Cyrus ayant marché quelques jours à travers des montagnes couvertes de neige, plusieurs soldats furent attaqués d'inflammations aux yeux, tandis que d'autres perdirent entierement la vue. La blancheur de la neige guide suffisamment ceux qui vont de nuit dans les rues, lors même qu'il ne fait pas clair de lune. Olaüs magnus nous apprend que dans les pays septentrionaux, lorsque la lune luit, & que la neige en refléchit la lumiere, on peut fort bien voir & voyager sans peine, & même découvrir de loin les ours & les autres animaux féroces.
La froideur de la neige n'a rien de particulier ; c'est sans fondement que quelques auteurs l'ont crue inférieure à celle de la glace. Toutes les observations & les expériences prouvent le contraire. La neige & la glace sont également froides, soit dans l'instant de leur formation, soit après qu'elles sont formées, toutes les autres circonstances étant d'ailleurs les mêmes.
Quant au goût de la neige, il n'offre non plus rien de remarquable. Celle qui tombe actuellement n'a aucune saveur ; il est vrai que long-tems après, lorsqu'elle a séjourné sur la terre, & qu'elle s'y est tassée, elle y contracte quelque chose de mordicant qui se fait sentir sur la langue. On peut croire que selon les climats & les circonstances du tems & du sol, la neige a quelquefois des qualités que l'eau commune n'a pas. On prétend par exemple que les habitans des Alpes & des environs ne sont sujets aux goëtres, que parce qu'ils boivent en hiver de l'eau de neige fondue. Cependant la plûpart des habitans de la Norvege, qui, comme les premiers, n'en ont pas d'autre pendant l'hiver, sont exempts de cette incommodité.
Des essais chimiques faits avec soin donneroient sans doute bien des lumieres sur la nature des exhalaisons terrestres & des corps hétérogenes dont la neige peut être chargée. M. Margraff a trouvé un peu de nitre dans la pluie & dans la neige qui tombent à Berlin.
La quantité de neige qui tombe dans certains pays, mérite d'être remarquée. M. Léopold rapporte dans son voyage de Suede, qu'en 1707 il neigea en une seule nuit dans la partie montueuse de Smalande, de la hauteur de trois piés. On observa en 1729, sur les frontieres de Suede & de Norvege, près du village de Villaras, qu'il y tomba subitement une si affreuse quantité de neige, que quarante maisons en furent couvertes, & que tous ceux qui étoient dedans en furent étouffés. M. Wolf nous apprend qu'on a vu arriver la même chose en Silésie & en Bohême. M. de Maupertuis nous parle de certaines tempêtes de neige qui s'élevent tout-à-coup en Laponie. « Il semble alors, dit-il, que le vent souffle de tous les côtés à la fois, & il lance la neige avec une telle impétuosité, qu'en un moment tous les chemins sont perdus. Celui qui est pris d'un tel orage à la campagne, voudroit en vain se retrouver par la connoissance des lieux ou des marques faites aux arbres ; il est aveuglé par la neige, & s'y abysme s'il fait un pas ».
La neige n'étant que de l'eau congelée ne peut se former que dans un air refroidi au degré de la congélation ou au-delà : si en tombant elle traverse un air chaud, elle sera fondue avant que d'arriver sur la terre ; c'est la raison pour laquelle on ne voit point de neige dans la zone torride, ni en été dans nos climats, si ce n'est sur les hautes montagnes. A Montpellier, où j'écris, je n'ai jamais vu neiger lorsque le thermometre a marqué plus de 5 degrés au-dessus du terme de la glace.
La neige survenant après quelques jours de forte gelée, on observe que le froid, quoique toujours voisin de la congélation, diminue sensiblement ; c'est que d'une part le tems doit être couvert pour qu'il neige, & que de l'autre les vents de sud, d'ouest, &c. qui couvrent le ciel de nuages, diminuent presque toujours la violence du froid, & souvent amenent le dégel.
C'est ce qui arrive pour l'ordinaire ; car tout le monde sait qu'il neige aussi quelquefois par un froid très-vif & très piquant, qui augmente lorsque la neige a cessé de tomber. M. Musschenbroek a observé que la neige qui tomboit en forme d'aiguilles étoit toujours suivie d'un froid considérable : celle qui tombe par un tems doux, & qui est mêlée avec la pluie, a des gros flocons ; ce qui est aisé à comprendre, plusieurs flocons se fondant alors en partie, & s'unissant entr'eux. Essais de Physique.
En Provence & dans tout le bas-Languedoc, le vent de nord-est, qu'on y appelle communément le vent grec, est celui qui amene le plus souvent la neige ; c'est qu'il y est froid & humide, & très-souvent pluvieux, par les raisons que nous exposerons ailleurs. Voyez Pluie.
Comme la neige tombe pour l'ordinaire en hiver, & toujours par un tems assez froid : il n'est pas surprenant que plusieurs physiciens ayent cru qu'elle n'étoit jamais accompagnée de tonnerre ; ils se trompoient certainement. Le 1 Janvier 1715, il éclaira & il tonna à Montpellier dans le tems même qu'il neigeoit. Il faut pourtant avouer que cela n'arrive que très-rarement. Dans le dernier siecle, il y eut à Senlis, à Châlons & dans les villes voisines, un orage des plus violens, au milieu de l'hiver : la foudre tomba en plusieurs endroits & fit d'effroyables ravages, pendant une neige fort grosse & fort épaisse. Le P. le Bossu, dans son traité du Poëme épique, oppose ce fait remarquable à la critique de Scaliger, qui a repris Homere d'avoir représenté les éclairs se suivant sans relâche & traversant les cieux, pendant que le maître du tonnere se prépare à couvrir la terre de grêle ou de monceaux de neige. Madame Dacier, après avoir rapporté ce fait, d'après le P. le Bossu, ne manque pas de dire qu'Homere avoit sans doute vû la même chose, & que les connoissances philosophiques de ce pere des poëtes étoient supérieures à celles de Scaliger. Illiad. liv. X. Notes de Madame Dacier sur ce livre.
Si la neige, comme on n'en sauroit douter, dépend dans sa formation de la constitution présente de l'atmosphere, il n'est pas moins certain qu'étant tombée, elle influe à son tour sur cette même constitution. Les vents qui ont passé sur des montagnes couvertes de neige, refroidissent toujours les plaines voisines où ils se font sentir : c'est la raison pour laquelle certains pays sont plus froids ou moins chauds qu'ils ne devroient être par leur situation sur notre globe. Les neiges qui couvrent perpétuellement les sommets des plus hautes montagnes de la chaîne des Cordillieres, moderent beaucoup les chaleurs qu'on ressent au Pérou, qui sans cela pourroient être excessives. Il en est de même de plusieurs autres pays situés dans la zone torride, ou, hors de cette zone, dans le voisinage des tropiques. Par la même raison certains pays, comme l'Arménie, sont très-froids, quoique sous la latitude de 40 degrés. M. Arbuthnot, dans son Essai des effets de l'air sur le corps humain, remarque que la neige des Alpes influe sur le tems qu'il fait en Angleterre. On observe dans le bas-Languedoc que lorsque les montagnes d'Auvergne & de Dauphiné, dont les premieres sont au nord, & les autres à l'est de cette province, sont également couvertes de neige, le vent de sud ne souffle presque jamais ; en sorte qu'on jouit au milieu de l'hiver du tems le plus serein. La raison en est que la froideur de la neige condensant l'air qui est au-tour de ces montagnes, cet air devenu plus pesant tend vers le sud, où il se raréfie, & fait par conséquent un vent de nord. La même chose arrive par la même raison quand les montagnes d'Auvergne sont plus chargées de neige que celles de Dauphiné ; mais si ces dernieres sont couvertes de neige pendant que celles d'Auvergne en sont déchargées, le vent du sud pourra souffler avec violence, l'air qui est au nord lui résistant alors trop foiblement. Physique de Regis, liv. V. chap. xj.
La neige se formant dans l'air, & n'étant que de de l'eau congelée, doit être mise au nombre des météores aqueux. Voyez Météore.
Tout le monde sait que la neige en se fondant fournit une grande quantité d'eau aux ruisseaux & aux fleuves, & que sa fonte trop subite cause souvent des inondations considérables.
Un très-grand nombre de plantes se conservent ensevelies dans la neige pendant l'hiver, & on les voit pousser au printems avec rapidité, pourvu que la neige qui les couvroit, se soit fondue lentement & peu-à-peu ; car en fondant subitement, elle pourroit détruire l'organisation & le tissu des végétaux. Rien n'est sur-tout plus pernicieux aux arbres & aux plantes qu'une neige, qui séjournant sur la terre, se fond en partie pendant le jour pour se geler de nouveau la nuit suivante. C'est ce qui fit mourir dans plusieurs contrées du bas-Languedoc & de la Provence quantité d'oliviers, de figuiers & d'autres arbres fruitiers pendant l'hiver de 1755, où l'on vit se renouveller en partie ce qu'on avoit éprouvé en 1709.
La neige peut être employée au défaut de la glace, dans la préparation d'une infinité de boissons rafraîchissantes nécessaires pour les délices de la vie, que la Philosophie même ne doit pas toujours négliger. Ces mêmes boissons sont d'usage en Médecine. Je ne dirai rien ici de plusieurs vertus attribuées à la neige assez gratuitement, non plus que de la propriété qu'elle a de guérir les membres gelés sur lesquels elle est appliquée. J'ai parlé ailleurs de cette propriété, & j'ai fait voir que la neige ne faisoit en pareil cas que ce qu'auroit fait de l'eau médiocrement froide. Voyez Gelée & Glace. Cet article est de M. de Ratte, secrétaire perpétuel de la société royale des Sciences de Montpellier.
Neige, (Mat. méd. & Diete.) c'est une des matieres que l'on emploie pour appliquer un degré de froid considérable, le froid glacial aux corps humains, ou à différentes substances destinées à fournir aux hommes des alimens & des boissons, ou des remedes. Les considérations qu'on a fait sur la glace, dans ce point de vue, conviennent pareillement & très-exactement à la neige. (Voyez Glace, Médecine.) Nous remarquerons seulement ici que c'est la neige spécialement que le peuple du nord emploie, d'après un très-ancien usage de leur pays, pour rappeller la chaleur & la vie dans les membres gelés. C'est communément sous forme de frictions que la neige s'emploie dans ces cas ; mais la simple application peut suffire. Agricola (Chirurgiæ parer. tract. 5.) assure que les engelures du nez ou des oreilles sont guéries dans un quart d'heure par l'application de la neige. Barkllei rapporte dans son Euphormion, part IV. chap. viij. qu'un roi d'Angleterre fut guéri en très-peu de tems d'une engelure au doigt, l'ayant plongé dans la neige par le conseil de certains habitans de Norvege.
Il y a dans l'art un usage fort bizarre qui paroît avoir été peu suivi, & qui enfin paroît entierement abandonné avec raison ; c'est d'éteindre le sentiment par l'application de la neige dans une partie sur laquelle on est sur le point d'exécuter une opération chirurgicale ; cependant ce moyen singulier pourroit absolument être employé peut-être avec avantage dans quelque cas singulier. (b)
Neige, eau de, (Chimie.) Voyez à l'article Eau, Chimie.
Neige, Oiseau de, (Hist. nat.) c'est un oiseau semblable à la linotte par la figure, le bec & la couleur, qui se trouve à Spitzberg. Son nom lui vient de ce qu'il ne se voit jamais que sur la neige glacée. Il est de la grosseur d'un moineau. Il a le bec court & pointu, & la tête aussi grosse que le cou. Ses jambes sont celles de la linotte, mais ses piés sont divisés en trois doigts armés d'ongles longs & crochus : il est blanc depuis la tête jusqu'à la queue, ainsi que sous le ventre ; les plumes du dos & des aîles sont grises. Ces oiseaux sont si familiers qu'ils se laissent prendre à la main ; ce qui est produit par la faim qu'ils éprouvent dans ce climat glacé. Leur chair est d'un assez bon goût.
Neige ou Nage, terme de riviere, espece d'oreillons qui se fabriquent aux deux extrémités d'un train, qui servent à porter les avirons pour nager, & qui sont faits d'un fort chantier chacun.
Neige, s. f. (terme de Confiseur.) composition de sucre & de jus de certains fruits, comme de framboise, de groseille ou de cerise qu'on fait glacer, & qu'on sert sur la table.
Neige, (Bout. Passement.) petite dentelle faite au métier, & qui est de peu de valeur.
Wiktionnaire
Nom commun - français
neige \n??\ féminin
-
(Météorologie) Forme de pluie cristalline se produisant lorsque la température descend en dessous de 0 °C, les gouttes d'eau s'étant transformées en flocons blancs et légers.
- La condensation des vapeurs ou nuages donne lieu à la pluie ou à la neige, suivant les températures. ? (Frère Ogérien, Histoire naturelle du Jura, tome 1 : Géologie, 1er fascicule, 1865, p. 112)
- Toutes ces brumes ne tarderont pas à se résoudre en neige, et, pour peu que le vent se lève, nous pourrons bien être battus par quelque grosse tempête. ? (Jules Verne, Le Pays des fourrures, J. Hetzel et Cie, Paris, 1873)
- Par suite de la difficulté des communications, résultant de l'encombrement des gares et des neiges qui obstruaient les voies, le capitaine Marois ne put arriver à Lyon que le 27 [?] ? (Général Antoine Chanzy, La Deuxième Armée de la Loire)
- Voici venir ces veillées de famille, si délicieuses quand tout au dehors est neige, verglas et brouillards [?] ? (Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit, 1842)
- Et, dans sa curiosité [?] de serviteur toujours prêt à mourir, comme ces soldats qui, seuls et abandonnés, criaient dans les neiges de la Russie : Vive l'Empereur ! ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- Nous étions loin des igloos de neige, demeures primitives des Groenlandais. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- Dans le bois, où j'arrive enfin à quatre pattes, la neige est crevée de myriades de trous, d'alvéoles profonds et serrés, ouverts par le dégel de midi. ? (Roger Vercel, Capitaine Conan, Albin Michel, 1934, collection Le Livre de Poche, page 12)
- [?] et des flocons de neige tremblotaient par instants dans le halo des réverbères au milieu des hachures de l'averse. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
- Seuls les enfants et les chiens semblent comprendre de quoi la neige est vraiment faite. La neige est faite d'eau transformée en congé scolaire, en parc d'amusement à l'échelle du village, c'est une abeille qui fond sur la langue, la disponibilité soudaine des deux parents à la fois. ? (Pascale Quiviger, Le cercle parfait, éditions L'Instant même, 2003, page 30)
-
(Par extension) Climat neigeux.
- L'Empire romain, qui s'étendait des sables d'Arabie jusqu'aux neiges d'Écosse, fut constamment à la recherche de frontières défendables. ? (Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L'Islam et l'État, 1987, traduction d'Odette Guitard, 1992, page 163)
- Ce qui présente l'apparence de la neige.
- J'étais alors enveloppé dans une nuée de moustiques blancs qui ne piquaient pas, mais dont le bruit m'étourdissait. Je restai bien cinq minutes dans ce brouillard vivant, pareil à ces tourbillons d'éphémères que l'on prendrait pour de la neige. ? (François-Auguste Biard, Deux années au Brésil, 1862)
-
(Argot) (Populaire) Cocaïne.
- À l'avenir, je ne prendrai que de la neige de qualité supérieure. J'y veillerai. Je ne remettrai jamais les pieds chez ce dealer de Brentwood. Jamais. ? (Dominique Antonin, Un peu d'encre sur la neige : l'expérience de la cocaïne par les écrivains, éditions du Lézard, 1997, page 194)
- Sniffer de la neige dans une Lamborghini Countach ? Difficile de trouver mieux, tu ne crois pas ? ? (Don Winslow, Cool, Seuil, 2012, page 159)
-
(Familier) (Télévision) Bruit blanc sur un écran de télévision analogique.
- Le drapeau américain strié des lignes verticales et horizontales de l'image vidéo, puis la neige envahit l'écran. Fin des programmes. ? (Cahiers du cinéma, 1990, no 434-438)
- En cette journée glaciale l'univers entier est devenu le grand tube cathodique d'un vieux poste de télévision après la fin des émissions, quand la neige envahit l'écran de ses parasites scintillants. ? (Brice Matthieussent, Good Vibrations : Chronique pour quatre personnages, POL Éditeur, 2014)
- (Botanique) (Antilles) Breynia nivosa?[1].
Trésor de la Langue Française informatisé
NEIGE, subst. fém.
Neigé, ée, au Scrabble
Le mot neigé, ée, vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot neige--ee- - 7 lettres, 5 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot neigé, ée, au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
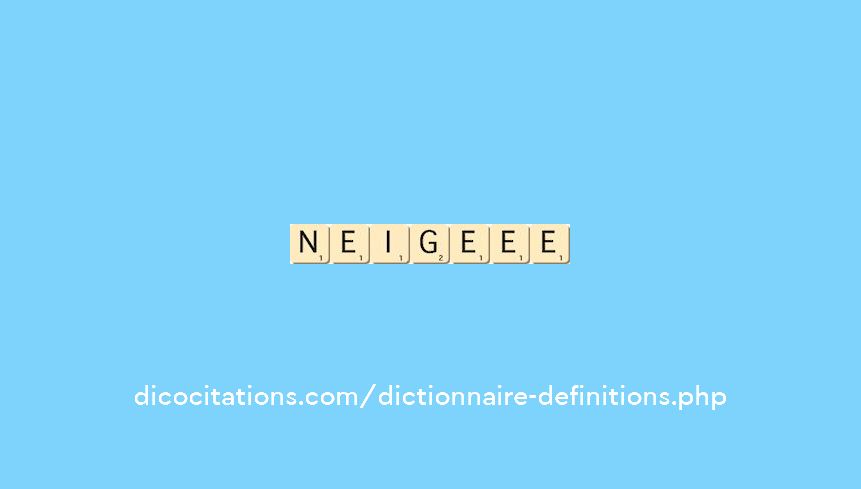
Les mots proches de Neigé, ée,
Neige Neigé, ée, Neiger Neigeux, euse neige neige neigé neigeait Neigem neiger neigera neigerait neiges neiges neigeuse neigeuses neigeuxMots du jour
Entr'accuser (s') Brière Mordieu Crotale Exiler Nourrisseur Niobé Puits Prochaineté Ensanglanté, ée
Les citations avec le mot Neigé, ée,
Les citations du Littré sur Neigé, ée,
Les mots débutant par Nei Les mots débutant par Ne
Une suggestion ou précision pour la définition de Neigé, ée, ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 11h58

- Nain - Naissance - Naitre - Naître - Naivete - Nation - Nature - Necessite - Neutre - Noblesse - Noël - Noir - Normalisation - Normalite - Nostalgie - Nourriture - Nouveau - Nouvel_an - Nuit
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur neigé, ée,
Poèmes neigé, ée,
Proverbes neigé, ée,
La définition du mot Neigé, ée, est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Neigé, ée, sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Neigé, ée, présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
