Définition de « adverbe »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot adverbe de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur adverbe pour aider à enrichir la compréhension du mot Adverbe et répondre à la question quelle est la définition de adverbe ?
Une définition simple : (fr-rég|ad.v??b)
Définitions de « adverbe »
Trésor de la Langue Française informatisé
ADVERBE, subst. masc.
GRAMM. Partie du discours neutre et invariable qui peut être rapportée à un verbe, à un adjectif, à une préposition ou à un autre adverbe, c'est-à-dire à toute partie du discours (autre que l'article et les déterminatifs) qui se réfère elle-même à un terme lui servant de support. Mot appartenant à cette partie du discours :Wiktionnaire
Nom commun - français
adverbe \ad.v??b\ masculin
-
(Grammaire) Mot généralement invariable qui se joint avec les verbes, les adjectifs ou les adverbes et qui les nuance de diverses manières.
- Tout est métaphysique dans ces deux parties surtout; et si je veux me soustraire, ou soustraire mes élèves aux idées abstraites, il faudra absolument me borner à dire qu'un nom est un nom, ou un mot qui se décline, même dans les langues où l'on ne décline pas ; qu'un verbe est un verbe, ou un mot qui se conjugue, y eût-il des langues où l'on ne conjuguât pas; qu'un adverbe est un mot qui se place auprès du verbe, en dépit de l'usage qui le place si souvent ailleurs, etc. ? (Dieudonné Thiébault, « Instruction publique » dans Frédéric-le-Grand sa famille, sa cour, son gouvernement, etc., tome 5 : Son académie, ses amis philosophes et littérateurs, 4e éd. publiée par son fils le baron Thiébault, Paris : chez A. Dossange & chez Arthus Bertrand, Leizig : chez A. Dossange, 1827, p. 213)
- Un dernier travail de peaufinage consistera à enlever les mots qui ne servent à rien, les adverbes qui alourdissent et vous êtes prêt(e) pour la dernière étape : lisez-le à voix haute, en veillant à garder une tonalité neutre. ? (Jérôme Lefeuvre, Les 5 règles d'or pour bien communiquer, Hachette Pratique, 2012)
- Les adverbes « soudain » ou « brusquement » ne sont jamais utilisés par les Morvandiaux qui leur préfèrent, de loin, la locution « tout par un coup »: [?]. ? (Henri Micaux, On m'a dit? dans le Morvan: histoires presque vraies, 2004, page 87)
- Un jour il se présente au Colonel avant un départ en mission : « Mon Colonel, je venais vous prier déféremment d'accepter mes respects ». L'adverbe était si bien dans la note professionnelle que tous les assistants, dont le Colonel, ont éclaté de rire, sans que le type comprenne leur hilarité. ? (Daniel Gallois, Inédits, Association des amis de Daniel Gallois, 1979, page 87)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Grammaire. Mot invariable qui se joint avec les verbes, les adjectifs ou les adverbes et qui les modifie de diverses manières. Adverbe de lieu. Adverbe de temps. Adverbe dérivé d'un verbe. Adverbe dérivé d'un adjectif. Ici et là sont des adverbes de lieu. Aujourd'hui, demain, bientôt, tantôt sont des adverbes de temps. Beaucoup et peu sont des adverbes de quantité. Doucement et fortement sont des adverbes de manière.
Littré
- Terme de grammaire. Partie invariable du discours qui modifie les verbes ou les adjectifs.
HISTORIQUE
XIIIe s. Averbes et pars d'oraison
, Bat. des sept Arts.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
ADVERBE. - HIST. Ajoutez?:
XVIe s. L'adverbe c'est un mot sans nombre qui est adjoinct à un autre
, Ramus, dans LIVET, Gramm. franç. p. 232.
Encyclopédie, 1re édition
ADVERBE, s. m. terme de Grammaire : ce mot est formé de la préposition Latine ad, vers, auprès, & du mot verbe ; parce que l'adverbe se met ordinairement auprès du verbe, auquel il ajoûte quelque modification ou circonstance : il aime constamment, il parle bien, il écrit mal. Les dénominations se tirent de l'usage le plus fréquent : or le service le plus ordinaire des adverbes est de modifier l'action que le verbe signifie, & par conséquent de n'en être pas éloignés ; & voilà pourquoi on les a appellés adverbes, c'est-à-dire mots joints au verbe ; ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait des adverbes qui se rapportent aussi au nom adjectif, au participe & à des noms qualificatifs, tels que roi, pere, &c. car on dit, il m'a paru fort changé ; c'est une femme extrèmement sage & fort aimable ; il est véritablement roi.
En faisant l'énumération des différentes sortes de mots qui entrent dans le discours, je place l'adverbe après la préposition, parce qu'il me paroît que ce qui distingue l'adverbe des autres especes de mots, c'est que l'adverbe vaut autant qu'une préposition & un nom ; il a la valeur d'une préposition avec son complément ; c'est un mot qui abrége ; par exemple, sagement vaut autant que avec sagesse.
Ainsi tout mot qui peut être rendu par une préposition & un nom, est un adverbe ; par consequent ce mot y, quand on dit il y est, ce mot, dis-je, est un adverbe qui vient du Latin ibi ; car il y est est comme si l'on disoit, il est dans ce lieu-là, dans la maison, dans la chambre, &c.
Où est encore un adverbe qui vient du Latin ubi, que l'on prononçoit oubi, où est-il ? c'est-à-dire, en quel lieu.
Si, quand il n'est pas conjonction conditionnelle, est aussi adverbe, comme quand on dit, elle est si sage, il est si savant ; alors si vient du Latin sic, c'est-à-dire, à ce point, au point que, &c. c'est la valeur ou signification du mot, & non le nombre des syllabes, qui doit faire mettre un mot en telle classe plûtôt qu'en telle autre ; ainsi à est préposition quand il a le sens de la préposition Latine à ou celui de ad, au lieu que a est mis au rang des verbes quand il signifie habet, & alors nos peres écrivoient ha.
Puisque l'adverbe emporte toûjours avec lui la valeur d'une préposition, & que chaque préposition marque une espece de maniere d'être, une sorte de modification dont le mot qui suit la préposition fait une application particuliere ; il est évident que l'adverbe doit ajoûter quelque modification ou quelque circonstance à l'action que le verbe signifie ; par exemple, il a été reçû avec politesse ou poliment.
Il suit encore de-là que l'adverbe n'a pas besoin lui-même de complément ; c'est un mot qui sert à modifier d'autres mots, & qui ne laisse pas l'esprit dans l'attente nécessaire d'un autre mot, comme font le verbe actif & la préposition ; car si je dis du Roi qu'il a donné, on me demandera quoi & à qui. Si je dis de quelqu'un qu'il s'est conduit avec, ou par, ou sans, ces prépositions font attendre leur complément ; au lieu que si je dis, il s'est conduit prudemment, &c. l'esprit n'a plus de question nécessaire à faire par rapport à prudemment : je puis bien à la vérité demander en quoi a consisté cette prudence ; mais ce n'est plus là le sens nécessaire & grammatical.
Pour bien entendre ce que je veux dire, il faut observer que toute proposition qui forme un sens complet est composée de divers sens ou concepts particuliers, qui, par le rapport qu'ils ont entr'eux, forment l'ensemble ou sens complet.
Ces divers sens particuliers, qui sont comme les pierres du bâtiment, ont aussi leur ensemble. Quand je dis le soleil est levé ; voilà un sens complet : mais ce sens complet est composé de deux concepts particuliers : j'ai le concept de soleil, & le concept de est levé : or remarquez que ce dernier concept est composé de deux mots est & levé, & que ce dernier suppose le premier. Pierre dort : voilà deux concepts énoncés par deux mots : mais si je dis, Pierre bat, ce mot bat n'est qu'une partie de mon concept, il faut que j'énonce la personne ou la chose que Pierre bat : Pierre bat Paul ; alors Paul est le complément de bat : bat Paul est le concept entier, mais concept partiel de la préposition Pierre bat Paul.
De même si je dis Pierre est avec, sur, ou dans, ces mots avec, sur, ou dans ne sont que des parties de concept, & ont besoin chacun d'un complément ; or ces mots joints à un complément font un concept, qui, étant énoncé en un seul mot, forme l'adverbe, qui, en tant que concept particulier & tout formé, n'a pas besoin de complément pour être tel concept particulier.
Selon cette notion de l'adverbe, il est évident que les mots qui ne peuvent pas être réduits à une préposition suivie de son complément, sont ou des conjonctions ou des particules qui ont des usages particuliers : mais ces mots ne doivent point être mis dans la classe des adverbes ; ainsi je ne mets pas non, ni oui parmi les adverbes ; non, ne, sont des particules négatives.
A l'égard de oui, je crois que c'est le participe passif du verbe ouir, & que nous disons oui par ellipse, cela est oui, cela est entendu : c'est dans le même sens que les Latins disoient, dictum puto. Ter. Andr. act. I. sc. 1.
Il y a donc autant de sortes d'adverbes qu'il y a d'especes de manieres d'êtres qui peuvent être énoncées par une préposition & son complément, on peut les réduire à certaines classes.
Adverbes de tems. Il y a deux questions de tems, qui se font par des adverbes, & auxquelles on répond ou par des adverbes ou par des prépositions avec un complément.
1. Quando, quand viendrez-vous ? demain, dans trois jours.
2. Quandiu, combien de tems ? tandiu, si long-tems que, autant de tems que.
D. Combien de tems Jesus-Christ a-t-il vêcu ? R. Trente-trois ans : on sous-entend pendant.
Voici encore quelques adverbes de tems : donec jusqu'à ce que ; quotidie tous les jours : on sous-entend la préposition pendant, per : nunc maintenant, présentement, alors, c'est-à-dire à l'heure.
Auparavant : ce mot étant adverbe ne doit point avoir de complément ; ainsi c'est une faute de dire auparavant cela ; il faut dire avant cela, autrefois, dernierement.
Hodie, aujourd'hui, c'est-à-dire au jour de hui, au jour présent ; on disoit autrefois simplement hui, je n'irai hui. Nicod. Hui est encore en usage dans nos provinces méridionales ; heri, hier ; cras, demain ; olim, quondam, alias, autrefois, un jour, pour le passé & pour l'avenir.
Aliquando, quelquefois ; pridie, le jour de devant ; postridie, quasi posterà die, le jour d'après ; perindie, après demain ; mane, le matin ; vespere & vesperi, le soir ; sero, tard ; nudius-tertius, avant-hier, c'est-à-dire, nunc est dies tertius, quartus, quintus, &c. il y a trois, quatre, cinq jours, &c. unquam, quelques jours, avec affirmation ; nunquam, jamais, avec négation ; jam, déjà ; nuper, il n'y a pas long-tems.
Diu, long-tems ; recens & recenter, depuis peu ; jam-dudum, il y a long-tems ; quando, quand ; antehac, ci-devant ; posthac, ci-après ; dehinc, deinceps, à l'avenir ; antea, priùs, auparavant ; antequam, priusquam, avant que ; quoad, donec, jusqu'à ce que ; dum, tandis que ; mox, bien-tôt ; statim, dabord, tout-à-l'heure ; tum, tunc, alors ; etiam-nunc, ou etiam-num, encore maintenant ; jam-tum, dès-lors ; prope-diem, dans peu de tems ; tandem, demum, denique, enfin ; deinceps, à l'avenir ; plerumque, crebro, frequenter, ordinairement, d'ordinaire.
Adverbes de lieu. Il y a quatre manieres d'envisager le lieu : on peut le regarder 1°. comme étant le lieu où l'on est, où l'on demeure ; 2°. comme étant le lieu où l'on va ; 3°. comme étant le lieu par où l'on passe ; 4°. comme étant le lieu d'où l'on vient. C'est ce que les Grammairiens appellent in loco, ad locum, per locum, de loco ; ou autrement, ubi, quo, qua, unde.
1. In loco, ou ubi, où est-il ? il est là ; où & là, sont adverbes ; car on peut dire en quel lieu ? R. en ce lieu ; hic, ici, où je suis ; istic, où vous êtes ; illic, & ibi, là où il est.
2. Ad locum, ou quò ; ce mot pris aujourd'hui adverbialement, est un ancien accusatif neutre, comme duo & ambo ; il s'est conservé en quocirca, c'est pourquoi, c'est pour cette raison : quò vadis, où allez-vous ? R. Huc, ici ; istuc, là où vous êtes ; illuc, là où il est ; eò, là.
3. Qua ? qua ibo ? là, où irai-je ? R. hac, par ici ; istac, par là où vous êtes ; illac, par là où il est.
4. Unde ? unde venis ? D'où venez-vous ? hinc, d'ici ; istinc, de-là ; illinc, de-là ; inde, de-là.
Voici encore quelques adverbes de lieu ou de situation ; y, il y est, ailleurs, devant, derriere, dessus, dessous, dedans, dehors, partout, autour.
De quantité : quantum, combien ; multum, beaucoup, qui vient de bella copia, ou selon un beau coup ; parum, peu ; minimum, fort peu ; plus, ou ad plus, davantage ; plurimum, très-fort ; aliquantulum, un peu ; modicè, médiocrement ; largè, amplement ; affatim, abundanter, abundè, copiosè, ubertim, en abondance, à foison, largement.
De qualité : doctè, savamment ; piè, pieusement ; ardenter, ardemment ; sapienter, sagement ; alacriter, gaiement ; benè, bien ; malè, mal ; feliciter, heureusement ; & grand nombre d'autres formés des adjectifs, qui qualifient leurs substantifs.
De maniere : celeriter, promptement ; subitò, tout d'un coup ; lentè, lentement ; festinanter, properè, properanter, à la hâte ; sensim, peu-à-peu ; promiscuè, confusément ; protervè, insolemment ; multifariam, de diverses manieres ; bifariam, en deux manieres : racine, bis & viam, ou faciem, &c.
Utinam peut être regardé comme une interjection, ou comme un adverbe de desir, qui vient de ut, uti, & de la particule explétive nam : nous rendons ce mot par une périphrase, plût à Dieu que.
Il y a des adverbes qui servent à marquer le rapport, ou la relation de ressemblance : ita ut, ainsi que ; quasi, ceu, par un c, ut, uti, velut, veluti, sic, sicut, comme, de la même maniere que ; tanquam, de même que.
D'autres au contraire marquent diversité ; aliter, autrement ; alioquin, cæteroquin, d'ailleurs, autrement.
D'autres adverbes servent à compter combien de fois : semel, une fois ; bis, deux fois ; ter, trois fois, &c. en François, nous sous-entendons ici quelques prépositions, pendant, pour, par trois fois ; quoties, combien de fois ; aliquoties, quelquefois ; quinquies, cinq fois ; centies, cent fois ; millies, mille fois ; iterum, denuò, encore ; saepè, crebrò, souvent ; rarò, rarement.
D'autres sont adverbes de nombre ordinal, primò, premierement ; secundò, secondement, en second lieu : ainsi des autres.
D'interrogation : quare, c'est-à-dire, quâ de re, & par abréviation, cur, quamobrem, ob quam rem, quapropter, pourquoi, pour quel sujet ; quomodò, comment. Il y a aussi des particules qui servent à l'interrogation, an, anne, num, nunquid, nonne, ne, joint à un mot ; vides-ne ? voyez-vous ? ec joint à certains mots, ecquando, quand ? ecquis, qui ? ecqua mulier (Cic.), quelle femme ?
D'affirmation : etiam, ita, ainsi ; certè, certainement ; sanè, vraiment, oui, sans doute : les Anciens disoient aussi Hercle, c'est-à-dire, par Hercule ; Pol, Ædepol, par Pollux ; Næcastor, ou Mecastor, par Castor, &c.
De négation : nullatenus, en aucune maniere ; nequaquam, haudquaquam, neutiquam, minimè, nullement, point du tout ; nusquam, nulle part, en aucun endroit.
De diminution : fermè, ferè, penè, propè, presque ; tantum non, peu s'en faut.
De doute : fors, forte, forsan, forsitan, fortasse, peut-être.
Il y a aussi des adverbes qui servent dans le raisonnement, comme quia, que nous rendons par une préposition & un pronom, suivi du relatif que, parce que, propter illud quod est ; atque ita, ainsi ; atqui, or ; ergo, par conséquent.
Il y a aussi des adverbes qui marquent assemblage : una, simul, ensemble ; conjunctim, conjointement ; pariter, juxta, pareillement : d'autres division : seorsim, seorsum, privatim, à part, en particulier, séparément ; sigillatim, en détail, l'un après l'autre.
D'exception : tantum, tantummodo, solum, solummodo, duntaxat, seulement.
Il y a aussi des mots qui servent dans les comparaisons pour augmenter la signification des adjectifs : par exemple on dit au positif pius, pieux ; magis pius, plus pieux ; maximè pius, très-pieux ; ou fort pieux. Ces mots plus, magis, très-fort, sont aussi considérés comme des adverbes : fort, c'est-à-dire fortement, extrèmement ; très, vient de ter, trois fois ; plus, c'est-à-dire, ad plus, selon une plus grande valeur, &c. minus, moins, est encore un adverbe qui sert aussi à la comparaison.
Il y a des adverbes qui se comparent, surtout les adverbes de qualité, ou qui expriment ce qui est susceptible de plus ou de moins : comme diu, long-tems ; diutius, plus long-tems ; doctè, savamment ; doctius, plus savamment ; doctissimè, très-savamment ; fortiter, vaillamment ; fortiùs, plus vaillamment ; fortissimè, très-vaillamment.
Il y a des mots que certains Grammairiens placent avec les conjonctions, & que d'autres mettent avec les adverbes : mais si ces mots renferment la valeur d'une préposition, & de son complément, comme quia, parce que ; quapropter, c'est pourquoi, &c. ils sont adverbes, & s'ils font de plus l'office de conjonction, nous dirons que ce sont des adverbes conjonctifs.
Il y a plusieurs adjectifs en Latin & en François qui sont pris adverbialement. transversa tuentibus hircis, où transversa est pour transversè, de travers ; il sent bon, il sent mauvais, il voit ciair, il chante juste, parlez bas, parlez haut, frappez fort. (F)
Étymologie de « adverbe »
Provenç. adverbe, adverbi?; espagn. adverbio?; ital. avverbio?; de adverbium, de ad, à, et verbum, verbe (voy. VERBE).
- Du latin adverbium.
adverbe au Scrabble
Le mot adverbe vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot adverbe - 7 lettres, 3 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot adverbe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
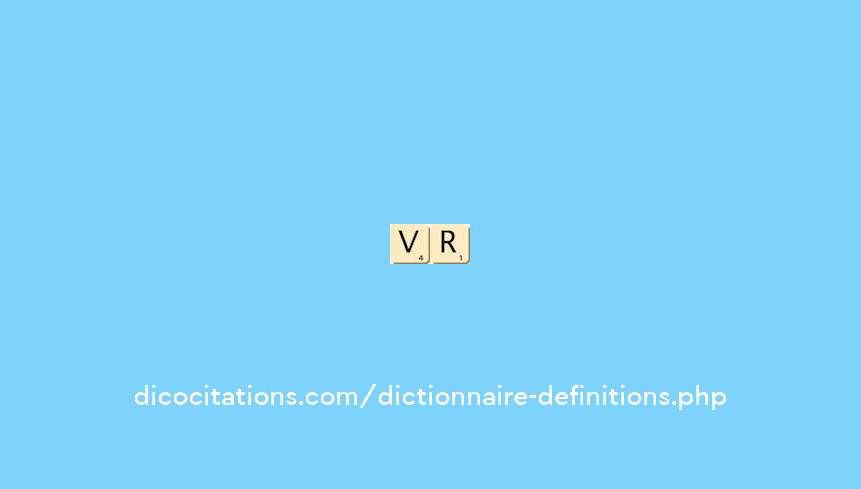
Les rimes de « adverbe »
On recherche une rime en RB .
Les rimes de adverbe peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Rb
Rimes de barbe Rimes de sorbes Rimes de exacerbe Rimes de masturbent Rimes de bourbe Rimes de superbes Rimes de rhubarbes Rimes de résorbent Rimes de Dourbes Rimes de gerbent Rimes de verbe Rimes de fourbes Rimes de herbe Rimes de adverbes Rimes de fourbe Rimes de serbe Rimes de barbes Rimes de adverbe Rimes de proverbe Rimes de serbes Rimes de théorbes Rimes de malherbe Rimes de barbent Rimes de gerbes Rimes de masturbe Rimes de courbe Rimes de superbe Rimes de imberbe Rimes de courbent Rimes de birbe Rimes de birbes Rimes de courbes Rimes de courbe Rimes de recourbe Rimes de absorbent Rimes de résorbe Rimes de courbe Rimes de courbes Rimes de théorbe Rimes de exacerbent Rimes de barbes Rimes de tourbes Rimes de gerbes Rimes de serbe Rimes de euphorbe Rimes de superbe Rimes de proverbes Rimes de verbes Rimes de gerbe Rimes de chtourbeMots du jour
barbe sorbes exacerbe masturbent bourbe superbes rhubarbes résorbent Dourbes gerbent verbe fourbes herbe adverbes fourbe serbe barbes adverbe proverbe serbes théorbes malherbe barbent gerbes masturbe courbe superbe imberbe courbent birbe birbes courbes courbe recourbe absorbent résorbe courbe courbes théorbe exacerbent barbes tourbes gerbes serbe euphorbe superbe proverbes verbes gerbe chtourbe
Les citations sur « adverbe »
- L'absolu n'a guère plus de sens aujourd'hui que son adverbe.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- «Enfin», dit-il. «Encore», pensa-t-elle. Les dissentiments commencent souvent par une question d'adverbes.Auteur : Denis Langlois - Source : ARPA, Revue de poésie (janvier 2008)
- Je vous aime beaucoup. Ou plutôt non, je retire beaucoup. Cet adverbe d'intensité serait restrictif. Dans certains cas, le verbe aimer doit être employé seul.Auteur : Maurice Denuzière - Source : Amélie ou la concordance des temps (2001)
- Aimer, ça se conjugue sans adverbe et sans condition.Auteur : Katherine Pancol - Source : Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi (2010)
- Aujourd'hui: adverbe désignant le jour où on est. Définition risible quand aujourd'hui n'est pas un repère mais un simple rappel d'hier, identique à avant-hier et à demain.Auteur : Nina Bouraoui - Source : La Voyeuse interdite (1991)
- Dans la langue française n'est-il pas amusant de constater que mot est bien un mot; que nom est un mot et un nom; que adjectif est un mot, un nom et un adjectif; tandis que adverbe n'est pas un adverbe.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le tour du chat en 365 jours (2006)
- Légalement est un adverbe bien robuste, il supporte bien des fortunes.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Les Paysans (1855)
- Dieu aime les adverbes.Auteur : Joseph Hall - Source : Holy Observations, 1607
- Elle cueille son verre délicatement (ah, que l'adverbe est donc la prise de conscience de la langue!) ...Auteur : Frédéric Dard - Source : San-Antonio, Remets ton slip, gondolier (1976)
- Vous... vous, je vous aime exactement. Il ne concevait pas de plus belle déclaration d'amour. Je vous aime exactement. Peut-être laisserait-il un temps entre le verbe et son adverbe: Je vous aime... exactement. Peut-être pas.Auteur : Daniel Pennac - Source : La petite marchande de prose (1989)
- Extérieurement, je suis déclinable. En moi-même (subjectivement), je suis absolument indéclinable. «Je ne m'accorde pas.» Un «adverbe» en quelque sorte.Auteur : Vassili Vassilievitch Rozanov - Source : Esseulement (1912)
- J'aime un peu les petits pois, beaucoup les endives braisées, pas du tout les rutabagas, mais Roméo aime Juliette. Sans adverbe.Auteur : Katherine Pancol - Source : Scarlett, si possible (1985)
- Si. Le mot le plus lourd de sens et d'implications, dans toutes les langues. Surtout quand on y accole l'adverbe seulement.Auteur : Douglas Kennedy - Source : Quitter le monde (2009)
- Tant de pages, tant de livres qui furent nos sources d'émotion, et que nous relisons pour y étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs!Auteur : Emil Cioran - Source : Syllogismes de l'amertume (1952)
- Les journalistes ne doivent pas oublier qu'une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ceux qui voudront user d'un adjectif passeront me voir dans mon bureau. Ceux qui emploieront un adverbe seront foutus à la porte.Auteur : Georges Clemenceau - Source : Circulaire signée alors qu'il était rédacteur en chef de L'Aurore.
Les mots proches de « adverbe »
Adverbe Advers, erse Adversaire Adverse Adversité AdvertanceLes mots débutant par adv Les mots débutant par ad
advenait advenir adventices adventiste adventiste advenu advenue advenue advenues adverbe adverbes adversaire adversaires adverse adverses adversité adversités adviendra adviendrait advienne adviennent advient advînt advint
Les synonymes de « adverbe»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot adverbe dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « adverbe » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot adverbe dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Adverbe ?
Citations adverbe Citation sur adverbe Poèmes adverbe Proverbes adverbe Rime avec adverbe Définition de adverbe
Définition de adverbe présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot adverbe sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot adverbe notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 7 lettres.
