La définition de Ode du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Ode
Nature : s. f.
Prononciation : o-d'
Etymologie : Le grec signifie, chant, ode ; sanscr. vad, parler.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de ode de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec ode pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Ode ?
La définition de Ode
Chez les anciens, poëme destiné à être chanté.
Toutes les définitions de « ode »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Antiquité. Poème lyrique composé d'une strophe, d'une antistrophe et d'une épode, que le chœur chantait en décrivant certaines évolutions. Les odes de Pindare. Par analogie, il se dit d'un Poème lyrique divisé en strophes qui sont ordinairement semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers. Les odes d'Horace, de Ronsard, de Victor Hugo. Ode héroïque, Celle dont le sujet et le style sont nobles, élevés. Ode anacréontique, Celle dont le sujet et le style sont légers, gracieux.
Littré
-
1Chez les anciens, poëme destiné à être chanté.
Il [Alexandre] battit les Grecs qui tentèrent vainement de secouer le joug, et ruina Thèbes où il n'épargna que la maison et les descendants de Pindare, dont la Grèce admirait les odes
, Bossuet, Hist. I, 8.Vos odes sont tendres, gracieuses, souvent véhémentes, rapides, sublimes
, Fénelon, Dial. des morts anc. Horace, Virgile.Une ode de Pindare fut anciennement inscrite en caractères d'or dans un temple de Minerve
, Bitaubé, Instit. Mém. litt. et beaux-arts, t. IV, p. 411. -
2Aujourd'hui, poëme divisé en strophes semblables par le nombre et la mesure des vers.
L'ode avec plus d'éclat et non moins d'énergie, Élevant jusqu'au ciel son vol ambitieux, Entretient dans ses vers commerce avec les dieux?; Aux athlètes dans Pise elle ouvre la barrière, Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière, Mène Achille sanglant au bord du Simoïs, Ou fait fléchir l'Escaut sous le joug de Louis
, Boileau, Art p. II.L'ode était assez oubliée depuis Malherbe?; l'élévation qu'elle demande, les contraintes particulières qu'elle impose avaient causé sa disgrâce?
, Fontenelle, Rép. évêq. Luç. ?uv. t. III, p. 351, dans POUGENS.De toutes les odes modernes, celle où il règne le plus grand enthousiasme qui ne s'affaiblit jamais, et qui ne tombe ni dans le faux ni dans l'ampoulé, est le Timothée ou la fête d'Alexandre par Dryden?; elle est encore regardée en Angleterre comme un chef-d'?uvre inimitable, dont Pope n'a pu approcher quand il a voulu s'exercer dans le même genre
, Voltaire, Dict. phil. Enthousiasme.L'ode dont l'orgueil rejette encore plus ce qui est commun dans les expressions que dans les idées
, D'Alembert, Éloges, Lamotte.La faveur que l'ode semble avoir perdue, l'épître paraît l'avoir gagnée
, D'Alembert, Mél. t. V, Réflexions sur l'ode.Ode héroïque, celle dont le sujet et le style sont nobles élevés.
Ode anacréontique, celle dont le sujet et le style sont légers, gracieux.
- 3S. f. pl. Les odes, recueil qui contient les odes d'un auteur. Les odes de Victor Hugo.
- 4Ode-symphonie, poëme musical mêlé de chant, de récitatif noté et parlé, et dans lequel l'orchestre joue un rôle très important. Le Désert de Félicien David est une ode-symphonie.
HISTORIQUE
XVIe s. Et osay le premier des nostres enrichir ma langue de ce nom d'ode
, Ronsard, Ép. au lecteur, Odes. Ce nom d'ode a esté introduit de nostre temps par Pierre de Ronsard
, Pelletier du Mans, Art poétique, liv. II, Ode. Fameux harpeur et prince de nos odes
, Du Bellay, J. II, 22, recto. Introduisismes entre autres deux nouvelles especes de poesie?: les odes dont nous empruntasmes la façon des Grecs et Latins?
, Pasquier, Recherches, liv. VII, p. 611. Car depuis que Ronsard eut amené les modes Du tour et du retour et du repos des odes, Imitant la pavane ou du roi le grand bal, Le françois n'eut depuis en Europe d'egal
, Vauquelin, Art poétique, dans RICHELET.
Encyclopédie, 1re édition
ODE, s. f. (Poésie lyriq.) Dans la poésie greque & latine, l'ode est une piece de vers qui se chantoit, & dont la lyre accompagnoit la voix. Le mot ode signifie chant, chanson, hymne, cantique.
Dans la poésie françoise, l'ode est un poëme lyrique, composé d'un nombre égal de rimes plates ou croisées, & qui se distingue par strophes qui doivent être égales entr'elles, & dont la premiere fixe la mesure des autres.
L'ode avec plus d'éclat, & non moins d'énergie,
Elevant jusqu'au ciel son vol ambitieux,
Entretient dans ses vers commerce avec les dieux ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrier ;
Mene Achille sanglant au bord du Simoïs,
Ou fait fléchir l'Escaut sous le joug de Louis ;
Son style impétueux souvent marche au hasard,
Chez elle un beau desordre est un effet de l'art.
C'est M. Boileau qui parle, & qui dans ses beaux vers si dignes de la sublime matiere qu'il traite, donne sur cette espece de poésie des préceptes excellens qu'il a essayé de pratiquer lui-même avec assez peu de succès.
Comme l'ode est une poésie faite pour exprimer les sentimens les plus passionnés, elle admet l'enthousiasme, le sublime lyrique, la hardiesse des débuts, les écarts, les digressions, enfin le desordre poétique. Nous pouvons en croire Rousseau sur ce sujet : écoutons-le.
Si pourtant quelque esprit timide
Du Pinde ignorant les détours,
Opposoit les regles d'Euclide
Au desordre de mes discours ;
Qu'il sache qu'autrefois Virgile
Fit même aux Muses de Sicile
Approuver de pareils transports :
Et qu'enfin cet heureux délire
Des plus grands maîtres de la lyre
Immortalise les accords.
L'enthousiasme ou fureur poétique est ainsi nommée, parce que l'ame qui en est remplie est toute entiere à l'objet qui le lui inspire. Ce n'est autre chose qu'un sentiment quel qu'il soit, amour, colere, joie, admiration, tristesse, &c. produit par une idée.
Ce sentiment n'a pas proprement le nom d'enthousiasme, quand il est naturel, c'est-à-dire, qu'il existe dans un homme qui l'éprouve par la réalité même de son état ; mais seulement quand il se trouve dans un artiste, poëte, peintre, musicien ; & qu'il est l'effet d'une imagination échauffée artificiellement par les objets qu'elle se représente dans la composition.
Ainsi l'enthousiasme des artistes n'est qu'un sentiment vif, produit par une idée vive, dont l'artiste se frappe lui-même.
Il est aussi un enthousiasme doux qu'on éprouve quand on travaille sur des sujets gracieux, délicats, & qui produisent des sentimens forts, mais paisibles.
Le sublime qui appartient à l'ode est un trait qui éclaire ou qui brûle. Voici comment il se forme, dit l'auteur des Beaux-Arts réduits au même principe.
Un grand objet frappe le poëte : son imagination s'éleve & s'allume : elle produit des sentimens vifs qui agissent à leur tour sur l'imagination & augmentent encore son feu. De là les plus grands efforts pour exprimer l'état de l'ame : de-là les termes riches, forts, hardis, les figures extraordinaires, les tours singuliers. C'est alors que les prophetes voient les collines du monde qui s'abaissent sous les pas de l'éternité ; que la mer fuit ; que les montagnes tressaillissent. C'est alors qu'Homere voit le signe de tête que Jupiter fait à Thétis, & le mouvement de son front immortel qui fait balancer l'univers.
Le sublime de l'ode consiste donc dans l'éclat des images & dans la vivacité des sentimens. C'est cette vivacité qui produit la hardiesse des débuts, les écarts, les digressions & le desordre lyrique, dont nous allons maintenant parler.
Le début de l'ode est hardi, parce que quand le poëte saisit sa lyre, on le suppose fortement frappé des objets qu'il se représente. Son sentiment éclate, part comme un torrent qui rompt la digue : & en conséquence il n'est guere possible que l'ode monte plus haut que son début ; mais aussi le poëte, s'il a du goût, doit s'arrêter précisément à l'endroit où il commence à descendre.
Les écarts de l'ode sont une espece de vuide entre deux idées, qui n'ont point de liaison immédiate. On sait quelle est la vîtesse de l'esprit. Quand l'ame est échauffée par la passion, cette vîtesse est incomparablement plus grande encore. La fougue presse les pensées & les précipite : & comme il n'est pas possible de les exprimer toutes, le poëte seulement saisit les plus remarquables, & les exprimant dans le même ordre qu'elles avoient dans son esprit, sans exprimer celles qui leur servoient de liaison, elles ont l'air d'être disparates & décousues. Elles ne se tiennent que de loin, & laissent par conséquent entr'elles quelques vuides qu'un lecteur remplit aisément, quand il a de l'ame & qu'il a saisi l'esprit du poëte.
Les écarts ne doivent se trouver que dans les sujets qui peuvent admettre des passions vives, parce qu'ils sont l'effet d'une ame troublée, & que le trouble ne peut être causé que par des objets importans.
Les digressions dans l'ode sont des sorties que l'esprit du poëte fait sur d'autres sujets voisins de celui qu'il traite, soit que la beauté de la matiere l'ait tenté, ou que la stérilité de son sujet l'ait obligé d'aller chercher ailleurs dequoi l'enrichir.
Il y a des digressions de deux sortes : les unes qui sont des lieux communs, des vérités générales, souvent susceptibles des plus grandes beautés poétiques ; comme dans l'ode où Horace, à-propos d'un voyage que Virgile fait par mer, se déchaîne contre la témérité sacrilege du genre humain que rien ne peut arrêter. L'autre espece est des traits d'histoire ou de la fable, que le poete emploie pour prouver ce qu'il a en vûe. Telle est l'histoire de Régulus, & celle d'Europe dans le même poëte. Ces digressions sont plus permises aux lyriques qu'aux autres, pour la raison que nous avons dite.
Le desordre poétique de l'ode consiste à présenter les choses brusquement & sans préparation, ou à les placer dans un ordre qu'elles n'ont pas naturellement : c'est le desordre des choses. Il y a celui des mots d'où résulte des tours qui, sans être forcés, paroissent extraordinaires & irréguliers.
En général les écarts, les digressions, le desordre, ne doivent servir qu'à varier, animer, enrichir le sujet. S'ils l'obscurcissent, le chargent, l'embarassent, ils sont mauvais. La raison ne guidant pas le poëte, il faut au moins qu'elle puisse le suivre : sans cela l'enthousiasme n'est qu'un délire, & les égaremens qu'une folie.
Des observations précédentes, on peut tirer deux conséquences.
La premiere est que l'ode ne doit avoir qu'une étendue médiocre. Car si elle est toute dans le sentiment, & dans le sentiment produit à la vûe d'un objet, il n'est pas possible qu'elle se soutienne longtems : animorum incendia, dit Ciceron, celeriter extinguntur. Aussi voit on que les meilleurs lyriques se contentent de présenter leur objet sous les différentes faces qui peuvent produire ou entretenir la même impression ; après quoi ils l'abandonnent presqu'aussi brusquement qu'ils l'avoient saisi.
La seconde conséquence est qu'il doit y avoir dans une ode, unité de sentiment, de même qu'il y a unité d'action dans l'épopée & dans le drame. On peut, on doit même varier les images, les pensées, les tours, mais de maniere qu'ils soient toûjours analogues à la passion qui regne : cette passion peut se replier sur elle-même, se développer plus ou moins, se retourner ; mais elle ne doit ni changer de nature, ni céder sa place à une autre. Si c'est la joie qui a fait prendre la lyre, elle pourra bien s'égarer dans ses transports, mais ce ne sera jamais en tristesse : ce seroit un défaut impardonnable. Si c'est par un sentiment de haine qu'on débute, on ne finira point par l'amour, ou bien ce sera un amour de la chose opposée à celle qu'on haïssoit : & alors c'est toûjours le premier sentiment qui est seulement déguisé. Il en est de même des autres sentimens.
Il y a des odes de quatre especes. L'ode sacrée qui s'adresse à Dieu, & qui s'appelle hymne ou cantique. C'est l'expression d'une ame qui admire avec transport la grandeur, la toute-puissance, la sagesse de l'Etre suprème, & qui lui témoigne son ravissement. Tels sont les cantiques de Moïse, ceux des prophetes, & les pseaumes de David.
La seconde espece est des odes héroïques, ainsi nommées, parce qu'elles sont consacrées à la gloire des héros. Telles sont celles de Pindare sur-tout, quelques-unes d'Horace, de Malherbe, de Rousseau.
La troisieme espece peut porter le nom d'ode morale ou philosophique. Le poëte frappé des charmes de la vertu ou de la laideur du vice, s'abandonne aux sentimens d'amour ou de haine que ces objets produisent en lui.
La quatrieme espece naît au milieu des plaisirs, c'est l'expression d'un moment de joie. Telles sont les odes anacréontiques, & la plûpart des chansons françoises.
La forme de l'ode est différente suivant le goût des peuples où elle est en usage. Chez les Grecs elle étoit ordinairement partagée en stances, qu'ils appelloient formes, ????.
Alcée, Sapho, & d'autres lyriques, avoient inventé avant Pindare d'autres formes, où ils mêloient des vers de différentes especes, avec une symmétrie qui revenoit beaucoup plus souvent. Ce sont ces formes qu Horace a suivies. Il est aisé de s'en faire une idée d'après ses poésies lyriques.
Les François ont des odes de deux sortes : les unes qui retiennent le nom générique, & les autres qu'on nomme cantates, parce qu'elles sont faites pour être chantées, & que les autres ne se chantent pas.
Le caractere de l'ode de quelque espece qu'elle soit, ce qui la distingue de tous les autres poëmes, consiste dans le plus haut degré de pensée & de sentiment dont l'esprit & le c?ur de l'homme soient capables. L'ode choisit ce qu'il y a de plus grand dans la religion, de plus surprenant dans les merveilles de la nature, de plus admirable dans les belles actions des héros, de plus aimable dans les vertus, de plus condamnable dans les vices, de plus vif dans les plaisirs de Bacchus, de plus tendre dans ceux de l'amour ; elle ne doit pas seulement plaire, étonner, elle doit ravir & transporter.
Les cantiques de l'Ecriture & les pseaumes de David célebrent de grandes merveilles ; cependant Rousseau & les autres poëtes judicieux n'ont pas traduit toutes ces odes sacrées, ils n'ont choisi que celles qui leur ont paru les plus propres à notre poésie lyrique. Tout est admirable dans l'univers : mais tous ses phénomenes ne doivent pas entrer également dans l'ode. Il faut préferer dans chaque espece les premiers êtres aux êtres moins sensibles & moins bienfaisans ; le soleil, par exemple, aux autres astres. Il faut rassembler dans leur description les circonstances les plus intéressantes, & placer, pour ainsi dire, ces êtres dans l'excès des biens & des maux qu'ils peuvent produire. Si vous décrivez un tremblement de terre, il doit paroître seul plus terrible que ceux que l'Histoire a jamais fait connoître : si vous peignez un paysage, il faut qu'il réunisse tous les charmes de ceux que la Peinture a jamais représentés. Une ode doit parler à l'esprit, au jugement, aux sens, au c?ur, & leur offrir tour à tour les objets les plus capables de les occuper entierement.
Autant Erato est rebelle à ceux qui, sans autre guide que l'esprit, osent mettre un pié profane dans son sanctuaire, autant elle est favorable à ceux qui y sont introduits par le génie. Elle leur ouvre le champ le plus vaste, le plus noble & le plus beau ; elle leur permet & leur ordonne même de lâcher la bride à leur imagination, de prendre l'essor le plus rapide & le plus élevé, de se dérober aux regards des foibles mortels à-travers les feux & les éclairs, de s'élancer jusqu'au plus haut des cieux, tels que des aigles intrépides, d'aller prendre la foudre dans les mains de Jupiter pour en frapper les impies Salmonées & les orgueilleux Titans, &c.
Des mouvemens imprévus, des idées saillantes, des expressions hardies, des images fortes, mais gracieuses, un ordre qui soit caché avec art sous le voile d'un desordre apparent, beaucoup d'harmonie, des écarts éclatans, mais réglés par la raison, des transports sublimes, de nobles fureurs, &c. voilà les ornemens qui conviennent à l'ode : elle abhorre la médiocrité, si elle n'échauffe, elle glace. Si elle ne nous enleve, si elle ne nous transporte par son divin enthousiasme, elle nous laisse transis & morfondus. C'est dans ce genre qu'on peut presque affirmer qu'il n'est point de degré du médiocre au pire. Le poëte, pour donner de la vie aux sujets qu'il traite, doit les animer par la fiction, & les soutenir par les peintures & par la cadence nombreuse. Tous les trésors de la fable, de la poésie, de l'imagination, & de toute la nature, lui sont ouverts ; il peut y puiser à son gré tout ce qu'ils renferment de plus frappant & de plus précieux.
J'ai déja pris soin d'insinuer, & je le répete encore ici, que tous les sublimes transports de l'ode doivent être réglés par la raison, & que tout ce désordre apparent ne doit être en effet qu'un ordre plus caché. Il ne s'agit point de lancer au hasard des idées éblouissantes, ni d'étaler avec emphase un galimatias pompeux. Ce désordre même que l'ode exige, ce qui est une de ses plus grandes beautés, ne doit peut-être avoir pour objet que le retranchement des liaisons grammaticales, & de certaines transitions scrupuleuses qui ne feroient qu'énerver la poésie lyrique. Quoi qu'il en soit, c'est à l'art de régler le desordre apparent de l'ode. Toutes les figures si variées & si hardies doivent tendre à une même fin, & s'entreprêter des beautés mutuelles.
L'ode où l'on chante les dieux ou les héros, doit briller dès le début même. L'hyperbole est son langage favori. Le poëte y peut promettre des miracles. La carriere qu'il doit fournir est si courte, qu'il n'aura pas le tems de perdre haleine, ni de réfroidir ses lecteurs : c'est-là l'ode pindarique. Elle commence souvent dans Pindare par la description sublime de quelques phénomenes naturels, dont il fait ensuite l'application à son sujet. La surprise est le sentiment qu'elle doit produire. Toutes les odes de ce genre qui ne portent pas ces caractères, ne meritent que le nom de stances.
Il est un autre genre d'odes moins superbe, moins éclatant, mais non moins agréable ; c'est l'ode anacréontique. Elle chante les jeux, les ris folâtres, les plaisirs & les agrémens de la vie champêtre, &c. Jamais la lyre du voluptueux Anacréon ne raisonne pour célébrer les héros & les combats. Partagé entre Bacchus & l'Amour, il ne produit que des chansons inspirées par ces deux divinités.
Il tient parmi les Poëtes le même rang qu'Epicure parmi les Philosophes. Toutes ses odes sont courtes, pleines de douceur, d'élégance, de naïveté, & animées d'une fiction toujours galante, ingénieuse & naturelle. Son imagination livrée toute entiere aux plaisirs, ne lui fournit que des idées douces & riantes, mais souvent trop capables d'allarmer la vertu.
La dixieme muse, la tendre & fidele Sapho, a composé un petit nombre d'odes consacrées aussi à l'amour. On connoît celle qui a été traduite si élégamment par Catulle, Despréaux & Adisson ; trois traductions admirables sans qu'on ait pu dire laquelle méritoit la préférence. Le lecteur les trouvera, je pense, au mot Gradation.
Horace s'est montré tantôt Pindare, & tantôt Anacréon ; mais s'il imite Pindare dans ses nobles transports, il le suit aussi quelquefois un peu trop dans son désordre ; s'il imite la délicatesse & la douceur naïve d'Anacréon, il adopte aussi sa morale voluptueuse, & la traite d'une maniere encore plus libre, mais moins ingénue.
Malherbe s'est distingué par le nombre & l'harmonie ; il est inimitable dans la cadence de ses vers, & l'on doit excuser la foiblesse de ceux qu'il n'a fait que pour servir de liaisons aux autres. Il faut encore avoir la force de lui passer ses expressions surannées.
Rousseau a été tout-à la-fois Pindare, Horace, Anacréon, Malherbe, &c. Il a rassemblé tous les talens partagés entre ces grands poëtes ; son génie vigoureux, né pour la lyre, en a embrassé tous les genres, & y a excellé.
Avant lui M. de la Motte avoit composé des odes pleines d'élégance & de délicatesse dans le goût d'Anacréon. Je ne reprocherai point à cet aimable poëte d'avoir été trop moral dans le genre lyrique, parce que Rousseau ne l'est pas moins. Je dirai seulement que l'un moralise en poëte, & l'autre en philosophe ; l'un est sublime dans ses sentences, & l'autre n'est qu'ingénieux ; l'un éclairant, échauffe & transporte ; l'autre en instruisant se contente d'amuser.
Il est sans doute permis dans le lyrique d'étaler de belles & solides maximes ; mais il faut qu'elles soient revêtues des brillantes couleurs qui conviennent à ce genre de poésie. Ainsi le vrai défaut de M. de la Motte est de n'être pas assez animé ; ce défaut se trouve dans ses descriptions & dans ses peintures qui sont trop uniformes, froides & mortes en comparaison de la force, de la variété, & des belles images de celles du célebre Rousseau. Mais j'entrerai dans d'autres détails sur les poëtes dont je viens de parler, au mot Poete lyrique, & je tâcherai en même tems de ne me pas répéter.
Les Anglois seroient sans doute les premiers poëtes lyriques du monde, si leur goût & leur choix répondoient à la force de leur esprit & à la fécondité de leur imagination. Ils apperçoivent ordinairement dans un objet plus de faces que nous n'en découvrons ; mais ils s'arrêtent trop à celles qui ne méritent point leur attention : ils éteignent & ils étouffent le feu de notre ame à force d'y entasser idées sur idées, sentimens sur sentimens.
Jamais la Gréce & la république Romaine n'ont fourni un aussi vaste champ pour l'ode, que celui que l'Angleterre offre à ses poëtes depuis deux siécles. Le regne florissant d'Elisabeth ; la mort tragique de la reine d'Ecosse ; les trois couronnes réunies sur la tête de Jacques I. le despotisme qui renversa le trône de Charles & qui le fit périr sur un échafaud ; l'interregne odieux, mais brillant de l'usurpateur ; le rétablissement du roi légitime ; les divisions & les guerres civiles renaissantes sous ce prince ; une nouvelle révolution sous son successeur ; la nation entiere divisée en autant de sectes dans la religion, que de partis dans le gouvernement ; le roi chassé de son trône & de sa patrie ; un étranger appellé pour régner en sa place ; une nation épuisée par des guerres & des défaites malheureuses ; mais qui se releve tout-à-coup, & qui monte au plus haut point de sa gloire sous le regne d'une femme : en faudroit-il davantage pour livrer toutes les muses à l'enthousiasme ? Rousseau auroit-il été réduit, s'il eût vêcu en Angleterre, à dresser une ode à M. Duché sur les affaires de sa famille, & une autre à M. de Pointis, sur un procès que lui firent les Flibustiers ? (Le chevalier de Jaucourt.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
ode \?d\ féminin
-
(Antiquité) Poème lyrique (donc chanté) composé d'une strophe, d'une antistrophe et d'une épode, que le ch?ur chantait en décrivant certaines évolutions.
- Les odes de Pindare.
- Les Sirènes dévient l'odos d'Odysseus (l'ode en langue grecque veut dire en même temps le chemin et le chant). ? (Pascal Quignard, La haine de la musique, Gallimard, 1996, collection Folio, page 219)
-
(Par analogie) Poème lyrique divisé en strophes qui sont ordinairement semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers.
- En bon Champenois, il célébra le vin de Champagne dans une ode en vers iambiques, dont le style vif et pétillant, présente la belle image de cette charmante liqueur. ? (Jean-Baptiste-Joseph Boulliot, Biographie ardennaise ou Histoire des ardennais, Paris : Ledoyen, 1830, page 259)
- Plus d'un jeune instituteur stagiaire a retrouvé dans le siècle celle pour qui s'échafaudaient ses odes et ses sonnets. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
Trésor de la Langue Française informatisé
ODE, subst. fém.
Ode au Scrabble
Le mot ode vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot ode - 3 lettres, 2 voyelles, 1 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ode au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
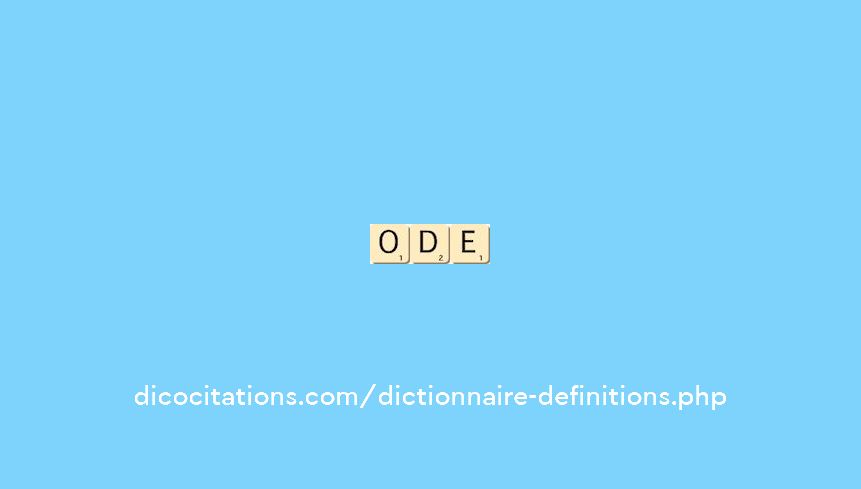
Les mots proches de Ode
Ode Odelette Odéon ou odéum Odeur ode Odeigne odelette odelettes Odenas odéon Oderen odes odette odeur Odeur odeursMots du jour
Situer Alcool Dépiquer Dégradement Ressemblant, ante Désenclouer Affainéanti, ie Syriacisme Nocivité Batardeau
Les citations avec le mot Ode
- Le public moderne semble avoir un faible pour les écrivains confus qui ne livrent jamais leur dernier secret et qui, peut-être, dans leurs désordres, n'en cachent aucun.Auteur : Roger Puthoste, dit André Thérive - Source : Moralistes de ce temps (1948)
- Toutes les grandes figures de l'Histoire, de Gengis Khan à Napoléon, en passant par les chevaliers de notre industrie moderne, utilisaient tous ceux qu'ils croisaient sur leur chemin. Amis et ennemis, intellectuels et manants, ceux qui leur faisaient confiance et ceux qui se méfiaient d'eux... ils se sont servis de tous. Nous ne sommes pas d'aussi grands personnages. Nous faisons partie de ceux qu'on exploite, alors exceptionnellement, pour que nos familles soient fières de nous, il serait bon que nous nous servions des autres.Auteur : Arthur Upfield - Source : Sinistres augures (1954)
- Si Marivaux n'était un modèle ni de style ni de goût, du moins il avait racheté ce défaut par beaucoup d'esprit, et par une manière qu'il n'avait empruntée à personne.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Marivaux
- Dans un groupe qui se constitue, il faut inventer des codes, des références communes, des expressions, des surnoms, des anecdotes à partager, afin que le groupe se soude et qu'une complicité se crée entre les membres.Auteur : Michel Bussi - Source : Gravé dans le sable
- Votre grade hors du commun
Incommode fort qui vous aime.Auteur : Pierre Corneille - Source : Poésies diverses, X - Se rebeller contre l'inévitable et se résigner à l'évidence : c'est ce qui caractérise l'homme moderne.
Auteur : Nicolás Gómez Dávila - Source : Le Réactionnaire authentique, Nicolás Gómez Dávila, éd. Le Rocher, coll. Anatolia, 2005 (ISBN 2-268-05300-8), p. 85
- Il est remarquable que ce soit dans les périodes où la société donne à l'individu le moins de garanties et d'avantages qu'elle lui demande le plus de sacrifices et d'efforts.Auteur : Pierre Reverdy - Source : Sans référence
- Un autre reproche qu'on peut faire à Marivaux dans ses romans, c'est de s'y être permis de trop longs épisodes; celui de la religieuse, dans Marianne, occupe lui seul plus d'un volume.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Marivaux
- Elle suit la mode et ne le regrette point: elle dort au bercement de l'eau, voit l'aube rose, entend chanter «mille rossignols».Auteur : Maurice Genevoix - Source : Route de l'aventure (1959)
- Drifter il avait dix ans d'avance sur la mode «rasta», mais il ne vécut pas assez loin pour le savoir.Auteur : Philippe Labro - Source : Des bateaux dans la nuit (1982)
- Si j'étais à nouveau un jeune homme et devais décider comment gagner ma vie, je n'essaierais pas de devenir savant, chercheur ou enseignant. Je choisirais plutôt de devenir plombier ou colporteur, afin de trouver cette modeste part d'indépendance dont on peut encore bénéficier dans les circonstances présentes.Auteur : Albert Einstein - Source : En 1954, dans une déclaration au Reporter
- Pour produire de bons écrits,
Nourrissez-vous de bons modèles.Auteur : Antoine-Vincent Arnault - Source : L'Abeille - Que de beaux discours à l'odeur de chloroforme on se croit obligé d'écouter.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- Pistolet à amorphes : Arme d'autodéfense pour individus apathiquesAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Suis la mode, ou quitte le monde.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- Celui à qui tout réussit est nécessairement superficiel. L'échec est la version moderne du néant.Auteur : Emil Cioran - Source : Entretiens (1995)
- Odeur des pieds: Signe de santé.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Quand tu es loin de moi tu es toujours présente
Tu demeures dans l'air comme une odeur de pain
Je t'attendrai cent ans mais déjà tu es mienne
Par toutes ces prairies que tu portes en toi.Auteur : René-Guy Cadou - Source : Hélène ou le règne végétal (1952) - Cette odeur de moisissure et d'eau morte qui sort ici des murs mêmes, empoisonne jusqu'à l'air du jardin.Auteur : Georges Bernanos - Source : Monsieur Ouine (1943)
- Au teint, on juge l'étoffe; au bouquet, le vin; à l'odeur, la fleur; au parler, l'homme.Auteur : Proverbes allemands - Source : Proverbe
- La modération des grands hommes ne borne que leurs vertus.Auteur : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont - Source : Poésies
- Les nationalismes qui ont fait tant de mal à notre continent peuvent renaître à tout moment. Et ce n'est pas seuls que nous ferons face aux bouleversements économiques du monde. La France doit affirmer l'exigence d'une Europe puissance. D'une Europe politique. D'une Europe qui garantisse notre modèle social. C'est notre avenir qui est en jeu. Portons toujours cet idéal et cette volonté.Auteur : Jacques Chirac - Source : Allocution radiotélévisée du président de la République, Jacques Chirac, prononcée dimanche 11 mars 2007
- Les modes changent, étant nées elles-mêmes du besoin de changement.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919)
- Or ils sont exaucés, mes voeux. A mon appel
Dieu t'envoya vers moi, ô ma Madone calme,
Du charme le plus pur toi le plus pur modèle.Auteur : Alexandre Pouchkine - Source : La Madone - L'odeur de l'être qu'on aime se sent sous tous les parfums et je sais, moi, qu'Oreste n'a pas pu oublier celle de sa mère... Il n'est pas de fils qui l'oublient et qui, vieux, n'en rêvent encore, dans leurs peines...Auteur : Jean Anouilh - Source : Pièces secrètes (1977)
Les citations du Littré sur Ode
- [Lors de l'éruption du Vésuve] Pline se lève appuyé sur deux valets, et, dans le moment, tombe mort, suffoqué apparemment par l'odeur de la fuméeAuteur : ROLLIN - Source : Hist. anc. t. XI, 2e part. p. 623, dans POUGENS
- Les yeux [du cheval] gros, grands, noirs et clairs comme miroirs, emboutissant en hors ainsi que goderonsAuteur : O. DE SERRES - Source : 301
- De là viennent l'orgueil, l'ambition, les desirs immoderésAuteur : CHARRON - Source : Sagesse, II, 2
- Les heretiques modernes font bouclier d'Yrenée et TertullienAuteur : CALV. - Source : Instit. 375
- Nous citerons Desgodets, architecte des bâtiments du roi sous Louis XIV, le premier qui produisit un plan d'Hôtel-Dieu en rayonsAuteur : TENON - Source : ib.
- Les vicissitudes des composés ne sont que des modes du mouvementAuteur : DIDER. - Source : Opinion des anc. phil. (Épicurisme).
- Je vous assure qu'un rhumatisme est une des belles pièces qu'on puisse avoir ; j'ai un grand respect pour lui ; il a son commencement, son augmentation, son période et sa finAuteur : Madame de Sévigné - Source : 247
- La muscade ronde est plus recherchée que la longue, qui n'en est qu'une variété ; on estime surtout celle qui est récente, grosse, pesante, de bonne odeur, d'une saveur agréable, quoique amère, et qui, étant piquée, rend un suc huileuxAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. II, 8
- Le commun des hommes aime les phrases et les périodesAuteur : LA BRUY. - Source : XV
- Le voilà qui vient rôder autour de vousAuteur : Molière - Source : G. Dand. II, 4
- RodeurAuteur : COTGRAVE - Source :
- Cette mode [une sorte de coiffure] durera peu ; elle est mortelle pour les dentsAuteur : Madame de Sévigné - Source : 4 avr. 1671
- On se divertit à voir outrer cette mode jusqu'à la folieAuteur : Madame de Sévigné - Source : 29
- Il a trouvé [en musique] des méthodes plus claires, plus commodes, plus simples qui facilitent, les unes la composition, les autres l'exécution, et auxquelles il ne manque pour être admises que d'être proposées par un autre que par luiAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : 2e dial.
- À Jehan du Vivier orfevre et varlet de chambre du roy, pour avoir fait et forgié un petit reliquaire d'or pendant à une chayenne d'or, ouquel a de la vraye croix de Rodes et de plusieurs autres reliques, pour mettre et porter au col dudit seigneurAuteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 478
- Sévigné, de qui les attraits Servent aux Grâces de modèle, Et qui naquîtes toute belle, à votre indifférence prèsAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. IV, 1
- Et porroit l'en respondre, que aucuns ars sont de delettacion, si come art de faire pigmens, confettions et odeursAuteur : ORESME - Source : Eth. 221
- Elle n'entendra point de bruit.... eh ! bon Dieu, pourrait-on être incommodée d'un bruit qui fait espérer votre retour ?Auteur : Madame de Sévigné - Source : 26 avr. 1680
- J'ai voulu me raccommoder avec le chocolat, j'en pris avant-hier pour digérer mon dîner, afin de bien souper ; et j'en ai pris hier pour me nourrir, et pour jeûner jusqu'au soirAuteur : Madame de Sévigné - Source : 94
- Le ridicule consiste à choquer la mode ou l'opinion, et communément on les confond assez avec la raisonAuteur : DUCLOS - Source : Consid. moeurs, 9
- Pendant que le parlement d'Angleterre songe à congédier l'armée, cette armée, toute indépendante, réforme à sa mode le parlement, qui eût gardé quelques mesures, et se rend maîtresse de toutAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- On a trouvé plus agréables les reliures à la grecque et à dos brisé.... on n'abandonnera jamais entièrement cette méthode de grecquer les livres et de les coudre à deux ou trois cahiers, parce qu'un livre grecqué est beaucoup plus aisé à coudre que celui qui ne l'est pas, en ce que les trous pour passer l'aiguille sont tous faitsAuteur : LESNÉ - Source : la Reliure, p. 115
- Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, Ma soeur, que de tousser et de cracher comme elleAuteur : Molière - Source : F. sav I, 1
- Les maisons y sont propres, commodes, riantes, mais sans ornements ; la superbe architecture n'y est pas ignorée, mais elle est réservée pour les temples des dieuxAuteur : FÉN. - Source : Tél. V
- Fallut-il essuyer à sa porte de mauvaises heures, pour attendre un de ses moments commodes ?Auteur : FLÉCH. - Source : Lamoignon.
Les mots débutant par Ode Les mots débutant par Od
Une suggestion ou précision pour la définition de Ode ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 22h33

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur ode
Poèmes ode
Proverbes ode
La définition du mot Ode est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Ode sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Ode présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
