Définition de « axiome »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot axiome de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur axiome pour aider à enrichir la compréhension du mot Axiome et répondre à la question quelle est la définition de axiome ?
Une définition simple : (fr-rég|ak.sjom)
Définitions de « axiome »
Trésor de la Langue Française informatisé
AXIOME, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
axiome \ak.sjom\ masculin
-
Postulat ou principe, considéré comme évident en soi ; proposition générale, reçue et établie.
- Or, les lois de l'irradiation sont connues. [?]. Demander pourquoi elles sont vraies, ce serait demander pourquoi sont vrais les axiomes sur lesquels s'appuie la démonstration de ces lois. Il n'y a rien de démontrable, pour parler strictement ; [?]. ? (Edgar Poe, Eureka, 1848, traduction de Charles Baudelaire, 1864)
- La politique doit se diriger en conséquence de ce qui existe, sans quoi elle s'égare ; voilà un axiome dont on fait trop peu de cas de nos jours. ? (Anonyme, Des intérêts en politique. - M. Canning et M. de Metternich, Revue des Deux Mondes, 1829, tome 1)
- Il y avait aussi des livres de morale pratique dont les principes, pour n'être pas païens, n'étaient pas beaucoup plus acceptables pour l'église ; c'étaient les traités qui avaient pour base les axiomes et en quelque sorte le code de la morale chevaleresque, [?] ? (Jean-Jacques Ampère, La Littérature française au moyen-âge, Revue des Deux Mondes, tome 19, 1839)
- Il y a un axiome populaire qui dit : buvez ou ne buvez pas de vin, et vous n'en aurez pas moins la goutte. ? (Édouard Monneret et Louis Fleury, Compendium de médecine pratique, tome 4, Béchet jeune & Labbé, 1841, page 357)
- L'amour parlé ne vaut pas l'amour prouvé, toutes les jeunes filles de vingt ans en ont cinquante pour pratiquer cet axiome. ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- Déjà en couronnant Sen, puis Stiglitz, puis Krugman, le jury du Nobel d'économie avait montré qu'il tenait pour non pertinents les paradigmes et axiomes de Milton Friedman et du monétarisme. ? (Michel Rocard, Le prix Nobel d'économie pour l'autogestion, "Libération", 2009-10-20)
- Le bruit courut que les trois frères avaient été empoisonnés, et le public n'eut pas besoin de savoir le latin pour chercher à découvrir le coupable par l'application du vieil axiome « is fecit cui prodest ». ? (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Institut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 121)
Littré
- Vérité évidente de soi et non démontrable, par exemple?: le tout est plus grand que sa partie. Toutes les sciences partent d'axiomes qui leur servent de fondements.
Voulez-vous peindre et toucher, on vous demande des axiomes et des corollaires
, Chateaubriand, Génie, I, 4.Ces propositions claires et intelligibles par elles-mêmes s'appellent axiomes ou premiers principes
, Bossuet, Conn. de Dieu, I, 13.
SYNONYME
Ce qui distingue axiome des mots d'un sens analogue, tels que maxime, sentence, apophthegme, aphorisme, c'est que axiome exprime une proposition évidente de soi, échappant à toute démonstration, et s'imposant par un principe d'évidence ou autrement de certitude qui entre dans la constitution de l'esprit humain.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
AXIOME. Ajoutez?: - HIST. XVIe s. N'est-ce pas une chose que toute l'eschole tient comme un axiome qu'il faut toujours commencer aux plus aisez remedes??
Paré, Apologie.
Encyclopédie, 1re édition
AXIOME, s. m. Les axiomes ou les principes sont des propositions, dont la vérité se fait connoître par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de la démontrer. On les appelle autrement des premieres vérités : la connoissance que nous en avons est intuitive. Comme elles sont évidentes par elles-mêmes, & que tout esprit les saisit sans qu'il lui en coûte le moindre effort, quelques-uns ont supposé qu'elles étoient innées. Ils auroient pû dire la même chose d'une infinité de propositions qui ne sont pas moins évidentes, & qui sont aussi bien qu'elles, du ressort de la connoissance intuitive ; cependant ils ne les ont jamais mises au nombre de ces idées innées. Voyez Connoissance.
Mais pourquoi l'esprit donne-t-il son consentement à ces axiomes dès la premiere vûe, sans l'intervention d'aucune preuve ? Cela vient de la convenance ou de la disconvenance, que l'esprit apperçoit immédiatement, sans le secours d'aucune autre idée intermédiaire : mais ce privilége ne convient pas aux seuls axiomes. Combien de propositions particulieres qui ne sont pas moins évidentes ?
Voyons maintenant quelle est l'influence des axiomes sur les autres parties de notre connoissance. Quand on dit qu'ils sont le fondement de toute autre connoissance, l'on entend ces deux choses : 1°. que les axiomes sont les vérités les premieres connues à l'esprit ; 2°. que nos autres connoissances dépendent de ces axiomes. Si nous démontrons qu'ils ne sont ni les premieres vérités connues à l'esprit, ni les sources d'où découlent dans notre esprit un nombre d'autres idées, qui se ressentent de la simplicité de leur origine, nous détruirons par-là le préjugé trop favorable qui les maintient dans toutes les sciences ; car il n'y en a point qui ne fournissent certains axiomes qui leur soient propres, & qu'elles regardent comme leur appartenant de droit. Mais avant d'entrer dans cette discussion, il faut que je prévienne l'objection qu'on peut me faire. Comment concilier ce que nous disons ici des axiomes, avec ce que l'on doit reconnoître dans les premiers principes, qui sont si simples, si lumineux & si féconds en conséquences ? Le voici, c'est que par les premiers principes nous entendons un enchaînement de vérités externes & objectives, c'est-à-dire, de ces vérités dont l'objet existe hors de notre esprit. Or c'est en les envisageant simplement sous ce rapport, que nous leur attribuons cette grande influence sur nos connoissances. Mais nous restraignons ici les axiomes à des vérités internes, logiques & métaphysiques, qui n'ont aucune réalité hors de l'esprit, qui en apperçoit, d'une vûe intuitive, tant qu'il vous plaira, la convenance ou la disconvenance. Tels sont ces axiomes. :
Il est impossible qu'une même chose soit & ne soit pas en même tems.
Le tout est plus grand que sa partie.
De quelque chose que ce soit, la négation ou l'affirmation est vraie.
Tout nombre est pair ou impair.
Si à des choses égales vous ajoûtez des choses égales, les tous seront égaux.
Ni l'art, ni la nature ne peuvent faire une chose de rien.
On peut assûrer d'une chose tout ce que l'esprit découvre dans l'idée claire qui la représente.
Or c'est de tous ces axiomes, qui ne semblent pas dans l'esprit de bien des gens, avoir de bornes dans l'application, que nous osons dire d'après M. Locke, qu'ils en ont de très-étroites pour la fécondité, & qu'ils ne menent à rien de nouveau. Je me hâte de le justifier.
1°. Il paroît évidemment que ces vérités ne sont pas connues les premieres, & pour cela il suffit de considérer qu'une proposition générale n'est que le résultat de nos connoissances particulieres, pour s'appercevoir qu'elle ne peut nous faire descendre qu'aux connoissances qui nous ont élevés jusqu'à elle, ou qu'à celles qui auroient pû également nous en frayer le chemin. Par conséquent, bien loin d'en être le principe, elle suppose qu'elles sont toutes connues par d'autres moyens, ou que du moins elles peuvent l'être.
En effet, qui ne s'apperçoit qu'un enfant connoît certainement qu'un étrangere n'est pas sa mere, & que la verge qu'il craint, n'est pas le sucre qui flate son goût, long-tems avant de savoir qu'il est impossible qu'une chose soit & ne soit pas ? Combien peut-on remarquer de vérités sur les nombres, dont on ne peut nier que l'esprit ne les connoisse parfaitement, avant qu'il ait jamais pensé à ces maximes générales, auxquelles les Mathématiciens les rapportent quelquefois dans leurs raisonnemens ? Tout cela est incontestable : les premieres idées qui sont dans l'esprit, sont celles des choses particulieres. C'est par elles que l'esprit s'éleve par des dégrés insensibles à ce petit nombre d'idées générales, qui étant formées à l'occasion des objets des sens, qui se présentent le plus souvent, sont fixées dans l'esprit avec les noms généraux dont on se sert pour les désigner. Ce n'est qu'après avoir bien étudié les vérités particulieres, & s'être élevé d'abstraction en abstraction, qu'on arrive jusqu'aux propositions universelles. Les idées particulieres sont donc les premieres que l'esprit reçoit, qu'il discerne, & sur lesquelles il acquiert des connoissances. Après cela viennent les idées moins générales ou les idées spécifiques, qui suivent immédiatement les particulieres. Car les idées abstraites ne se présentent pas si-tôt ni si aisément que les idées particulieres aux enfans, ou à un esprit qui n'est pas encore exercé à cette maniere de penser. Ce n'est qu'un usage constant & familier, qui peut rendre les esprits souples & dociles à les recevoir. Prenons, par exemple, l'idée d'un triangle en général : quoiqu'elle ne soit ni la plus abstraite, ni la plus étendue, ni la plus mal aisée à former, il est certain qu'il est impossible de se la représenter ; car il ne doit être ni équilatere, ni isocele, ni scalene, & cependant il faut bien qu'un triangle qu'on imagine soit dans l'un de ces cas. Il est vrai que dans l'état d'imperfection où nous sommes, nous avons besoin de ces idées, & nous nous hâtons de les former le plûtôt que nous pouvons, pour communiquer plus aisément nos pensées, & étendre nos propres connoissances. Mais avec tout cela, ces idées abstraites sont autant de marques de notre imperfection, les bornes de notre esprit nous obligeant à n'envisager les êtres que par les endroits qui leur sont communs avec d'autres que nous leur comparons. Voyez la maniere dont se forment nos abstractions, à l'article Abstraction.
De tout ce que je viens de dire, il s'ensuit évidemment, que ces maximes tant vantées ne sont pas les principes & les fondemens de toutes nos autres connoissances. Car s'il y a quantité d'autres vérités qui soient autant évidentes par elles-mêmes que ces maximes, & plusieurs même qui nous sont plûtôt connues qu'elles, il est impossible que ces maximes soient les principes d'où nous déduisons toutes les autres vérités. Il n'y a que quatre manieres de connoître la vérité. Voyez Connoissance. Or les axiomes n'ont aucun avantage sur une infinité de propositions particulieres, de quelque maniere qu'on en acquiere la connoissance.
Car 1°. la perception immédiate d'une convenance ou disconvenance d'identité, étant fondée sur ce que l'esprit a des idées distinctes, elle nous fournit autant de perceptions évidentes par elles-mêmes, que nous avons d'idées distinctes. Chacun voit en lui-même qu'il connoît les idées qu'il a dans l'esprit, qu'il connoît aussi quand une idée est présente à son esprit, ce qu'elle est en elle-même, & qu'elle n'est pas une autre. Ainsi, quand j'ai l'idée du blanc, je sai que j'ai cette idée. Je sai de plus ce qu'elle est en elle-même, & il ne m'arrive jamais de la confondre avec une autre, par exemple, avec l'idée du noir. Il est impossible que je n'apperçoive pas ce que j'apperçois. Je ne peux jamais douter qu'une idée soit dans mon esprit quand elle y est. Elle s'y présente d'une maniere si distincte que je ne puis la prendre pour une autre qui n'est pas moins distincte. Je connois avec autant de certitude que le blanc dont j'ai l'idée actuelle est du blanc, & qu'il n'est pas du noir, que tous les axiomes qu'on fait tant valoir. La considération de tous ces axiomes ne peut donc rien ajoûter à la connoissance que j'ai de ces vérités particulieres.
2°. Pour ce qui est de la coëxistence entre deux idées, ou d'une connexion entr'elles tellement nécessaire, que, dès que l'une est supposée dans un sujet, l'autre le doive être aussi d'une maniere inévitable ; l'esprit n'a une perception immédiate d'une telle convenance ou disconvenance, qu'à l'égard d'un très petit nombre d'idées. Il y en a pourtant quelques-unes ; par exemple, l'idée de remplir un lieu égal au contenu de sa surface, étant attachée à notre idée du corps, c'est une proposition évidente par elle-même, que deux corps ne sauroient être dans le même lieu. Mais en cela les propositions générales n'ont aucun avantage sur les particulieres. Car, pour savoir qu'un autre corps ne peut remplir l'espace que le mien occupe, je ne vois point du tout, qu'il soit nécessaire de recourir à cette proposition générale, savoir que deux corps ne sauroient être tout-à-la-fois dans le même lieu.
Quand à la troisieme sorte de convenance, qui regarde les relations des modes, les Mathématiciens ont formé plusieurs axiomes sur la seule relation d'égalité, comme si de choses égales on en ôte des choses égales, le reste est égal : mais quoique cette proposition & les autres de ce genre soient effectivement des vérités incontestables, elles ne sont pourtant pas plus clairement évidentes par elles-mêmes, que celles-ci : Un & un sont égaux à deux. Si de cinq doigts d'une main vous en ôtez deux, & deux autres des cinq doigts de l'autre main, le nombre des doigts qui restera sera égal.
4°. A l'égard de l'existence réelle, je ne suis pas moins assûré de l'existence de mon corps en particulier, & de tous ceux que je touche & que je vois autour de moi, que je le suis de l'existence des corps en général.
Mais, me dira-t-on, ces maximes-là sont-elles donc absolument inutiles ? Nullement, quoique leur usage ne soit pas tel qu'on le croît ordinairement. Nous allons marquer précisément à quoi elles sont utiles, & à quoi elles ne sauroient servir.
1°. Elles ne sont d'aucun usage pour prouver, ou pour confirmer des propositions particulieres, qui sont évidentes par elles-mémes. On vient de le voir.
2°. Il n'est pas moins visible, qu'elles ne sont & n'ont jamais été les fondemens d'aucune science. Je sai bien que sur la foi des scholastiques, on parle beaucoup des Principes ou axiomes sur lesquels les sciences sont fondées : mais il est impossible d'en assigner aucune qui soit bâtie sur ces axiomes généraux : ce qui est, est ; il est impossible qu'une chose, &c. Ces maximes générales peuvent être du même usage dans l'étude de la Théologie que dans les autres Sciences ; c'est-à-dire, qu'elles peuvent aussi bien servir en Théologie à fermer la bouche aux chicaneurs & à terminer les disputes, que dans toute autre Science. Mais personne ne prendra de cet aveu aucun droit de dire, que la religion Chrétienne est fondée sur ces maximes, elle n'est fondée que sur la révélation ; donc par la même raison on ne peut dire qu'elles soient le fondement des autres Sciences. Lorsque nous trouvons une idée, par l'intervention de laquelle nous découvrons la liaison de deux autres idées, c'est une révélation qui nous vient de la part de Dieu par la voix de la raison ; car dèslors nous connoissons une vérité que nous ne connoissions pas auparavant. Quand Dieu lui-même nous enseigne une vérité, c'est une révélation qui nous est communiquée par la voix de son esprit ; & dès-là notre connoissance est augmentée : mais dans l'un & l'autre cas, ce n'est point de ces maximes que notre esprit tire sa lumiere ou sa connoissance.
3°. Ces maximes générales ne contribuent en rien à faire faire aux hommes des progrès dans les Sciences, ou des découvertes de vérités nouvelles. Ce grand secret n'appartient qu'à la seule analyse. M. Newton a démontré plusieurs propositions qui sont autant de nouvelles vérités, inconnues auparavant aux savans, & qui ont porté la connoissance des Mathématiques plus loin qu'elle n'étoit encore : mais ce n'est point en recourant à ces maximes générales, qu'il a fait ces belles découvertes. Ce n'est pas non plus par leur secours qu'il en a trouvé les démonstrations : mais en découvrant des idées intermédiaires, qui lui fissent voir la convenance ou la disconvenance des idées telles qu'elles étoient exprimées dans les propositions qu'il a démontrées. Voilà ce qui aide le plus l'esprit à étendre ses lumieres, à reculer les bornes de l'ignorance, & à perfectionner les Sciences ; mais les axiomes généraux sont absolument stériles, loin d'être une source féconde de connoissances. Ils ne sont point les fondemens, sur lesquels reposent comme sur une base immobile ces admirables édifices, qui sont l'honneur de l'esprit humain, ni les clefs qui ont ouvert aux Descartes, aux Newtons, aux Leibnitz, le sanctuaire des Sciences les plus sublimes & les plus élevées.
Pour venir donc à l'usage qu'on fait de ces maximes, 1°. elles peuvent servir dans la méthode qu'on employe ordinairement pour enseigner les sciences jusqu'au terme où elles ont été poussées : mais elles ne servent que fort peu, ou point du tout, pour porter plus avant les sciences ; elles ne peuvent servir qu'à marquer les principaux endroits par où l'on a passé ; elles deviennent inutiles à ceux qui veulent aller en avant. Ainsi que le fil d'Ariane, elles ne font que faciliter les moyens de revenir sur nos pas.
2°. Elles sont propres à soulager la mémoire, & à abréger les disputes, en indiquant sommairement les vérités dont on convient de part & d'autre : les écoles ayant établi autrefois la dispute comme la pierre de touche de l'habileté & de la sagacité, elles adjugeoient la victoire à celui à qui le champ de bataille demeuroit, & qui parloit le dernier ; desorte qu'on en concluoit, que s'il n'avoit pas soûtenu le meilleur parti, du moins il avoit eu l'avantage de mieux argumenter. Mais, parce que selon cette méthode, il pouvoit fort bien arriver que la dispute ne pût être décidée entre deux combattans également experts, & que c'eût été l'hydre toûjours renaissante ; pour éviter que la dispute ne s'engageât dans une suite infinie de syllogismes, & pour couper d'un seul coup toutes les têtes de cette hydre, on introduisit dans les écoles certaines propositions générales évidentes par elles-mêmes, qui étant de nature à être reçûes de tous les hommes avec un entier assentiment, devoient être regardées comme des mesures générales de la vérité, & tenir lieu de principes. Ainsi, ces maximes ayant reçû le nom de principes, qu'on ne pouvoit nier dans la dispute, on les prit par erreur pour l'origine & la vraie source de nos connoissances ; parce que, lorsque dans les disputes, on en venoit à quelques-unes de ces maximes, on s'arrêtoit sans aller plus avant, & la question étoit terminée.
Encore un coup, les axiomes ne servent qu'à terminer les disputes ; car au fond, si l'on en presse la signification, ils ne nous apprennent rien de nouveau : cela a été déjà fait par les idées intermédiaires, dont on s'est servi dans la dispute. Si dans les disputes les hommes aimoient la vérité pour elle-même, on ne seroit point obligé, pour leur faire avoüer leur défaite, de les forcer jusques dans ces derniers retranchemens ; leur sincérité les obligeroit à se rendre plûtôt. Je ne pense pas qu'on ait regardé ces maximes comme des secours fort importans pour faire de nouvelles découvertes, si ce n'est dans les écoles, où les hommes, pour obtenir une frivole victoire, sont autorisés & encouragés à s'opposer & à résister de toute leur force à des vérités évidentes, jusqu'à ce qu'ils soient battus, c'est-à-dire qu'ils soient réduits à se contredire eux-mêmes, ou à combattre des principes établis. En un mot, ces maximes peuvent bien faire voir où aboutissent certaines fausses opinions, qui renferment souvent de pures contradictions : mais quelque propres qu'elles soient à dévoiler l'absurdité ou la fausseté du raisonnement ou de l'opinion particuliere d'un homme, elles ne sauroient contribuer beaucoup à éclairer l'entendement, ni à lui faire faire des progrès dans la connoissance des choses : progrès qui ne seroient ni plus ni moins prompts & certains, quand l'esprit n'auroit jamais pensé aux propositions générales. A la vérité elles peuvent servir pour réduire un chicaneur au silence, en lui faisant voir l'absurdité de ce qu'il dit, & en l'exposant à la honte de contredire ce que tout le monde voit, & dont il ne peut s'empêcher de reconnoître lui-même la vérité : mais autre chose est de montrer à un homme qu'il est dans l'erreur, & autre chose de l'instruire de la vérité.
Je voudrois bien savoir quelles vérités ces propositions peuvent nous faire connoître, que nous ne connussions pas auparavant ? Tirons-en toutes les conséquences que nous pourrons, ces conséquences se réduiront toûjours à des propositions identiques, où une idée est affirmée d'elle-même ; & toute l'influence de ces maximes, si elles en ont quelqu'une, ne tombera que sur ces sortes de propositions. Or chaque proposition particuliere identique est aussi évidente par elle-même, que les propositions les plus universelles, avec cette seule différence, que ces dernieres pouvant être appliquées à tous les cas, on y insiste davantage.
Quant aux autres maximes moins générales, il y en a plusieurs qui ne sont que des propositions purement verbales, & qui ne nous apprennent autre chose que le rapport que certains noms ont entr'eux ; telle est celle-ci : le tout est égal à toutes ses parties ; car, je vous prie, quelle vérité réelle sort d'une telle maxime ? Un enfant, à qui l'on ôte une partie de sa pomme, le connoît mieux dans cet exemple particulier que par cette proposition générale, un tout est égal à toutes ses parties.
Quoique les propositions générales s'introduisent dans notre esprit à la faveur des propositions particulieres, cependant il prend après cela un chemin tout différent ; car réduisant sa connoissance à des principes aussi généraux qu'il le peut, il se les rend familiers, & s'accoûtume à y recourir comme à des modeles du vrai & du faux ; & les faisant servir ordinairement de regles pour mesurer la vérité des autres propositions, il vient à se figurer dans la suite, que les propositions plus particulieres empruntent leur vérité & leur évidence de la conformité qu'elles ont avec ces propositions générales.
Mais que veut-on dire, quand on dit communément qu'il faut avoir des principes ? Si l'on entend par principes des propositions générales & abstraites, qu'on peut au besoin appliquer à des cas particuliers ; qui est-ce qui n'en a pas ? Mais aussi quel mérite y a-t-il à en avoir ? Ce sont des maximes vagues, dont rien n'apprend à faire de justes applications. Si l'on doit avoir des principes, ce n'est pas qu'il faille commencer par-là, pour descendre ensuite à des connoissances moins générales : mais c'est qu'il faut avoir bien étudié les vérités particulieres, & s'être élevé d'abstraction en abstraction jusqu'aux propositions universelles. Ces sortes de principes sont naturellement déterminés par les connoissances particulieres qui y ont conduit ; on en voit toute l'étendue, & l'on peut s'assûrer de s'en servir toûjours avec exactitude. Voyez Analyse. (X)
Étymologie de « axiome »
??????, proposition, de ?????, penser, juger, de ?????, digne, de ???, pousser, faire (voy. AGIR), ????? signifiant ce qui pousse, agit, ce qui a force, vertu, valeur.
- Du latin axioma (« proposition évidente »), du grec ancien ??????, axioma, -atos.
axiome au Scrabble
Le mot axiome vaut 16 points au Scrabble.
Informations sur le mot axiome - 6 lettres, 4 voyelles, 2 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot axiome au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
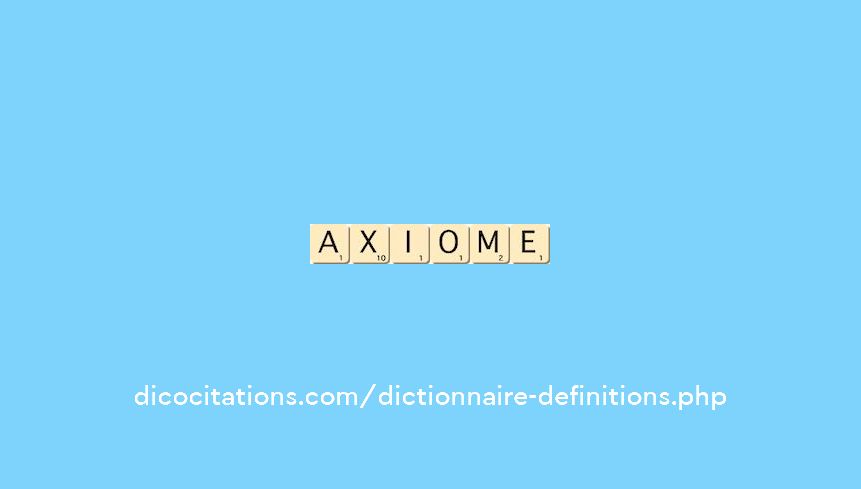
Les rimes de « axiome »
On recherche une rime en OM .
Les rimes de axiome peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Om
Rimes de chilom Rimes de nommes Rimes de compendium Rimes de thallium Rimes de sommes Rimes de gomme Rimes de tepidarium Rimes de idiomes Rimes de delphinium Rimes de home Rimes de diplôme Rimes de millenium Rimes de glaucome Rimes de potassium Rimes de basilicum Rimes de aérodromes Rimes de Gingelom Rimes de méningiome Rimes de mobil-home Rimes de imperium Rimes de sacrum Rimes de critérium Rimes de continuum Rimes de fibromes Rimes de surconsomme Rimes de paludamentum Rimes de tom Rimes de seaborgium Rimes de caecum Rimes de solarium Rimes de sommes Rimes de natrum Rimes de medium Rimes de assommes Rimes de métronomes Rimes de vivarium Rimes de guillaume Rimes de dénomment Rimes de forum Rimes de skydome Rimes de astronomes Rimes de entolomes Rimes de sagum Rimes de phascolome Rimes de referendum Rimes de agronomes Rimes de vanadium Rimes de manubrium Rimes de variorum Rimes de chômeMots du jour
chilom nommes compendium thallium sommes gomme tepidarium idiomes delphinium home diplôme millenium glaucome potassium basilicum aérodromes Gingelom méningiome mobil-home imperium sacrum critérium continuum fibromes surconsomme paludamentum tom seaborgium caecum solarium sommes natrum medium assommes métronomes vivarium guillaume dénomment forum skydome astronomes entolomes sagum phascolome referendum agronomes vanadium manubrium variorum chôme
Les citations sur « axiome »
- «Après cela, donc à cause de cela» est souvent un axiome faux.Auteur : André Maurois - Source : Un Art de vivre
- Le premier axiome de l'humanisme confucéen est: - Etudier, apprendre par l'expérience.Auteur : Confucius - Source : Sentences
- «Après cela, donc à cause de cela», est souvent un axiome faux.Auteur : André Maurois - Source : Un Art de vivre
- Aucune femme n'est quittée sans raison. Cet axiome est écrit au fond du coeur de toutes les femmes, et de là vient la fureur de la femme abandonnée.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Comédie humaine (1842-1852)
- Toute opinion philosophique, tout axiome, toute proposition générale et solennelle, énoncée sous forme d'aphorisme, est une bêtise.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Abel Sanchez
- L'axiome est l'atome du raisonnement.Auteur : Victor Hugo - Source : Philosophie prose
- Il n'y a ni beaux ni vilains sujets et on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l'Art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Louise Colet, 16 janvier 1852
- L'un des axiomes de Sherlock est le suivant : C'est une grossière erreur que d'émettre des hypothèses avant d'avoir des données... car on a tendance à déformer les faits pour étayer les hypothèses, au lieu que les hypothèses viennent étayer les faits.Auteur : Harlan Coben - Source : Dans les bois (2007)
- L'école est une institution fondée sur l'axiome que l'éducation est le résultat d'un enseignement.Auteur : Ivan Illich - Source : Une société sans école
- Toute la bassesse et la cruauté de notre civilisation se mesure à cet axiome stupide que les peuples heureux n'ont pas d'histoire.Auteur : Albert Camus - Source : La Mort heureuse (1971)
- J'étais un adepte de l'axiome de García Márquez : « Tout le monde a trois vies : une vie publique, une vie privée et une vie secrète. »Auteur : Guillaume Musso - Source : La Jeune Fille et la nuit (2018)
- La clé qui ouvre l'accès au perfectionnement de l'âme, c'est l'axiome des vies successives.Auteur : Ostad Elahi - Source : 100 Maximes de Guidance
- Il n'y a pas un conditionnement kantien, mais à coup sûr une esthétique de simplicité et d'élégance qui gouverne également la formulation de conjectures ; les mathématiciens considèrent que la beauté d'un théorème exige certaines proportions divines entre la simplicité des axiomes au point de départ, et la simplicité de la thèse à l'arrivée. Le laborieux, l'ennuyeux, a toujours été réservé au chemin entre les deux, à la démonstration. Auteur : Guillermo Martínez - Source : Mathématique du crime (2008)
- Messieurs, messieurs, retenez bien cet axiome: «On ne vit pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on digère».Auteur : Alexandre Dumas - Source : Ingénue (1853)
- On ne peut jamais atteindre le summum du bonheur sans être sûr de se casser le nez : presque une axiome mathématique. Je l'appelle la loi de l'humilité. Tu n'as pas remarqué ? Chaque fois qu'on est trop enthousiaste c'est une garantie d'échec.Auteur : Catherine Cusset - Source : Le Problème avec Jane (1999)
- Axiome de l'économie: quand deux économistes ont des avis contraires, aucun d'eux n'a forcément tort.Auteur : Hervé Le Tellier - Source : Guerre et plaies (2003)
- «Dis-moi par qui tu fais juger et je te dirai qui tu es». Il n'est pas en politique d'axiome plus sûr.Auteur : François Mitterrand - Source : Sans référence
- Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Qui oublie cet axiome de bon sens met son couple en danger.Auteur : Bernard Pivot - Source : Les mots de ma vie (2011)
- Cette diversité d'effets provenant tous d'une même cause, peut servir pour le dire en passant, à montrer le peu de justesse de l'axiome prétendu, si souvent mis en usage sur la proportionnalité des causes à leurs effets.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Traité de dynamique
- C'est un axiome que ceux à qui tout le monde accorde la seconde place ont des titres indiscutables à la première.Auteur : Jonathan Swift - Source : Le Conte du tonneau
- On demanda un jour à Fontenelle d'où il venait qu'il eût tant d'amis et si peu d'ennemis: par ces deux axiomes, répondit-il: tout est possible, et tout le monde a raison.Auteur : Georg Christoph Lichtenberg - Source : Le miroir de l'âme
- La partie de cette connaissance qui a pour objet le présent et le passé (l'histoire), quoiqu'elle ne soit fondée que sur le simple témoignage, produit souvent en nous une persuasion aussi forte que celle qui naît des axiomes.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Discours préliminaire à l'Encyclopédie (1751)
- Car ces choses qu'on appelle axiomes n'ont jamais existé et ne peuvent pas exister.Auteur : Edgar Allan Poe - Source : Histoires extraordinaires (1856), Euréka
- Les idées d'un homme qui n'a plus de bretelles ni de bottes ne sont plus celles d'un homme qui porte ces deux tyrans de notre esprit. Remarquez que ceci n'est un axiome que dans la vie conjugale. En morale, c'est ce que nous appelons un théorème relatif.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Petites Misères de la vie conjugale (1845)
- Axiome: le superflu est le premier des besoins.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Sans référence
Les mots proches de « axiome »
Axial, ale Axillaire Axiomatique AxiomeLes mots débutant par axi Les mots débutant par ax
axial axiale Axiat axillaire axiomatisation axiome axiomes axis
Les synonymes de « axiome»
Les synonymes de axiome :- 1. postulat
2. prémisse
3. principe
4. proposition
5. évidence
6. adage
7. aphorisme
8. maxime
9. sentence
10. vérité
11. certitude
12. réalité
13. truisme
14. lapalissade
15. banalité
16. authenticité
17. clarté
18. convention
19. hypothèse
20. théorie
21. véracité
22. exactitude
23. justesse
24. dogme
synonymes de axiome
Fréquence et usage du mot axiome dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « axiome » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot axiome dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Axiome ?
Citations axiome Citation sur axiome Poèmes axiome Proverbes axiome Rime avec axiome Définition de axiome
Définition de axiome présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot axiome sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot axiome notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
