Définition de « bol »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot bol de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur bol pour aider à enrichir la compréhension du mot Bol et répondre à la question quelle est la définition de bol ?
Une définition simple : (fr-rég|b?l) bol (m)
Expression : Bol alimentaire : Masse que forment les aliments lorsquils ont été soumis à la mastication et à laction de la salive.
Définitions de « bol »
Trésor de la Langue Française informatisé
BOL1, subst. masc.
BOL2, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
bol \b?l\ masculin
-
Coupelle hémisphérique, plus grande qu'une tasse, sans anse, qui sert à prendre certaines boissons ou certains aliments.
- Quand on eut mangé l'omelette, la servante apporta un bol plein de groseilles à maquereau. ? (André Dhôtel, Le Pays où l'on n'arrive jamais, 1955)
- Un bol de porcelaine, de faïence, d'argent.
- Chaque personne dispose d'un bol de riz, d'une paire de baguettes de bois ou de bambou, d'une cuillère de porcelaine à fond plat et d'une petite assiette.
-
(Par extension) (Synecdoque) Contenu du récipient du même nom.
- Un bol de lait, de tisane.
- Ces précautions prises, il parut moins inquiet et fit venir un bol de punch. ? (Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, 1848)
-
(Familier) (Indénombrable) Chance.
- Quel bol ! Il a toujours du bol.
-
(Argot) (Rare) Tête, crâne.
- À la snobinarde, qu'il défouraille, le gestapien ! Comme le marquis du Glandard au tir aux pigeons de Saint-Cloud ! Le grand maigre s'abat d'une masse, une olive en plein bol... ? (Frédéric Dard (San-Antonio), Fais gaffe à tes os, Fleuve Noir, 1956)
- Leur chagrin leur tourneboule parfois le bol, aux grognaces, et elles vous servent des tartines de bobards en veux-tu en voilà ! ? (Frédéric Dard (San-Antonio), Tout le plaisir est pour moi, Fleuve Noir, 1959, pages 26-27)
Nom commun 1 - français
bol \b?l\ masculin
-
(Minéralogie) (Icône) Terre argileuse friable, miscible dans l'eau.
- La terre pourrie, les bols, [employés pour l'avivage des métaux] sont des argiles non plastiques plus ou moins riches en oxyde de fer. ? (M. Gasnier, Dépôts métalliques directs et indirects, 1927, p. 266)
- Bol d'Arménie., utilisé pour la fabrication d'icônes chez les chrétiens orthodoxes.
-
(Médecine) (Désuet) Petite boule composée de cette terre riche en oxydes, autrefois utilisée comme médicament.
- Bol d'Arménie.
-
(Par extension) Du sens de « boule d'argile servie comme médicament » :
-
(Pharmacie) Grosse pilule de consistance molle, de forme ovoïde, destinée à être avalée en une seule fois.
- Il me survint un étouffement périodique, qui durait vingt-quatre heures. On prétend qu'il était occasionné par les frictions mercurielles que m'avait prodiguées, sans nécessité, le jeune Labadie, et par les bols pris intérieurement, que me prodiguait également mon ami Bonnet l'apothicaire ? (Nicolas Rétif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, 1796), Bibliothèque de la Pléiade, Tome 1, p. 988.
-
(Médecine vétérinaire) Préparation médicamenteuse du volume d'une grosse noix et de consistance molle qu'on fait avaler de force à un cheval ou à un b?uf.
- Les comprimés, et les bols (gros comprimés) sont un des moyens les plus faciles et les plus sûrs de donner un médicament. Ils n'ont pas besoin d'être mélangés à l'eau. Ils sont faciles à doser.? (Bill Forse, Christian Meyer, et al., Que faire sans vétérinaire ?, Cirad / CTA / Kathala, 2002, page 340)
- (Médecine) Bol alimentaire : quantité d'aliments mastiqués et imprégnés de salive, déglutis en une seule fois.
-
(Pharmacie) Grosse pilule de consistance molle, de forme ovoïde, destinée à être avalée en une seule fois.
-
(Art) Argile riche en oxydes employée par les peintres, les doreurs, les relieurs.
- Bol de Sinope.
- Bol jaune : argile jaune qui, par calcination, fournit l'ocre rouge utilisée en peinture.
- Bol d'Arménie : Kaolin mélangé à de l'oxyde de fer rouge utilisé par les doreurs à la feuille.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Coupe, vase demi-sphérique qui sert à prendre certaines boissons. Un bol de porcelaine, de faïence, d'argent. Il se dit aussi de Ce qu'un bol peut contenir. Un bol de lait, de tisane.
Littré
-
1 Terme de pharmacie. Terre argileuse colorée, qui était employée autrefois en médecine comme tonique et astringente.
Bol d'Arménie ou bol oriental, argile ocreuse rouge (couleur due à l'oxyde de fer), grasse au toucher, tonique et astringente.
- 2Portion d'électuaire officinal ou magistral, d'un poids déterminé que l'on avale en une fois.
- 3 Terme de physiologie. Bol alimentaire, masse arrondie que forme l'aliment au moment où il est rassemblé sur la partie supérieure de la langue pour être porté dans le pharynx par la déglutition.
HISTORIQUE
XVIe s. Ung pot de bol armenicque prisé six escus
, De Laborde, Émaux, p. 169. Bol armene, terre sigillée
, Paré, V, 9. Il pourra user d'un bol de casse ou d'une infusion de rheubarbe
, Paré, VII, 5. Puis sera instillé terebenthine de Venise avec un peu de bol fin
, Paré, VIII, 30.
Encyclopédie, 1re édition
BOL, s. m. (Hist. nat.) terre graisseuse & argilleuse, pesante & styptique ; elle s'attache promptement à la langue & teint les mains : il y a des bols de différentes couleurs, ordinairement de jaunes & de rouges ; il y en a aussi de blancs, &c. Autrefois on alloit chercher du bol dans le Levant, en Arménie, pour l'usage de la Medecine : mais on s'est à la fin convaincu que le bol que nous avons très-communément en France, est aussi bon que celui d'Arménie. On en fait venir de Blois, de Saumur, de Baville, &c. Voyez Terre. (I)
* Les plus connus d'entre les bols sont celui d'Arménie, qui est maintenant fort rare. La description générale de bol qui précede, lui convient. On lui attribue la vertu alexipharmaque & de l'astringence. Il y en a de jaune & de blanc.
Celui de Blois, qui est une terre d'un rouge pâle.
Celui d'Allemagne, dont la couleur est un peu plus foible que celui d'Arménie. Il est parsemé de veines jaunes ; on le tire des mines de Boheme. Il n'a aucune propriété particuliere.
Le bol blanc, qui vient de Gran en Hongrie, & de Coltberg sur le territoire de Liége ; on le dit d'un efficacité singuliere dans la dyssenterie.
Le bol de France, qui vient de Blois, de Saumur & de la Bourgogne. Le jaune passe pour le meilleur.
Celui de Transylvanie, il a tous les caracteres de celui d'Arménie. Il se fond dans la bouche comme beurre ; il vient des environs de Toccai.
Les Doreurs, pour faire l'assiette de l'or, se servent du bol d'Arménio. Les Relieurs l'écrasent avec une molette en l'humectant avec un peu de blanc-d'?uf mêlé d'eau sur une pierre polie ; quand il est bien broyé, ils le renferment dans un petit pot, pour en mettre dans l'occasion une couche très-mince sur la tranche du livre, après qu'elle a été bien ratissée. Voyez Pinceau au Bol.
Bol, (Pharmacie) forme sous laquelle on fait prendre certains médicamens, pour épargner aux malades le dégoût qu'ils ont, qui souvent leur donne beaucoup de répugnance ; en effet le bol n'étant qu'une bouchée très-petite, est très-aisé à avaler.
Le bol doit être mou & un peu plus épais que le miel : on le compose avec tout ce qui peut être pris intérieurement ; lorsque ce sont des substances seches ou des poudres, on leur donne une consistance molle, en les mêlant avec des conserves ou des sirops. Lorsqu'elles sont liquides & qu'on a intention de les faire prendre sous la forme de bol, on y joint des poudres telles que la poudre de réglisie & autres, par le moyen desquelles on les rend un peu plus solides.
Le sucre en poudre est un des ingrédiens, dont on se sert pour donner la consistance d'un bol aux médicamens gras & huileux, tels que les baumes.
L'on se sert de pain azyme pour envelopper le bol, empêcher qu'il ne s'en échappe quelque partie, & en faciliter la déglutition.
Le bol a diverses qualités, selon la différence des médicamens dont il est composé ; il y en a d'altérant, de purgatif, d'astringent, selon les indications qui se présentent à remplir.
On a soin de prescrire au malade une boisson appropriée à sa maladie, qui puisse aider à diviser le bol lorsqu'il est dans le ventricule. (N)
Étymologie de « bol »
- (XIIIe siècle) Du latin bolus (« boulette, motte »), attesté sous la forme bol armenike (bol d'Arménie).
- (XVIIIe siècle) De l'anglais bowl ; le syntagme bowl o' punch est très courant au XVIIe siècle et est francisé en bolleponge, un siècle plus tard, le mot prend le sens de « vase demi-sphérique qui sert à prendre certaines boissons telles que le lait, le punch ». Pour le sens familier de « chance », il dérive d'un sens perdu, à l'origine de avoir du bol et ras le bol, celui de cul[1]... Le sens de tête (à l'inverse) semble limité à Frédéric Dard.
?????, motte de terre.
bol au Scrabble
Le mot bol vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot bol - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot bol au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
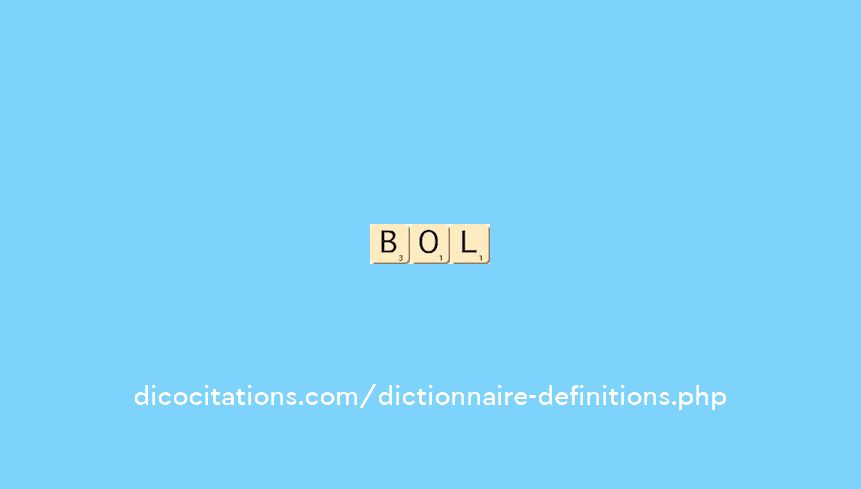
Les rimes de « bol »
On recherche une rime en OL .
Les rimes de bol peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ol
Rimes de komsomol Rimes de lipiodol Rimes de croquignol Rimes de bricolent Rimes de carole Rimes de couloir-symbole Rimes de affole Rimes de menthols Rimes de franco-mongole Rimes de convolent Rimes de fofolles Rimes de colle Rimes de dôle Rimes de guiboles Rimes de rubéole Rimes de somnolent Rimes de gondoles Rimes de frôles Rimes de negro spiritual Rimes de vitriols Rimes de scarole Rimes de pétroles Rimes de métropoles Rimes de gloriole Rimes de embole Rimes de accolent Rimes de folles Rimes de duopole Rimes de cajolent Rimes de viols Rimes de tôles Rimes de créoles Rimes de espagnol Rimes de anti-vols Rimes de rôles Rimes de tournesol Rimes de étole Rimes de bols Rimes de camisoles Rimes de ergol Rimes de gaudriole Rimes de protocoles Rimes de aréoles Rimes de gaules Rimes de discobole Rimes de cambrioles Rimes de volent Rimes de roséole Rimes de espagnoles Rimes de contrôlesMots du jour
komsomol lipiodol croquignol bricolent carole couloir-symbole affole menthols franco-mongole convolent fofolles colle dôle guiboles rubéole somnolent gondoles frôles negro spiritual vitriols scarole pétroles métropoles gloriole embole accolent folles duopole cajolent viols tôles créoles espagnol anti-vols rôles tournesol étole bols camisoles ergol gaudriole protocoles aréoles gaules discobole cambrioles volent roséole espagnoles contrôles
Les citations sur « bol »
- C'est par ses admirations surtout que le symbolisme a été grand. Il a mis presque tout son génie à choisir ses patronages.Auteur : Julien Gracq - Source : Préférences
- Sérieusement quand ils se seraient défiés tous trois à qui me louerait davantage, ils n'auraient pas employé d'expressions plus hyperboliques. Ma modestie ne fut point à l'épreuve de tant d'éloges.Auteur : Alain René Lesage - Source : Histoire de Gil Blas de Santillane (1724)
- Dans une épée d'académicien, il y a toujours des signes. Elle ne sert pas à pourfendre ses confrères, à se protéger des critiques. Non, c'est un objet symbolique.Auteur : Jean-François Deniau - Source : Discours de réception à l'Académie française, 7 décembre 1992.
- Au different que le peuple eut avec les nobles touchant l'abolition des debtes.Auteur : Jacques Amyot - Source : Alcibiade et Corolian, 5
- Savoir est le premier mot du symbole de la religion naturelle: car savoir est la première condition du commerce de l'homme avec les choses, de cette pénétration de l'univers qui est la vie intellectuelle de l'individu: savoir, c'est s'initier à Dieu.Auteur : Ernest Renan - Source : L'Avenir de la science, Pensées de 1848 (1890)
- J’ai mis beaucoup de temps à me considérer comme une victime car justement j’avais été consentante. Mais j’étais tout de même en dessous de la majorité sexuelle. J’aurais donc pu aller en justice, sauf qu’à chaque fois je me disais : « J’étais consentante. J’y ai repensé bien plus tard, il y avait prescription. Avec mon livre, j’ai entrepris autre chose, une réparation symbolique.Auteur : Vanessa Springora - Source : Interview de Vanessa Springora, BibliObs, par Elisabeth Philippe, le 26 décembre 2019
- Par une extravagance une autre est abolie;
D'âge en âge on ne fait que changer de folie.Auteur : Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée - Source : L'Ecole des mères (1744) - Bien que la plupart de nos visions nocturnes ne soient peut-être rien d'autre que de vagues et bizarres reflets de nos expériences à l'état de veille – n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril -, il en reste néanmoins dont le caractère dépaysant et éthéré ne permet aucune interprétation banale, et dont l'effet vaguement provocateur et inquiétant évoque la possibilité de brefs aperçus dans une sphère d'existence mentale non moins importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière pratiquement infranchissable.Auteur : Howard Phillips Lovecraft - Source : L'Appel de Cthulhu (1926)
- L'ethnographie n'est-elle pas une tentative de rachat et un symbole d'expiation de l'Occident?Auteur : André Reszler - Source : L'Intellectuel contre l'Europe (1976)
- Il y a un ras-le-bol fiscal en France, il faut donner de l'oxygène.Auteur : François Baroin - Source : RTL Matin, 10 novembre 2016.
- Regardez Jésus, il prenait des mots simples, et quand ça se compliquait, il faisait des paraboles. - C'est ça, un bon animateur télé.Auteur : Jacques Martin - Source : Télé 7 jours, 20 septembre 2000.
- Certains objets ont le pouvoir d'abolir le temps, mais jamais la peine. Le réconfort qu'ils vous procurent se paie. Le bonheur qu'ils semblent raviver s'en va d'autant plus loin quand vous les relâchez, comme le ressac d'une vague.Auteur : Gilles Legardinier - Source : Complètement cramé ! (2012)
- La France va organiser à Paris, avec l'ONG Ensemble contre la peine de mort, une rencontre au plus haut niveau rassemblant les sociétés civiles des États appliquant encore la peine de mort ou un moratoire afin de convaincre leurs dirigeants de l'importance et de l'urgence de l'abolir.Auteur : Emmanuel Macron - Source : Au Panthéon, lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le 09/10/2021
- Celui qui se réjouit encore sur le bûcher ne triomphe pas de la douleur, mais de ce qu'il ne sent pas la douleur où il l'attendait. Un symbole.Auteur : Friedrich Wilhelm Nietzsche - Source : Par-delà le bien et le mal (1886)
- J'ai lancé contre une pierre un bol cette nuit ;
L'acte brutal, j'étais ivre quand je l'ai commis ;
Le bol m'a dit en son langage de bol :
« J'ai été ce que tu es ! tu seras toi aussi ce que je suis ! »Auteur : Omar Khayyam - Source : Ruba'iyat - Hier au soir, j'étais ivre et j'ai jeté mon bol
par terre : il s'est brisé aussitôt sur le sol.
Et c'était comme si montait une prière :
« J'étais un homme, et tu redeviendras poussière. »Auteur : Omar Khayyam - Source : Ruba'iyat - Tuer un homme est le symbole du Mal. Tuer sans que rien ne compense cette perte de vie, c'est le Mal, Mal absolu.Auteur : Jean Genet - Source : Pompes funèbres (1947)
- C'est par là que Magdeleine, cette fameuse pécheresse et cette pénitente aussi célèbre, obtint l'entière abolition de tous les déréglements de sa vie, et qu'elle parvint à un degré si éminent de sainteté.Auteur : Louis Bourdaloue - Source : Pensées, tome II
- Les banques symbolisent la faillite de nos civilisations. Les clients et le personnel sont tous aussi malheureux d'y venir, mais personne n'a le choix.Auteur : Gilles Legardinier - Source : Demain j'arrête! (2011)
- Celui qui pense qu'il n'y a rien de plus dangereux, de plus pernicieux, de plus diabolique qu'un rebelle, qu'il l'assassine, qu'il l'assomme, l'étrangle, le saigne, publiquement ou secrètement.Auteur : Martin Luther - Source : Pamphlet contre les paysans allemands et les révoltés du Bundschuh (1525)
- Pourquoi avoir choisi le laurier comme symbole de la gloire ? - Sans doute parce que le fruit du laurier est un poison.Auteur : Gilbert Cesbron - Source : Libérez Barabbas (1957)
- On ne peut abolir la guerre que par la guerre. Pour qu'il n'y ait plus de fusils, il faut prendre le fusil.Auteur : Mao Zedong - Source : Citations du président Mao Tsé-Toung (1967), V
- Le progrès technologique n'abolit pas les obstacles; il en change simplement la nature.Auteur : Aldous Huxley - Source : Les portes de la perception (1954)
- Vieil océan, tu es le symbole de l'identité: toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle ...Auteur : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont - Source : Les chants de Maldoror (1869)
- Ah! si quelques années après votre mort vous reveniez, hommes oubliés, au milieu du monde, vous vous vous hâteriez de rentrer dans vos tombeaux pour ne voir pas votre nom terni, votre mémoire abolie.Auteur : Jacques Bénigne Bossuet - Source : Sans référence
Les mots proches de « bol »
Bol ou bolus Bolbec Boldo Bolet BolivarLes mots débutant par bol Les mots débutant par bo
bol bola Bolandoz bolas Bolazec Bolbec bolchevik bolcheviks bolchevique bolcheviques bolchevisme bolcheviste bolchevistes bolcho bold boldo bolduc bolée bolées boléro boléros bolet bolets bolge bolide bolides Bolinne bolivar Bolivie bolivien bolivien bolivienne bolivienne boliviens boliviens Bolland Bollène Bollène-Vésubie Bolleville Bolleville Bollezeele Bollwiller bolognais bolognaise bolognaise bolognaises Bologne bolonaise bolonaise Bolozon
Les synonymes de « bol»
Les synonymes de bol :- 1. jatte
2. bolée
3. écuelle
4. récipient
5. assiette
6. sébile
7. soucoupe
8. coupe
9. tasse
10. gobelet
11. presse
- 1. dégoût
2. saturation
synonymes de bol
Fréquence et usage du mot bol dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « bol » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot bol dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Bol ?
Citations bol Citation sur bol Poèmes bol Proverbes bol Rime avec bol Définition de bol
Définition de bol présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot bol sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot bol notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 3 lettres.
