La définition de Ponctuation du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Ponctuation
Nature : s. f.
Prononciation : pon-ktu-a-sion ; en vers, de cinq syllab
Etymologie : Ponctuer.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de ponctuation de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec ponctuation pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Ponctuation ?
La définition de Ponctuation
Art de distinguer par des signes reçus les phrases entre elles, les sens partiels qui constituent ces phrases, et les différents degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens. Les signes de la ponctuation. Mettre la ponctuation.
Toutes les définitions de « ponctuation »
Wiktionnaire
Nom commun - français
ponctuation \p??k.t?a.sj??\ féminin
-
Art de ponctuer.
- Les règles de la ponctuation.
- Une faute de ponctuation.
- Les divers signes de ponctuation.
- Manière de ponctuer.
- Cet écrivain a une ponctuation singulière.
- Ponctuation vicieuse.
- Les derniers éditeurs ont rectifié la ponctuation de ce passage.
- Respectez la ponctuation !
- Signe de ponctuation.
- La ponctuation préférée de l'auteur est la virgule car, tout comme dans la langue parlée, les propos s'enchaînent sur le papier. ? (Damira Titonel Asperti, Écrire pour les autres, mémoires d'une résistante : Les antifascistes italiens en Lot-et-Garonne sous l'Occupation, Presses universitaires de Bordeaux, 1999, p. 16)
- En parlant de la langue hébraïque et de quelques autres langues orientales, il se dit principalement des points dont on se sert pour suppléer les voyelles.
- (Musique) Art de marquer les repos, de distinguer les phrases.
-
Ensemble de petites taches, semblables à des points.
- Ici, en effet, le métasternum est régulièrement couvert partout d'une ponctuation assez serrée, médiocre et peu profonde ; la ponctuation du premier segment ventral est très superficielle, à peine plus fine que celle du métasternum ; [?]. ? (Bulletin & annales de la Société royale belge d'entomologie, 1895, vol.39, page 93)
Littré
-
1Art de distinguer par des signes reçus les phrases entre elles, les sens partiels qui constituent ces phrases, et les différents degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens. Les signes de la ponctuation. Mettre la ponctuation.
Mettant dans sa lecture cette espèce de ponctuation délicate qui fait sentir les différents genres de mérite par des inflexions aussi fines que variées
, D'Alembert, Éloges, Lamotte. - 2Manière de ponctuer. Une ponctuation vicieuse. Rectifier la ponctuation d'un passage.
- 3Points qui suppléent les voyelles dans quelques langues orientales. La ponctuation hébraïque.
- 4 Terme de musique. Art de ponctuer.
- 5 Terme de botanique. Ponctuations des vaisseaux, enfoncements que l'on remarque à la surface extérieure de certains de ces organes.
HISTORIQUE
XVIe s. Si toutes les langues generalement ont leur differences en parler et escriture, toutesfois nonobstant cela elles n'ont qu'une ponctuation seulement, et ne trouveras qu'en icelle les Grecs, Latins, François ou Hespaignols soient differents
, Et. Dolet, dans LIVET, la Gramm. franç. p. 114.
Encyclopédie, 1re édition
PONCTUATION, s. f. c'est l'art d'indiquer dans l'écriture par les signes reçus, la proportion des pauses que l'on doit faire en parlant.
Il existe un grand nombre de manuscrits anciens, où ni les mots, ni les sens, ni les propositions, ne sont distingués en aucune maniere ; ce qui porteroit à croire que l'art de la ponctuation étoit ignoré dans les premiers tems. Les principes en sont même aujourd'hui si incertains, si peu fixés par l'usage uniforme & constant des bons auteurs, qu'au premier aspect on est porté à croire que c'est une invention moderne ; le pere Buffier, Gramm. fr. n°. 975. & M. Restaut, chap. xvj. disent expressément que c'est une pratique introduite en ces derniers siecles dans la Grammaire.
On trouve néanmoins dans les écrits des anciens, une suite de témoignages qui démontrent, que la nécessité de cette distinction raisonnée s'étoit fait sentir de bonne heure ; qu'on avoit institué des caracteres pour cette fin, & que la tradition s'en conservoit d'âge en âge ; ce qui apparemment auroit porté l'art de ponctuer à sa perfection, si l'Imprimerie, qui est si propre à éterniser les inventions de l'esprit humain, eût existé dès ces premiers tems.
Dans le vij. siecle de l'ere chrétienne, Isidore de Séville parle ainsi des caracteres de la ponctuation connue de son tems : quædam sententiarum notæ apud celeberrimos auctores fuerunt, quasque antiqui ad distinctionem scripturarum carminibus & historiis apposuerunt. Nota est figura propria in litteræ modum posita, ad demonstrandam unamquamque verbi, sententiarumque, ac versuum rationem. Orig. I. 20.
Vers la fin du iv. siecle, & au commencement du v. S. Jérome traduisit en latin l'Ecriture-sainte qu'il trouva sans aucune distinction dans le texte original ; c'est sa version que l'Eglise a adoptée sous le nom de vulgate, excepté les pseaumes, qui sont presque entierement de l'ancienne version. Or le saint docteur remarque dans plusieurs de ses préfaces, que l'on trouve à la tête des bibles vulgates (in Josue, in lib. paralip. in Ezech.), qu'il a distingué dans sa version les mots, les membres des phrases, & les versets.
Cicéron connoissoit aussi ces notes distinctives, & l'usage qu'il convenoit d'en faire. On peut voir (article Accent.) un passage de cet orateur (Orat. lib. III. n. xliv.), où il est fait mention des Librariorum notis, comme de signes destinés à marquer des repos & des mesures.
Aristote, qui vivoit il y a plus de 2000 ans, se plaint (Rhet. III. 5.) de ce qu'on ne pouvoit pas ponctuer les écrits d'Héraclite, sans risquer de lui donner quelque contre sens. Nam scripta Heracliti interpungere operosum est, quia incertum utri vox conjungenda, an priori, an verò posteriori, ut in principio ipsius libri ; ait enim : Rationis existentis semper imperiti homines nascuntur, (??? ????? ????' ?????? ???? ???????? ???????? ?????????) ; incertum est enim illud semper (????)) utri interpunctione conjungas. Ce passage prouve que le philosophe de Stagyre, non-seulement sentoit la nécessité de faire avec intelligence des pauses convenables dans l'énonciation du discours, & de les marquer dans le discours écrit, mais même qu'il connoissoit l'usage des points pour cette distinction : car le mot original ?????????, rendu ici par interpungere & interpunctione, a pour racines le verbe ?????, pungo, & la préposition ???, qui, selon l'auteur des racines grecques de P. R. vient de ????, divido ; en sorte que ?????????, signifie proprement pungere ad dividendum, ou punctis distinguere.
Comment est-il donc arrivé que si long-tems après l'invention des signes distinctifs de la ponctuation, il se soit trouvé des copistes, & peut-être des auteurs, qui écrivoient sans distinction, non-seulement de phrases ou de membres de phrases, mais même de mots ? Par rapport aux livres saints, il est facile de le concevoir. Antérieurs de beaucoup, pour la plûpart, à l'art de ponctuer, ils ont dû être écrits sans aucun signe de distinction. Les Israélites faisant profession de n'avoir point de commerce avec les autres peuples, ne durent pas être instruits promptement de leurs inventions ; & les livres inspirés, même dans les derniers tems, durent être écrits comme les premiers, tant pour cette cause, que par respect pour la forme primitive. Ce même respect, porté par les Juifs jusqu'au scrupule & à la minutie, ne leur a pas permis depuis d'introduire dans le texte sacré le moindre caractere étranger. Ce ne fut que longtems après leur derniere dispersion dans toutes les parties de la terre, & lorsque la langue sainte devenue une langue morte eut besoin de secours extraordinaires pour être entendue & conservée, que les docteurs juifs de l'école de Tibériade, aujourd'hui connus sous le nom de Massorethes, imaginerent les points voyelles (voyez Point.), & les signes de la ponctuation que les Hébraïsans nomment accentus pausantes & distinguentes : mais les témoignages que je viens de rapporter d'une tradition plus ancienne qu'eux sur la ponctuation, prouvent qu'ils n'en inventerent point l'art ; ils ne firent que le perfectionner, ou plutôt que l'adapter aux livres sacrés, pour en faciliter l'intelligence.
Pour ce qui est des autres nations, sans avoir le même attachement & le même respect que les Juifs pour les anciens usages, elles purent aisément préférer l'habitude ancienne aux nouveautés que les bons esprits leur présentoient : c'est une suite de la constitution naturelle de l'homme ; le peuple sur-tout se laisse aller volontiers à l'humeur singeresse dont parle Montagne, & il n'y a que trop de savans qui sont peuples, & qui ne savent qu'imiter ou même copier. D'ailleurs la communication des idées nouvelles, avant l'invention de l'Imprimerie, n'étoit ni si facile, ni si prompte, ni si universelle, qu'elle l'est aujourd'hui : & si nous sommes étonnés que les anciens ayent fait si peu d'attention à l'art de ponctuer, il seroit presque scandaleux, que dans un siecle éclairé comme le nôtre, & avec les moyens de communication que nous avons en main, nous négligeassions une partie si importante de la Grammaire.
« Il est très-vrai, dit M. l'abbé Girard, (tome II. disc. xvj. page 435.) que par rapport à la pureté du langage, à la netteté de la phrase, à la beauté de l'expression, à la délicatesse & à la solidité des pensées, la ponctuation n'est que d'un mince mérite? mais? la ponctuation soulage & conduit le lecteur. Elle lui indique les endroits où il convient de se reposer pour prendre sa respiration, & combien de tems il y doit mettre. Elle contribue à l'honneur de l'intelligence, en dirigeant la lecture de maniere que le stupide paroisse, comme l'homme d'esprit, comprendre ce qu'il lit. Elle tient en regle l'attention de ceux qui écoutent, & leur fixe les bornes du sens : elle remédie aux obscurités qui viennent du style ».
De même que l'on ne parle que pour être entendu, on n'écrit que pour transmettre ses pensées aux absens d'une maniere intelligible. Or il en est à-peu-près de la parole écrite, comme de la parole prononcée : « le repos de la voix dans le discours, dit M. Diderot (article Encyclopédie.), & les signes de la ponctuation dans l'écriture, se correspondent toujours, indiquent également la liaison ou la disjonction des idées ». Ainsi il y auroit autant d'inconvénient à supprimer ou à mal placer dans l'écriture les signes de la ponctuation, qu'à supprimer ou à mal placer dans la parole les repos de la voix. Les uns comme les autres servent à déterminer le sens ; & il y a telle suite de mots qui n'auroit, sans le secours des pauses ou des caracteres qui les indiquent, qu'une signification incertaine & équivoque, & qui pourroit même présenter des sens contradictoires, selon la maniere dont on y grouperoit les mots.
On rapporte que le général Fairfax, au lieu de signer simplement la sentence de mort du roi d'Angleterre Charles. I. songea à se ménager un moyen pour se disculper dans le besoin, de ce qu'il y avoit d'odieux dans cette démarche, & qu'il prit un détour, qui, bien apprécié, n'étoit qu'un crime de plus. Il écrivit sans ponctuation, au bas de la sentence : si omnes consentiunt ego non dissentio ; se réservant d'interpréter son dire, selon l'occurrence, en le ponctuant ainsi : si omnes consentiunt ; ego non ; dissentio, au lieu de le ponctuer conformément au sens naturel qui se présente d'abord, & que sûrement il vouloit faire entendre dans le moment : si omnes consentiunt, ego non dissentio.
« C'est par une omission de points & de virgules bien marquées, dit le P. Buffier, (Gramm. fr. n°. 975.) qu'il s'est trouvé des difficultés insurmontables, soit dans le texte de l'Ecriture-sainte, soit dans l'exposition des dogmes de la Religion, soit dans l'énonciation des lois, des arrêts, & des contrats de la plus grande conséquence pour la vie civile. Cependant, ajoute-t-il, on n'est point encore convenu tout-à-fait de l'usage des divers signes de la ponctuation. La plûpart du tems chaque auteur se fait un système sur cela ; & le système de plusieurs, c'est de n'en point avoir.... Il est vrai qu'il est très-difficile, ou même impossible, de faire sur la ponctuation un système juste & dont tout le monde convienne ; soit à cause de la variété infinie qui se rencontre dans la maniere dont les phrases & les mots peuvent être arrangés, soit à cause des idées différentes que chacun se forme à cette occasion ».
Il me semble que le P. Buffier n'a point touché, ou n'a touché que trop légerement la véritable cause de la difficulté qu'il peut y avoir à construire & à faire adopter un système de ponctuation. C'est que les principes en sont nécessairement liés à une métaphysique très-subtile, que tout le monde n'est pas en état de saisir & de bien appliquer ; ou qu'on ne veut pas prendre la peine d'examiner ; ou peut-être tout simplement, qu'on n'a pas encore assez déterminée, soit pour ne s'en être pas suffisamment occupé, soit pour l'avoir imaginée toute autre qu'elle n'est.
Tout le monde sent la justesse qu'il y a à définir la ponctuation, comme je l'ai fait dès le commencement ; l'art d'indiquer dans l'écriture, par les signes reçus, la proportion des pauses que l'on doit faire en parlant.
Les caracteres usuels de la ponctuation, sont la virgule, qui marque la moindre de toutes les pauses, une pause presque insensible ; un point & une virgule, qui désigne une pause un peu plus grande ; les deux points qui annoncent un repos encore un peu plus considérable ; & le point qui marque la plus grande de toutes les pauses.
Le choix de ces caracteres devant dépendre de la proportion qu'il convient d'établir dans les pauses, l'art de ponctuer se réduit à bien connoître les principes de cette proportion. Or il est évident qu'elle doit se régler sur les besoins de la respiration, combinés néanmoins avec les sens partiels qui constituent les propositions totales. Si l'on n'avoit égard qu'aux besoins de la respiration, le discours devroit se partager en parties à-peu-près égales ; & souvent on suspendroit maladroitement un sens, qui pourroit même par-là devenir inintelligible ; d'autres fois on uniroit ensemble des sens tout-à-fait dissemblables & sans liaison, ou la fin de l'expression d'un sens avec le commencement d'un autre. Si au contraire on ne se proposoit que la distinction des sens partiels, sans égard aux besoins de la respiration ; chacun placeroit les caracteres distinctifs, selon qu'il jugeroit convenable d'anatomiser plus ou moins les parties du discours : l'un le couperoit par masses énormes, qui mettroient hors d'haleine ceux qui voudroient les prononcer de suite : l'autre le réduiroit en particules qui feroient de la parole une espece de bégayement dans la bouche de ceux qui voudroient marquer toutes les pauses écrites.
Outre qu'il faut combiner les besoins des poûmons avec les sens partiels, il est encore indispensable de prendre garde aux différens degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens partiels dans l'ensemble d'une proposition ou d'une période, & d'en tenir compte dans la ponctuation par une gradation proportionnée dans le choix des signes. Sans cette attention, les parties subalternes du troisieme ordre, par exemple, seroient séparées entre elles par des intervalles égaux à ceux qui distinguent les parties du second ordre & du premier ; & cette égalité des intervalles ameneroit dans la prononciation une sorte d'équivoque, puisqu'elle présenteroit comme parties également dépendantes d'un même tout, des sens réellement subordonnés les uns aux autres, & distingués par différens degrés d'affinité.
Que faudroit-il donc penser d'un système de ponctuation qui exigeroit, entre les parties subalternes d'un membre de période, des intervalles plus considérables qu'entre les membres primitifs de la période ? Tel est celui de M. l'abbé Girard, qui veut (tome II. page 463.) que l'on ponctue ainsi la période suivante :
Si l'on fait attention à la conformation délicate du corps féminin : si l'on connoît l'influence des mouvemens histériques : & si l'on sait que l'action en est aussi forte qu'irréguliere ; on excusera facilement les foiblesses des femmes.
C'est l'exemple qu'il allegue d'une regle qu'il énonce en ces termes : « Il n'est pas essentiel aux deux points de servir toujours à distinguer des membres principaux de période : il leur arrive quelquefois de se trouver entre les parties subalternes d'un membre principal qui n'est distingué de l'autre que par la virgule ponctuée. Cela a lieu lorsqu'on fait énumération de plusieurs choses indépendantes entre elles, pour les rendre toutes dépendantes d'une autre qui acheve le sens ». Mais, je le demande, qu'importe à l'ensemble de la période l'indépendance intrinseque des parties que l'on y réunit ? S'il y faut faire attention pour bien ponctuer, & s'il faut ponctuer d'après la regle de l'académicien ; il faut donc écrire ainsi la phrase suivante :
L'officier : le soldat : & le valet se sont enrichis à cette expédition.
Cependant M. Girard lui-même n'y met que des virgules ; & il fait bien, quoiqu'il y ait énumération de plusieurs choses indépendantes entr'elles, rendues toutes dépendantes de l'attribut commun, se sont enrichis à cette expédition, lequel attribut acheve le sens. Ce grammairien a senti si vivement qu'il n'y avoit qu'une bonne métaphysique qui pût éclaircir les principes des langues, qu'il fait continuellement les frais d'aller la chercher fort loin, quoiqu'elle soit souvent assez simple & assez frappante : il lui arrive alors de laisser la bonne pour des pointilles ou du précieux.
Il s'est encore mépris sur le titre de son seizieme discours, qu'il a intitulé de la ponctuation françoise. Un système de ponctuation construit sur de solides fondemens, n'est pas plus propre à la langue françoise qu'à toute autre langue. C'est une partie de l'objet de la Grammaire générale ; & cette partie essentielle de l'Orthographe ne tient de l'usage nationnal que le nombre, la figure, & la valeur des signes qu'elle emploie.
Mais passons au détail du système qui doit naître naturellement des principes que je viens d'établir. J'en réduis toutes les regles à quatre chefs principaux, relativement aux quatre especes de caracteres usités dans notre ponctuation.
I. De la virgule. La virgule doit être le seul caractere dont on fasse usage par-tout où l'on ne fait qu'une seule division des sens partiels, sans aucune soudivision subalterne. La raison de cette premiere regle générale est que la division dont il s'agit se faisant pour ménager la foiblesse ou de l'organe ou de l'intelligence, mais toujours un peu aux dépens de l'unité de la pensée totale, qui est réellement indivisible, il ne faut accorder aux besoins de l'humanité que ce qui leur est indispensablement nécessaire, & conserver le plus scrupuleusement qu'il est possible, la vérité & l'unité de la pensée dont la parole doit présenter une image fidelle. C'est donc le cas d'employer la virgule qui est suffisante pour marquer un repos ou une distinction, mais qui, indiquant le moindre de tous les repos, désigne aussi une division qui altere peu l'unité de l'expression & de la pensée. Appliquons cette regle générale aux cas particuliers.
1°. Les parties similaires d'une même proposition composée doivent être séparées par des virgules, pourvû qu'il y en ait plus de deux, & qu'aucune de ces parties ne soit soudivisée en d'autres parties subalternes.
Exemples pour plusieurs sujets : la richesse, le plaisir, la santé, deviennent des maux pour qui ne sait pas en user. Théor. des sent. ch. xiv.
Le regret du passé, le chagrin du présent, l'inquiétude sur l'avenir, sont les fléaux qui affligent le plus le genre humain. Ib.
Exemple de plusieurs attributs réunis sur un même sujet : un prince d'une naissance incertaine, nourri par une femme prostituée, élevé par des bergers, & depuis devenu chef de brigands, jetta les premiers fondemens de la capitale du monde. Vertot. Révol. rom. liv. I.
Exemple de plusieurs verbes rapportés au même sujet : il alla dans cette caverne, trouva les instrumens, abattit les peupliers, & mit en un seul jour un vaisseau en état de voguer. Télémaque, liv. VII.
Exemple de plusieurs complémens d'un même verbe : ainsi que d'autres encore plus anciens qui enseignerent à se nourrir de blé, à se vêtir, à se faire des habitations, à se procurer les besoins de la vie, à se précautionner contre les bêtes féroces. Trad. par M. l'abbé d'Olivet, de cette phrase de Cicéron, qui peut aussi entrer en exemple. etiam superiores qui fruges, qui vestitum, qui tecta, qui cultum vitæ, qui præsidia contrà feras invenerunt. Tuscul. I. 25.
M. l'abbé Girard (tom. II. pag. 456.) se conforme à la regle que l'on vient de proposer, & ponctue avec la virgule la phrase suivante.
Je connois quelqu'un qui loue sans estimer, qui décide sans connoître, qui contredit sans avoir d'opinion, qui parle sans penser, & qui s'occupe sans rien faire.
Quatre lignes plus bas, il ponctue avec les deux points une autre phrase tout-à-fait semblable à celle-là, & qui par conséquent n'exigeoit pareillement que la virgule.
C'est un mortel qui se moque du qu'en dira-t-on : qui n'est occupé que du plaisir : qui critique hardiment tout ce qui lui déplaît : dont l'esprit est fécond en systèmes, & le c?ur peu susceptible d'attachement : que tout le monde recherche & veut avoir à sa compagnie.
Dire pour justifier cette disparate, que les parties similaires du premier exemple sont en rapport d'union, & celles du second en rapport de partie intégrante, c'est fonder une différence trop réelle sur une distinction purement nominale, parce que le rapport de partie intégrante est un vrai rapport d'union, puisque les parties intégrantes ont entr'elles une union nécessaire pour l'intégrité du tout : d'ailleurs quelque réelle que pût être cette distinction, elle ne pourroit jamais être mise à la portée du grand nombre, même du grand nombre des gens de lettres ; & ce seroit un abus que d'en faire un principe dans l'art de ponctuer, qui doit être accessible à tous. Il ne faut donc que la virgule au lieu des deux points dont s'est servi l'académicien, & la seule virgule qu'il a employée, il faut la supprimer en vertu de la regle suivante.
2°. Lorsqu'il n'y a que deux parties similaires, si elles ne sont que rapprochées sans conjonction, le besoin d'indiquer la diversité de ces parties, exige entre deux une virgule dans l'ortographe & une pause dans la prononciation. Exemple : des anciennes m?urs, un certain usage de la pauvreté, rendoient à Rome les fortunes à-peu-près égales. Montesquieu, grandeur & décad. des Rom. ch. iv.
Si les deux parties similaires sont liées par une conjonction, & que les deux ensemble n'exedent pas la portée commune de la respiration, la conjonction suffit pour marquer la diversité des parties, & la virgule romproit mal-à-propos l'unité du tout qu'elles constituent, puisque l'organe n'exige point de repos. Exemples : l'amagination & le jugement ne sont pas toujours d'accord. Gramm. de Buffier, n°. 980. Il parle de ce qu'il ne sait point ou de ce qu'il sait mal. La Bruyere. ch. xj.
Mais si les deux parties similaires réunies par la conjonction, ont une certaine étendue qui empêche qu'on ne puisse aisément les prononcer tout de suite sans respirer ; alors, nonobstant la conjonction qui marque la diversité, il faut faire usage de la virgule pour indiquer la pause : c'est le besoin seul de l'organe qui fait ici la loi. Exemples : il formoit ces foudres dont le bruit a retenti par-tout le monde, & ceux qui grondent encore sur le point d'éclater. Pelisson. Elle (l'Eglise) n'a jamais regardé comme purement inspiré de Dieu, que ce que les Apôtres ont écrit, ou ce qu'ils ont confirmé par leur autorité. Bossuet, Disc. sur l'hist. univ. part. II.
M. Restaut (ch. xvj.) veut qu'on écrive sans virgule : l'exercice & la frugalite fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir ni vous parler. Et il fait bien. « Mais on met la virgule, dit-il, avant ces conjonctions, si les termes qu'elles assemblent sont accompagnés de circonstances ou de phrases incidentes, comme quand on dit : l'exercice que l'on prend à la la chasse, & la frugalité que l'on observe dans le repas, fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir dans l'état où vous êtes, ni vous parler des risques que vous courez ». Cette remarque indique une raison fausse : l'addition d'une circonstance ou d'une phrase incidente ne rompt jamais l'unité de l'expression totale, & conséquemment n'amene jamais le besoin d'en séparer les parties par des pauses : ce n'est que quand les parties s'alongent assez pour fatiguer l'organe de la prononciation, qu'il faut indiquer un repos entre deux par la virgule ; si l'addition n'est pas assez considérable pour cela, il ne faudra point de virgule, & l'on dira très-bien sans pause : un exercice modéré & une frugalité honnête fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir ici ni vous parler sans témoins : dans ce cas la regle de M. Restaut est fausse, pour être trop générale.
3°. Ce qui vient d'être dit de deux parties similaires d'une proposition composée, doit encore se dire des membres d'une période qui n'en a que deux, lorsque ni l'un ni l'autre n'est subdivisé en parties subalternes, dont la distinction exige la virgule : il faut alors en séparer les deux membres par une simple virgule. Exemples : la certitude de nos connoissances ne suffit pas pour les rendre précieuses, c'est leur importance qui en fait le prix. Théor. des sent. ch. j. On croit quelquefois haïr la flaterie, mais on ne hait que la maniere de flater. La Rochefoucault, pensée 329. éd. de 1741. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. Id. pensée 31.
M. l'abbé Girard, au lieu d'employer un point & une virgule dans les périodes suivantes (tom. I. pag. 458), auroit donc dû les ponctuer par une simple virgule, en cette maniere : l'homme manque souvent de raison, quoiqu'il se definisse un être raisonnable. Si César eût eu la justice de son côté, Caton ne se seroit pas déclaré pour Pompée. Non-seulement il lui a refusé sa protection, mais il lui a encore rendu de mauvais services.
4°. Dans le style coupé, où un sens total est énoncé par plusieurs propositions qui se succedent rapidement, & dont chacune a un sens fini, & qui semble complet ; la simple virgule suffit encore pour séparer ces propositions, si aucune d'elles n'est divisée en d'autres parties subalternes qui exigent la virgule. Exemple : les voilà comme deux bêtes cruelles qui cherchent à se déchirer ; le feu brille dans leurs yeux, ils se raccourcissent, ils s'alongent, ils se baissent, ils se relevent, ils s'élancent, ils sont altérés de sang. Télémaque, liv. XVI. On débute par une proposition générale : les voilà comme deux bêtes cruelles qui cherchent à se déchirer ; & elle est séparée du reste par une ponctuation plus forte ; les autres propositions sont comme différens aspects & divers développemens de la premiere.
Autre exemple : il vient une nouvelle, on en rapporte les circonstances les plus marquées, elle passe dans la bouche de tout le monde, ceux qui en doivent être les mieux instruits la croyent & la répandent, j'agis sur cela ; je ne crois pas être blâmable. « Toutes les parties de cette période, dit le P. Buffier (Gramm. fr. n°. 997.), ne sont que des circonstances ou des jours particuliers de cette proposition principale : je ne crois pas être blâmable ». C'est aussi pour cela que je l'ai séparée du reste par une ponctuation plus forte ; ce que n'a pas fait le P. Buffier.
Quoique chacune des propositions dont il s'agit ici soit isolée par rapport à sa constitution grammaticale, elle a cependant avec les autres une affinité logique, qui les rend toutes parties similaires d'un sens unique & principal ; si elles ne sont unies sensiblement par aucune conjonction expresse, c'est pour arrêter moins la marche de l'esprit par l'attirail traînant de mots superflus, & pour donner au style plus de feu & de vivacité. L'exemple du Télémaque offre une peinture bien plus animée, & celui du P. Buffier est une apologie qui a beaucoup plus de chaleur que si l'on avoit lié scrupuleusement par des conjonctions expresses les parties de ces deux ensembles. Ce seroit donc aller directement contre l'esprit du style coupé, & détruire sans besoin la vérité & l'unité de la pensée totale, que d'en assujettir l'expression à une prononciation appesantie par des intervalles trop grands. Il en faut pour la distinction des sens partiels & pour les repos de l'organe ; mais rendons-les les plus courts qu'il est possible, & contentons-nous de la virgule quand une division subalterne n'exige rien de plus.
C'est pourtant l'usage de la plûpart des écrivains, & la regle prescrite par le grand nombre des grammairiens, de séparer ces propositions coupées par un point & une virgule, ou même par deux points. Mais outre que je suis persuadé, comme je l'ai déja dit, que l'autorité dans cette matiere ne doit être considérée qu'autant qu'elle vient à l'appui des principes raisonnés ; si l'on examine ceux qui ont dirigé les grammairiens dont il s'agit, il sera facile de reconnoître qu'ils sont erronés.
« On le met, dit M. Restaut parlant du point (ch. xvj.), à la fin d'une phrase ou d'une période dont le sens est absolument fini, c'est-à-dire lorsque ce qui la suit en est tout-à-fait indépendant. Nous observerons, ajoute-t-il un peu après, que dans le style concis & coupé, on met souvent les deux points à la place du point, parce que les phrases étant courtes, elles semblent moins détachées les unes des autres ».
Il est évident que ce grammairien donne en preuve une chose qui est absolument fausse ; car c'est une erreur sensible de faire dépendre le degré d'affinité des phrases de leur plus ou moins d'étendue ; un atôme n'a pas plus de liaison avec un atôme, qu'une montagne avec une montagne : d'ailleurs c'est une méprise réelle de faire consister la plénitude du sens dans la plénitude grammaticale de la proposition, s'il est permis de parler ainsi ; les deux exemples que l'on vient de voir le démontrent assez ; & M. l'abbé Girard va le démontrer encore dans un raisonnement dont j'adopte volontiers l'hypothese, quoique j'en rejette la conséquence, ou que j'en déduise une toute opposée.
Il propose l'exemple que voici dans le style coupé, & il en sépare les propositions partielles par les deux points : l'amour est une passion de pur caprice : il attribue du mérite à l'objet dont on est touché : il ne fait pourtant pas aimer le mérite : jamais il ne se conduit par reconnoissance : tout est chez lui goût ou sensation : rien n'y est lumiere ni vertu. « Pour rendre plus sensible, dit-il, ensuite (tom. II. p. 461.) la différence qu'il y a entre la distinction que doivent marquer les deux points & celle à qui la virgule ponctuée est affectée, je vais donner à l'exemple rapporté un autre tour, qui, en mettant une liaison de dépendance entre les portions qui les composent, exigera que la distinction soit alors représentée autrement que par les deux points : l'amour est une passion de pur caprice ; qui attribue du mérite à l'objet aimé ; mais qui ne fait pas aimer le mérite ; à qui la reconnoissance est inconnue ; parce que chez lui tout se porte a la volupté ; & que rien n'y est lumiere ni ne tend à la vertu ».
Il est vrai, & c'est l'hypothèse que j'adopte, & qu'on ne peut peut pas refuser d'admettre ; il est vrai que c'est le même fonds de pensée sous deux formes différentes ; que la liaison des parties n'est que présumée, pour ainsi dire, ou sentie sous la premiere forme, & qu'elle est expressément énoncée dans la seconde ; mais qu'elle est effectivement la même de part & d'autre. Que suit-il de-là ? L'académicien en conclut qu'il faut une ponctuation plus forte dans le premier cas, parce que la liaison y est moins sensible ; & qu'il faut une ponctuation moins forte dans le second cas, parce que l'affinité des parties y est exprimée positivement. J'ose prétendre au contraire que la ponctuation doit être la même de part & d'autre parce que de part & d'autre il y a réellement la même liaison, la même affinité, & que les pauses dans la prononciation, comme les signes qui les marquent dans l'écriture, doivent être proportionnées aux degrés réels d'affinité qui se trouvent entre les sens partiels d'une énonciation totale.
Mais il est certain que dans tous les exemples que l'on rapporte du style coupé, il y a, entre les propositions élémentaires qui font un ensemble, une liaison aussi réelle que si elle étoit marquée par des conjonctions expresses, quand même on ne pourroit pas les réduire à cette forme conjonctive : tous ces sens partiels concourent à la formation d'un sens total & unique, dont il ne faut altérer l'unité que le moins qu'il est possible, & dont par conséquent on ne doit séparer les parties, que par les moindres intervalles possibles dans la prononciation, & par des virgules dans l'écriture.
5°. Si une proposition est simple & sans hyperbate, & que l'étendue n'en excéde pas la portée commune de la respiration ; elle doit s'écrire de suite sans aucun signe de ponctuation. Exemples : L'homme injuste ne voit la mort que comme un fantôme affreux. Théor. des sent. ch. xiv. Il est plus honteux de se défier de ses amis que d'en être trompé. La Rochefoucault, pens. 84. Mea mihi conscientia pluris est quàm omnium sermo. Cic. ad Attic. xij. 28. Je préfere le témoignage de ma conscience à tous les discours qu'on peut tenir de moi. M. l'abbé d'Olivet, trad. de cette pensée de Cicéron.
Mais si l'étendue d'une proposition excede la portée ordinaire de la respiration, dont la mesure est à-peu-près dans le dernier exemple que je viens de citer ; il faut y marquer des repos par des virgules, placées de maniere qu'elles servent à y distinguer quelques-unes des parties constitutives, comme le sujet logique, la totalité d'un complément objectif, d'un complément accessoire ou circonstanciel du verbe, un attribut total, &c.
Exemple où la virgule distingue le sujet logique : La venue des faux christs & des faux prophetes, sembloit être un plus prochain acheminement à la derniere ruine. Bossuet, disc. sur l'hist. univ. part. II.
Exemple où la virgule sépare un complément circonstanciel : Chaque connoissance ne se développe, qu'après qu'un certain nombre de connoissances précédentes se sont développées. Fontenelle, préf. des élém. de la Géom. de l'infini.
Exemple où la virgule sert à distinguer un complément accessoire : L'homme impatient est entraîné par ses desirs indomptés & farouches, dans un abîme de malheurs. Télémaque, liv. XXIV.
Lorsque l'ordre naturel d'une proposition simple est troublé par quelque hyperbate ; la partie transposée doit être terminée par une virgule, si elle commence la proposition ; elle doit être entre deux virgules, si elle est enclavée dans d'autres parties de la proposition.
Exemple de la premiere espece : Toutes les vérités produites seulement par le calcul, on les pourroit traiter de vérités d'expérience. Fontenelle, ibid. C'est le complément objectif qui se trouve ici à la tête de la phrase entiere.
Exemple de la seconde espece : La versification des Grecs & des Latins, par un ordre réglé de syllabes brèves & longues, donnoit à la mémoire une prise suffisante. Théor. des sent. ch. iij. Ici c'est un complément modificatif qui se trouve jetté entre le sujet logique & le verbe.
Il n'en est pas de même du complément déterminatif d'un nom ; quoique l'hyperbate en dispose, comme cela arrive fréquemment dans la poésie, on n'y emploie pas la virgule, à moins que le trop d'étendue de la phrase ne l'exige pour le soulagement de la poitrine. Le grand prêtre Joad parle ainsi à Abner. Athalie, act. I. sc. j.
Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Rousseau (Ode sacrée tirée du ps. 90.) emploie une semblable hyperbate :
Le juste est invulnérable ;
De son bonheur immuable
Les anges sont les garants.
Remarquez encore que je n'indique l'usage de la virgule, que pour les cas où l'ordre naturel de la proposition est troublé par l'hyperbate ; car s'il n'y avoit qu'inversion, la virgule n'y seroit nécessaire qu'autant qu'elle pourroit l'être dans le cas même où la construction seroit directe.
De tant d'objets divers le bisarre assemblage. Racine.
Je ne sentis point devant lui le désordre où nous jette ordinairement la présence des grands hommes. Dialog. de Sylla & d'Eucrate. Il ne faut point de virgule en ces exemples, parce qu'on n'y en mettroit point si l'on disoit sans inversion : Le bisarre assemblage de tant d'objets divers ; je ne sentis point devant lui le désordre où la présence des grands hommes nous jette ordinairement.
La raison de ceci est simple. Le renversement d'ordre, amené par l'inversion, ne rompt pas la liaison des idées consécutives, & la ponctuation seroit en contradiction avec l'ordre actuel de la phrase, si l'on introduisoit des pauses où la liaison des idées est continue.
6°. Il faut mettre entre deux virgules toute proposition incidente purement explicative, & écrire de suite sans virgule toute proposition incidente déterminative. Une proposition incidente explicative est une espece de remarque interjective, qui n'a pas, avec l'antécédent, une liaison nécessaire, puisqu'on peut la retrancher sans altérer le sens de la proposition principale ; elle ne fait pas avec l'antécédent un tout indivisible, c'est plutôt une répétition du même antécédent sous une forme plus développée. Mais une proposition incidente déterminative est une partie essentielle du tout logique qu'elle constitue avec l'antécédent ; l'antécédent exprime une idée partielle, la proposition incidente déterminative en exprime une autre, & toutes deux constituent une seule idée totale indivisible, de maniere que la suppression de la proposition incidente changeroit le sens de la principale, quelquefois jusqu'à la rendre fausse. Il y a donc un fondement juste & raisonnable à employer la virgule pour celle qui est explicative, & à ne pas s'en servir pour celle qui est déterminative : dans le premier cas, la virgule indique la diversité des aspects sous lesquels est présentée la même idée, & le peu de liaison de l'incidente avec l'antécédent ; dans le second cas, la suppression de la virgule indique l'union intime & indissoluble des deux idées partielles exprimées par l'antécédent & par l'incidente.
Il faut donc écrire avec la virgule : Les passions, qui sont les maladies de l'ame, ne viennent que de notre révolte contre la raison. Pens. de Cic. par M. l'abbé d'Olivet. Il faut écrire sans virgule : La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. La Rochefoucault, pens. 157.
Les propositions incidentes ne sont pas toujours amenées par qui, que, dont, lequel, duquel, auquel, laquelle, lesquels, desquels, auxquels, où, comment, &c. c'est quelquefois un simple adjectif ou un participe suivi de quelques complémens, mais il peut toujours être ramené au tour conjonctif. Ces additions sont explicatives quand elles précedent l'antécédent, ou que l'antécédent précede le verbe, tandis que l'addition ne vient qu'après : dans l'un & l'autre cas il faut user de la virgule pour la raison déja alléguée. Exemples.
Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Abner, & n'ai point d'autre crainte.
Avides de plaisir, nous nous flattons d'en recevoir de tous les objets inconnus qui semblent nous en promettre. Théor. des sent. ch. iv.
Le fruit meurt en naissant, dans son germe infecté.
Si ces additions suivent immédiatement l'antécédent, on peut conclure qu'elles sont explicatives, si on peut les retrancher sans altérer le sens de la proposition principale ; & dans ce cas on doit employer la virgule.
Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan & sur elle
Répandre cet esprit d'imprudence & d'erreur,
De la chûte des rois funeste avant-coureur.
7°. Toute addition mise à la tête ou dans le corps d'une phrase, & qui ne peut être regardée comme faisant partie de sa constitution grammaticale, doit être distinguée du reste par une virgule mise après, si l'addition est à la tête ; & si elle est enclavée dans le corps de la phrase, elle doit être entre deux virgules. Exemples :
Contre une fille qui devient de jour en jour plus insolente, qui me manque, à moi, qui vous manquera bientôt, à vous. Le pere de famille, act. III. sc. vij. Cet à moi, & cet à vous sont deux véritables hors-d'?uvres, introduits par énergie dans l'ensemble de la phrase, mais entierement inutiles à sa constitution grammaticale.
Oculorum, inquit Plato, est in nobis sensus acerrimus, quibus sapientiam non cernimus. Cic. de Finibus, II. 16. Ici l'on voit la petite proposition, inquit Plato, insérée accidentellement dans la principale, à laquelle elle n'a aucun rapport grammatical, quoiqu'elle ait avec elle une liaison logique.
Non, non, bien loin d'être des demi-dieux, ce ne sont pas même des hommes. Télémaque, liv. XVII. Ces deux non qui commencent la phrase n'ont avec elle aucun lien grammatical ; c'est une addition emphatique dictée par la vive persuasion de la vérité qu'énonce ensuite Télémaque.
O mortels, l'espérance enivre. Médit. sur la foi, par M. de Vauvenargues. Ces deux mots ô mortels, sont entierement indépendans de la syntaxe de la proposition suivante, & doivent en être séparés par la virgule ; c'est le sujet d'un verbe sousentendu à la seconde personne du pluriel, par exemple, du verbe écoutez, ou prenez-y garde : or si l'auteur avoit dit, mortels, prenez y garde, l'espérance enivre, il auroit énoncé deux propositions distinctes qu'il auroit dû séparer par la virgule ; cette distinction n'est pas moins nécessaire parce que la premiere proposition devient elliptique, ou plutôt elle l'est encore plus, pour empêcher qu'on ne cherche à rapporter à la seconde un mot qui ne peut lui convenir.
Il suit de cette remarque que, quand l'apostrophe est avant un verbe à la seconde personne, on ne doit pas l'en séparer par la virgule, parce que le sujet ne doit pas être séparé de son verbe ; il faut donc écrire sans virgule : Tribuns cédez la place aux consuls. Révol. rom. liv. II. Cependant l'usage universel est d'employer la virgule dans ce cas-là même ; mais c'est un abus introduit par le besoin de ponctuer ainsi dans les occurrences où l'apostrophe n'est pas sujet du verbe, & ces occurrences sont très-fréquentes.
Vous avez vaincu, plébéiens. Ib. Il faut ici la virgule, quoique le mot plébéiens soit sujet de avez vaincu ; mais ce sujet est d'abord exprimé par vous, lequel est à sa place naturelle, & le mot plébéiens n'est plus qu'un hors-d'?uvre grammat
Trésor de la Langue Française informatisé
PONCTUATION, subst. fém.
Ponctuation au Scrabble
Le mot ponctuation vaut 15 points au Scrabble.
Informations sur le mot ponctuation - 11 lettres, 5 voyelles, 6 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ponctuation au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
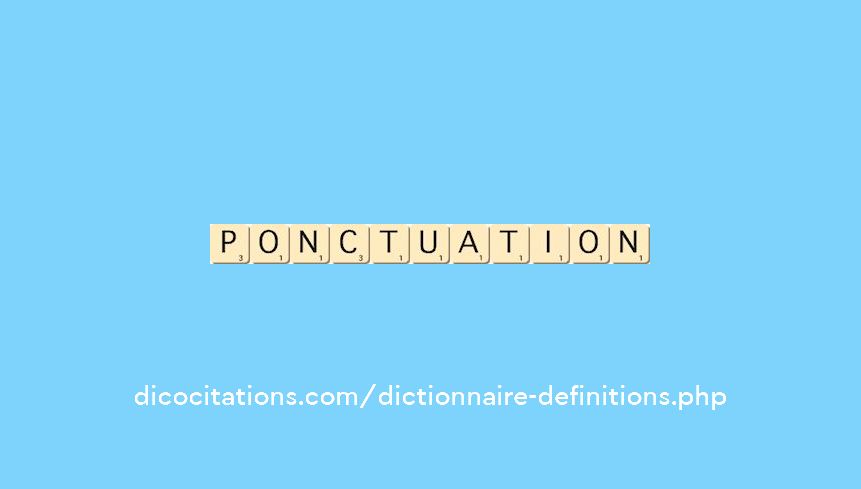
Les mots proches de Ponctuation
Ponant Ponçage Ponce Poncé, ée Ponceau Ponceau Poncer Ponceux, euse Poncif Poncire Ponction Ponctualité Ponctuateur Ponctuation Ponctué, ée Ponctuel, elle Ponctuellement Ponctuer Pondération Pondérer Pondéreux, euse Pondérosité Pondeur Pondoir Pondre Pongitif, ive Pont Ponte Ponte Ponté, ée Pontée Ponter Ponter Pontier Pontife Pontifical, ale Pontifical Pontificalement Pontificat Pontifiée Pontifier Pont-levis Pont-neuf Ponton Pontonage Pontonnier ponant ponçage ponçait ponçant ponce ponce poncé Poncé-sur-le-Loir ponceau ponceau ponceaux poncée poncées poncer ponces poncés ponceuse Poncey-lès-Athée Poncey-sur-l'Ignon Ponchapt Ponchel Ponches-Estruval poncho Ponchon ponchos poncif poncifs Poncin Poncins ponction ponctionna ponctionnait ponctionne ponctionner ponctions ponctua ponctuaient ponctuait ponctualité ponctuant ponctuation ponctuations ponctué ponctue ponctuée ponctuée ponctuées ponctuées ponctuel ponctuelleMots du jour
-
intrinsèque glapisseurs comblant genouillères terrorisé complète disciplinera réchauffants bue congèlerais
Les citations avec le mot Ponctuation
- Chaque fois qu'elle lisait, il lui semblait tout à fait juste que le signe de ponctuation placé à la fin d'une question eût la forme d'un crochet destiné à prendre au piège une personne déterminée à passer son chemin.Auteur : Jane Urquhart - Source : Les rescapés du Styx (2007)
- Le vin, c'est un partage, c'est l'amitié, des lieux, des ponctuations.Auteur : Pierre Perret - Source : Laissez-vous tenter, RTL, 28 octobre 2016.
- [Thomas] se prépare à parler comme il se prépare à chanter, décontracte ses muscles, discipline sa respiration, conscient que la ponctuation est l'anatomie du langage, la structure du sens, si bien qu'il visualise la phrase d'amorce, sa ligne sonore, et apprécie la première syllabe qu'il prononcera, celle qui va fendre le silence, précise, rapide comme une coupure – l'estafilade plutôt que la craquelure sur la coquille de l'oeuf, plutôt que la lézarde grimpée sur le mur quand la terre tremble.Auteur : Maylis de Kerangal - Source : Réparer les vivants (2013)
- Mettant dans sa lecture cette espèce de ponctuation délicate qui fait sentir les différents genres de mérite par des inflexions aussi fines que variées.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Lamotte
- Pour les citoyens d'Ankh-Morpork, l'orthographe était pour ainsi dire en sus. Ils y croyaient comme ils croyaient à la ponctuation peu importait où on la plaçait du moment qu'elle était là.Auteur : Terry Pratchett - Source : Les Annales du Disque-monde, La Vérité (2005)
- Chiure de mouche : Signe primitif de ponctuation.Auteur : Ambrose Bierce - Source : Le Dictionnaire du Diable (1911)
- Mon univers est un réseau d'entrelacs de mots, de membres liés à des membres, d'os à des muscles, de pensées et d'images enchevêtrées. Je suis constituée de lettres, un personnage créé par de phrases, un produit de l'imagination forgé par la lecture de romans.
Ils veulent effacer chaque signe de ponctuation de ma vie sur terre et je ne pense pas pouvoir les laisser faire. Auteur : Tahereh Mafi - Source : Insaisissable, tome 1 : Ne me touche pas
- Ponctuation: les points d'exclamation de la pluie, la virgule des herbes, les points de suspension du brouillard, la parenthèse de midi, le point final du soir, l'alinéa de l'aube.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Si l'on considère la langue comme une vieille ville avec son inextricable réseau de ruelles et de places, ses secteurs qui ramènent loin dans le passé, ses quartiers assainis et reconstruits et sa périphérie qui ne cesse de gagner sur la banlieue, je ressemblais à un habitant qui, après une longue absence, ne se reconnaîtrait pas dans cette agglomération, ne saurait plus à quoi sert un arrêt de bus, ce qu'est une arrière-cour, un carrefour, un boulevard ou un pont. L'articulation de la langue, l'agencement syntaxique de ses différents éléments, la ponctuation, les conjonctions et jusqu'aux noms désignant les choses les plus simples, tout était enveloppé d'un brouillard impénétrable. Auteur : W. G. Sebald - Source : Austerlitz (2001)
- Miami est un signe de ponctuation crasseux sur une péninsule d'infortune; un appendice.Auteur : Roger Jon Ellory - Source : Vendetta (2005)
Les citations du Littré sur Ponctuation
- Si toutes les langues generalement ont leur differences en parler et escriture, toutesfois nonobstant cela elles n'ont qu'une ponctuation seulement, et ne trouveras qu'en icelle les Grecs, Latins, François ou Hespaignols soient differentsAuteur : ÉT. DOLET - Source : dans LIVET, la Gramm. franç. p. 114
- C'est [M. Cassandre, tragédie bourgeoise] une espèce de parade en style burlesquement tragique, où l'on emploie les tournures, les expressions, le galimatias, l'interponctuation extravagante, la pantomime puérile de tous les mauvais dramesAuteur : LA HARPE - Source : Corresp. litt. Lett. XV
- Mettant dans sa lecture cette espèce de ponctuation délicate qui fait sentir les différents genres de mérite par des inflexions aussi fines que variéesAuteur : D'ALEMB. - Source : Éloges, Lamotte.
Les mots débutant par Pon Les mots débutant par Po
Une suggestion ou précision pour la définition de Ponctuation ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 22h02
- Paix - Papa - Paradis - Paradoxe - Paraître - Pardon - Pardonner - Parent - Paresse - Parler - Parole - Parole chanson - Partage - Partir - Pas - Passé - Passé - Passion - Passoire - Patience - Patient - Patrie - Patriotisme - Pauvre - Pauvrete - Pauvreté - Payer - Pays - Paysan - Péché - Peche - Pédagogie - Pédanterie - Peine - Peinture - Pensée - Pensées - Penser - Perception - Père - Père noel - Père fils - Amour Papa - Enfants Père - Amour Père - Aime Père - Aime Papa - Père coeur - Père enfant - Père Mère - Père Fille - Père Fils - Fête des Pères - Bonne fête des pères - Perfection - Perfidie - Permanence - Perséverance - Personnage - Personnalité - Personne - Persuader - Pessimisme - Peuple - Peur - Philosophie - Phrases - Physiologie - Physique - Piano - Piege - Piston - Pitie - Pitié - Plagiat - Plaindre - Plaire - Plaisir - Plannification - Pleonasme - Pleur - Pleurer - Poésie - Poesie - Poète - Poete - Pognon - Police - Politesse - Politicien - Politique - Ponctualite - Populaire - Popularité - Pornographie - Porte - Posologie - Posséder - Postérité - Pouvoir - Prédiction - Préférence - Préjugé - Prendre - Présent - Président - Pret - Prétention - Prévoir - Prier - Principes - Prison - Privilege - Prix - Probabilite - Probleme - Producteur - Profit - Progres - Proletariat - Promenade - Promesse - Promettre - Prononciation - Proposer - Propriété - Prose - Prostituée - Prouver - Proverbe - Prudence - Psychanalyse - Psychologie - Psychose - Publicité - Pucelage - Pudeur - Punition - Pureté
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur ponctuation
Poèmes ponctuation
Proverbes ponctuation
La définition du mot Ponctuation est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Ponctuation sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Ponctuation présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
