La définition de Tige du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Tige
Nature : s. f.
Prononciation : ti-j'
Etymologie : Lat. tibia, jambe, dont le sens a été appliqué à la jambe d'une plante, d'un arbre. Tigel diminutif de tige s'est dit des jambes des chausses.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de tige de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec tige pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Tige ?
La définition de Tige
Partie de la plante qui tend à s'élever verticalement, et qui porte les feuilles, les fleurs et les fruits ; on l'appelle tronc dans les arbres dicotylédons ; stipe dans les monocotylédones arborescentes ; chaume dans les graminées ; hampe dans les oignons, lorsque, naissant au milieu des feuilles, elle est nue, droite et terminée par les fleurs.
Toutes les définitions de « tige »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Partie d'une plante qui sort de la terre et qui pousse des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits. Cet arbre a une belle tige. Tige branchue. Laisser monter la tige d'un arbre. Arbre à haute tige ou, elliptiquement, Haute tige se dit d'un Arbre fruitier dont on laisse la tige s'élever. Arbre à basse tige ou, par ellipse, Basse tige, Celui dont on empêche la tige de s'élever.
TIGE se dit plus spécialement en parlant des Plantes qui ne sont ni arbres ni arbrisseaux. Laisser mourir une fleur sur sa tige. Tige de lis. Tige de pavot. Plante à plusieurs tiges. Tige rameuse. Tige simple. Tige droite. Tige couchée. Tige carrée. Tige cylindrique. Tige glabre. Tige velue. Tige ligneuse. Tige herbacée. En termes de Généalogie, il désigne le Premier père duquel sont sorties toutes les branches d'une famille, tant la branche aînée que la cadette. Il sort d'une tige illustre.
TIGE se dit, par analogie, de la Partie allongée de diverses choses. La tige d'un rinceau, L'espèce de branche qui part d'un culot ou fleuron et qui porte les feuillages d'un rinceau d'ornement. La tige d'une colonne, Le fût. La tige d'une clef, La partie longue et cylindrique qui est entre l'anneau et le panneton. La tige d'un flambeau, La partie d'un flambeau qui prend depuis le pied jusqu'à la bobèche. La tige d'un guéridon, La partie qui prend depuis le pied jusqu'à la tablette. La tige d'une botte, La partie de la botte qui surmonte l'empeigne et enveloppe la jambe.
Littré
-
1Partie de la plante qui tend à s'élever verticalement, et qui porte les feuilles, les fleurs et les fruits?; on l'appelle tronc dans les arbres dicotylédons?; stipe dans les monocotylédones arborescentes?; chaume dans les graminées?; hampe dans les oignons, lorsque, naissant au milieu des feuilles, elle est nue, droite et terminée par les fleurs.
?ce chêne énorme Dont la tige toujours informe S'épuise en rameaux superflus
, Gresset, Épît P. Bougeant.De ta tige détachée, Pauvre feuille desséchée, Où vas-tu?? - Je n'en sais rien
, A. Arnault, Fabl. v, 16.Arbres à hautes tiges, ou, simplement, hautes tiges, arbres dont on laisse les tiges s'élever.
Arbres à basses tiges, ou, simplement, basses tiges, ceux qu'on empêche de s'élever.
Demi-tige, arbre fruitier de quatre ou cinq pieds de haut, et dont la croissance naturelle a été arrêtée.
Tige se dit, chez les jardiniers, des arbres auxquels on ne laisse qu'un seul jet, pour les distinguer de ceux qu'on destine à former des espaliers ou des gobelets
Fig.
Vous reconnaissez que l'Église a une tige toujours subsistante, dont on ne peut se séparer sans se perdre
, Bossuet, Hist. II, 13. - 2Il se dit plus particulièrement en parlant des plantes qui ne sont ni arbres ni arbrisseaux. Laisser mourir une fleur sur sa tige. Tige de lis. Tige droite. Tige couchée.
-
3 Terme de généalogie. Chef de qui sont sorties les branches d'une famille, tant la branche aînée que la cadette.
Et que si de cette couronne, Que sa tige illustre lui donne [à Henri IV], Les lois ne l'eussent revêtu
, Malherbe, II, 4.Tel le grand saint Louis, la tige des Bourbons, Lui-même du soudan forçait les bataillons
, Corneille, Victoires du roi.Un peuple qui ne s'est jamais regardé que comme une seule famille, nous conduit naturellement, à Abraham qui en est la tige
, Bossuet, Hist. II, 13.Triste reste de nos rois, Chère et dernière fleur d'une tige si belle
, Racine, Athal. IV, 6.Abdolonyme, descendu, quoique de loin, de la tige royale [de Tyr]
, Rollin, Hist. anc. ?uv. t. VI, p. 263.Saint Louis, neuvième du nom, roi de France, est la tige de la branche des Bourbons
, Voltaire, Henr. I, Notes.De ce nombre [des protestants sauvés par des catholiques lors de la Saint-Barthélemy] fut un Tronchin, qui resta plusieurs jours caché dans un tonneau, et, s'étant retiré à Genève, y a été la tige de la famille de ce nom
, Voltaire, Henr. II, Notes.Par extension, il se dit des animaux.
Dans l'état actuel, on doit regarder le loup et le renard comme des tiges majeures du genre des cinq animaux que nous avons indiqués?; le chien, le chacal et l'isatis n'en sont que les branches latérales
, Buffon, Quadrup. t. VII, p. 251.Lignée.
Tous les mâles depuis vingt ans et au-dessus qui pouvaient aller à la guerre, furent comptés par tiges par familles et par maisons
, Sacy, Bible, Nomb. I, 22.Faire tige, devenir l'origine d'une famille. La branche d'où il est issu a fait tige en France.
Fig.
Si quelques-uns [des saints Pères] ont eu quelque chose de particulier dans leurs sentiments ou dans leurs expressions, tout cela s'est évanoui et n'a pas fait tige dans l'Église
, Bossuet, 1er avert. 37. -
4 Fig. Origine, source.
Les luthériens, qui étaient la tige de la réforme
, Bossuet, 6e avert. 3e part. 4.Toutes les Églises naissantes venaient de la tige commune des apôtres, ou de ceux que les apôtres avaient envoyés, et en tiraient leurs pasteurs avec la doctrine
, Bossuet, 2e instr. past. 64.On a vu sortir de cette tige d'iniquité des rejetons honteux, qui ont été l'opprobre de leur nom et de leur siècle
, Massillon, Pet. carême, Hum. des gr. -
5 Par analogie, tout prolongement allongé et plus ou moins cylindrique, qui fait partie d'un corps quelconque.
La tige d'une colonne, le fût.
La tige d'un rinceau, l'espèce de branche qui part d'un culot ou fleuron, et qui porte les feuillages d'un rinceau d'ornement.
La tige d'une roue de montre, l'arbre de cette roue quand il est un peu mince.
Terme d'architecture. Pied qui supporte une coupe d'où jaillit une fontaine.
La tige d'une clef, etc. la partie mince et allongée qui est entre l'anneau et le panneton.
Tige de flambeau, le tuyau depuis la patte jusqu'à l'embouchure.
La tige d'un guéridon, la partie qui prend depuis le pied jusqu'à la table.
Tige d'une plume, la partie qui surmonte le tuyau et de chaque côté de laquelle se développent les barbes.
Tige de botte, le corps de la botte où l'on met la jambe.
La partie d'un bas de tricot où on le rétrécit.
Corps d'un clou.
Tige de pompe, manche auquel tient le piston.
-
6 Terme de sculpture. Tige d'un trépan, partie de cet instrument à laquelle on applique l'archet.
Terme de métallurgie. Tige de laminoir, partie carrée qui se trouve en dehors du tourillon, et sur laquelle s'adaptent les intermédiaires du mouvement.
- 7Carabine à tige, carabine portant une tige fixée à la culasse, de manière à ménager, entre elle et le canon, un espace annulaire dans lequel se loge la poudre. La balle prend appui sur l'extrémité de cette tige, et elle est forcée par des coups de baguette qui l'aplatissent et l'engagent dans les rayures.
REMARQUE
Au XVIe siècle, tige devint masculin chez quelques-uns, malgré l'étymologie et l'usage plus ancien.
HISTORIQUE
XIe s. [Guenes] Vait s'apuier suz le pin à la tige
, Ch. de Rol. XXXVI.
XIVe s. Prenez la tige du rouge chol [chou]
, Modus, f° XCIV.
XVIe s. De la racine procede ung tige unicque, rond, ferulacé, verd on dehors
, Rabelais, Pant. III, 49. Pour esclaircir le branchage de ce tige foisonnant en trop de gaillardise
, Montaigne, III, 98. Le roseau produict une longue tige et droicte
, Montaigne, IV, 168. Pyrrus issu de la noble tige de Hercules
, Amyot, Mar. et Pyr. 4. Tant que tige fait souche, elle ne branche jamais
, Cotgrave ?
Encyclopédie, 1re édition
TIGE, s. f. (Botan.) c'est la partie des plantes qui tire sa naissance de la racine, & qui soutient les feuilles, les fleurs & les fruits. La tige dans les arbres prend le nom de tronc, en latin, truncus ; & celui de caudex dans les herbes, on l'appelle caulis, & scaphus lorsqu'elle est droite comme une colonne. Les auteurs modernes l'ont nommée viticulus, lorsqu'elle est grèle & couchée, comme est celle de la nummulaire. Enfin, la tige des plantes graminées, s'appelle culmus.
Mais ce ne sont pas des mots qui intéressent les physiciens, ce sont les phénomenes curieux de la végétation ; par exemple, le redressement des tiges, car on sait que de jeunes tiges de plantes inclinées vers la terre se redressent peu-à-peu, & regardent la perpendiculaire. Dans celles qui n'ont de libre que l'extrémité, c'est cette extrémité qui se redresse. M. Dodart est le premier qui ait observé ce fait en France. Des pins qu'un orage avoit abattus sur le penchant d'une colline, attirerent l'attention de cet habile physicien. Il remarqua avec surprise, que toutes les sommités des branches s'étoient repliées sur elles-mêmes, pour regagner la perpendiculaire ; ensorte que ces sommités formoient avec la partie inclinée, un angle plus ou moins ouvert, suivant que le sol étoit plus ou moins oblique à l'horison.
M. Dodart cite à ce sujet dans les Mém. de l'acad. des Sciences ann. 1700. l'exemple de quelques plantes qui croissent dans les murs, telles que la pariétaire ; ces plantes après avoir poussé horisontalement, se redressent pour suivre la direction du mur : mais il n'a pas approfondi davantage la nature de ce mouvement de tiges ; nous savons seulement qu'il s'opere presque toujours, de façon que la partie qui se redresse devient extérieure à celle qui demeure inclinée : la tige prend alors la forme d'un siphon à trois branches : j'ai appris que depuis vingt ans, M. Bonnet a tenté plusieurs expériences curieuses sur cette matiere ; mais il en reste encore beaucoup à faire avant que de chercher à en assigner la cause, car ce n'est pas avec des dépenses d'esprit & des hypothèses, qu'on y peut parvenir. (D. J.)
Tige, s. f. (Archit.) on appelle ainsi le fût d'une colonne.
Tige de rinceau, espece de branche qui part d'un culot ou d'un fleuron, & qui porte les feuillages d'un rinceau d'ornement. (D. J.)
Tige, s. f. (Hydr.) voyez Souche. (K)
Tige de Fontaine, (Archit. hydr.) espece de balustre creux, ordinairement rond, qui sert à porter une ou plusieurs coupes de fontaines jaillissantes, & qui a son profil différent à chaque étage. (D. J.)
Tige, s. f. terme de plusieurs ouvriers, la tige d'une clé, en terme de Serrurier, est le morceau rond de la clé, qui prend depuis l'anneau jusqu'au panneton.
La tige d'une botte, en terme de Cordonnier, est le corps de la botte, depuis le pié jusqu'à la genouillere.
La tige d'un flambeau, en terme d'Orfevre, est le tuyau du flambeau, qui prend depuis la pate jusqu'à l'embouchure inclusivement.
La tige d'un guéridon, en terme de Tourneur, est la partie du guéridon, qui prend depuis la pate jusqu'à la tablette. (D. J.)
Tige, nom que les Horlogers donnent à l'arbre d'une roue ou d'un pignon, lorsqu'il est un peu mince ; c'est ainsi que l'on dit la tige de la roue de champ, de la roue de rencontre, &c. Voyez Arbre, Aissieu, Axe, &c.
Tige, (Serrurerie.) c'est la partie de la clé, comprise depuis l'anneau jusqu'au bout du panneton, elle est ordinairement ronde, quelquefois cependant en tiers-point.
Tige, adj. terme de Blason, qui se dit des plantes & des fleurs représentées sur leurs tiges.
Le Fevre d'Ormeson & d'Eaubonne à Paris, d'azur à trois lis au naturel d'argent, feuillés & tigés de synople.
France Terme
Manche d'une canne.
Wiktionnaire
Nom commun - français
tige \ti?\ féminin
-
(Botanique) Partie d'une plante qui sort de la terre et sur laquelle poussent des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits. Organe de la plante, en forme d'axe, qui relie ses organes fondamentaux : feuilles et racines.
- Ce sont les larves des pucerons qui, réunies en familles innombrables, recouvrent quelquefois des branches entières de nos arbres fruitiers, la tige de nos fleurs, de nos légumes. ? (Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, Les Métamorphoses et la généagénèse, Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 3, 1856 (pages 496-519))
- Le chanvre femelle continuant à végéter jusqu'à la maturité de la graine, sa tige acquiert plus de force, sa fibre plus de dureté et on ne peut en tirer parti que dans les carderies. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 148)
- Elle sourit en baissant les yeux; sur ses bras, elle portait toute une gerbe de fleurs vives aux longues tiges. ? (Out-el-Kouloub, Zaheira, dans Trois contes de l'Amour et de la Mort, 1940)
- Il sait aussi fabriquer une flûte douce dans l'entre-n?ud d'une grosse tige de berce. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Les trous seront effectués à la tarière hélicoïdale ou à la barre à mine avec comme objectif d'enfoncer la tige à 1 mètre de profondeur. ? (Vincent Thècle, Peupliers : comment réussir les nouvelles plantations., dans La France agricole, n° 3361 du 26 novembre 2010)
-
Jardin dickinsonien ?
Un enchevêtrement
de tiges, feuilles et fleurs
de sucepin,
venant
d'un herbier iridescent,
envahit
le jardin panoramique
?
de ma vitre givrée. ? (Cornéliu Tocan, Chutes microscopiques. 50 micronouvelles illustrées, Créatique, Québec, 2020, pages 59-60)
- (Par analogie) (Rare) (Botanique) Pédoncule d'une fleur.
-
(Par métonymie) (Foresterie) Arbre, semis, pied.
- Dans les cas où ces chênes sont entourés de charmes ou, à plus forte raison, de hêtres, le suivi de la régénération devra être continu et fin pour ne pas risquer de perdre trop de chênes et donc limiter le choix ultérieur des tiges qui composeront le peuplement final. ? (Thierry Sardin, Chênaies continentales, Office national des forêts, 2008, ISBN 978-2-84207-321-3 ? lire en ligne)
-
(Généalogie) Premier père duquel sont sorties toutes les branches d'une famille, tant la branche aînée que la cadette.
- Il sort d'une tige illustre.
-
(Par analogie) Partie allongée de diverses choses.
- (En particulier) L'espèce de branche qui part d'un culot ou fleuron et qui porte les feuillages d'un rinceau d'ornement.
- (En particulier) Le fût d'une colonne.
- (En particulier) La partie longue et cylindrique d'une clef, qui est entre l'anneau et le panneton.
- (En particulier) La partie d'un flambeau qui prend depuis le pied jusqu'à la bobèche.
- (En particulier) La partie d'un guéridon qui prend depuis le pied jusqu'à la tablette.
- (Golf) Manche d'une canne.
-
(En particulier) La partie de la botte qui surmonte l'empeigne et enveloppe la jambe.
- Au bruit de leurs lourds sabots, à tiges de toile bise, les marins dévalaient par groupes, le dos courbé sous le poids de leurs filets ; [?]. ? (Octave Mirbeau, Les eaux muettes)
- Son pantalon à grand pont, éraillé aux boutonnières et bombé aux genoux, s'arrêtait à mi-jambe sur la tige d'une forte botte dont le cuir ne ployait pas ? (Gustave Flaubert et Maxime Du Camp, Par les champs et les grèves (Voyage en Bretagne), 1886, Le Livre de poche, 2012, page 180)
-
(Familier) Cigarette.
- Ça te tente-tu de revenir ? l'interrompit Maria d'une voix rauque qui trahissait une forte consommation de tiges de huit. ? (Luc Baranger, Maria chape de haine, chapitre I, Baleine, 2010)
- La cueillette n'a pas été très fructueuse. Les bouts de cigarettes deviennent de plus en plus courts. Tout ça à cause des filtres. Si ça continue, les gens vont fumer leurs « tiges » jusqu'au coton hydrophile (dit tampax dans le jargon populaire). ? (Guy Vicq, Janine, Éditions Edilivre, 2014)
Trésor de la Langue Française informatisé
TIGE, subst. fém.
Tige au Scrabble
Le mot tige vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot tige - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot tige au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
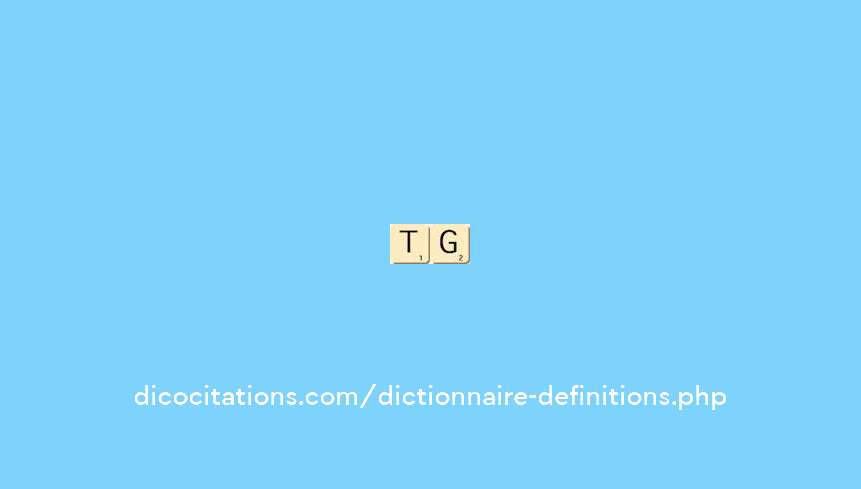
Les mots proches de Tige
Tige Tignard Tignasse Tignon Tigre et tigresse Tigré, ée Tigrerie tige Tigeaux tigelles Tigery Tigery tiges tiges Tignac tignasse tignasses Tigné Tignécourt Tignée Tignes Tignet Tignieu-Jameyzieu Tigny-Noyelle tigre tigré tigré tigrée tigrée tigrées tigres tigrés tigrés tigresse tigresses tigrure TigyMots du jour
Ambition Tripot Donjon Concorder Décolleur Funingue Aï Jardin Ameuter Rhume
Les citations avec le mot Tige
- Tout être humain est un abime. On a le vertige quand on regarde dedans. Auteur : Valentin Musso - Source : Un autre jour (2019)
- Le culte du vertige... mais n'oublions pas que le vertige se prend sur les hauteurs.Auteur : Raymond Radiguet - Source : Oeuvres, Art poétique (1922)
- Le sujet d'un livre, on n'écrit que pour le chercher. Quand il est sorti de toutes ces préparations comme une fleur de sa tige, miraculeusement, il décrit avec les couleurs qu'il arrache à l'obscurité de la sève.Auteur : Joë Bousquet - Source : Oeuvre romanesque complète (1979-1984), Il ne fait pas assez noir
- Deux mains qui se joignent. C'est comme le baiser d'un ange. Comme le vertige du funambule en équilibre sur un fil.Auteur : Guillaume Musso - Source : Je reviens te chercher (2009)
- Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges.Auteur : Arthur Rimbaud - Source : Une saison en enfer (1873), Délires II, Alchimie du verbe
- La rose coupée sur sa tige peut rester fraîche et pure. La rose, même en bouton, même sur le rosier, mais tripotée, est pire que fanée.Auteur : Paul Bourget - Source : Physiologie de l'amour moderne (1883)
- Tu ne revivras pas, mais il y a ce chemin des mots qui mène un peu plus près de ton sourire; le souvenir ne te rend pas, mais tu sourds quelquefois de cette folie douce de t'écrire, avec au bout le son-vertige de ta voix.Auteur : Philippe Delerm - Source : La Cinquième Saison
- Quand l'épervier se lamente devant un nid vide, les étourneaux voltigent alentour, insultant à sa douleur.Auteur : Prosper Mérimée - Source : Colomba (1840)
- Que tes baisers brûlants sentent le vin d'Espagne!
Que l'esprit du vertige et des bruyants repas
A l'ange du plaisir nous porte dans ses bras!Auteur : Alfred de Musset - Source : Rolla (1833) - Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m'apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l'ensemble ! C'est l'éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c'est calme ! c'est calme ! et c'est fort, ça a des fanons comme le bœuf de Leconte.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance à Louise Colet, 26 août 1853
- Si l'amour porte des ailes, n'est-ce pas pour voltiger?Auteur : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais - Source : Sans référence
- Ce n'est pas parce que je m'en vais plus tôt que d'autres que je perds quelque chose d'important. Je rends grâce, au contraire, de connaître ces instants. L'éternité n'est pas dans le temps, elle est dans la profondeur. Dans son vertige.Auteur : Laurence Tardieu - Source : Puisque rien ne dure (2006)
- Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite.Auteur : Filippo Tommaso Marinetti - Source : Manifeste du futurisme, Le Figaro, 20 février 1909.
- Paris avait alors un tel prestige aux yeux de la province que la bonne société s'efforçait de modifier son accent pour « parler pointu »Auteur : Paul Guth - Source : Jeanne la mince
- ... celui qui regarde vers le haut ne peut jamais avoir le vertige.Auteur : Milan Kundera - Source : Jacques et son maître
- Dans le village, il n'y avait plus de vieux. Il y avait en revanche beaucoup d'enfants, très jeunes. La famine avait dévoré la base et le sommet de la pyramide des âges. L'avait rabotée jusqu'à en faire une tige de bilboquet.Auteur : Paul Greveillac - Source : Maîtres et esclaves
- Ma calvitie s'explique très bien. Je suis d'une taille extravagante... Alors vous comprenez, mes cheveux ont le vertige... et ils tombent!Auteur : Amédée de Noé, dit Cham - Source : Sans référence
- Je n'ai pas peur. J'ai seulement le vertige. Il me faut réduire la distance entre l'ennemi et moi. L'affronter horizontalement.Auteur : René Char - Source : Feuillets d'Hypnos (1946)
- Sois dissimulé, tu paraîtras mystérieux, et ton prestige croîtra en fonction de ta réserve, car les hommes imaginent des merveilles derrière toutes les portes fermées. Tout vide voilé leur fait l'effet d'un trésor caché.Auteur : Gustave Thibon - Source : L'ignorance étoilée (1974)
- J'étais dans une apesanteur de fin d'histoire d'amour, la brusque suspension des sentiments, une sorte de vertige que donnent le détachement, la distance, une appréhension différente du temps.Auteur : Michèle Lesbre - Source : Un lac immense et blanc (2011)
- Partir. Maintenant. Comme ça. Etre libre. Libre de quoi. Quand tu ouvres à la mésange la porte de sa cage, est-ce qu'elle déploie ses ailes tout de suite ? Où va-t-elle une fois dehors ? L'espace reste un vertige.Auteur : Valentine Goby - Source : Kinderzimmer (2013)
- Des employés amateurs sacrifiant à leur coupable fainéantise la dignité de leurs fonctions, jusqu'à laisser choir dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule l'antique prestige des administration de l'Etat.Auteur : Georges Courteline - Source : Messieurs les ronds-de-cuir (1893)
- Le rossignol est gris et chétif, le ver à soie n'a pas d'aspect. Le paon est superbe, mais quel ramage! le papillon est éclatant, mais il n'est l'ouvrier de rien: un arc-en-ciel qui voltige de fleur en fleur, et qu'est-ce que l'arc-en-ciel?Auteur : Charles Dollfus - Source : De la Nature humaine (1868)
- Les positions cyniques et réalistes permettent de trancher et de mépriser. Les autres obligent à comprendre. D'où le prestige des premières sur les intellectuels.Auteur : Albert Camus - Source : Carnets III, mars 1951 - décembre 1959 (1989)
- Maintenant quand Gianni jonglait, il prenait Nello sur ses épaules, et cette superposition de deux jongleurs n'en faisant qu'un, amenait dans le voltigement des boules, des jeux bizarres et inattendus.Auteur : Edmond de Goncourt - Source : Les Frères Zemganno (1879)
Les citations du Littré sur Tige
- Un rameau d'un arbre est moins âgé que sa tige, et son aubier que son troncAuteur : BERN. DE ST-P. - Source : Harm. liv. V, Harm. anim.
- Le pic n'abandonne jamais la tige des arbres, à l'entour de laquelle il lui est ordonné de ramper ; la barge doit rester dans ses marais, l'alouette dans ses sillons, la fauvette dans ses bocagesAuteur : BUFF. - Source : le Bec-en-ciseaux.
- Le tige de la passe-roze s'esleve jusqu'à dix ou douze pieds et davantage ; sa fleur est assez grande, de la figure d'une cloche, faite à pans, de couleur rouge-pasle ; il y a aussi des passe-rozes jaunes et blanches plus espesses que les rozes mesmesAuteur : O. DE SERRES - Source : 575
- L'indigotier est une plante droite et assez touffue ; de sa racine s'élève une tige ligneuse, cassante, haute de deux pieds, ramifiée dès son origine, blanche à l'intérieur et couverte d'une écorce grisâtreAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. VI, 17
- Monsieur le capitoul, vous avez des vertigesAuteur : PIRON - Source : Métrom. V, 4
- Pierre Chrysologue, au cinquième siècle, imagina les limbes, espèce d'enfer mitigé, et proprement bord d'enfer, où vont les petits enfants morts sans baptêmeAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Baptême.
- D'un devin suborné les infâmes prestigesAuteur : Corneille - Source : Oedipe, V, 1
- Comme deux raims en une tigeAuteur : A. CHART. - Source : p. 627
- Ceux-là [oiseaux voyageurs] partent les premiers qui vivent d'insectes voltigeants et, pour ainsi dire, aériens, parce que ces insectes manquent les premiersAuteur : BUFF. - Source : Ois. t. XII, p. 312
- Platof [général des cosaques] a dit lui-même qu'à cette affaire un officier fut blessé près de lui, ce qui le surprit peu ; mais qu'il n'en fit pas moins fustiger devant tous ses cosaques le sorcier qui l'accompagnait, l'accusant hautement de paresse pour n'avoir pas détourné les balles par ses conjurations, comme il en était expressément chargéAuteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. VII, 5
- Il paraît que l'intérieur des temples destinés à la célébration des mystères admettait certains prestiges de lumière et d'obscurité, faits pour ébranler l'imagination des assistantsAuteur : QUATREMÈRE DE QUINCY - Source : Instit. Mém. hist. et litt. anc. t. III, p. 266
- Son asne voltigeoyt après les elephans la gueule bée, comme s'il brailloyt et, braillant martialement, sonnast l'assautAuteur : François Rabelais - Source : Pant. V, 40
- Le sarrazin qui nous est venu depuis soixante ans, Contes d'Eutrapel, dans LE HÉRICHER, Flore pop. de Norm. p. 83. Le millet sarrazin en est une autre espece ; c'est celui qu'en France l'on appelle bucail ; il a la paille rouge, bas enjambé, le tige branchu, le grain noir, fait à angles, la farine en dedans fort blancheAuteur : O. DE SERRES - Source : 110
- Le millet-sarrazin a le tige branchuAuteur : O. DE SERRES - Source : 110
- De la racine procede ung tige unicque, rond, ferulacé, verd on dehorsAuteur : François Rabelais - Source : Pant. III, 49
- Autour de ces rois voltigeaient, comme des hiboux dans la nuit, les cruels soupçons, les vaines alarmesAuteur : FÉN. - Source : Tél. XVIII
- Il y a un prestige dont il est difficile de se garantir, c'est celui d'un grand harmonisteAuteur : DIDEROT - Source : Essai sur la peint. II
- ...ce chêne énorme Dont la tige toujours informe S'épuise en rameaux superflusAuteur : GRESSET - Source : Épît P. Bougeant.
- Votre esprit sera délivré de toutes ces petites images voltigeantes par l'air, nommées des espèces intentionnelles, qui travaillent tant l'imagination des philosophesAuteur : DESC. - Source : Dioptr. I
- C'est un beau spectacle que celui des lois féodales : un chêne antique s'élève, l'oeil en voit de loin les feuillages ; il approche, il en voit la tige, mais il n'en aperçoit point les racines ; il faut percer la terre pour les trouverAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXX, 1
- Comme les pensées noires voltigent assez dans ces bois iciAuteur : Madame de Sévigné - Source : 8 déc. 1675
- Louis XIV, lassé de voltiger et de cueillir des faveurs passagères, se fixa enfin à la VallièreAuteur : SAINT-SIMON - Source : 411, 155
- Une jeune fille de Corinthe prête à marier étant morte, sa nourrice posa sur son tombeau dans un panier quelques petits vases que cette fille avait aimés pendant sa vie, et, afin que le temps ne les gâtât pas sitôt étant à découvert, elle mit une tuile sur le panier, qui ayant été posé par hasard sur la racine d'une plante d'acanthe, il arriva, lorsque au printemps les feuilles et les tiges commencèrent à sortir, que le panier qui était sur le milieu de la racine, fit élever le long de ses côtés les tiges de la plante, qui, rencontrant les coins de la tuile, furent contraintes de se recourber en leur extrémité et faire le contournement des volutes ; le sculpteur Callimachus, passant auprès de ce tombeau, vit le panier et de quelle sorte ces feuilles naissantes l'avaient environné ; cette forme nouvelle lui plut infiniment, et il en imita la manière dans les colonnes qu'il fit depuis à Corinthe, établissant et réglant sur ce modèle les proportions et la manière de l'ordre corinthienAuteur : PERRAULT - Source : Vitruve, IV, 1
- Dans ses premiers écrits, il s'attache davantage à détruire ce prestige d'illusion qui nous donne une admiration stupide pour les instruments de nos misères et à corriger cette estimation trompeuse qui nous fait honorer des talents pernicieuxAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Dial. 3
- Cette liberté mitigée N'étant ni prude, ni catinAuteur : Voltaire - Source : Ép. 31
Les mots débutant par Tig Les mots débutant par Ti
Une suggestion ou précision pour la définition de Tige ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 09h26
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur tige
Poèmes tige
Proverbes tige
La définition du mot Tige est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Tige sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Tige présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
