Définition de « âcre »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot acre de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur âcre pour aider à enrichir la compréhension du mot âcre et répondre à la question quelle est la définition de acre ?
Une définition simple :
Définitions de « acre »
Trésor de la Langue Française informatisé
ACRE, subst. fém.
MÉTROL. (agraire). Mesure agraire usitée autrefois en France, d'une valeur, d'environ 50 ares, variable selon les provinces, encore en usage dans les pays britanniques, où elle vaut environ 40 ares :Wiktionnaire
Nom commun - français
acre \ak?\ féminin
- Unité de surface égale à 0,4 hectare ou à 4046,9 mètres carrés, encore utilisée en agriculture et dans divers pays avec des valeurs différentes.
- En Normandie, les Terres & Prés se mesurent par acres ; Les Bois & Bocages, par arpent ; [?] L'acre a 160 perches [carrées]. ? (L'Agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur, Rouen, 1787)
- En France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, partout, sauf en Amérique, il est bien rare que le petit propriétaire terrien possède plus de dix à vingt acres. ? (Thomas Couët, Le bois, voilà l'ennemi !, Revue Franco-Américaine, 1909)
-
Lorsque mon père était en congé, il mettait tout un matin pour faire sa tournée, et à cheval.
? Eh mais, dit Gwinett, cela représente un domaine assez considérable : dix mille acres, au moins.
? À peu près, dit la jeune femme. Je me souviens maintenant : dix à douze mille acres. ? (Pierre Benoit, Le lac salé, Albin Michel, 1921, réédition Le Livre de Poche, page 133) - Venu d'Ontario avec de puissants moyens, il avait défriché entièrement non seulement les cent soixante acres de son homestead, mais les trois quarts de sections qui étaient contiguës, et qu'il avait fait prendre à ses fils. ? (Maurice Constantin-Weyer, Un homme se penche sur son passé, 1928, réédition Nelson, page 160)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Mesure de superficie en usage dans l'ancienne France et encore employée dans divers pays avec des valeurs différentes. L'acre anglaise vaut un peu plus de 10 ares.
Littré
- Mesure de terre employée en divers pays, et d'une étendue différente suivant les localités. L'acre anglaise vaut 40 ares 467. L'Angleterre contient, dans toute son étendue, 39 038 500 acres.
REMARQUE
Quelques auteurs font acre du masculin?; entre autres Vauban?: La mesure de la province de Normandie est l'acre. Cet acre est composé de 160 perches carrées, et la perche de 22 pieds carrés (22 pieds en carré, c'est-à-dire 484 pieds carrés)?; mais les pieds sont différents?; la mesure la plus commune les fait d'onze pouces, et le pouce de douze lignes, Dîme, 46.
HISTORIQUE
XVIe s. Les plus communes sont aujourd'hui entre nous?: arpents, journées, asnées, journaux, sesterées, acres, couples de b?ufs
, De Serres, 10.
Encyclopédie, 1re édition
* ACRE, s. (Géogr.) Ptolémaïde, S. Jean d'Acre, ville d'Asie, qui appartient aux Turcs, proche de Tyr. Lon. 57. lat. 32. 40.
Acre, s. f. (Commerce.) mesure de terre, différente selon les différens pays. Voyez Mesure, Verge & Perche.
Ce mot vient du Saxon accre, ou de l'Allemand acker, lequel vraissemblablement est formé d'acer, & signifie la même chose. Saumaise cependant le fait venir d'acra, qui a été dit pour akena, & signifioit chez les Anciens une mesure de terre de dix piés.
L'acre en Angleterre & en Normandie est de 160 perches quarrées. L'acre Romaine étoit proprement la même chose que le jugerum. Voyez Arpent.
Il y a en Angleterre une taille réelle imposée par Charles II. à raison du nombre d'acres que possedent les habitans.
Le Chevalier Petty a calculé dans l'Arithmétique politique que l'Angleterre contient 39038500 acres ; les Provinces Unies 4382000, &c.
L'acre des bois est de quatre vergées, c'est-à-dire, 960 piés. Voyez Vergée. (E & G)
Acre, adj. (Chimie) se dit de ce qui est piquant, mordicant, & d'un goût désagréable. Tout excès & toute dépravation de salure fait l'acre. C'est en Medecine qu'on emploie plus communément ce terme.
Il y a autant de différentes especes d'acres que de différentes especes de sels. Il y a des acres aigres, des acres alkalis, & des acres moyens, qui tiennent de l'acide & de l'alkali en différentes proportions ; & on peut éprouver les acres pour en connoître l'espece, comme on éprouve les sels pour savoir s'ils sont acides ou alkalis, ou neutres. Voyez Sels.
On peut aussi distinguer les acres en acre scorbatique, acre vérolique, &c. Lorsque les différens sels qui sont naturellement dans les liqueurs du corps, sont en quantités disproportionnées, ou lorsque la dépuration de ces liqueurs est troublée, & leur chaleur naturelle augmentée, il se fait des acres de différentes especes. Certaines gangrenes font voir que les liqueurs du corps humain peuvent devenir si acres, qu'elles en sont caustiques. Les alkalis urineux qui se forment naturellement dans les corps vivans, sont dissolvans des parties animales, non-seulement des humeurs & des chairs, mais aussi des nerfs & des cartilages ; & les acres acides des animaux, comme est l'acide du lait, amollissent & dissolvent les os les plus durs. On peut en faire l'expérience avec du lait aigre ; on verra qu'il dissout jusqu'à l'ivoire.
Souvent un acre contre nature se trouve confondu dans les humeurs, & ne produit point de mal sensible tant qu'il n'y est pas en assez grande quantité, ou qu'il est plus foible que ne le sont les liqueurs qui n'ont qu'une salure naturelle. On a vû souvent des personnes qui portant un levain de vérole dans leurs humeurs, paroissoient se bien porter tant que le virus n'avoit pas fait assez de progrès pour se rendre sensible. Il y a des gouteux qui se portent bien dans les intervalles des accès de goutte, quoiqu'ils ayent dans eux de l'humeur acre de la goutte : c'est pour cette raison-là que les Medecins sages & habiles ont égard à la cause de la goutte dans toutes les maladies, qui arrivent aux gouteux, comme aux autres hommes.
Des charbons de peste ont sorti tout d'un coup à des personnes qui paroissoient être en parfaite santé ; & lorsque ces charbons pestilentiels sortent de quelque partie intérieure du corps, ceux à qui ce malheur arrive, meurent sans garder le lit ; & quelquefois même ils tombent morts dans les rues en allant à leurs affaires : ce qui prouve bien qu'on peut porter dans soi pendant quelque tems un levain de maladie, & d'une maladie très-dangereuse, sans s'en appercevoir. C'est ce qu'ont peine à comprendre ceux qui ayant la vérole conservent cependant toutes les apparences d'une bonne santé, n'ont rien communiqué, & ont des enfans sains.
Souvent des personnes sont prêtes d'avoir la petite vérole & semblent se porter bien ; cependant elles ont en elles le levain de cette maladie, qui quelques jours après les couvrira de boutons & d'ulceres. Ces choses sont approfondies, & clairement expliquées dans la Chimie Medicinale. (M)
Étymologie de « acre »
Bas-lat. acrum, acrus?; allem. acker?; angl. acre?; celt. acair?; comp. le latin ager, le grec ????? et le sanscrit ájras, plaine.
- Passé en français par le normand : du vieux norrois akr (« champ cultivé, terrain à labourer »), renforcé par le vieil anglais æcer et parent du néerlandais akker, de l'allemand Acker. Il est passé du sens de « champ » à celui de « mesure agraire, quantité mesurée de terre » en vieil anglais. L'étymon germanique est apparenté au latin ager, agri (« champ cultivé »).
- Passé en français par le normand : du vieux norrois akr (« champ cultivé, terrain à labourer »), renforcé par le vieil anglais æcer et parent du néerlandais akker, de l'allemand Acker. Il est passé du sens de « champ » à celui de « mesure agraire, quantité mesurée de terre » en vieil anglais. L'étymon germanique est apparenté au latin ager, agri (« champ cultivé »).
âcre au Scrabble
Le mot âcre vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot acre - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot âcre au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
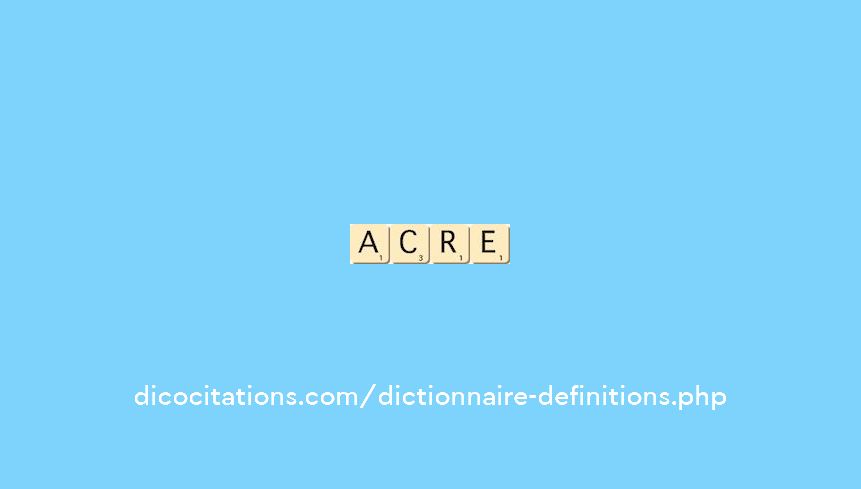
Les rimes de « âcre »
On recherche une rime en KR .
Les rimes de âcre peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en kR
Rimes de susucre Rimes de sucrent Rimes de pouacre Rimes de archidiacre Rimes de lucre Rimes de acre Rimes de exècre Rimes de ocres Rimes de consacres Rimes de simulacre Rimes de médiocre Rimes de sépulcre Rimes de macres Rimes de ancre Rimes de sucres Rimes de fiacre Rimes de exècrent Rimes de âcre Rimes de sépulcres Rimes de sucres Rimes de fiacres Rimes de massacres Rimes de consacre Rimes de ancre Rimes de sucre Rimes de ocre Rimes de ancres Rimes de sacre Rimes de fiacre Rimes de encre Rimes de diacre Rimes de ancres Rimes de âcres Rimes de nacre Rimes de acres Rimes de sacres Rimes de convaincre Rimes de cancre Rimes de médiocres Rimes de simulacres Rimes de échancre Rimes de crayon-encre Rimes de consacrent Rimes de massacrent Rimes de nacres Rimes de encre Rimes de sacres Rimes de encres Rimes de chancres Rimes de médiocresMots du jour
susucre sucrent pouacre archidiacre lucre acre exècre ocres consacres simulacre médiocre sépulcre macres ancre sucres fiacre exècrent âcre sépulcres sucres fiacres massacres consacre ancre sucre ocre ancres sacre fiacre encre diacre ancres âcres nacre acres sacres convaincre cancre médiocres simulacres échancre crayon-encre consacrent massacrent nacres encre sacres encres chancres médiocres
Les citations sur « âcre »
- D'emblée dans la vie la fatigue touche aux deux portes sacrées: l'amour, le sommeil. L'amour qu'elle use comme de l'eau sur la pierre. Le sommeil qu'elle entasse comme de l'eau sur de l'eau.Auteur : Christian Bobin - Source : Une petite robe de fête (1991)
- A la Saint-Fiacre, soleil ardent, - Pour huit jours encore, du beau temps.Auteur : Dictons - Source : 30 août
- Il serait là, solitaire et secoué de spasmes, dans la puanteur ammoniacale, l'âcre odeur d'excréments, de cigare refroidi et de désinfectant.Auteur : Claude Simon - Source : Le Palace (1962)
- Les rites de consécration, qui introduisent dans le monde du sacré un être ou une chose, et les rites de désacralisation, ou d'expiation, qui, à l'inverse, rendent une personne ou un objet pur ou impur au monde profane.Auteur : Roger Caillois - Source : L'Homme et le sacré (1939)
- Cheval de fiacre peut rapporter, mais pas longtemps.Auteur : Proverbes italiens - Source : Proverbe
- Ce brave général néglige la tenue diplomatique: dans l'intimité, il donne de grands coups de poing dans le dos de Maxime en l'appelant sacré farceur.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, 15 décembre 1850
- Consacre tes loisirs à essuyer la poussière qui ternit le miroir de ton coeur.Auteur : Musluh al-Din Saadi - Source : Le Jardin des Fruits
- Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré qui nous défend d'en faire un jeu de hasard. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Théophile Gautier
- Le sacrement du mariage est un désinfectant.Auteur : Louis Veuillot - Source : Les Libres penseurs
- La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'adultère est identique à ce qu'on appelait autrefois l'hérésie.Auteur : Victor Hugo - Source : Tas de pierres (1901)
- De ce bourbier vos pas seront tirés,
Dit Pompignan; votre dur cas me touche:
Tenez, prenez mes Cantiques Sacrés,
Sacrés, ils sont, car personne n'y touche.Auteur : Voltaire - Source : Satires, le Pauvre Diable (1758) - Aujourd'hui, quatre ans après mon évasion, je peux respirer et me consacrer au chapitre le plus difficile du travail : tirer un trait sur le passé et regarder devant moi.Auteur : Natascha Kampusch - Source : 3096 jours (2010)
- Il reste à savoir si le mariage est un des sept sacrements ou un des sept péchés capitaux.Auteur : John Dryden - Source : Sans référence
- Le mariage est un sacrement en vertu duquel nous ne communiquons que des chagrins.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Sans référence
- Il m'a fallu ès jours sacrez de mon triumphe ensepvelir coup sur coup, de mes propres mains, mes deux jeunes enfans.Auteur : Jacques Amyot - Source : Paul-Aemile, 58
- Le mariage est plus inviolable que la religion? La partie est plus grande que le tout? Il n' y a que deux choses sacrées: en religion, la foi; en union, l'amour. Croyez. Aimez. Ceci est toute la loi.Auteur : Victor Hugo - Source : Choses vues (1887-1900)
- La querelle des sacrements refusés aux jansénistes a été la première étincelle de l'embrasement.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Destruction des jésuites
- La parole de mon père demandait à parler par moi, comme elle n'avait jamais parlé, au-delà de nos deux forces réunies. Elle me niait, me demandait mon aide pour se consacrer à elle-même, et je voulais cela (c'est pourquoi je n'apparais presque pas dans ces pages). Auteur : Pierre Pachet - Source : Autobiographie de mon père (1987)
- On voit scintiller aux murailles, aux arceaux, aux voûtes, un revêtement qui semble une étoffe brodée et rebrodée de nacre et d'or, sur fond vert. Peut-être un vieux brocart à ramages.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Jérusalem (1894)
- J'ai la sensation que ma vie est achevée, c'est-à-dire que je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus désormais être que du temps à perdre. Après tout j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais 1. assez mon esprit. Je crois que ce que j'ai trouvé d'important — je suis sûr de cette valeur — ne sera pas facile à déchiffrer de mes notes. — Peu importe. Je connais my heart aussi. Il triomphe. Plus fort que tout, que mon esprit, que l'organisme. — Voilà le fait. Le plus obscur des faits. Plus fort que le vouloir vivre et que le pouvoir comprendre est donc ce sacré coeur. — « Coeur », c'est mal nommé. Je voudrais au moins, trouver le vrai nom de ce terrible résonateur. Il y a quelque chose en l'être qui est créateur de valeurs, et cela est tout-puissant, irrationnel, inexplicable, ne s'expliquant pas. Source d'énergie séparée mais qui peut se décharger aussi bien pour que contre la vie de l'individu.Auteur : Paul Valéry - Source : Cahiers, 10 mai 1945
- Consacre tous tes soins à l'action présente, disait à peu près Marc Aurèle ;
Laisse le reste au hasard ou aux dieux.Auteur : André Comte-Sponville - Source : Le Goût de vivre et cent autres propos (2010) - Après, elle a râlé contre moi, elle m'a dit, sacré conarde, qu'est-ce que t'avais besoin de raconter cette histoire de hache?Auteur : Raymond Queneau - Source : Zazie dans le métro (1959)
- Le banquet ... dura quarante-huit heures. Il y fut bu quatre hectolitres d'un vin blanc du Nord, bon marché et âcre, mais riche en alcaloïdes qui excitent au plus haut point les nerfs moteurs.Auteur : Roger Vailland - Source : 325 000 francs (1955)
- Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à voler. Il y a tant et tant à apprendre!Auteur : Richard Bach - Source : Jonathan Livingston le goéland
- Le temps est si précieux, la vie est si courte. Il faudrait les consacrer à aimer vraiment. À aimer de tout son coeur. Auteur : Joël Dicker - Source : L'Énigme de la Chambre 622 (2020)
Les mots proches de « acre »
Acraux Acre Âcre Âcreté Acrimonie Acrobatie Acrochordon Acrologique Acromion Acropole ou acropolis Acrostiche AcrotèreLes mots débutant par acr Les mots débutant par ac
acra âcre acre acré âcrement âcres acres âcreté acrimonie acrimonieuse acrimonieusement acrimonieuses acrimonieux acrobate acrobates acrobatie acrobaties acrobatique acrobatiquement acrobatiques acrocéphale acromion acronyme acrophobie acropole acrostiche acrotère acrylique acrylique acryliques acryliques acrylonitrile
Les synonymes de « acre»
Les synonymes de âcre :- 1. acide
2. aigre
3. aigrelet
4. acidulé
5. piquant
6. sur
7. suret
8. tourné
9. acerbe
10. acrimonieux
11. âpre
12. irritant
13. mordant
14. acariâtre
15. fielleux
16. amer
17. astringent
18. saumâtre
19. vert
20. fiel
21. criard
22. discordant
23. perçant
24. aigu
25. désagréable
26. criant
27. tapageur
28. choquant
29. évident
30. manifeste
31. rance
32. moisi
33. vieux
34. gâ
synonymes de âcre
Fréquence et usage du mot âcre dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « acre » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot âcre dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de âcre ?
Citations âcre Citation sur âcre Poèmes âcre Proverbes âcre Rime avec âcre Définition de âcre
Définition de âcre présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot âcre sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot âcre notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
