La définition de Dos du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Dos
Nature : s. m.
Prononciation : dô ; dans la conversation l's ne se lie
Etymologie : Berry, dous ; provenç. et anc. catal. dors, dos ; espagn. et portug. dorso ; ital. dorso, dosso ; du latin dorsum. La suppression de l'r du latin dans dos est remarquable, d'autant plus qu'elle se trouve aussi dans le provençal et dans l'italien, à côté de la forme en r. Au XVIe siècle, quelques écrivains avaient repris l'r étymologique.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de dos de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec dos pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Dos ?
La définition de Dos
Partie du corps de l'homme et des animaux depuis les épaules jusqu'aux reins ou lombes, et qui est postérieure chez l'homme et supérieure chez les animaux. Le dos d'un cheval. Porter sur le dos. Tomber, s'étendre sur le dos.
Toutes les définitions de « dos »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Partie du corps de l'homme ou de l'animal, depuis le cou jusqu'aux reins. Il était couché sur le dos. Dos courbé, voûté. Porter un homme sur son dos. On lui lia les mains derrière le dos. Dos à dos. Le dos d'un cheval, d'un mulet, d'un âne. En termes militaires, Mettre sac au dos, S'apprêter à partir. Soldats, sac au dos. Fig. et fam., Avoir le dos au feu et le ventre à table, ou Être le dos au feu et le ventre à table, Prendre toutes ses aises en mangeant. Fam., Faire le gros dos, se dit des Chats lorsqu'ils relèvent leur dos en bosse. Fig. et fam., Plier le dos, Céder, se résigner à ce qui arrive de fâcheux. Fig., Tendre le dos aux coups. Voyez TENDRE. Fig. et fam., Porter quelqu'un sur son dos, En être importuné, fatigué. Avoir toujours quelqu'un sur le dos, En être sans cesse obsédé, poursuivi. Très fam., Avoir plein le dos d'une personne ou d'une chose, Être excédé de cette personne ou de cette chose. Fig. et fam., Mettre tout sur le dos de quelqu'un, Se décharger sur lui de toute la responsabilité, de tout le blâme, rejeter sur lui tous les torts. On dit dans un sens analogue, Battre quelqu'un sur le dos d'un autre, Faire retomber indirectement sur quelqu'un les reproches que l'on adresse à une autre personne. Fam., Tourner le dos à quelqu'un, Tourner le dos du côté où il a le visage, lui présenter le dos. Il se dit, figurément et familièrement, lorsqu'on quitte quelqu'un et qu'on le laisse là par mépris, par indignation, ou lorsqu'on abandonne ses intérêts. Dans la mauvaise fortune, la plupart des amis vous tournent le dos. Tourner le dos aux ennemis, à l'ennemi, ou, simplement, Tourner le dos, Fuir. Il tourne le dos à l'endroit où il veut aller, se dit d'un Homme qui, au lieu d'aller où il veut, prend un chemin tout opposé. Tourner le dos signifie encore S'en aller. Vous n'aurez pas tourné le dos, vous n'aurez pas le dos tourné qu'il ne se souviendra plus de vous. Fig. et fam., Avoir bon dos, se dit de Quelqu'un à qui l'on attribue toutes les sottises qui se disent, toutes les fautes qui se font. Fig. et fam., Avoir quelqu'un à dos, se mettre quelqu'un à dos, L'avoir pour ennemi, s'en faire un ennemi. Se mettre tout le monde à dos. Fig. et fam., Renvoyer des gens dos à dos, Renvoyer chacune de leur côté deux personnes qui sont en différend, sans donner à l'une aucun avantage sur l'autre. Fig. et fam., Le dos lui démange, se dit d'une Personne qui fait tout ce qu'il faut pour qu'on en vienne à la battre. En dos d'âne. Voyez ÂNE. Il désigne aussi, par analogie, la Partie de certaines choses qui, par sa destination, par sa position ou par sa forme, offre quelque rapport avec le dos de l'homme ou de l'animal. Le dos d'un habit, d'une robe, La partie d'un habit, d'une robe qui sert à couvrir le dos; Le dos d'une chaise, d'un fauteuil, etc., La partie d'une chaise, etc., contre laquelle on s'appuie le dos. Le dos d'un couteau, Partie opposée au tranchant. Le dos d'un livre, Partie opposée à la tranche et sur laquelle on met ordinairement le titre. Dos brisé, se dit d'une Reliure faite de telle sorte que le livre que l'on ouvre ne se referme pas de lui-même. Le dos d'un papier, d'un billet, d'un acte, etc., Le revers. Mettre sa signature au dos d'un chèque. Le dos de la main, Le côté extérieur de la main, la partie opposée à la paume de la main.
Littré
-
1Partie du corps de l'homme et des animaux depuis les épaules jusqu'aux reins ou lombes, et qui est postérieure chez l'homme et supérieure chez les animaux. Le dos d'un cheval. Porter sur le dos. Tomber, s'étendre sur le dos.
Il faut remettre encor le harnais sur le dos
, Tristan, Mort de Chrispe, III, 2.Depuis plus d'une semaine Je n'ai trouvé personne à qui rompre les os?; La vertu de mon bras se perd dans le repos, Et je cherche quelque dos Pour me remettre en haleine
, Molière, Amph. I, 2.Les mains liées derrière le dos
, Fénelon, Tél. I.Sur le dos des gens du village Après boire il cassait les pots
, Béranger, Enfant de la maison.L'épine du dos, la colonne vertébrale.
Le dos au feu, le ventre à table, se dit de ceux qui, en dînant, ont le dos tourné vers un bon feu?; et, figurément, de ceux qui se donnent toutes leurs aises.
Familièrement. Il n'a pas une chemise sur son dos, une chemise à se mettre sur le dos, il n'a rien à se mettre sur le dos, se dit d'une personne extrêmement pauvre.
Dans un sens opposé. C'est une femme qui met tout sur son dos, c'est une femme qui dépense en toilette tout ce qu'elle a ou gagne.
Fig. et familièrement. Le dos lui démange, se dit d'une personne qui fait tout ce qu'il faut pour qu'on la batte.
Faire le gros dos, se dit des chats lorsqu'ils relèvent leur dos en bosse, ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on les caresse en leur passant la main sur le dos, dans le sens de la tête à la queue, et aussi lorsque l'animal est en colère.
Par extension.
Faire le gros dos, s'est dit d'une espèce de contorsion qu'affectaient les petits-maîtres à Paris, mettant une main dans la ceinture de la culotte, et l'autre dans la veste, et par là faisant un gros dos voûté, comme un matou
, Leroux, Dict. comique.Qui faisant le gros dos, la main dans la ceinture, Viennent pour tout mérite étaler leur figure
, Regnard, le Joueur, I, 2.Puis m'appuyant sur Scipion et faisant le gros dos, je gagnai une salle
, Lesage, Gil Blas, X, 3.Fig. et familièrement. Faire le gros dos, ou faire gros dos, faire l'important, l'homme capable.
Le fils de Saumery, à force de faire l'important et le gros dos, imposait à une partie de la cour
, Saint-Simon, 71, 172.Plier le dos, céder. Laissez passer la bourrasque, pliez le dos. Et aussi être humble devant ses supérieurs?: il n'a jamais su plier le dos.
Mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un, l'en rendre responsable.
Je suis bien aise de savoir que le pont d'Avignon est encore sur le dos du coadjuteur?; c'est donc lui qui vous y a fait passer
, Sévigné, 35.Cela ira sur son dos, se dit d'une perte, d'un dommage qui sera mis au compte de quelqu'un.
Il faut que tout le mal tombe sur notre dos
, Molière, Sgan. 17.Le roi s'était flatté toute sa vie de faire pénitence sur le dos d'autrui
, Saint-Simon, 250, 77.Battre quelqu'un sur le dos d'un autre, faire à quelqu'un des reproches, des critiques qui retombent sur un autre. C'est sur mon dos que vous avez battu Platon.
Il se laisse tondre la laine sur le dos, se dit d'un homme trop débonnaire ou insouciant qui se laisse dépouiller, voler. Dans le même sens, se laisser manger la laine sur le dos.
Il a été battu dos et ventre, on lui en a donné sur le dos et partout, se dit d'un homme qui a été violemment battu.
Un peuple qui le pousse à bout, Et qui, dos et ventre et partout, Le batte et toute sa cohorte
, Scarron, Virg. trav. IV.Être sur le dos, être couché ou alité. Voilà trois semaines que je suis sur le dos.
Tourner le dos, présenter son dos, au lieu de présenter la partie antérieure du corps.
Les sages quelquefois, ainsi que l'écrevisse, Marchent à reculons, tournent le dos au port
, La Fontaine, Fabl. XII, 10.La noblesse supplie le roi de réformer l'immodestie de son clergé, qui cause et parle haut et tourne le dos à l'autel
, Sévigné, Lett. 19 janv. 1674.Fig. Tourner le dos à la mangeoire, se mettre dans une situation contraire à la chose qu'on veut faire.
Tourner le dos dans une bataille, fuir devant l'ennemi.
Ils tournèrent le dos quand tu fus assailli
, Malherbe, I, 4.Tourner le dos, s'éloigner un moment. Je n'ai fait que tourner le dos, il était déjà parti.
Dès que j'ai eu le dos tourné
, Sévigné, 480.Tourner le dos à quelqu'un, lui témoigner, en lui tournant effectivement le dos, son mécontentement, son mépris.
Le roi, pour toute réponse, lui tourna le dos brusquement
, Marmontel, Mém. IV.Il tourne le dos où il veut aller, se dit d'un homme qui, au lieu d'aller où il veut, prend un chemin tout opposé.
Fig. Tourner le dos, ne pas voir, dédaigner.
Je leur tournerai le dos, et non le visage, au jour de leur perte
, Sacy, Bible, Jérémie, XVIII, 17.Lorsque Dieu courroucé vous tournera le dos, En des feux sans lumière, en des nuits sans repos Vous expierez vos vices
, Racan, 2e psaume.Nous tournons le dos à la vérité
, Bossuet, Resp. 2.Que fait donc un poëte qui finit tout?? Il tourne le dos à la nature
, Diderot, Salon de 1767, ?uvres, t. XIV, p. 450, dans POUGENS.Avoir bon dos, avoir un dos sur lequel on peut frapper fortement?; et, figurément et familièrement, avoir bon dos, être en état de supporter une perte, ou bien être insensible aux railleries.
Il ne s'agit que de mille écus?; M. Turcaret a bon dos, il portera bien encore cette charge-là
, Lesage, Turcaret, I, 2.Avoir bon dos signifie aussi ne pas s'épouvanter des reproches. Mettez les fautes sur moi, j'ai bon dos. Dans une autre nuance?: On s'en prend toujours à moi [on m'accuse de tout]?; il est vrai que j'ai bon dos [que je suis souvent en faute].
Avoir le dos solide se dit comme avoir les reins solides, avoir de grandes ressources. C'est un homme qui fait cent entreprises à la fois, mais il a le dos solide, c'est-à-dire il a les capitaux suffisants.
Dos à dos, figure de danse dans laquelle le danseur et son vis-à-vis passent l'un derrière l'autre sans se regarder.
Fig. et familièrement. Mettre les gens dos à dos, renvoyer deux personnes qui sont en différend, sans donner aucun avantage à l'une ni à l'autre. Il se dit souvent dans les comptes rendus de procès?: On les a renvoyés dos à dos.
Porter sur le dos, porter une charge qui est placée sur le dos. Il avait un sac sur le dos.
On dit au dos dans cette locution?: avoir le sac au dos, c'est-à-dire porter le sac militaire, être soldat.
Fig. Avoir, porter quelqu'un sur son dos, en être obsédé, ennuyé.
Populairement. J'en ai plein le dos, j'en suis très fatigué, ennuyé.
Être sur le dos de quelqu'un, l'importuner, l'obséder. Il est toujours sur mon dos.
Populairement. Scier le dos de quelqu'un, l'ennuyer, le fatiguer. Il me scie le dos.
À dos, derrière soi.
J'avais à dos une campagne immense qui ne m'avait été annoncée que par l'habitude d'apprécier les distances entre des objets interposés
, Diderot, Salon de 1767, ?uvres, t. XIV, p. 185, dans POUGENS.Fig. Se mettre tout le monde à dos, avoir chacun contre soi.
Quoi, volage, prenez-vous donc Pour vous mettre à dos les jésuites? Coquilles, rosaire et bourdon
, Béranger, Pèler. de Lisette.Avoir quelque chose à dos, ne pouvoir s'en séparer.
Quittons-nous cette ville unique, Nous voyageons Paris à dos
, Béranger, J. de Paris. - 2 Terme d'anatomie. Partie postérieure chez l'homme, supérieure chez les animaux, du tronc depuis la dernière vertèbre cervicale jusqu'à la dernière lombaire.
-
3 Terme de manége. Dos de carpe, ou de mulet, dos convexe. Dos double, dos de cheval, dans lequel on remarque un léger sillon médian.
Le dos présente une légère concavité?; s'il est trop concave, l'animal est dit ensellé. Le dos large accuse un fort développement des muscles et l'ampleur de la poitrine. Le dos court annonce beaucoup de force. Le dos long est moins fort que le dos court.
-
4 Par analogie, la partie postérieure de certaines choses. Le dos d'un habit, d'une chaise.
Qui prenaient, sur le dos de leurs chaises, de ces postures aisées et galantes qui marquent qu'on est au fait des bons airs
, Marivaux, Marianne, 2e part.Le dos d'un couteau, le dos d'un rasoir, la partie opposée au tranchant.
Le dos d'un billet, d'un acte, le revers.
Le dos du nez, de la main, du pied, de la langue, la partie supérieure du nez, de la main, du pied, de la langue.
Terme de botanique. Le dos d'une strie, la partie saillante. Le dos d'une graine, celle des faces qui est comprimée et tournée du côté des parois du péricarpe. Le dos d'une feuille, sa face inférieure.
Terme d'entomologie. La partie supérieure du mésothorax et du prothorax?; l'une ou l'autre de ces parties.
Le dos d'un livre, la partie opposée à la tranche.
Terme de reliure. Dos brisé, dos d'un livre tellement fait, que le livre que l'on ouvre demeure de lui-même tout ouvert.
Il leur faut des livres à dos brisés, des livres qui se tiennent ouverts sur la table
, Lesné, la Reliure, p. 113, 1820.L'époque de l'introduction des dos brisés en France est très incertaine? il y a à peu près cinquante ans que cette espèce de reliure est devenue de mode
, Lesné, ib. p. 186. -
5Dans le style élevé et dans la poésie, la partie supérieure.
Cependant sur le dos de la plaine liquide?
, Racine, Phèdre, V, 6.Nous montions sur le dos des vagues
, Fénelon, Tél. IV. -
6En dos d'âne, en configuration du dos d'un âne, c'est-à-dire telle qu'il y ait un talus incliné des deux côtés. Toit, pont en dos d'âne.
Les rues étroites et sans pente, quoique le terrain soit en dos d'âne, sont toujours bourbeuses
, Raynal, Hist. phil. XIII, 43.Dos d'âne, ustensile dont se servent les bouchers.
Terme de marine. Dos d'âne, ouverture en demi-cercle, faite à certains bâtiments, pour couvrir le bout de la manivelle du gouvernail.
- 7 Terme de jardinage. Dos de bahut ou dos de carpe, se dit d'une certaine manière de relever le terrain d'un parterre.
-
8Dos brûlé, quadrupède du genre paresseux (achée aï).
Dos bleu, un des noms de la sittelle.
Dos rouge, nom d'un oiseau de la Guyane, le tangara septicolore (granivores).
HISTORIQUE
XIe s. Tute l'eschine [il] Iui desevre du dos
, Ch. de Rol. XCI. De ceus d'Espaigne qui ont les dos tournez
, ib. CLXXIV.
XIIe s. En son dos [il] vest un blanc aubert dopler [doublé]
, Ronc. p. 49.
XIIIe s. Se Tybers de son dos la grant rue ne tert [n'essuye, sur la claie]?
, Berte, XCIII. Si mist arriere dos toute couardie, et se feri en els l'espée traicte
, H. de Valenciennes, XI. Quand li roi Ferrans et sa gent virent qu'il ne poroit plus endurer, si tournerent le dos, et Anglès encaucierent [poursuivirent] jusques à la nuit oscure
, Chron. de Rains, p. 78. Nus [nul] chevax qui porte à dos ne doit paier que obole de chaucie
, Liv. des mét. 275. Themis, quant oï la requeste, Qui moult estoit bonne et honeste, Lors conseilla [à Deucalion et à Pyrrha] qu'il s'en alassent, Et qu'il après lor dos gitassent Tantost les os de lor grant mere
, la Rose, 17822. La dame, qui aler voloit Au moustier si com el soloit, Geta en son dos sa chemise, Et puis si a sa robe prise
, Rutebeuf, 324. Le roy m'apela là où je me seoie avec les riches hommes du pays, de là en un prael, et me fist le dos tourner vers eulz
, Joinville, 289.
XIVe s. Bien dix mille Espaignols des meilleurs qu'il y a [il] Mist en une bataille, et bien les arrousta, Une riviere au dos, qui couroit par de là
, Guesclin. 11660. Ne pourront prendre de corroyer un dos [peau] que deux sols six deniers
, Ordonn. des rois de Fr. t. II, p. 365. Flamens fist assalir, point ne les espargna?; Chil tournerent les dos?; car cascuns s'esmaia [s'effraya], Quant Henris leur failli?
, Baud. de Seb. VI, 574.
XVe s. Et quand les Anglois y chevauchent [en Écosse], il convient que leurs pourveances, si ils veulent vivre, les suivent toujours à dos [par derrière]
, Froissart, II, II, 228. Nous faisons doute, quoi qu'il vous ait mandé ni quoi qu'il dise ni promette, que il ne vous tournast le dos
, Froissart, II, II, 39. L'un d'iceulx compaignons fist bas dos au suppliant et à l'un des autres, et monterent par dessus un petit mur
, Du Cange, dorsum. Porter harnois sur vostre doux
, Bibl. des Chartes, 4e série, t. V, p. 362. J'ai toujours porté sur mon dos Paine, travail à grant planté?; Ne nulle choses n'ay hanté, Dont on dye qu'aye failly
, Orléans, Compl. de l'amant et de l'amour. Et se riens y a d'offense passée, prestement après le pardon fait est mise darriere le dos
, Chastelain, Expos. s. vérité. Ayant le dos au feu et le ventre à la table
, Basselin, II. Jehanne fait la beste à deux dos, Perrette est ung peu trop pansue, L'aultre est feutrée sur le dos, Pource qu'elle est ung peu bossue
, Coquillart, Monologue des perruques. Cinq cent dos de fines martres gebelines
, J. de Saintré, p. 210, dans LACURNE. Bois qui estoit croissant sur les dodasnes des fossez de la dite ville
, Du Cange, ramiliae. Le suppliant bailla à Perrinet de la quarre ou du doulx de la main gaulche en arriere main sur la joue
, Du Cange, dodus. Tous les rivaiges ou dosdasnes qui au prieur appartenoient
, Du Cange, ib. Et sur le dos [de la lettre]?: Au deleal Girard?
, Louis XI, Nouv. XXVI. Le bon mari print place en une chaire à dos
, Louis XI, ib. XXIX.
XVIe s. Il charge sus son dours les deux pretieuses coingnées
, Rabelais, Pant. IV, Nouv. prol. Frere Jean daulba Rouge-museau, dours et ventre, bras et jambes
, Rabelais, Pant. IV, 16. Je voy le dos d'une mer Couppé de rames legeres
, Du Bellay, J. III, 41 verso. ? et qui se donne los D'avoir porté son vieil pere [Anchise] à son dos
, Du Bellay, J. IV, 23, verso. Brief, haut et bas, en face et à dos, à dextre et à gauche nous sommes assiegez et assaillis
, Calvin, Instit. 791. Les Flamens qui nous aimoyent, et lesquels on a contrains de nous haïr, de quelle allegresse nous sauteroyentils à dos?!
Lanoue, 24. Il disoit que, pour devenir riche, il ne falloit que tourner le dos à Dieu, cinq ou six bons ans
, Despériers, Contes, LV. Mais pensez qu'en chaude colere, M. de Rachaut lui donna à dos [la battit]
, Despériers, ib. t. I. p. 273, dans LACURNE. Ses parens maternels lui tournerent tous le dos en haine de la Religion
, D'Aubigné, Vie, XX. À peine fut-il parti que la reine mere, qui en fut avertie, lui mit à dos plusieurs partis pour le prendre
, D'Aubigné, ib. XLIII. Doux-d'asne? dos d'asne
, D'Aubigné, Hist. II, 280. Les uns à dos renversés, estendus, Les uns à ventre, en leur long espandus
, Am. Jamyn, Poésies, f° 29, dans LACURNE. Ont dit et escrit ce que bon leur a semblé, rempli trois feuillets de papier en dos et en ventre [le recto et le verso]
, Nouv. coutum. génér. t. III, p. 282. Parce que Socrates avoit la chair dure, qu'il avoit bon dos, qu'il portoit tout?
, Cholières, Contes, t. II, Après-dînée II, p. 46, dans POUGENS.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
DOS. Ajoutez?:Encyclopédie, 1re édition
DOS, s. m. terme d'Anatomie, qui se dit de la partie postérieure du thorax.
Dos de la main et du pié, c'est le côté extérieur de la main & du pié, ou cette partie opposée à la paume & à la plante du pié. Voyez Paume ; voy. aussi Main & Pied.
Dos du nez, c'est le sommet du nez qui regne tout le long de cette partie. Voyez Nez.
Dans ces nez que l'on appelle nez à la Romaine, le dos est plus haut ou plus en bosse vers le milieu, que dans tout le reste : cette partie est appellée l'épine. Voyez Epine. (L)
Dos d'ane, (Marine.) c'est une ouverture que l'on fait en demi-cercle à quelques vaisseaux, afin de couvrir le passage de la manuelle.
Le dos d'âne d'un vaisseau de cinquante canons s'étend à dix-huit pouces du fronteau, & il a quinze pouces de large ; il va en s'étrécissant, & finit à un pié & demi du bord. Ses côtés sont faits d'une planche coupée de travers, d'un pouce & demi d'épaisseur, & il est épais de planches épaisses d'un pouce.
Le dos d'âne n'est pas d'usage pour tous les vaisseaux. Voyez la manuelle cotée 81. fig. 1. Planc. IV. (Z)
Dos, (Manege.) Le dos du cheval va depuis le garrot jusqu'aux reins ; c'est la partie du corps du cheval, sur laquelle on met la selle. Voyez Garrot.
Monter un cheval à dos ou à dos nud, c'est le monter à poil & sans selle.
* Dos, (Arts & Métiers.) terme relatif à devant, & quelquefois synonyme à derriere. Il a d'autres corrélatifs, comme tranche ; car on dit le dos & la tranche d'un livre ; tranchant, car on dit le dos & le tranchant d'un rasoir, &c. On apprend à connoître ces corrélatifs par l'usage. Il faut seulement observer en général, que dans toutes les occasions où l'on distingue les côtés par des noms différens, & où l'on donne à l'un de ces côtés le nom de dos ; ce côté appellé dos est toûjours l'opposé de celui où l'on a pratiqué une des formes principales & remarquables de la chose.
Dos, (Manuf. en laine.) on dit mieux faîte : c'est dans une étoffe le côté opposé aux lisieres.
Wiktionnaire
Nom commun - français
dos \do\ masculin
-
(Anatomie) Partie du corps humain située au-dessus du postérieur, depuis le cou jusqu'aux reins.
- Tandis que j'arrondis le dos en m'inclinant, elle m'honore d'un salut de tête qui ne met en jeu que les vertèbres de son long cou, [?]. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre III, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
- Je demeurai couché sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. ? (Henry Miller, L'ancien combattant alcoolique au crâne en planche à lessive, dans Max et les Phagocytes, traduction par Jean-Claude Lefaure, éditions du Chêne, 1947)
-
Partie équivalente au dos humain du corps de certains animaux.
- Il leur suffisait [?] de passer la main sur le dos d'une vache pour que le lait tournât en urine. ? (Octave Mirbeau, Rabalan,)
-
Envers, partie de certaines choses qui, par sa destination, par sa position ou par sa forme, offre quelque rapport avec le dos de l'homme ou de l'animal.
- Le dos d'un habit, d'une robe, partie d'un habit, d'une robe qui sert à couvrir le dos;
- Le dos d'une chaise, d'un fauteuil, etc., partie d'une chaise, etc., contre laquelle on s'appuie le dos.
- Le dos d'un livre, partie opposée à la tranche et sur laquelle on met ordinairement le titre.
- Dos brisé, reliure faite de telle sorte que le livre que l'on ouvre ne se referme pas de lui-même.
- Le dos d'un papier, d'un billet, d'un acte, etc., le revers.
- Mettre sa signature au dos d'un chèque.
- Le dos de la main, côté extérieur de la main, opposé à la paume de la main.
-
(Natation) Dos crawlé (style de nage).
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
- (Armement) Partie opposée au tranchant d'une lame, qui porte généralement les inscriptions indiquant le nom du fournisseur de l'arme.
- (Bibliothéconomie) Côté du livre où se trouve la reliure. À ne pas confondre avec la quatrième de couverture.
-
(Argot) (Désuet) Proxénète.
-
Puis, déguerpissant tour à tour,
Chaque dos rentre sa marmite,
Compte la braise et fait l'amour ! ? (Georges Gillet, dans Le Fin de siècle du 20 juin 1891, page 2) - [?] mais qu'un mec se soit appelé un dos, un poisse et, plus tard, un hareng, ça ne change rien à son état civil. ? (Francis Carco, Messieurs les vrais de vrai, Les Éditions de France, Paris, 1927)
-
Puis, déguerpissant tour à tour,
-
(Sports hippiques) Dans une course hippique, espace situé derrière un cheval, sillage.
-
avoir le dos de
- être dans le sillage de
-
prendre le dos de
- se mettre dans le sillage de
-
offrir son dos
- se présenter devant
-
avoir le dos de
Trésor de la Langue Française informatisé
DOS, subst. masc.
Dos au Scrabble
Le mot dos vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot dos - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot dos au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
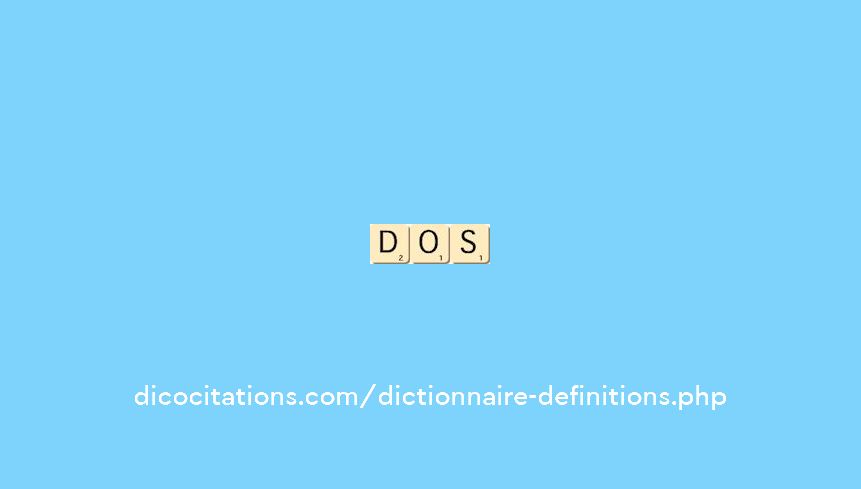
Les mots proches de Dos
Dos Dosable Dose Doser Dossage Dosse Dosseret Dossier Dossière dos dos-d'âne dosage dosages dosaient dosais dosait dosant Dosches dose dose dosé dosée dosées dosent doser doses doses dosés doseur doseurs dosimètre Dosnon Dossainville dossard dossards Dossenheim-Kochersberg Dossenheim-sur-Zinsel dosseret dossier dossière dossières dossiers dostoïevskiensMots du jour
-
condamneraient chassées différemment tangibles noisette australiennes éconduis tonnelier tripangs arabique
Les citations avec le mot Dos
- Regarde tes terreurs en face ou elles grimperont dans ton dos.Auteur : Frank Herbert - Source : Dune (1965)
- J'ai un faible pour les négresses au dos luisant comme un boa.Auteur : Claude Nougaro - Source : Des goûts et des couleurs
- Et furent les uns tuez par les ennemis qu'ilz avoient à dos, les autres par entre eux mesmes.Auteur : Jacques Amyot - Source : Nicias, 39
- Quand on avance vers l'ennemi, on ne meurt pas de deux balles dans le dos.Auteur : Pierre Lemaitre - Source : Au revoir là-haut (2013)
- Il faut savoir supporter la vérité, à petite dose ce n'est pas mortel et ça immunise.Auteur : Roland Topor - Source : La Princesse Angine (1967)
- Il y a ici un vieux chat qui ne joue plus, qui ne fait plus le gros dos et qui se sauve, quand il voit un enfant: voilà l'expérience.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Journal tome 1, juin 1859
- Il feuilleta le livre avec dévotion et se dit qu’il y avait quelque chose d’humain dans cet objet : il avait un pied, un dos, une odeur, une peau et, quand on en tournait les pages, une voix.
Auteur : Alexandre Najjar - Source : Kadicha (2011)
- Le cinéma occupe une place singulière dans l'industrie, celle d'une économie de prototypes. Autrefois un solide pifomètre, une bonne dose d'expérience et la place privilégiée du cinéma comme divertissement familial laissaient une certaine marge d'erreur et de folie aux créateurs et aux producteurs. Depuis l'arrivée de la télévision, l'éclosion des technologies nouvelles et des groupes intégrés, le modèle industriel prévaut de plus en plus. On assiste à une rationalisation des modes de fabrication du domaine audiovisuel, le cinéma n'en étant plus qu'une branche. Ainsi, on a assisté à l'apparition d'une tendance lourde au management. On a vu débarquer des contrôleurs de gestion, des comptabilités analytiques, et toute une batterie d'économies d'échelle et de standards de financement : bref, l'industrie a soufflé dans les bronches du petit peuple des artistes. Auteur : Jean-Jacques Beineix - Source : Les Chantiers de la gloire (2006)
- Je considère Ombre est Lumière comme l’album emblématique de l’esprit IAM. Il est le fondement et la base du groupe. Comme De la planète Mars, il s’illustre par son dosage savant d’humour et de textes engagés, contre le racisme ordinaire, la délinquance en col blanc, ou bien le fondamentalisme religieux.
Mais dans ce disque nous avons choisi d’élargir notre propos. Avec Joe, nous écrivons souvent nos textes intimistes sur le registre du storytelling, cette manière de raconter les histoires caméra à l’épaule.Auteur : Philippe Fragione, dit Akhenaton - Source : La Face B, Akhenaton, éd. Don Quichotte, 2010
- Auvers sur Oise : Village d'Ile de France qui fut fatal à Van Gogh, mort d'une Auvers dose.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Je ne puis pas oublier la misère de ce temps, - O siècle pareil à ceux qui campèrent sous les tentes! ... - Peu à peu notre destin nous ruisselle sur le dos.Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Ode génoise (1924)
- Celui qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si les autres lui grimpent sur le dos.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- La Fortune se lasse de porter toujours un même homme sur son dos.Auteur : Baltasar Gracián y Morales - Source : Maximes de l'homme de cour (1647)
- Pascal, Dostoïevski, Nietzsche, Baudelaire - tous ceux dont je me sens près ont été des malades.Auteur : Emil Cioran - Source : Cahiers, 1957-1972 (1997)
- Aussi perçante soit ta vue, tu ne peux te voir de dos.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- Jusque-là, l'idée que je me faisais du «temps» avait quelque chose d'extraordinairement enfantin. Je ne connaissais pas encore cette impression torturante du «temps» qui, dans votre dos, vous vrille du regard et, en avant, vous tend une embuscade.Auteur : Kenzaburo Oe - Source : Dites-nous comment survivre à notre folie (1982)
- L'autre vaut toujours mieux que l'étiquette que nous lui collons sur le dos.Auteur : Tim Guénard - Source : Plus fort que la haine (1999)
- Le discours est comme un remède, une petite dose guérit, une forte dose tue.Auteur : Hazrat Ali-ul-Murtaza - Source : Proverbes et sentences
- Le rapport de forces entre la défense et les juges est, finalement, une affaire de dosage. Il faut trouver la bonne distance, celle qui bénéficiera à l'accusé.Auteur : Eric Dupond-Moretti - Source : Bête noire (2012)
- Un poison violent, c'est ça l'amour
Un truc à n'pas dépasser la dose.Auteur : Serge Gainsbourg - Source : Anna (1967), Un poison violent c'est ça l'amour - Il faut se laisser dépasser par les événements, ça permet de les voir de dos.Auteur : Grégoire Lacroix - Source : Les euphorismes de Grégoire (2007)
- Vêtue de noir, énorme, le dos rond, on eût dit qu'elle dialoguait avec le feu dont le murmure répondait au sien.Auteur : Julien Green - Source : Léviathan (1929)
- L'enfant poussa la grille, son petit cartable brinqueballant sur son dos, puis il s'arrêta au seuil du parc.Auteur : Marguerite Duras - Source : Moderato Cantabile (1958)
- Décidément, il n'y a pas grand-chose à faire avec les poètes!... Les yeux fixés sur le passé, vous tournez le dos à l'avenir... Vous parlez de liberté... et vous êtes esclave d'une rime... Vous ne voyez jamais que ce que vous voulez voir...Auteur : Sacha Guitry - Source : Béranger
- Docile et solide en amour ces mots se tournent le dos.Auteur : Guénane Cade - Source : Couleur Femme (2007)
Les citations du Littré sur Dos
- Et pour toute vertu fit au dos d'un carrosse, à côté d'une mitre armorier sa crosseAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. VI
- Un dosin d'avaine [une certaine mesure]Auteur : DU CANGE - Source : dosinus.
- Il [Théodose] faisait chercher des gués et faire des ponts avec une diligence incroyableAuteur : FLÉCH. - Source : Hist. de Théodose, III, 94
- Théodose, apprenant ces heureuses nouvelles, leva les mains au cielAuteur : FLÉCH. - Source : Hist. de Théod. III, 113
- Les premiers fourmis chargent ce ver sur leur dosAuteur : MONT. - Source : II, 179
- Ce qui constitue la reliure, c'est la couture et l'endossementAuteur : LESNÉ - Source : la Reliure, p. 152
- Après avoir saigné et pellé le pourceau, ils lui couppent la teste et les quatre jambes, pour en faire des jambons : est fendu de long en long par le dos, puis est eventré. les intestins sont emploiés avec le sang.... Le lard est divisé en trois parties : le ventre et les deux espisAuteur : O. DE SERRES - Source : 838
- Que chacun endosse son armure et place devant lui son bouclierAuteur : CHATEAUBR. - Source : Desthona, 233
- L'Indostan, si l'on en excepte un petit nombre de lieux ingrats et sablonneux, est encore le pays le plus fertile du mondeAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. I, 7
- Cependant sur le dos de la plaine liquide S'élève à gros bouillons une montagne humideAuteur : Jean Racine - Source : Phèdre, V, 6
- Et y mettoient grans doubtes aucuns, veu que à leurs dos n'avoyent nulles places pour eux retirerAuteur : COMM. - Source : I, 2
- Autrefois [dans le comté de Nice] on employait trois systèmes principaux de vidange : 1° le petit flottage pour les billots ; 2° la découpe sur place et le transport à dos de mulet pour les planches et chevrons ; 3° le traînage et le grand flottage pour les poutresAuteur : L. GUIOT - Source : Mém. Soc. centr. d'Agr. 1874, p. 173
- Il faut lui passer doucement l'estrille, le peigne, l'espoussete et le bouchon sur le dosAuteur : O. DE SERRES - Source : 306
- Le roy m'apela là où je me seoie avec les riches hommes du pays, de là en un prael, et me fist le dos tourner vers eulzAuteur : JOINV. - Source : 289
- ....Suivaient de loin deux grisons bien dispos, Non des grisons de l'espèce indolente De celui-là qui porta sur son dos Le palfrenier du fameux Rossinante ; C'étaient vraiment bien d'autres animaux.... deux cordeliersAuteur : PIRON - Source : Le Moine bridé, conte.
- Vois-tu ce petit trait de feinte que voilà ? Ce fleuret ? ces coupés courant après la belle ? Dos à dos, face-à-face, en se pressant sur elle ?Auteur : Molière - Source : Fâch. I, 5
- Ils prennent armes en dos [ils endossent]Auteur : MONT. - Source : II, 275
- Boghan est un petit village entièrement arabe, cramponné sur le dos d'un mamelon soleilleux et toujours arideAuteur : FROMENTIN - Source : Un été dans le Sahara, p. 27
- Et [je] vi qu'à ceste vesteüre N'auroie pain n'endosseüre [vêtement pour le dos]Auteur : RUTEB. - Source : II, 74
- Les Morvandiaux sont bons soldats ; conscrits, ils quittent leurs chères montagnes avec regret ; mais à peine ont-ils posé leurs sabots et endossé l'habit militaire....Auteur : DUPIN - Source : Morvand, p. 24
- Qui prenaient, sur le dos de leurs chaises, de ces postures aisées et galantes qui marquent qu'on est au fait des bons airsAuteur : MARIVAUX - Source : Marianne, 2e part.
- Il [le loup] s'habille en berger, endosse un hoqueton, Fait sa houlette d'un bâton, Sans oublier la cornemuseAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. III, 3
- S'il ne l'eust requis de la vie, il l'eust assommé de l'ast, mais il n'en endossa seulement que trois ou quatre coups, le laissant en un très piteux estatAuteur : CARL. - Source : VI, 5
- Qu'il [Dieu] donne une dose de patience au delà de l'ordinaire à ce pauvre chevalierAuteur : Madame de Sévigné - Source : 27 sept. 1687
- La réunion de toutes les douelles intérieures forme l'intrados, et celle de toutes les douelles extérieures est appelée l'extrados de la voûteAuteur : LEGOARANT - Source :
Les mots débutant par Dos Les mots débutant par Do
Une suggestion ou précision pour la définition de Dos ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 23h55
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur dos
Poèmes dos
Proverbes dos
La définition du mot Dos est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Dos sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Dos présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
