Définition de « son »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot son de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur son pour aider à enrichir la compréhension du mot Son et répondre à la question quelle est la définition de son ?
Une définition simple : (fr-accord-mixte|p=ses|fs=sa|pms=s??|pfs=sa|pp=s?)
Expression : ° sonunda : finalement. - Campardon sonunda servis merdivenine biti?ik bir kap?n?n önünde durdu. Campardon finalement s’arrêta devant une porte qui donnait sur l’escalier de service. - Zola. Pot-bouille. Traduction de Bekir Karao?lu.
Approchant : abat-son, assonance, assonant, assoner, infrason, infra-son, infrasonore, infra-sonore, insonore, insonorisation, insonoriser, insonorité, présonoriser, résonnance, résonnant, résonner
Définitions de « son »
Trésor de la Langue Française informatisé
SON1, SA, SES, adj. poss.
[Déterm. du subst. ayant d'une part une fonction d'actualisation comparable à celle de l'art. le, la, les et renvoyant, d'autre part, par anaphore au possesseur de 3epers. Comme déterm., il s'accorde en genre (son, sa) et en nombre (ses) avec le subst. du groupe nom.; comme élém. anaphorique, il marque le nombre du possesseur (son, sa, ses p. oppos. à leur, leurs)]SON2, subst. masc.
SON3, subst. masc.
Wiktionnaire
Adjectif possessif - français
son \s??\ masculin singulier
-
Troisième personne du sujet, objet masculin singulier.
- J'ai lu son livre.
- Son coup droit fait mal.
-
(Familier) Indique des rapports d'habitude, de connaissance, etc.
- Voilà son public.
- Posséder son Homère.
- Il sait bien son arithmétique.
-
Joint aux verbes « sentir, faire » dans le langage familier, il renforce le sens de la phrase.
- Il sent son homme de qualité ; il sent son hypocrite.
- Il fait son malin.
son féminin singulier
- Forme supplétive de sa, utilisée quand la chose possédée est au féminin, pour effectuer une liaison obligatoire avec le mot suivant qui commence par une voyelle ou un h muet.
- Une ville, sa ville ; une île, son île.
- Une maison, sa maison, son immense maison.
Nom commun 1 - français
son \s??\ masculin
- Quelque chose que l'on peut écouter ou entendre.
- Tout à coup, comme si le son s'évadait brusquement du tournant de la montagne, on entendit des voix hurlantes, beuglant de tous leurs poumons, aussi faux que possible. ? (Louis Pergaud, Le retour, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
- Au bord même de notre abri, un 88 dirigeait son tir foudroyant ; tous les combattants connaissent cette pièce autrichienne dont le projectile arrive plus vite que le son. ? (Alain, Souvenirs de guerre, page 207, Hartmann, 1937)
- Depuis l'Argonne de 1914, [?] je n'ai pas l'oreille si mal bâtie que d'avoir, en vingt et un ans, oublié l'art d'apprécier au son la trajectoire d'un obus et le point de chute probable. ? (Marc Bloch, L'étrange défaite : La déposition d'un vaincu, 1940, FolioHistoire Gallimard, 1990, page 86)
- J'éduquais mon oreille à traduire des multitudes de sons infimes, petits trots de souris et grincements de bois, [?]. ? (Claude Collignon, L'?il de la chouette, Éditions du Seuil, 1988, page 41)
- (Par extension) ? Cet animal s'oriente dans l'espace par écholocation : il émet des sons de très haute fréquence et utilise l'écho renvoyé par les obstacles ou les proies pour les localiser. ? (Olivier Raurich, Science, méditation et pleine conscience, Chêne-Bourg : Jouvence Éditions, 2017)
-
(En particulier) Bruit harmonieux produit par un instrument de musique, caractérisé par un timbre et représenté par une note.
- Oh ! les chastes églogues ! Oh ! les idylles chantées par les poètes ! Oh ! les paysanneries enrubannées et naïves qui défilent, conduites par la muse de Mme Deshoulières, au son des flageolets et des tambourins ! ? (Octave Mirbeau, Le Tripot aux champs, Le Journal, 27 septembre 1896)
- Il ne savait aucune des paroles du grand choral de Luther, mais il ouvrait toute grande sa bouche et émettait des sons vastes, graves et partiellement harmonieux? ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 263 de l'édition de 1921)
- La texture des sons elle-même ne ressemblait à rien. Elle n'avait pas, comme le violon, les gémissements de la voix humaine, ne bôombait pas à la manière des profonds tambours qui s'apparentent aux cloches ni ne tintait, même dans les aigus, comme les sonnailles. ? (Bruno Nassim Aboudrar, Ici-bas, Éditions Gallimard, 2009, p. 256)
-
(Linguistique) Phone.
- Le phonème \r\ par exemple correspond aux sons : [r], [?], [?], [?], [?], [?], etc.
Nom commun 2 - français
son \s??\ masculin
-
(Meunerie) Résidu de la mouture du blé et d'autres céréales, provenant du péricarpe des grains.
- Si l'on écrase entre deux pierres des grains de blé, l'enveloppe corticale de chaque grain est brisée, et les débris, qui portent le nom de son, se mêlent à la farine provenant de la trituration de la partie intérieure ; comme cette dernière est plus fine il suffit d'un tamisage pour la séparer du son. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 107)
- Nous nous en allions, quand nous apercevons une petite boutique en plein vent, une charmante boutique d'objets à 0,50 franc : glaces de poche, images, bonbons, bagues en or, colliers blancs ou roses, tous perdus dans des tas de son, et on farfouille dedans comme on veut. ? (Colette Vivier, La maison des petits bonheurs, 1939, éd. Casterman Poche, page 168.)
- Du fait de la richesse en cellulose (35%), le son est un bon laxatif mécanique, mais il peut irriter l'intestin de certains malades.? (François Couplan, Le Régal végétal, 2015, page 127)
-
(Par analogie) (Familier) Déchets de bois produits lorsque l'on scie, sciure.
- Le poète reparut dans l'amant, il replaçait sur un piédestal de déesse la poupée dont il avait entrevu le son sous la couverte de peau rose. ? (Joris-Karl Huysmans, Marthe, 1876)
Adjectif - ancien français
son \Prononciation ?\ masculin
- Son, à lui, à elle, à soi (etc).
Préposition - ancien français
son \Prononciation ?\
- Variante de segont.
Nom commun 2 - ancien français
son \Prononciation ?\ masculin
- Variante de saon.
Nom commun 1 - ancien français
son \Prononciation ?\ masculin
-
Son, chant, musique.
- De lor douz sons e de lor chant ? (Le Roman de Troie, édition de Constans, tome IV, page 230, c. 1165)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
, qui répond au pronom de la troisième personne Il, se, soi. On le met toujours devant le nom ou l'adjectif qui précède le nom. Son père. Son argent. Son honneur. Son premier livre. Il fait au féminin SA. Sa sœur. Sa patrie. Sa honte. Mais lorsque le nom ou l'adjectif féminin devant lequel il est placé commence par une voyelle ou une h muette, au lieu de Sa on dit Son. Son amitié. Son habitude. Son excellente amie. Il fait au pluriel SES pour les deux genres. Ses biens, ses amis, ses prétentions. Il s'emploie familièrement pour indiquer des rapports d'habitude, de connaissance, etc. Voilà son public. Il connaît ses auteurs. Posséder son Homère. Il sait bien son arithmétique. Joint aux verbes Sentir, Faire, dans le langage familier, il renforce le sens de la phrase. Il sent son homme de qualité; il sent son hypocrite. Il fait son malin.
Littré
SA (sa), f. sing. SES (sê, l's se lie?: sê-z amis), pluriel des deux genres. Adjectif possessif qui répond aux pronoms de la 3e personne du singulier, il, elle, soi, se.
-
1Il détermine le nom, en y ajoutant une idée de possession. Son père. Sa mère. Ses cousins.
Chacun, à ses périls et fortune, peut croire tout ce qu'il lui plaît
, Molière, Mal. imag. III, 3.Nul homme n'est à soi-même sa raison, sa lumière, sa sagesse?; si ce n'est peut-être lorsque sa raison est une raison particulière, sa lumière une fausse lueur, sa sagesse une folie
, Malebranche, Rech. vér. éclair. liv. I, t. IV, p. 91, dans POUGENS.Cette femme qui prenait le temps de demander son masque, lorsqu'elle l'avait sur son visage
, La Bruyère, XI.La peine a ses plaisirs, le péril a ses charmes
, Voltaire, Henr. IV.Il faut que chaque parti ait son fou, comme autrefois chaque parti avait son chansonnier
, Voltaire, Lett. Damilaville, 15 oct. 1766.Rien de Robert ne me plaît que lui-même?; C'est sa valeur et ses grâces que j'aime
, Voltaire, Ce qui plaît aux dames.Les lacs ont leurs oiseaux, la mer a ses serpents, Et ses poissons ailés et ses poissons rampants
, Delille, Trois règnes, VIII.
PROVERBE
À chaque jour suffit sa peine. -
2Dans des cas rares, où un verbe à l'infinitif donne quelque chose de général à la phrase, on peut mettre son, sa, ses, bien que le verbe principal ne soit pas à la 3e personne.
Je trouve fort triste de vivre et de mourir sans son archevêque
, Maintenon, Lett. au card. de Noailles, 24 oct. 1700.Dans des cas encore plus rares et qui ne sont pas à imiter, son se rapporte à un possesseur vague qui n'est pas nommé.
Le meilleur de tous les biens, s'il y a des biens, c'est le repos, la retraite et un endroit qui soit son domaine
, La Bruyère, De la cour. Il faudrait?: qui soit notre domaine. -
3Dans le langage familier, son, sa, ses, joint au verbe sentir, équivaut à l'article.
? pour me l'amener tu t'en vas en personne? N'envoyer qu'un valet sentirait son mépris
, Corneille, le Ment. IV, 4.Un vieux renard, mais des plus fins,? Sentant son renard d'une lieue
, La Fontaine, Fabl. V, 5.La ballade, à mon goût, est une chose fade?; Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps
, Molière, Fem. sav. III, 5.Cela sent son vieillard, qui, pour s'en faire accroire, Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire
, Molière, Éc. des maris, I, 1.Comme le vrai mérite a ses prérogatives? cette phrase, ce comme ne conviennent pas à Pompée?; cela sent trop son rhéteur
, Voltaire, Comm. Corn. Rem. Sertor. III, 2.Sa conversation, non moins instructive qu'amusante, ne sentait point son curé de village
, Rousseau, Conf. X. -
4Posséder son Homère, son Cicéron, ses auteurs anciens, connaître bien Homère, Cicéron, les auteurs anciens, etc.
Il savait Rabelais et son saint Augustin
, Voltaire, Marseill. et Lyon.Il n'avait en littérature qu'une légère superficie, il ne savait que son Ovide
, Marmontel, Mém. VI.On dit de même?: il possède bien son arithmétique.
Pontchartrain était appliqué, sachant bien sa marine, assez travailleur
, Saint-Simon, 305, 233. -
5Quelquefois son, sa, ses a une signification méprisante et de reproche.
M. Burnet me passe tous les faits que j'ai rapportés sur la réforme anglicane et sur son Cranmer, aussi bien que sur ses autres héros, sans en contredire aucun
, Bossuet, Déf. Var. 1er disc. 31. - 6Son, sa, ses, placés devant les adverbes comparatifs, forment un superlatif. Son plus riche habit. Sa moins belle robe.
- 7Son, quoique masculin, se dit au féminin devant un nom commençant par une voyelle ou une h muette?: son âme, son épée, son héroïne. Ce solécisme, qui est passé dans l'usage, n'était pas commis par nos aïeux, qui disaient en élidant l'a comme dans l'article?: s'ame, s'espée?; ce n'est qu'au XIVe siècle qu'il a commencé à s'introduire.
REMARQUE
1. La règle générale est d'employer l'adjectif son, sa, ses, lorsqu'on parle des personnes ou des choses personnifiées, c'est-à-dire auxquelles on attribue des vues et une volonté. Hors ces cas, il vaut mieux employer en. Au lieu de dire?: Le soin qu'on apporte au travail empêche de sentir sa fatigue?; dites?: d'en sentir la fatigue. Cependant ce n'est point une loi grammaticale qui y oblige, c'est la clarté et l'élégance, et plus d'une fois les écrivains s'en sont départis. J'ai honte de ma vie, et je hais son usage, Depuis que je la dois aux effets de ta rage
, Corneille, Méd. III, 3. On ne peut d'ailleurs qu'user de son, sa, ses quand le nom est en complément indirect, comme ici?: Lysidas [parlant de sa pièce]?: Tous ceux qui étaient là doivent venir à sa première représentation
, Molière, Critique, 7.
2. Pour l'emploi de son, sa, ses avec chacun, voy. CHACUN, Rem. 1.
HISTORIQUE
IXe s. Si Lodhwigs sagrament que son fradre Karlo jurat, conservat?
, Serment. Et Karlus meos sendra [mon seigneur], de suo part?
, ib.
Xe s. Un edre [un lierre] sore sen cheve [tête] Frag. de Valenc. p. 468. Mult laetatus, por que Deus cel edre li donat à sun soueir e à sun repausement
, ib. Ne aiet niuls male voluntatem contra sem peer
, ib. p. 469. Elle ent adunet [abandonne] lo suon element [doctrine]
, Eulalie. Qu'elle perdesse sa virginitet
, ib. Par souue clementia
, ib.
XIe s. D'icez sons sers [de ces siens serfs]
, St Alexis, XX. Se [il] mesfeist as homes de sa baillie
, Lois de Guill. 2. Serez ses hom [son homme] par honur et par bien
, Ch. de Rol. III. Li reis est fiers, et sis curages pesmes
, ib. IV.
XIIe s. [Que je] Ne puisse assez li [elle] et s'amor servir
, Couci, XI.
XIIIe s. En terre sen fil [son fils] [il] envoia, Qui aveques nous conversa
, St Graal, V. 2183. En son lit en seant [elle] prist ses heures à dire
, Berte, XI. Mal lui monstrons semblant que soions si ami
, ib. LXXI. Et l'apostoles li manda qu'il sermonnast de la croix par s'auctorité
, Villehardouin, I. Savés-vous qui estoit s'amie?? la Rose, 835 Dieu, en qui il mist sa fiance, le gardoit touz jours dès s'enfance
, Joinville, 201.
XIVe s. Cest os ou son extremité vers la jointure du coude
, H. de Mondeville, f° 21. Comme il se feist voie parmi la tourbe avecques son espée
, Bercheure, f° 32, recto. Son ire croissoit
, Bercheure, f° 40, verso. Il avoit defraudé son esperance
, Bercheure, f° 24, verso. Et doit icellui pecheur dire tout ce qui peut grever son ame
, Ménagier, I, 3.
XVe s. Du temps de ses feu pere et mere
, Louis XI, Nouv. X.
XVIe s. Et ayme mieux en s'amour avoir peine, Que sans s'amour avoir liesse plaine
, Marot, II, 375. Sy luy dirois la peine que j'endure Pour son amour, et elle orroit ma plaincte
, Marot, I, 376. Ce disant, Dindenault desguainoyt son espée
, Rabelais, Pant. IV, 5. Il tua son homme en ce mesme combat
, Montaigne, III, 296. La foy prend son commencement, accroissement et perfection de la parole
, Calvin, Instit. 1034. ? que la loy n'a de rien profité à ses observateurs
, Calvin, ib. 1045. Au gentilhomme bien né, son estude, exercice et plaisir, doit estre en toutes les vertus
, Lanoue, 201. Ainsi qu'on void avenir à une lanterne?: car plus sa vitre est claire, plus sa lumiere interieure s'apperçoit
, Lanoue, 531. Il commencea à user d'une franchise de parler, qui sentoit plus son accusateur que sa libre defense
, Amyot, Cor. 26.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. SON. - REM. Ajoutez?:3. Cet adjectif possessif peut se dire avec un substantif composé. Son contrains-le [de l'Évangile]?
, Voltaire, Philos. Déf. de Milord Bolingbroke, XXXII.
HISTORIQUE
VIIIe s. Per sa preceptione, pour?: per suam praeceptionem (716), dans JUBAINVILLE, De la déclinaison latine en Gaule à l'époque mérovingienne, p. 96.
Encyclopédie, 1re édition
Son, s. m. (Phys.) est une perception de l'ame qui lui est communiquée par le secours de l'oreille : ou bien c'est un mouvement de vibration dans l'air, qui est porté jusqu'à l'organe de l'ouie. Voyez Ouie.
Pour éclaircir la cause du son, nous observerons, 1°. que pour produire le son, il faut nécessairement du mouvement dans le corps sonore.
2°. Que ce mouvement existe d'abord dans les parties déliées & insensibles des corps sonores, & qu'il y est excité par leur choc & leur collision mutuelle, ce qui produit ce tremblement qui est si facile à remarquer dans les corps qui rendent un son clair, comme les cloches, les cordes des instrumens de musique, &c.
3°. Que ce mouvement se communique à l'air, ou produit un mouvement semblable dans l'air ou dans autant de ses parties qu'il y en a de capables de le recevoir & de le perpétuer ; d'autant plus que le mouvement des corps qui sont à quelque distance, ne peut point affecter nos sens sans la médiation d'autres corps qui reçoivent ces mouvemens du corps sonore, & les communiquent immédiatement à l'organe.
Enfin que ce mouvement doit être communiqué aux parties qui sont les instrumens propres & immédiats de l'ouie.
De plus, ce mouvement d'un corps sonore qui est la cause immédiate du son, doit être attribué à deux causes différentes ; ou au choc de ce corps & d'un autre corps dur, comme dans les tambours, les cloches, les cordes d'instrumens, ou bien au battement & au frottement du corps sonore & de l'air l'un contre l'autre immédiatement, comme dans les instrumens à vent, les flutes, les trompettes, &c.
Mais dans l'un & dans l'autre cas, le mouvement qui est la suite de cette action mutuelle, & la cause immédiate du mouvement sonore, que l'air porte jusqu'à l'oreille, est un mouvement presque insensible, qui se fait remarquer dans les parties déliées & insensibles du corps par un tremblement & des ondulations.
Pour expliquer ce méchanisme, on suppose que tous les corps sensibles sont composés d'un nombre de parties petites & insensibles, ou corpuscules parfaitement durs & incapables d'être comprimés. Voyez Corpuscule.
Ces parties en composent d'autres un peu plus grandes, mais encore insensibles ; & celles-ci different entre elles, selon les différentes figures & l'union des parties qui les composent. Celle-ci constituent encore d'autres masses plus grandes & beaucoup plus distinguées des premieres : & des différentes combinaisons de ces dernieres, sont composés ces corps grossiers qui sont visibles & palpables, &c.
Les premieres & les plus petites parties, comme nous l'avons observé, sont absolument dures ; les autres sont compressibles & unies de telle sorte, qu'étant comprimées par une impulsion extérieure, elles ont une force élastique ou restitutive, au moyen de de laquelle elles se rétablissent d'elles-mêmes dans leur premier état. Voyez Élasticité.
Lors donc qu'un corps en choque un autre, les petites particules par leur force élastique se meuvent avec une grande vîtesse, avec une sorte de tremblement & d'ondulations, comme on l'observe facilement dans les cordes des instrumens de musique, & c'est ce mouvement sonore qui est porté jusqu'à l'oreille ; mais il faut observer que c'est le mouvement insensible de ces particules, qu'on suppose être la cause immédiate du son ; & même parmi celles-là, il n'y a que celles qui sont proches de la surface, qui communiquent avec l'air ; le mouvement du tout ou des parties plus grandes, n'y servant qu'autant qu'il le communique aux autres.
Pour faire l'application de cette théorie, frappez une cloche avec quelque corps dur, vous appercevrez aisément un trémoussement sensible sur la surface qui se répand de lui-même sur le tout, & qui est d'autant plus sensible, que le choc est plus fort. Si on y touche dans quelqu'autre endroit, le tremblement & le son cesse aussi-tôt ; ce tremblement vient sans doute du mouvement des particules insensibles qui changent de situation, & qui sont en si grande quantité & si serrées les unes contre les autres, que nous ne pouvons pas appercevoir leurs mouvemens séparément & distinctement, mais seulement un espece de tremblement ou d'ondulation.
Le corps sonore ayant fait son impression sur l'air contigu, cette impression est continuée de particule en particule, suivant les lois de la pneumatique. Voyez Onde & Ondulation.
Les sons varient à-proportion des moyens qui concourent à leur production ; les différences principales résultent de la figure & de la nature du corps sonore ; de la force, du choc, de la vîtesse, &c. des vibrations qui se suivent ; de l'état & constitution du milieu ; de la disposition, distance, &c. de l'organe ; des obstacles qui se rencontrent entre l'organe, le corps sonore & les corps adjacens. Les différences les plus remarquables des sons, naissent des différens degrés & combinaisons des conditions dont nous venons de parler ; on les distingue en fort & foible, en grave & aigu, long & court.
La vîtesse du son ne differe pas beaucoup, soit qu'il aille suivant ou contre la direction du vent. A la vérité le vent transporte une certaine quantité d'air d'un lieu à un autre, & le son est accéléré tandis que ses vagues se meuvent dans cette partie d'air, lorsque leur direction est la même que celle du vent. Mais comme le son se meut avec beaucoup plus de vîtesse que le vent, l'accélération qu'il en reçoit est peu considérable. En effet, la vîtesse du vent le plus violent que nous connoissions, est à la vîtesse du son comme 1 est à 33 : & tout l'effet que nous appercevons que le vent peut produire, est d'augmenter ou de diminuer la longueur des ondulations ; de sorte qu'au moyen du vent, le son puisse être entendu d'une plus grande distance qu'il ne le seroit autrement.
Que l'air soit le milieu ordinaire du son, c'est ce qui résulte de plusieurs expériences qui ont été faites, soit dans un air condensé, soit dans l'air rarefié. Dans un récipient qui n'est point vuide d'air, une petite sonnette se fait entendre à quelque distance ; mais quand on en a pompé l'air, à-peine l'entend-on tout auprès : si l'air est condensé, le son sera plus fort à-proportion de la condensation ou de la quantité d'air pressé. Nous en avons plusieurs exemples dans les expériences de M. Hauksbée.
Mais l'air n'est pas seul capable des impressions du son, l'eau l'est aussi, comme on le remarque en sonnant une sonnette dans l'eau ; on en distingue pleinement le son : à la vérité il n'est pas si fort & plus bas d'une quarte, au jugement des bons musiciens. Mersene dit qu'un son produit dans l'eau paroît de même, que s'il étoit produit dans l'air & entendu dans l'eau. M. l'abbé Nollet a fait sur les sons entendus dans l'eau, plusieurs expériences curieuses. Mém. académ. 1741.
Le célebre M. Newton a donné à la fin du second livre de ses Principes, une théorie très-ingénieuse & très-savante des vibrations de l'air, & par conséquent de la vîtesse du son. Sa théorie est trop compliquée & trop géométrique pour être rendue ici ; nous nous contenterons de dire qu'il trouve la vîtesse du son par son calcul, à-peu-près la même que l'expérience la donne. Cet endroit des Principes de M. Newton, est peut-être le plus difficile & le plus obscur de tout l'ouvrage. M. Jean Bernoully le fils, dans son Discours sur la propagation de la lumiere, qui a remporté le prix de l'académie des Sciences en 1736, dit qu'il n'oseroit se flater d'entendre cet endroit des Principes. Aussi nous donne-t-il dans la même piece, une méthode plus facile & plus aisée à suivre que celle de M. Newton, & par le moyen de laquelle il arrive à la même formule qu'a donnée ce grand géometre.
Un auteur qui a écrit depuis sur cette matiere, prétend qu'on peut faire contre la théorie de MM. Newton & Bernoully, une objection considérable ; savoir, que ces deux auteurs supposent que le son se transmet par des fibres longitudinales vibrantes, qui se forment successivement, & qui sont toujours égales entr'elles ; or cette hyppothèse n'est point démontrée, & ne paroît point même appuyée sur des preuves solides. Le même auteur prétend que dans cette hyppothèse, M. Bernoully auroit dû trouver la vîtesse du son, double de ce qu'il l'a trouvée, & de ce qu'elle est réellement. M. Euler dans sa Dissertation sur le feu, qui a partagé le prix de l'académie en 1738, a donné aussi une formule pour la vîtesse du son ; elle est différente de celle de M. Newton, & l'auteur n'indique point le chemin qui l'y a conduit.
Voici en général de quelle maniere se font les expériences pour mesurer la vîtesse du son. On sait par la mesure actuelle, la distance d'un lieu A, à un autre B. Un spectateur placé en B, voit la lumiere d'un canon qu'on tire au lieu A, & comme le mouvement de la lumiere est presque instantané à de si petites distances, le spectateur B compte combien il s'écoule de secondes depuis le moment où il voit la lumiere du canon, jusqu'à ce qu'il en entende le bruit. Divisant ensuite l'espace qui est entre les lieux A & B, par le nombre de secondes trouvé, il a le nombre de toises que le son parcourt en une seconde.
Le son se transmet en ligne droite ; mais il se transmet aussi en tout sens, & suivant toutes sortes de directions à la fois, quoiqu'avec moins de vîtesse. Cela vient de ce que le son se transmet par un fluide, & que les pressions dans un fluide, se propagent en tout sens ; la lumiere au contraire, ne se propage jamais qu'en ligne droite : c'est ce qui donne lieu de croire qu'elle n'est point causée par la pression d'un fluide. Sur la réflexion du son, voyez Echo & Cabinet secret. (O)
La vîtesse du son est différente, suivant les différens auteurs qui la déterminent. Il parcourt l'espace de 968 piés en une minute suivant M. Isaac Newton : 1300 suivant M. Robert : 1200 suivant M. Boyle : 1338 suivant le docteur Walker : 1474 suivant Mersenne : 1142 suivant M. Flamsteed & le docteur Halley : 1148 suivant l'académie de Florence, & 1172 piés suivant les anciennes expériences de l'académie des Sciences de Paris. M. Derham prétend que la cause de cette variété vient en partie de ce qu'il n'y avoit pas une distance suffisante, entre le corps sonore & le lieu de l'observation, & en partie de ce que l'on n'avoit pas eu égard aux vents.
M. Derham propose quelques-unes des plus considérables questions relatives aux lois du son, & répond à chacun avec exactitude, par les expériences qu'il a faites lui-même sur cette matiere.
Son, en Musique ; quand l'agitation communiquée à l'air par un corps violemment frappé parvient jusqu'à notre oreille, elle y produit une sensation qu'on appelle bruit. Mais il y a une espece de bruit permanent & appréciable qu'on appelle son.
La nature du son est l'objet des recherches du physicien ; le musicien l'examine seulement par ses modifications, & c'est selon cette derniere idée que nous l'envisageons dans cet article.
Il y a trois choses à considerer dans le son : 1, le degré d'élevation entre le grave & l'aigu : 2, celui de véhémence entre le fort & le foible : 3, & la qualité du timbre qui est encore susceptible de comparaison du sourd à l'éclatant, ou de l'aigu au doux.
Je suppose d'abord que le véhicule du son n'est autre chose que l'air même. Premierement, parce que l'air est le seul corps intermédiaire de l'existence duquel on soit parfaitement assuré, entre le corps sonore & l'organe auditif, qu'il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité, & que l'air suffit pour expliquer la formation du son ; & de plus, parce que l'expérience nous apprend qu'un corps sonore ne rend pas de son dans un lieu exactement privé d'air. Si l'on veut absolument imaginer un autre fluide, on peut aisément lui appliquer tout ce que nous avons à dire de l'air dans cet article.
La permanence du son ne peut naître que de la durée de l'agitation de l'air. Tant que cette agitation dure, l'air vient sans cesse frapper l'organe de l'ouie, & prolonge ainsi la perception du son : mais il n'y a point de maniere plus simple de concevoir cette durée, qu'en supposant dans l'air des vibrations qui se succédent, & qui renouvellent ainsi à chaque instant la sensation du son. De plus, cette agitation de l'air, de quelque espece qu'elle soit, ne peut être produite que par une émotion semblable dans les parties du corps sonore. Or c'est un fait certain que les parties du corps sonore éprouvent de telles vibrations. Si l'on touche le corps d'un violoncelle dans le tems qu'on en tire du son, on le sent frémir sous la main, & l'on voit bien sensiblement durer les vibrations de la corde jusqu'à ce que le son s'éteigne. Il en est de même d'une cloche qu'on fait sonner en la frappant du batant ; on la sent, on la voit même frémir, & l'on voit sautiller les grains de sable qu'on jette sur sa surface. Si la corde se détend ou que la cloche se fende, plus de frémissement, plus de son. Si donc cette cloche ni cette corde ne peuvent communiquer à l'air que les mouvemens qu'elles éprouvent elles-mêmes, on ne sauroit douter que le son étant produit par les vibrations du corps sonore, il ne soit propagé par des vibrations semblables, que le même instrument communique à l'air. Tout cela supposé, examinons ce qui constitue le rapport des sons du grave à l'aigu.
Théon de Smyrne témoigne que Lasus, de même que le pythagoricien Hypase de Métapont, pour calculer au juste les rapports des consonances, s'étoient servi de deux vases semblables & resonnans à l'unisson ; que laissant vuide l'un des deux, & remplissant l'autre jusqu'au quart, la percussion de l'un & de l'autre avoit fait entendre la consonance de la quarte ; que remplissant ensuite le second jusqu'au tiers, jusqu'à la moitié, la percussion des deux avoit produit la consonance de la quinte, puis celle de l'octave.
Pythagore, au rapport de Nicomaque & de Censorin, s'y étoit pris d'une autre maniere pour calculer les mêmes rapports. Il suspendit, disent-ils, différens poids aux mêmes cordes, & détermina les rapports des sons sur ceux qu'il trouva entre les poids tendans ; mais les calculs de Pythagore sont trop justes pour avoir été faits de cette maniere, puisque chacun sait aujourd'hui sur les expériences de Vincent Galilée, que les sons sont entr'eux, non comme les poids tendans, mais en raison sous-double de ces mêmes poids.
Enfin on inventa le monocorde, appellé par les anciens canon harmonicus, parce qu'il donnoit la régle de toutes les divisions harmoniques. Il faut en expliquer le principe.
Deux cordes de même métal, de grosseur égale, & également tendues, forment un unisson parfait, si elles sont aussi égales en longueur : si les longueurs sont inégales, la plus courte donnera un son plus aigu. Il est certain aussi qu'elle fera plus de vibrations dans un tems donné ; d'où l'on conclud que la différence des sons du grave à l'aigu, ne procede que de celle du nombre des vibrations faites dans un même espace de tems, par les cordes ou instrumens sonores qui les font entendre ; & comme il est impossible d'estimer d'une autre maniere les rapports de ces mêmes sons, on les exprime par ceux des vibrations qui les produisent.
On sait encore, par des expériences non moins certaines, que les vibrations des cordes, toutes choses d'ailleurs égales, sont toujours réciproques aux longueurs. Ainsi, une corde double d'une autre, ne fera dans le même tems que la moitié du nombre de vibrations de celle-ci, & le rapport des sons qu'elles rendront s'appelle octave. Si les cordes sont comme 2 & 3, les vibrations seront comme 3 & 2, & le rapport des sons s'appellera quinte, &c. Voyez au mot Intervalles.
On voit par-là, qu'il est aisé avec des chevalets mobiles, de former sur une seule corde des divisions qui donnent des sons dans tous les rapports possibles entre eux, & avec la corde entiere ; c'est le monocorde, dont je viens de parler. Voyez son article.
On peut rendre des sons graves ou aigus par d'autres moyens. Deux cordes de longueur égales ne forment pas toujours l'unisson ; car si l'une est plus grosse ou moins tendue que l'autre, elle fera moins de vibrations en tems égaux, & conséquemment le son en sera plus grave. Voyez Cordes.
C'est sur ces deux régles combinées que sont fondés, la construction des instrumens à corde tels que le clavessin, & le jeu des violons & basses, qui, par un perpétuel & différent accourcissement des cordes sous les doigts, produit cette prodigieuse diversité de sons qu'on admire dans ces instrumens. Il faut raisonner de même pour les instrumens à vent. Les plus longs forment des sons plus graves si le vent est égal. Les trous, comme dans les flûtes & haubois, servent à les raccourcir pour faire des sons plus aigus. En donnant plus de vent on les fait octavier, & les sons deviennent plus aigus encore. Voyez les mots Orgue, Flute, Octavier, &c.
Si l'on racle une des plus grosses cordes d'une viole ou d'un violoncelle : ce qui se doit faire plutôt avec douceur qu'avec force, & un peu plus près du chevalet qu'à l'ordinaire ; en prétant une attention suffisante, une oreille exercée entendra distinctement, outre le son de la corde entiere, au-moins celui de son octave, de l'octave de sa quinte, & la double octave de sa tierce : on verra même frémir, & on entendra résonner toutes les cordes montées à l'unisson de ces sons-là. Ces sons accessoires accompagnent toujours un son principal quelconque : mais quand ce son est aigu, ils y sont moins sensibles. On appelle ces sons les harmoniques du son principal ; c'est par eux que M. Rameau prétend que tout son est appréciable, & c'est en eux qu'il a cherché le principe physique de toute l'harmonie. Voyez Harmonie.
Une difficulté qui resteroit à expliquer est de savoir comment deux ou plusieurs sons peuvent être entendus à la fois. Lorsqu'on entend, par exemple, les deux sons de la quinte, dont l'un fait deux vibrations, pendant que l'autre en fait trois ; on ne conçoit pas comment la même masse d'air peut fournir dans un même tems ces différens nombres de vibrations, & bien moins encore, quand il se trouve plus de deux sons ensemble. Mengoli & les autres se tirent d'affaire par des comparaisons. Il en est, disent-ils, comme de deux pierres qu'on jette à-la-fois dans l'eau à quelque distance, & dont les différens cercles qu'elles produisent, se croisent sans se détruire. M. de Mairan donne une explication plus philosophique. L'air, selon lui, est divisé en particules de diverses grandeurs, dont chacune est capable d'un ton particulier, & n'est susceptible d'aucun autre. De sorte qu'à chaque son qui se forme, les particules qui y sont analogues s'ébranlent seules, elles & leurs harmoniques, tandis que toutes les autres restent tranquilles jusqu'à ce qu'elles soient émues à leur tour par les sons qui leur correspondent. Ce système paroit très-ingénieux ; mais l'imagination a quelque peine à se prêter à l'infinité de particules d'air différentes en grandeur & en mobilité, qui devroient être répandues dans chaque point de l'espace, pour être toujours prêtes au besoin à rendre en tout lieu l'infinité de tous les sons possibles. Quand elles sont une fois arrivées au tympan de l'oreille, on conçoit encore moins comment, en les frappant plusieurs ensemble, elles peuvent y produire un ébranlement capable d'envoyer au cerveau la sensation de chacune d'elles en particulier. Il semble qu'on éloigne la difficulté plutôt qu'on ne la surmonte. Mengoli prétendoit aller au-devant de cette derniere objection, en disant que les masses d'air, chargées, pour ainsi dire, de différens sons, ne frappent le tympan que successivement, alternativement, & chacune à son tour ; sans trop songer à quoi cependant il occuperoit celles qui sont obligées d'attendre que les premieres aient achevé leur office.
La force du son dépend de celle des vibrations du corps sonore ; plus ces vibrations sont grandes, plus le son est vigoureux & s'entend de loin.
Quand la corde est assez tendue & qu'on ne force pas trop la voix ou l'instrument, les vibrations restent toujours isochrones, & par conséquent le ton demeure le même, soit qu'on renfle ou qu'on adoucisse le son : mais en raclant trop fort la corde, en soufflant ou en criant trop on peut faire perdre aux vibrations l'isochronisme nécessaire pour l'identité du ton ; & c'est peut-être la raison pourquoi, dans la musique françoise, où c'est un grand mérite de bien crier ; on est plus sujet à chanter faux que dans l'italienne, où la voix se modere plus sagement.
La vitesse du son, qui sembleroit devoir dépendre de sa force, n'en dépend point. Cette vitesse est toujours égale & constante, si elle n'est précipitée ou retardée par ces altérations de l'air : c'est-à dire que le son, fort ou foible, fera toujours la même quantité de chemin, & qu'il parcourra toujours dans deux secondes le double de l'espace qu'il aura parcouru dans une. Au rapport de Halley & de Flamstead, le son parcourt en Angleterre 1070 piés de France en une seconde. Le pere Mersene & Gassendi ont assuré que le vent, favorable ou contraire, n'accéléroit ni ne retardoit le son ; depuis les expériences que Derham & l'académie des sciences ont faites sur ce sujet, cela passe pour une erreur.
Sans ralentir sa marche, le son s'affoiblit en s'étendant, & cet affoiblissement, si la propagation est libre, qu'elle ne soit gênée par aucun obstacle, ni dérangée par le vent, suit ordinairement la raison des quarrés des distances.
Quant à la différence qui se trouve encore entre les sons par la qualité du timbre, il est évident qu'elle ne tient ni au degré de gravité, ni même à celui de force. Un hautbois aura beau se mettre exactement à l'unisson d'une flûte, il aura beau radoucir le son au même degré, le son de la flûte aura toujours je ne sai quoi de doux & de moëlleux, celui du hautbois je ne sai quoi de sec & d'aigre, qui empêchera qu'on ne puisse jamais les confondre. Que dirons-nous des differens timbres des voix de même force & de même portée ? chacun est juge de la variété prodigieuse qui s'y trouve. Cependant, personne que je sache n'a encore examiné cette partie, qui peut être, aussi-bien que les autres, se trouvera avoir ses difficultés : car la qualité de timbre ne peut dépendre, ni du nombre de vibrations qui font le degré du grave à l'aigu, ni de la grandeur ou de la force de ces mêmes vibrations qui fait le degré du fort au foible. Il faudra donc trouver dans les corps sonores une troisieme modification différente de ces deux, pour expliquer cette derniere propriété ; ce qui ne me paroît pas une chose trop aisée ; il faut recourir aux principes d'acoustique de M. Diderot, si l'on veut approfondir cette matiere.
Les trois qualités principales dont je viens de parler, entrent toutes, quoiqu'en différentes proportions, dans l'objet de la musique, qui est en général le son modifié.
En effet, le compositeur ne considere pas seulement si les sons qu'il emploie doivent être hauts ou bas, graves ou aigus, mais s'ils doivent être forts ou foibles, aigres ou doux ; & il les distribue à différens instrumens, en récits ou en ch?urs, aux extrémités ou dans le médium des voix, avec des doux ou des forts, selon les convenances de tout cela. Mais il est certain que c'est uniquement dans la comparaison des sons de l'aigu au grave que consiste toute la science harmonique. De sorte que, comme le nombre des sons est infini, on pourroit dire en ce sens que cette même science est infinie dans son objet.
On ne conçoit point de bornes nécessaires à l'étendue des sons du grave à l'aigu ; & quelque petit que puisse être l'intervalle qui est entre deux sons, on le concevra toujours divisible par un troisieme son. Mais la nature & l'art ont également concouru à limiter cette infinité prétendue par rapport à la pratique de la musique. D'abord, il est certain qu'on trouve bientôt dans les instrumens les bornes des sons, tant au grave qu'à l'aigu ; alongez ou racourcissez à un certain point une corde sonore, elle ne rendra plus de son : on ne peut pas non plus augmenter ou diminuer à discrétion la capacité d'une flûte ni sa longueur ; il y a des limites au-delà desquelles elle ne résonne plus. L'inspiration a aussi ses lois ; trop foible, la flûte ne rend point de son ; trop forte à un certain point, elle ne fait plus, de même que la corde trop courte, qu'un cri perçant qu'il n'est pas possible d'apprécier. Enfin, c'est une chose incontestable par l'expérience, que tous les sons sensibles sont renfermés dans des limites au-delà desquelles, ou trop graves ou trop aigus, ils ne sont plus apperçus, ou deviennent inappréciables. M. Euler a même, en quelque façon, fixé ces limites ; &, selon ses expériences & son calcul rapportés par M. Diderot, tous les sons sensibles sont compris entre les nombres 30 & 7552 ; c'est-à-dire que, selon ce savant auteur, le son le plus grave appréciable à notre oreille, fait trente vibrations par seconde, & le plus aigu 7552 vibrations dans le même tems ; intervalle qui renferme près de huit octaves.
D'un autre côté, on voit par la génération harmonique des sons, que parmi tous les sons possibles il n'y en a qu'un très-petit nombre qui puissent être admis dans un bon système de musique ; car tous ceux qui ne forment pas des consonances avec les sons fondamentaux, ou qui ne naissent pas médiatement ou immédiatement des différences de ces consonances, doivent être proscrits du système ; voilà pourquoi quelque parfait que puisse être aujourd'hui notre système de musique, il est pourtant borné à 12 sons seulement dans l'étendue d'une octave, desquels douze toutes les autres octaves ne contiennent que des répliques. Que si l'on veut compter toutes ces répliques pour autant de sons différens, en les multipliant par le nombre d'octaves auquel est bornée l'étendue des sons sensibles, on trouvera 96 en tout pour le plus grand nombre de sons praticables dans notre musique sur un même son fondamental.
On ne pourroit pas évaluer avec la même précision le nombre de sons praticables dans l'ancienne musique : car les Grecs formoient, pour ainsi dire, autant de système de musique qu'ils avoient de manieres différentes d'accorder leurs tétracordes. Il paroît par la lecture de leurs traités de musique, que le nombre de ces manieres étoit grand, & peut-être indéterminé. Or chaque accord particulier changeoit les sons de la moitié du système, c'est-à-dire, des deux cordes mobiles de chaque tétracorde. Ainsi l'on voit bien ce qu'ils avoient de sons dans une seule maniere d'accord, c'est-à-dire, seize seulement ; mais on ne peut pas calculer au juste combien ce nombre devoit se multiplier dans tous les changemens de mode, & dans toutes les modifications de chaque genre, qui introduisoient de nouveaux sons.
Par rapport à leurs tétracordes, les Grecs distinguoient les sons en deux classes générales ; savoir, les sons stables & permanens, dont l'accord ne changeoit jamais, & qui étoient au nombre de huit ; & les sons mobiles, dont l'accord changeoit avec le genre & avec l'espece du genre : ceux-ci étoient aussi au nombre de huit, & même de neuf & de dix, parce qu'il y en avoit qui se confondoient quelquefois avec quelques-uns des précédens, & quelquefois s'en séparoient ; ces sons mobiles étoient les deux moyens de chacun des cinq tétracordes. Les huits sons immuables étoient les deux extrèmes de chaque tétracorde, & la corde proslambanomene. Voyez tous ces mots.
Ils divisoient de-rechef les sons stables en deux especes, dont l'une s'appelloit soni apieni, & contenoit trois sons ; savoir, la proslambanomene, la nete synnéménon, & la nete hyperboleon. L'autre espece s'appelloit soni baripieni, & contenoit cinq sons, l'hypate hypaton, l'hypate meson, la mese, la paramese, & la nite drezeugnumenon. Voyez ces mots.
Les sons mobiles se subdivisoient pareillement en soni mesopieni, qui étoient cinq en nombre ; savoir, le second & montant de chaque tétracorde, & en cinq autres sons appellés soni oxipieni, qui étoient le troisieme en montant de chaque tétracorde. Voyez Tétracorde, Système, Genre, &c.
A l'égard des douze sons du système moderne, l'accord n'en change jamais, & ils sont tous immobiles. Brossard prétend qu'ils sont tous mobiles, fondé sur ce qu'ils peuvent être altérés par dièse ou par bémol ; mais autre chose est de substituer un son à un autre, & autre chose d'en changer l'accord. (S)
Sons harmoniques, ou Sons flutés, sont une qualité singuliere de sons qu'on tire de certains instrumens à corde, tels que le violon & le violoncelle, par un mouvement particulier de l'archet, & en appuyant très-peu le doigt sur certaines divisions de la corde. Ces sons sont fort différens, pour le degré & pour le timbre, de ce qu'ils seroient si l'on appuyoit tout-à-fait le doigt. Ainsi ils donneront la quinte quand ils devroient donner la tierce, la tierce quand ils devroient donner la quarte, &c. & pour le timbre, ils sont beaucoup plus doux que ceux qu'on tire à plein de la même corde, en la faisant porter sur la touche ; c'est pourquoi on les a appellés sons flûtés. Il faut pour en bien juger, avoir entendu M. Mondonville tirer sur son violon, ou le sieur Bertaud sur son violoncelle, une suite de ces beaux sons. En glissant même le doigt légerement de l'aigu au grave, depuis le milieu d'une corde qu'on touche en même tems de l'archet, on entend distinctement une succession de ces mêmes sons du grave à l'aigu, qui étonne fort ceux qui n'en connoissent pas la théorie.
Le principe sur lequel est fondée la regle des sons harmoniques, est qu'une corde étant divisée en deux parties commensurables entre elles, & par conséquent avec la corde entiere, si l'obstacle qu'on mettra au point de division, n'empêche qu'imparfaitement la communication des vibrations d'une partie à l'autre ; toutes les fois qu'on fera sonner la corde dans cet état, elle rendra non le son de la corde entiere, mais celui de la plus petite partie si elle mesure l'autre, ou si elle ne la mesure pas, le son de la plus grande aliquote commune à ces deux parties. Qu'on divise donc une corde 6 en deux parties 4 & 2, le son harmonique résonnera par la longueur de la petite partie 2 qui est aliquote de la grande partie 4 ; mais si la corde 5 est divisée selon 2 & 3, comme la petite partie ne mesure pas la grande, le son harmonique ne résonnera que selon la moitié 1 de la petite partie ; laquelle moitié est la plus grande commune mesure des deux parties 3 & 2, & de toute la corde
Au moyen de cette loi qui a été trouvée sur les expériences faites par M. Sauveur à l'académie des Sciences, & avant lui par Wallis, tout le merveilleux disparoît : avec un calcul très-simple, on assigne pour chaque degré le son harmonique qui lui répond : & quant au doigt glissé le long de la corde, on n'y voit plus qu'une suite de sons harmoniques, qui se succedent rapidement dans l'ordre qu'ils doivent avoir selon celui des divisions sur lesquelles on passe successivement le doigt.
Voici une table de ces sons qui peut en faciliter la recherche à ceux qui desirent de les pratiquer. Cette table indique les sons que rendroient les divisions de l'instrument touchées à plein, & les sons flûtés qu'on peut tirer de ces mêmes divisions touchées harmoniquement.
Table des sons harmoniques. La corde entiere à vuide, donne l'unisson.
La tierce mineure, donne la dix-neuvieme ou la double octave de la quinte.
La tierce majeure, donne la dix-septieme ou la double octave de la tierce majeure.
La quarte, donne la double octave.
La quinte, donne la douzieme, ou l'octave de la même quinte.
La sixte mineure, donne la triple octave.
La sixte majeure, donne la dix-septieme majeure, ou la double octave de la tierce.
L'octave, donne l'octave.
Après la premiere octave, c'est-à-dire, depuis le milieu de la corde jusque vers le chevalet, où l'on retrouve les mêmes sons harmoniques répétés dans le même ordre sur les mêmes divisions 1, c'est-à-dire, la dix-neuvieme sur la dixieme mineure ; la dix-septieme sur la dixieme majeure, &c.
Nous n'avons fait dans cette table aucune mention des sons harmoniques relatifs à la seconde & à la septieme ; premierement, parce que les divisions qui les donnent, n'ayant entre elles que des aliquotes fort petites, les sons en deviendroient trop aigus pour être agréables à l'oreille, & trop difficiles à tirer par un coup d'archet convenable : & de plus, parce qu'il faudroit entrer dans des soûdivisions trop étendues, qui ne peuvent s'admettre dans la pratique : car le son harmonique du ton majeur seroit la vingt-troisieme, ou la troisieme octave de la seconde, & l'harmonique du ton mineur seroit la vingt-quatrieme ou la troisieme octave de la tierce majeure. Mais quelle est l'oreille assez fine & la main assez juste, pour pouvoir distinguer & toucher à sa volonté un ton majeur ou un ton mineur ? (S)
Son, (Commerce.) on sait que c'est la peau des grains moulus séparée de la farine par le moyen du blutoir, du sas, ou du tamis. Les Amidonniers se servent du son de froment pour faire leur amidon, qui n'est autre chose que la fécule qui reste au fond des tonneaux où ils ont mis le son tremper avec de l'eau. Les Teinturiers mettent le son au nombre des drogues non colorantes, parce que de lui-même il ne peut donner aucune couleur ; c'est avec le son qu'ils font les eaux sûres, dont ils se servent dans la préparation de leurs teintures. (D. J.)
Son, (Littérature.) les anciens se frottoient de son dans leurs cérémonies lustrales ; ils en usoient aussi dans leurs cérémonies magiques, principalement quand ils vouloient inspirer de l'amour. Nous lisons dans le prophete Baruch, c. vj. vers. 42. que les femmes de Chaldée assises dans les rues y brûloient du son à ce dessein. Il est vrai qu'il y a dans la vulgate, succendentes ossa olivarum, brûlant des noyaux d'olive. L'auteur de la vulgate lisoit probablement ici, ??? ?????????, expression qui en effet signifie (Athén. l. II.) noyaux d'olive brûlés ; mais il est certain qu'il y a dans le texte ?? ??????, mot qui signifie du son. Théocrite dans sa Pharmaceutrie, nous fournit encore un exemple de cet usage ; l'enchanteresse Siméthe, après avoir essayé de plusieurs charmes pour enflammer le c?ur de son amant ; je vais maintenant brûler du son, ???? ?????? ; & elle ajoute vers la fin de l'Idylle, qu'elle a appris ce secret d'un assyrien. (D. J.)
Étymologie de « son »
Poit. seun?; picard sin ou sen devant une voyelle, chin, son, che, sa?; provenç. ses, son, au fém. sa?; au plur. siei, sei?; au fém. sas?; cat. sos, son?; espagn. suyo?; ital. suo?: du lat. suum?; comparez le grec ?????, et l'allem. sein. Dans l'ancienne langue, ses était le nominatif, son le régime, au sing. masculin?; si le nominatif pluriel, ses le régime pluriel.
- (Adjectif possessif) (842) Forme atone du latin suus.
- (Nom commun 1) Du latin sonus.
- (Nom commun 2) (1393) Du latin secundus (« second »), le son étant issu d'un deuxième tamisage de la farine ; le catalan segó procède du même étymon.
- (Nom commun 3) Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l'ajouter en cliquant ici.
- (Nom commun 4) (Abréviation). De section.
son au Scrabble
Le mot son vaut 3 points au Scrabble.
Informations sur le mot son - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot son au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
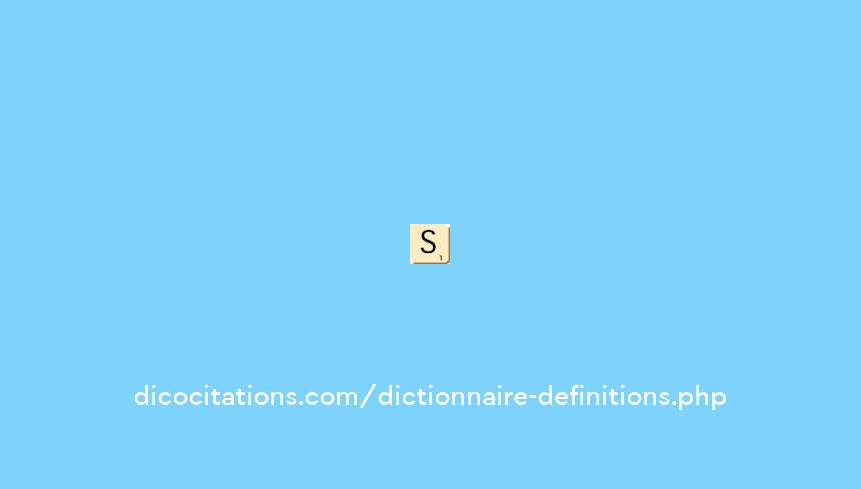
Les rimes de « son »
On recherche une rime en S§ .
Les rimes de son peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en s§
Rimes de chaussons Rimes de ultrason Rimes de saucissons Rimes de manchons Rimes de rapprochons Rimes de reconnaissons Rimes de berrichon Rimes de aubusson Rimes de greluchon Rimes de bouchons Rimes de rafraîchissons Rimes de bossons Rimes de colimaçons Rimes de balançons Rimes de offensons Rimes de pinsons Rimes de dépensons Rimes de pressons Rimes de anglo-saxons Rimes de crachons Rimes de glaçon Rimes de poinçons Rimes de cherchons Rimes de devançons Rimes de ensevelissons Rimes de embarrassons Rimes de aplanissons Rimes de bouchon Rimes de compatissons Rimes de professons Rimes de caparaçon Rimes de bénissons Rimes de boisson Rimes de repoussons Rimes de pachon Rimes de penchons Rimes de abolissons Rimes de nourrisson Rimes de maigrichons Rimes de pinçons Rimes de klaxon Rimes de cornichons Rimes de trébuchons Rimes de traçons Rimes de paillasson Rimes de plaçons Rimes de distançons Rimes de calissons Rimes de mollassons Rimes de bourrichonMots du jour
chaussons ultrason saucissons manchons rapprochons reconnaissons berrichon aubusson greluchon bouchons rafraîchissons bossons colimaçons balançons offensons pinsons dépensons pressons anglo-saxons crachons glaçon poinçons cherchons devançons ensevelissons embarrassons aplanissons bouchon compatissons professons caparaçon bénissons boisson repoussons pachon penchons abolissons nourrisson maigrichons pinçons klaxon cornichons trébuchons traçons paillasson plaçons distançons calissons mollassons bourrichon
Les citations sur « son »
- Le cancre oscille perpétuellement entre l'excuse d'être et le désir d'exister malgré tout, de trouver sa place, voire de l'imposer, fût-ce par la violence, qui est son antidépresseur.Auteur : Daniel Pennac - Source : Chagrin d'école (2007)
- Seule Françoise, son ouvrage tombé sur les genoux, regardait Caporal, étonnée de ce qu'il lisait sans faute et si longtemps.Auteur : Emile Zola - Source : La Terre (1887)
- Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse il n'y a qu'une différence d'intention.Auteur : Pierre Desproges - Source : Fonds de tiroir
- La gloire serait la plus vive de nos passions, sans son incertitude.Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- Dans chaque espèce, ce sont les solitaires qui tentent de nouvelles expériences. Ils forment un quota expérimental qui va à la dérive. Derrière eux, se referme la trace ouverte.Auteur : Erri De Luca - Source : Le poids du papillon (2009)
- La trahison, le vol et l'homosexualité sont les sujets essentiels de ce livre. Un rapport existe entre eux, sinon apparent toujours, du moins me semble-t-il reconnaître une sorte d'échange vasculaire entre mon goût pour la trahison, le vol et mes amours.Auteur : Jean Genet - Source : Journal du Voleur (1949)
- Au lieu de perdre son temps à gagner de l'argent ou telle situation d'où l'on s'imagine qu'on peut atteindre plus aisément les pommes d'or du jardin des Hespérides, il suffit de rester de plain-pied avec les grandes valeurs morales.Auteur : Jean Giono - Source : La Chasse au Bonheur (1988)
- Il y a des hommes qui sont sources.Auteur : Victor Hugo - Source : Faits et croyances
- Il y a plus atroce qu'un amour qui n'atteint pas son but: celui qui l'atteint trop vite.Auteur : Paul Gadenne - Source : Siloé (1941)
- Je ne trouve pas que le lustre des paroles fasse briller les mauvaises raisons et plus je vois de mots employés à soutenir un dire, plus je le soupçonne équivoque, ambigu.Auteur : Rodolphe Toepffer ou Töpffer - Source : Le Presbytère (1832)
- On ne peut pas manger son gâteau et le garder en même temps.Auteur : Serge Bouchard - Source : De la fin du mâle, de l'emballage et autres lieux communs (1996)
- Elle suivait avec angoisse la progression de la Sœur, entendait gronder dans son cœur le bruit de plus en plus proche des monnaies, baissait la tête avec humilité quand la main tendue exhaussant la bourse de velours passait à hauteur de son rang.Auteur : Edouard Glissant - Source : La Case du Commandeur (1981)
- L'incompréhension linguistique est source de pensées simples et affectueuses. Personne ne blesse personne. Avec la compréhension mutuelle naissent les fâcheries et les guerres.Auteur : Pierre Mérot - Source : Mammifères (2003)
- J'aimerais mieux choisir mes peines que mes plaisirs, par la raison que je crains plus les unes que je n'espère des autres.Auteur : Sophie Swetchine - Source : Airelles
- Lecteur passionné, il s'évade de la prison du quotidien par la force des voyages intérieurs.Auteur : Maxence Fermine - Source : Le Papillon de Siam (2010)
- Ils acceptaient les plaisirs dispensés par le matin, son clair soleil, l’enveloppement de l’eau et la douceur de l’air ; ils savouraient alors la joie des jeux et de moments si bien remplis que l’espoir, devenu moins nécessaire, se laissait oublier. Auteur : William Golding - Source : Sa Majesté des mouches (1954)
- Dans les domaines de la création, qui sont aussi les domaines de l'orgueil, la nécessité de se distinguer est indivisible de l'existence même.Auteur : Paul Valéry - Source : Variété, Situation de Baudelaire
- Les souvenirs ne sont en général, jamais exempts de souffrance.Auteur : Gao Xingjian - Source : La Montagne de l'Ame
- Je ne conçois pas comment on peut les trouver du même ton que celles des deux personnages principaux.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Sans référence
- Disons que Berne est à New Delhi ce qu'une tortue est à un microscope : absolument aucun rapport.Auteur : Laurent Genefort - Source : Points chauds (2012)
- Le Temps a sur son dos une besace où il jette les aumônes qu'il va recueillant pour l'Oubli, qui est un géant, monstre d'ingratitude.Auteur : William Shakespeare - Source : Troilus et Cressida (1602), III, 3, Ulysse
- Quand un homme est décoré, on devrait nommer son père pour le moins officier d'académie.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- Son esprit fatigué réclamait une nouvelle alimentation.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé (1927)
- Les Tyranides sont des créatures issues de nos pire cauchemars, mais n'oubliez pas qu'elles peuvent saigner et mourir.Auteur : Graham McNeill - Source : Les Guerriers d'Ultramar (2009)
- Nos actions sont comme les bouts-rimés, que chacun fait rapporter à ce qu'il lui plaît.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664), 382
Les mots proches de « son »
Son Son Son Sonate Sonde Sonder Sondeur Songe Songeard, arde Songe-creux Songe-malice Songer Songerie Songeur Sonica Sonnaille Sonnailler Sonnant, ante Sonné, ée Sonner Sonnerie Sonnet Sonnette Sonneur Sonnez Sonore SonorementLes mots débutant par son Les mots débutant par so
son son Son Sonac sonagramme sonar sonars sonate sonates sonatine Sonchamp Soncourt Soncourt-sur-Marne sonda sondage sondages sondaient sondait sondant sondas sonde sonde sondé sondé sondé sondée sondée sondée sondent sonder sonderai sondèrent Sondernach Sondersdorf sondes sondés sondés sondeur sondeurs sondeuse sondez sondions sondons Sône song songe songe songé songe-creux songea
Les synonymes de « son»
Les synonymes de son :- 1. bourdonnement
2. bruit
3. ronflement
4. vrombissement
5. rumeur
6. murmure
7. tintement
8. bruissement
9. fredonnement
10. tonalité
11. timbre
12. éclat
13. ton
14. sonorité
15. résonance
16. sien
17. à
synonymes de son
Fréquence et usage du mot son dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « son » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot son dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Son ?
Citations son Citation sur son Poèmes son Proverbes son Rime avec son Définition de son
Définition de son présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot son sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot son notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 3 lettres.
