Définition de « végétal »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot vegetal de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur végétal pour aider à enrichir la compréhension du mot Végétal et répondre à la question quelle est la définition de vegetal ?
Une définition simple :
Définitions de « végétal »
Trésor de la Langue Française informatisé
VÉGÉTAL, -ALE, -AUX, subst. masc. et adj.
Wiktionnaire
Nom commun - français
végétal \ve.?e.tal\ masculin
-
(Biologie) Être vivant pluricellulaire, organisme autotrophe capable de synthétiser les composants organiques à partir de sels minéraux puisés dans le sol et d'énergie solaire.
- Trembley trouvait donc ici deux grands phénomènes, jusque-là regardés comme appartenant exclusivement aux végétaux, la reproduction par boutures et la multiplication par bourgeons. ? (Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, Les Métamorphoses et la généagénèse, Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 3, 1856 (pp. 496-519))
- Dans les Pyrénées, la présence de végétaux propéméditerranéens est très fréquente le long des chaînons calcaires du Planturel et vers les Petites Pyrénées. ? (Henri Gaussen, Géographie des Plantes, Armand Colin, 1933, p.82)
- Après Prévost, il faudra attendre près de 50 ans encore et traverser les terribles famines d'Irlande pour que l'on reconnaisse enfin de façon irréfutable que les champignons vivants peuvent être la cause de maladies chez les végétaux. ? (Jean Semal, Pathologie des végétaux et géopolitique, 1982)
- Le végétal est-il l'avenir du steak?? ("Les steaks végétaux vont-ils remplacer la viande ?", France Inter, 2021 ? lire en ligne)
-
(Au pluriel) Un des cinq règnes de la vie regroupant des êtres pluricellulaires réalisant la photosynthèse.
- Le règne des végétaux.
Adjectif - français
végétal \ve.?e.tal\ masculin
- Relatif à ce qui pousse, à la végétation, aux plantes.
- Quand on sème une plante pour l'enterrer, on doit se souvenir que le but n'est pas la production granifère, mais la production de la masse la plus considérable possible de matière végétale. ? (Charles-Victor Garola, Engrais : Les matières fertilisantes, Paris : J.-B. Baillière & fils, 7e édition, 1925, page 185)
- On verse sur le tas ou dans le composteur tous les déchets végétaux du jardin en évitant le branchage d'un trop gros diamètre. ? (Alain Baraton, Mes trucs et astuces de jardinier, Éditions Flammarion, 2014)
- Les chancels, barrières basses qui séparent le ch?ur de la nef, reçoivent des ornements sculptés où la croix entrelacée de motifs végétaux évoquant la vie tient une place de choix. ? (Le monde de la Bible, numéro 222, page 44, éditeur Bayard, 2017)
Littré
-
1Qui appartient, qui a rapport aux plantes ou qui en provient.
Les matières végétales sont formées, dans leurs premiers principes, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, auxquels sont ajoutés, mais dans quelques cas seulement et comme accessoires non indispensables, l'azote, le soufre, le phosphore?
, Fourcroy, Conn. chim. t. VII, p. 57.Dans les champs parfumés le jeune arbuste étale De son luxe naissant la pompe végétale
, Delille, Parad. perdu, VII.Le règne végétal, l'ensemble des végétaux.
Terre végétale, voy. TERRE, n° 11.
-
2 S. m. Corps organisé qui végète, arbres, plantes, ou, biologiquement, tout être organisé qui accomplit son alimentation solide, liquide et gazeuse aux dépens du milieu minéral ou inorganique, par opposition à l'animal, qui s'alimente aux dépens d'êtres vivants ou qui ont vécu.
Mais, se laissant aller à l'ardeur qui l'emporte, Il passe aux végétaux, pour voir de quelle sorte, Dans son travail secret, la nature conduit L'admirable progrès de la plante et du fruit
, Perrault, Épît. à la Quintinye, dans RICHELET.Ces végétaux puissants qu'en Perse on voit éclore
, Voltaire, Sémiram. IV, 2.Nous différons beaucoup des végétaux?; cependant nous leur ressemblons plus qu'ils ne ressemblent aux minéraux, et cela parce qu'ils ont une espèce de forme vivante, une organisation animée, semblable en quelque façon à la nôtre
, Buffon, Hist. anim. I.Le terme constant de la nutrition et de l'accroissement dans les végétaux est la solidité qu'acquièrent ces êtres et l'état ligneux qu'ils contractent
, Fourcroy, Conn. chim. t. VII, p. 30.Les végétaux sont de véritables machines où s'exercent beaucoup d'opérations chimiques qui consistent en général dans la combinaison au moins ternaire des principes primitifs fournis par la terre
, Fourcroy, ib. t. VIII, p. 318.Végétaux fossiles, plantes enfouies dans le sein de la terre et dont on retrouve la matière transformée et minéralisée, ou seulement la forme.
HISTORIQUE
XVIe s. La maniere de distiller l'huile des vegetaux, c'est-à-dire, des herbes et plantes
, Paré, XXVI, 8.
Encyclopédie, 1re édition
VÉGÉTAL, adj. & subst. (Gram.) c'est le terme le plus étendu de la Botanique. Il se dit de toute plante & de tout ce qui croît par la végétation, ou à la maniere des plantes. Voyez Végétaux.
Végétal, (Chimie ou analyse végétale.) une substance végétale, une matiere végétale est pour le chimiste un corps quelconque provenu du regne végétal, soit que ce corps soit organisé, tel que les végétaux entiers, ou leurs différentes parties, tiges, racines, fleurs, &c. ou qu'il soit non-organisé, comme divers sucs concrets ou liquides, tels que les baumes, les résines, la gomme, &c. & enfin les produits quelconques des travaux chimiques sur les substances végétales, tels que l'esprit-de-vin, l'alkali fixe, diverses huiles, &c. sont encore des substances végétales.
Les matieres végétales organisées, ou tissues, texta, (voyez Tissu, Chimie.) ne different chimiquement des matieres végétales non organisées, que par leur ordre respectif de composition ; elles sont entre elles comme le composé est à ses principes ; car le tissu végétal est chimiquement formé par le concours de plusieurs de ces matieres végétales non organisées, soutenues par une charpente terreuse plus ou moins renforcée, & dans laquelle réside principalement l'organisation, dont les Chimistes ne se mettent point en peine, ou ce qui est la même chose, qui n'est point un objet chimique.
Les substances végétales de la premiere espece, les végétaux proprement dits, sont offerts immédiatement par la nature ; les substances végétales non organisées qui sont, comme nous venons de l'observer, les principes communs des végétaux, se présentent aussi quelquefois d'eux-mêmes, comme la gomme vulgaire, les baumes, les bitumes, que les Chimistes regardent avec beaucoup de probabilité, comme ayant une origine végétale. (Voyez Charbon de terre, &c.) Mais plus souvent ils ne sont manifestés que par l'art qui les a successivement tirés des végétaux pour divers usages. Il est clair par le simple énoncé que les substances végétales de la troisieme espece, savoir les produits des opérations chimiques, sont toujours des présens de l'art.
L'énumeration des différentes substances organisées, sur lesquelles les Chimistes se sont exercés, est assez connue ; elle renferme les tiges soit ligneuses, soit herbacées, les racines ligneuses, charnues, bulbeuses, &c. les écorces, les feuilles, les calices des fleurs, les pétales, les pistils, les étamines, & même leurs poussieres, les semences, & toutes leurs différentes especes d'enveloppe, parmi lesquelles on doit compter les pulpes des fruits & leurs écorces ; toutes leurs especes de plantes moins parfaites ou moins connues, comme champignons, mousses, & vraissemblablement toutes les especes de fleurs ou moisissures, &c.
Les substances végétales de la seconde espece, c'est-à-dire, celles qui proviennent soit naturellement, soit par art, des substances précédentes, sont une eau aromatique ou non aromatique ; le principe aromatique, l'acide spontané, l'alkali volatil spontané, le principe vif, piquant, indéfini, tel que celui de l'oignon, de la capucine, &c. l'huile essentielle, différentes especes d'huiles grasses, le baume, la résine, la gomme ou le mucilage, la gomme résine, l'extrait, la résine extrait, le corps muqueux, le sel essentiel, acidule, la partie colorante verte, & plusieurs autres matieres colorantes.
Nous énoncerons dans la suite de cet article toutes les substances végétales de la troisieme espece, c'est-à-dire véritablement artificielles.
Les Chimistes ont procédé à l'analyse des végétaux entiers ou de leurs parties, c'est-à-dire, des substances végétales de notre premiere espece, par deux moyens différens ; savoir par la distillation analytique, c'est-à-dire exécutée à la violence du feu, & sans intermede ; (voyez Distillation.) & par l'analyse menstruelle, &c. Voyez Menstruelle, analyse.
Toutes ces substances ont fourni assez généralement par le premier moyen, les produits suivans ; 1°. une eau ou flegme limpide, quelquefois aromatique, quelquefois inodore, selon que la matiere traitée est aromatique ou inodore ; mais dans le dernier cas même, annonçant jusqu'à un certain point la substance particuliere qui l'a fourni ; & toujours très-distinctement le regne auquel appartient cette substance, le regne végétal ; 2°. un flegme coloré & légerement empreint de l'odeur empyreumatique ; 3°. un flegme plus coloré, un peu trouble, & chargé d'une petite quantité d'esprit salin, quelquefois acide, mais plus souvent alkali ; une petite quantité d'huile jaunâtre & assez limpide, un peu d'air ; 4°. une liqueur plus saline, trouble, de l'huile plus abondante, plus dense & noirâtre, de l'air ; 5°. le plus souvent de l'alkali volatil concret ; une huile qui devient de plus en plus dense & noire, de l'air ; 6°. il reste enfin un résidu charbonneux, qui étant brûlé ou calciné à l'air libre, donne par la lixiviation de l'alkali fixe & quelques sels neutres ; savoir du tartre vitriolé ou du sel marin, ou bien l'un & l'autre.
Tels sont les produits communs & à-peu-près universels d'un végétal traité par la distillation analytique : ce sont ceux qu'ont obtenus constamment les premiers chimistes de l'académie des Sciences, MM. Dodart, Bourdelin, Tournefort, Boulduc, &c. ceux qui sont exposés dans un livre très-connu ; la matiere médicale de Geoffroy, &c. Mais la doctrine chimique dominante sur les produits caractéristiques & respectifs de la distillation analytique des végétaux & des animaux, n'en est pas moins que l'acide est ce produit spécial & propre aux végétaux, & que l'alkali volatil est ce produit propre & spécial aux animaux ; sur quoi il est observé dans un mémoire sur l'analyse des végétaux, imprimé dans le second volume des mémoires présentés à l'acad. royale des Sciences, par divers savans, &c. qu'on a toujours lieu d'être étonné sans doute de voir des erreurs de fait qu'une seule expérience doit détruire, se répandre & subsister ; que l'établissement de l'opinion particuliere dont il s'agit ici, & qui est moderne, est d'autant plus singulier, que tous les chimistes qui ont fait une mention expresse des distillations analytiques des végétaux, ont dénommé très-expressément parmi les produits de ces distillations, les esprits & les sels alkalis volatils ; que la présence de l'acide mentionné par tous ces chimistes est presque toujours fort équivoque, tandis que celle de l'alkali volatil est toujours très-évidente ; qu'on distingue très-vainement par ce produit les plantes de la famille des cruciferes de Tournefort, dont l'alkali volatil spontané qui se dégage de quelques-unes au plus léger degré de feu, ne doit être ici compté pour rien, puisque ces plantes n'ont rien de particulier quant au produit alkali volatil de leurs distillations analytiques ; puisqu'au contraire on retire par cette distillation, de plusieurs plantes des autres classes plus d'alkali volatil, même concret, que des plantes cruciferes qui contiennent le plus d'alkali volatil spontané ; par exemple, de la laitue & de l'oseille plus que du cochlearia ; & enfin que ce n'est qu'à la distillation des bois, & principalement à celle des bois durs & résineux, que convient la doctrine que nous combattons ; car ces bois donnent en effet abondamment de l'acide, & fort peu d'alkali volatil : & il est presque hors de doute que c'est de leur analyse particuliere, qu'on a déduit par une conséquence prématurée, ce qu'on a avancé trop généralement sur la distillation des végétaux.
Il est observé dans le même écrit que cette ancienne maniere de procéder à la décomposition des végétaux, est imparfaite & vicieuse ; parce qu'une analyse réguliere doit attaquer par rang les différens ordres de combinaison qui concourent à la formation du corps examiné ; & que l'analyse par la violence du feu atteint tout-d'un-coup au contraire les derniers ordres de combinaison dont elle simplifie les principes trop brusquement ; car, est-il ajouté, c'est avoir une idée très-fausse de l'analyse chimique, que de prétendre qu'on doive pousser immédiatement celle d'un corps quelconque jusqu'aux produits exactement simples, comme sembloient l'exiger les physiciens, qui rejettoient la doctrine des Chimistes, parce que les produits de leurs analyses, qu'ils appelloient les principes chimiques, n'étoient pas des corps simples ; tandis qu'au contraire le vice réel de leurs opérations consistoit précisément en ce qu'elle simplifioit trop ces principes.
On conclut de ces observations qu'il faut absolument substituer à cette maniere de procéder, la méthode nouvelle de l'analyse menstruelle ou par combinaison, par le moyen de laquelle on retire des végétaux les principes immédiats & évidemment inaltérés de leur composition ; chacun desquels peut être successivement & distinctement soumis à une analyse ultérieure. Il est dit aussi dans ce mémoire que les Chimistes n'ont encore que des connoissances fort imparfaites sur l'analyse particuliere de chacune des substances qu'on retire des végétaux par l'application de diverses menstrues, & qui sont celles dont nous avons fait mention plus haut, sous le nom de seconde espece de substance végétale ; savoir le baume, l'extrait, la gomme, &c. & que ce n'est presque que sur la résine & les matieres analogues, savoir les baumes, les bitumes, &c. que les Chimistes ont des notions distinctes.
Les substances végétales artificielles, dont nous avons annoncé plus haut l'énumération, sont outre les produits de la distillation analytique ci-dessus détaillée, les produits spéciaux des trois fermentations proprement dites ; savoir l'esprit-de-vin, le tartre, la lie du vin, le vinaigre, l'alkali volatil, l'esprit f?tide putride, absolument indéterminé jusqu'à présent, & enfin la suie végétale.
On trouvera dans ce Dictionnaire des articles particuliers pour toutes les substances végétales de la seconde & de la troisieme espece ; pour l'extrait, la gomme, la résine, les principes odorans, sous le mot Odorant ; l'huile essentielle, & l'huile grasse, l'esprit-de-vin sous le mot Vin ; le vinaigre, le tartre, la suie, &c. & dans ces articles, la maniere d'obtenir, de préparer, d'extraire, ou de produire la substance particuliere qui en fait le sujet. Les procédés nécessaires à cet objet sont, par exemple, exposés avec beaucoup de détail à l'article Eau distillée, à l'article Huile, à l'article Extrait, &c. Celui-ci a été spécialement destiné à la substance végétale très-composée, ou proprement dite au Tissu végétal. (b)
Végétal, acide, (Chimie & Médec.) l'acide végétal est le quatrieme & dernier acide simple connu. C'est le plus volatil de tous ; c'est celui qui est le plus fréquemment en usage, puisqu'il entre dans une grande partie de nos mets. Voyez acides en général à l'article Sel. Une saveur astringente, une odeur assez agréable, le caractérisent assez pour que nous ne nous arrêtions pas davantage sur cet article.
On le retire par la distillation de quelques végétaux, comme la canne à sucre, du tartre (voyez Tartre), & des substances qui ont subi une fermentation acide, après avoir été successivement du moût & du vin. La différence des sels que donnent ces différentes substances doit bien nous convaincre que tous les corps sont composés des mêmes élémens, & que la différente combinaison, un peu plus ou un peu moins, en font toute la différence. C'est par les voies les plus simples que la nature opere tant de merveilles. Notre admiration augmentera lorsque nous considérerons que ce moût qui précédemment avoit été acide, n'a fait que revenir à son ancien état. Quoique, à dire le vrai, ce n'est que par conjecture que nous soupçonnons que le verjus est, à quelque différence près, le même acide que le vinaigre, encore que leurs saveurs ne se ressemblent pas exactement. M. Gellert va plus loin ; il prétend que tous les végétaux contiennent le même acide, ce qui nous paroît bien éloigné de la vérité, puisqu'avec l'acide vitriolique & un peu d'essence de citron on fait une limonade semblable à celle que produisent les citrons, ce qu'on n'obtiendroit jamais avec le vinaigre distillé.
Dans l'état ordinaire, le vinaigre contient un principe huileux & tartareux, qui, en le privant d'une partie de son activité, empêche de faire avec ce menstrue toutes les dissolutions dont il est capable. La Chimie se sert de deux moyens, pour l'avoir dégagé de cette terre & de cette huile. Le premier est de le distiller. On a par cette opération une liqueur transparente beaucoup plus acide que n'est le vinaigre ordinaire, mais encore bien affoiblie par la grande quantité de phlegme qu'elle contient. On a donc imaginé une seconde méthode, qui consiste à prendre un sel neutre, dont l'acide est le vinaigre, à le dessécher, & en le décomposant distiller l'acide à un feu violent. Le vinaigre radical qui en résulte ne cede peut-être en rien aux autres acides pour sa force ; communément c'est du verdet qu'on le retire. Lorsqu'on veut concentrer le vinaigre sans le débarrasser de la terre & de l'huile dont la distillation le dépouille, on l'expose à une forte gelée : la partie phlegmatique se gele, tandis que l'acide conservant sa fluidité, s'écoule à-travers les lames de la glace.
Homberg & Neumann ont calculé que du fort vinaigre ne contient qu'une soixantieme partie d'acide, Boerhaave ne lui en accorde pas une quatre-vingtieme : nous sommes persuadés que si on débarrassoit encore cette quatre vingtieme partie de tout le phlegme superflu, elle se réduiroit à beaucoup moins.
Quoique les Chimistes ayent fait plusieurs expériences avec le vinaigre simple ou distillé, ils en ont peu fait avec le radical. Il reste donc encore bien des choses à éprouver & à découvrir sur cet acide, auquel les Chimistes n'ont peut-être pas donné toute l'attention qu'il méritoit. Geoffroy ne lui a accordé aucune colonne dans sa table des rapports ; M. Gellert omet plusieurs métaux & plusieurs terres dans la sienne. Il place l'or, l'argent, l'étain & le mercure comme indissolubles dans l'acide du vinaigre, & cependant le contraire vient d'être démontré au sujet du mercure ; il ne fait pas mention des terres calcaires : enfin il prouve combien peu on a fait de recherches sur un sujet aussi intéressant. En général on peut dire que cet acide est le plus foible de tous, que les sels qu'il forme avec les alkalis & les métaux sont décomposés par les acides minéraux. Quoique cet acide ne puisse pas dissoudre un grand nombre de métaux étant appliqué à nud, cependant il les dissout presque tous lorsqu'ils ont été précipités de leurs dissolvans propres. On peut le dulcifier avec l'esprit-de-vin, & en retirer un éther, suivant le procédé & la découverte de M. le comte de Lauragais.
Le vinaigre pris en petite quantité, délayé dans beaucoup d'eau, est, comme les autres acides, un tempérant propre à calmer la soif & la fievre ; mais il a une propriété singuliere, c'est qu'en même tems qu'il est un violent astringent, rafraîchissant & diurétique, il excite abondamment la transpiration, & par ces raisons il peut, étant pris immodérément, conduire à un desséchement, à un marasme général. L'assemblage de ces qualités le rend d'un très-grand secours dans les maladies pestilentielles, où il faut en même tems corriger la corruption de l'air infecté par la pourriture des cadavres, tempérer le mouvement du sang & exciter la transpiration. Il sert dans les tems de contagion à purifier les viandes, les habits, les appartemens, &c. Pour augmenter sa vertu, on le rend aromatique par l'infusion de quelques végétaux : les formules en sont sans nombre. Il est d'un très-grand usage dans la Pharmacie ; on en fait l'oxycrat, médicament souvent aussi utile que simple. On en compose l'oxymel, dont les anciens médecins faisoient un bien plus grand usage que nous ; extérieurement c'est un rafraîchissant, répercussif, astringent très-fort.
Lorsque dans les mets on emploie le vinaigre, on en compose toujours une espece de savon, puisque c'est avec des graisses ou des huiles & du sel qu'on le mêle. Quand le savon n'est ni trop huileux, ni trop acide, il est à son point de perfection, & le mets préparé est au goût de tout le monde : les parties huileuses qui entrent dans la composition du vinaigre, facilitent le mélange savonneux.
Végétale, terre, (Hist. nat.) humus, humus vegetabilis ; c'est la terre qui se trouve à la surface, elle est plus ou moins noire ou jaune ; c'est cette terre qui contribue à la croissance des plantes qui, par leurs racines qui pourrissent, lui rendent continuellement une portion de ce qu'elles en ont reçu. On voit par-là que la terre végétale est bien éloignée d'être une terre simple ; elle doit être un mélange d'argille, de terre calcaire, de sable, de gravier, de parties ferrugineuses, &c. auquel s'est joint une portion de la partie terreuse, huileuse & saline, des végétaux qui s'y pourrissent & s'y décomposent. Une des principales qualités de cette terre est d'être bien divisée, afin d'être propre à se prêter, pour ainsi dire, aux racines jeunes encore des plantes, pour cela il faut qu'elle ne soit ni trop compacte, ni trop spongieuse. Quand elle est trop dense, elle serre trop fortement les racines des plantes & empêche de s'étendre ; joignez à cela qu'elle retient les eaux qui ne pouvant point la traverser assez promptement, ou y séjournant trop long tems, pourrissent & endommagent les végétaux. Une terre trop grasse & trop chargée de glaise est dans ce cas. Voyez Glaise.
D'un autre côté, si la terre végétale est trop poreuse & trop légere, l'eau, si nécessaire pour la végétation & qui est le véhicule qui doit porter le suc nourricier aux plantes, n'y séjourne point assez pour produire cet effet, elle passe comme au-travers d'un crible. Telle est une terre végétale, qui seroit trop sablonneuse ou trop remplie de craie.
Pour remédier à ces inconvéniens dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la terre sera trop grasse, il faudra la diviser & la rendre plus légere, en y joignant soit de la craie, soit du gravier, soit du sable. Quant au second inconvénient, c'est-à-dire lorsque la terre végétale sera trop maigre, on pourra y joindre une terre plus grasse, du fumier de la marne argilleuse, &c.
L'on voit donc que tout le mystere de la fertilisation des terres dépend de rencontrer la juste proportion qui est nécessaire, pour que les terres soient dans un état de division qui facilite la circulation des eaux, & qui ne les arrête ni trop ni trop peu. Voyez les articles Glaise & Marne.
La terre végétale s'appelle aussi terreau, terre franche, terre des jardins.
Étymologie de « végétal »
Mot fait avec le radical du verbe végéter, et la terminaison adjective al.
- Du latin vegetus (« vivant ») et -al ? voir végéter.
végétal au Scrabble
Le mot végétal vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot vegetal - 7 lettres, 3 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot végétal au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
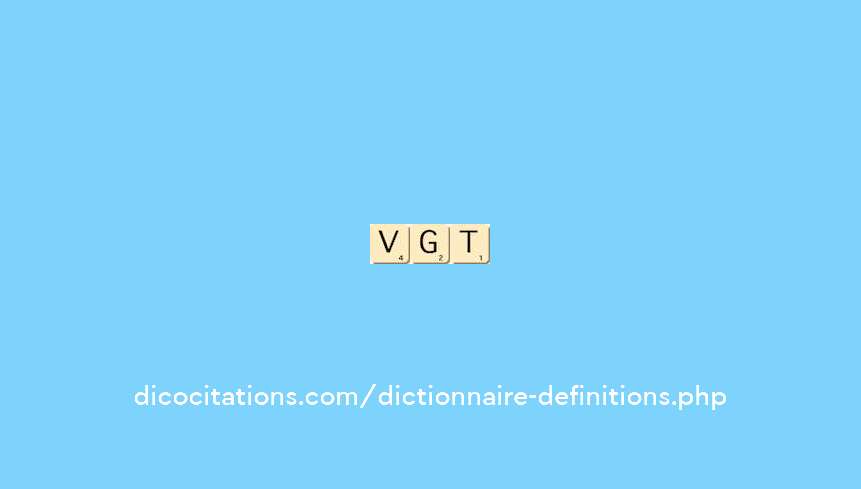
Les rimes de « végétal »
On recherche une rime en AL .
Les rimes de végétal peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en al
Rimes de buccales Rimes de prairial Rimes de poêle Rimes de vaisseau-amiral Rimes de pénales Rimes de stalle Rimes de shale Rimes de partiales Rimes de opale Rimes de polycéphale Rimes de frugales Rimes de départementale Rimes de zénithales Rimes de sénatoriales Rimes de asociale Rimes de télencéphale Rimes de animal Rimes de cavalent Rimes de sidéral Rimes de domanial Rimes de récitals Rimes de carcéral Rimes de rhumatismal Rimes de monumentale Rimes de Népal Rimes de nationales Rimes de trimballe Rimes de sagittal Rimes de pédale Rimes de successoral Rimes de horizontales Rimes de murale Rimes de ovoïdal Rimes de caporal Rimes de postale Rimes de quadriennal Rimes de Dormaal Rimes de cavale Rimes de ammoniacales Rimes de moyen-oriental Rimes de provinciale Rimes de sandale Rimes de baptismal Rimes de rixdales Rimes de étales Rimes de acéphale Rimes de fiscales Rimes de martingale Rimes de cérémonial Rimes de BousvalMots du jour
buccales prairial poêle vaisseau-amiral pénales stalle shale partiales opale polycéphale frugales départementale zénithales sénatoriales asociale télencéphale animal cavalent sidéral domanial récitals carcéral rhumatismal monumentale Népal nationales trimballe sagittal pédale successoral horizontales murale ovoïdal caporal postale quadriennal Dormaal cavale ammoniacales moyen-oriental provinciale sandale baptismal rixdales étales acéphale fiscales martingale cérémonial Bousval
Les citations sur « végétal »
- Le monde animal et le monde végétal ne sont pas utilisés seulement parce qu'ils sont là, mais parce qu'ils proposent à l'homme une méthode de pensée.Auteur : Claude Lévi-Strauss - Source : Sans référence
- Carnivore: Qui s'adonne à l'action cruelle de manger l'infortuné végétal, ainsi que ses usufruitiers et continuateurs.Auteur : Ambrose Bierce - Source : Le Dictionnaire du Diable (1911)
- Le motif végétal est un motif qui est central chez moi, l'arbre est là. Il est partout, il m'inquiète, il m'intrigue, il me nourrit.Auteur : Aimé Césaire - Source : Sans référence
- Le vice, écrivis-je, commence au choix. J'ai observé à Villefranche, jadis, des marins américains pour qui l'exercice de l'amour ne présentait aucune forme précise et qui s'arrangeaient de n'importe qui et de n'importe quoi. L'idée de vice ne leur traversait pas l'esprit. Ils agissaient à l'aveuglette. Ils se pliaient instinctivement aux règles très confuses des règnes végétal et animal.Auteur : Jean Cocteau - Source : La Difficulté d'être (1947)
- Le monde pourrait vivre sans tuer ni animal ni végétal.Auteur : Théodore Monod - Source : Sans référence
- Il a été prouvé que l’homme peut se passer de viande. Or celle-ci est évidemment plus difficile à produire que les denrées d’origine végétale, plus déplaisante à préparer et à manipuler, plus délicate à conserver. Mais qu’importe, n’est-ce pas, du moment qu’elle nous flatte plus agréablement le palais ! Auteur : Upton Sinclair - Source : La Jungle (1905)
- Ce repas se composait d'une bouillie où entrait essentiellement une variété de renouée ... je ne crois sincèrement pas que ce brouet végétal constituait l'ordinaire des anciens Germains qui étaient chasseurs et pêcheurs.Auteur : Michel Tournier - Source : Le Roi des Aulnes (1980)
- Les feuilles ô liberté végétale ô seule liberté terrestre.Auteur : Guillaume Apollinaire - Source : Alcools (1913), Poème lu au mariage d'André Salmon
- Et il en émane une odeur non de pièce morte, non de sacristie et de toiles d'araignée, mais d'espace végétal, de rafales qui retombent soudain en ouragan de plumes, de feuilles, de pollen de la forêt sans fin...Auteur : Pablo Neruda - Source : La solitude lumineuse (2004)
- Vous savez, mon ami, que, pour les esprits pensifs, toutes les parties de la nature, même les plus disparates au premier coup d'oeil, se rattachent entre elles par une foule d'harmonies secrètes, fils invisibles de la création que le contemplateur aperçoit, qui font du grand tout un inextricable réseau vivant d'une seule vie, nourri d'une seule sève, un dans la variété, et qui sont, pour ainsi parler, les racines mêmes de l'être. Ainsi, pour moi, il y a une harmonie entre le chêne et le granit, qui éveillent, l'un dans l'ordre végétal, l'autre dans la région minérale, les mêmes idées que le lion et l'aigle entre les animaux, puissance, grandeur, force, excellence. Auteur : Victor Hugo - Source : En voyage, tome II (1910)
- Vivre c'est être différent. C'est pourquoi toutes les grandes espèces végétales et zoologiques sont monstrueuses. Et il en est de même au moral.Auteur : Blaise Cendrars - Source : Moravagine (1926)
- Notre propagation sur terre passe par la carbonisation des espèces végétales supérieures et, d'une manière plus générale, par l'incessante combustion de toutes substances combustibles. De la première lampe-tempête jusqu'aux réverbères du XVIIIème siècle, et de la lueur des réverbères jusqu'au blême éclat des lampadaires qui éclairent les autoroutes, tout est combustion, et la combustion est le principe intime de tout objet fabriqué par nous. Auteur : W. G. Sebald - Source : Les Anneaux de Saturne (1995)
- En toi, je tomberai, végétale ambroisie, - Grain précieux jeté par l'Eternel Semeur, - Pour que de notre amour naisse la poésie - Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur!Auteur : Charles Baudelaire - Source : Sans référence
- Le lierre se glorifie de mourir où il s'attache. Oui, mais ce crampon du règne végétal oublie de nous dire que pendant toute sa vie il désagrège le mur qui le soutient.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- ARTICHAUT : Végétal qui fait du strip-tease avec son coeurAuteur : Georges-Armand Masson - Source : L'amour, de ah ! jusqu'à zut !
- La sève qui monte dans le tronc d'un arbre est poussée, pas aspirée, sinon le haut de l'arbre serait plus gros que le bas de l'arbre, question du musculaire végétal.Auteur : Jean-Marie Gourio - Source : Brèves de comptoir, 1988
- Il y a certaines plantes qui donnent une fleur et meurent après, je crois que Soupault est de cette espèce végétale.Auteur : Francis Picabia - Source : Sans référence
- Je ne veux pas laisser à la vie le plaisir de me gruger encore, une fois mort, de faire joujou avec mon corps en le décomposant, en se l'appropriant, en l'ingérant pour former une autre vie, même végétale, même minérale.Auteur : Isabelle Fortier, dite Nelly Arcan - Source : Paradis, Clef en main (2009)
- Aaujourd'hui, c'est la Terre qui est menacée. Ce n'est pas seulement le monde animal et végétal. C'est nous-mêmes, avec les pollutions, l'agriculture industrialisée. Nous avons mille menaces avec des conflits, les fanatismes, les refermetures sur soi. Il y a des causes absolument magnifiques pour les jeunes, la défense de la Terre, la défense de l'humanité, c'est-à-dire l'humanisme. On voit bien aussi bien la petite Greta Thunberg que d'autres jeunes, qu'ils sentent ceci. Moi, je pense que nous avons besoin, toujours, de nous mobiliser pour une chose commune, pour une communauté. On ne peut pas se réaliser en étant enfermé dans son propre égoïsme, dans sa propre carrière. On doit aussi participer à l'humanité et c'est une des raisons, je crois, qui m'a maintenu alerte jusqu'à mon âge.Auteur : Edgar Morin - Source : Grand entretien, France Info, le 08 juillet 2021
- L'état de l'animal que la mort naturelle va anéantir se rapproche de celui où il se trouvait dans le sein de sa mère, et même celui du végétal, qui ne vit qu'au-dedans, et pour qui toute la nature est en silence.Auteur : Marie François Xavier Bichat - Source : Recherche physiologiques sur la vie et la mort (1800)
- Au pied du Teide et sous la garde du plus grand dragonnier du monde la vallée de la Orotava reflète dans un ciel de perle tout le trésor de la vie végétale.Auteur : André Breton - Source : L'Amour fou (1937)
- Toute ma joie de vivre se tient dans cette tension et ce va-et-vient, ce jeu intérieur entre un mal que je sais depuis l'enfance être celui de tous les humains à la fois, à savoir de n'être que cela, humain dans un monde minéral, végétal, animal, divin, et une guérison dont personne ne voudrait, qui me priverait, en cas de réussite, de tout courage, de tout désir, de tout plaisir d'aller toujours au delà; en avant - et dont par intérêt bien compris depuis longtemps, je ne veux pas Auteur : Pierre Guyotat - Source : Coma
- Seul dans le domaine végétal, le vin permet à l'homme de comprendre la véritable saveur de la terre.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Sans référence
- Qu'avait donc ce jardin pour laisser croire à ses visiteurs que sa splendeur ne pouvait être entièrement naturelle, qu'on avait dû conclure un pacte avec le monde surnaturel pour y faire pousser une telle profusion végétale ?Auteur : Kate Morton - Source : Le jardin des secrets (2009)
- C'était une antipathie de nature, qui croissait avec la régularité d'une expansion végétale et donnait des fruits chaque année.Auteur : Anatole France - Source : Le Mannequin d'osier (1897)
Les mots proches de « vegetal »
Végétabilité Végétable Végétailler Végétal, ale Végétaliser Végétalité Végétant, ante Végétarianisme Végétarien Végétateur, trice Végétatif, ive Végétation Végéter Végéto-animal, aleLes mots débutant par veg Les mots débutant par ve
Végennes végéta végétaient végétais végétait végétal végétal végétale végétales végétalien végétalien végétalienne végétalienne végétalisme végétarien végétarien végétarienne végétariennes végétariens végétariens végétarisme végétât végétatif végétatifs végétation végétations végétative végétatives végétaux végétaux végète végété végètent végéter végéteras végéterez végètes végétons
Les synonymes de « vegetal»
Les synonymes de végétal :- 1. arbre
2. axe
3. plante
4. graminée
5. arbuste
6. sème
7. campe
8. abandonne
synonymes de végétal
Fréquence et usage du mot végétal dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « vegetal » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot végétal dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Végétal ?
Citations végétal Citation sur végétal Poèmes végétal Proverbes végétal Rime avec végétal Définition de végétal
Définition de végétal présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot végétal sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot végétal notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 7 lettres.
