Définition de « chaperon »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot chaperon de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur chaperon pour aider à enrichir la compréhension du mot Chaperon et répondre à la question quelle est la définition de chaperon ?
Une définition simple : (fr-rég|?a.pr??) chaperon (m)
Définitions de « chaperon »
Trésor de la Langue Française informatisé
CHAPERON, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
chaperon \Prononciation ?\ masculin
- Chaperon (coiffure).
Nom commun - français
chaperon \?a.p???\ masculin
- Personne âgée ou grave qui accompagne, par convenance, une jeune fille ou de jeunes gens dans le monde.
- Elle a pour chaperon une vieille tante, qui la suit partout.
- Servir de chaperon.
- Ils traversèrent l'avenue. Lorsqu'elle monta sur le trottoir d'en face, Julia regarda de nouveau à la dérobée son chaperon. ? (Arturo Pérez-Reverte, Le Tableau du maître flamand, page 161, 1990, traduit par Jean-Pierre Quijano, 1993, J.-C. Lattès)
-
(Vieilli) (Désuet) Coiffure de tête autrefois commune aux hommes et aux femmes, qui avait un bourrelet sur le haut et une queue pendante par derrière.
- Cet homme, sans chaperon et sans veste, au regard abruti, à la barbe et aux sourcils tachetés de plâtre, c'était son père! ? (Saintine, Une maitresse de Louis XIII, Paris : Librairie de L. Hachette & Cie, 1858, page 78)
- Pendant la lecture sous la lampe, Dechartre, assis sur le canapé auprès de la comtesse Martin, parlait tout bas de Dante avec enthousiasme, comme du plus sculpteur des poètes. Il vint à rappeler à Thérèse la peinture qu'ils avaient vue ensemble, l'avant-veille, à Santa-Maria, sur la porte des Servi, fresque presque effacée, où l'on devinait à peine encore le poète au chaperon ceint de lauriers, Florence et les sept cercles. ? (Anatole France, Le Lys rouge, 1894, réédition Le Livre de Poche, page 174)
- (Histoire, Militaire) Bonnet de mailles sous le heaume.
-
(Vieilli) (Désuet) Bande de velours, de satin, que les femmes et les filles attachaient sur leur tête.
- Un chaperon en pointe.
-
(Par analogie) Bourrelet particulier au costume des gens de robe, des docteurs, etc., qui a quelque ressemblance avec l'ancien chaperon et qui consiste en un bourrelet circulaire placé sur l'épaule gauche, d'où pend devant et derrière une bande d'étoffe garnie d'hermine à son extrémité.
- La couleur du chaperon diffère quelquefois de celle de la robe.
- (Vieilli) (Religion) Camail de certains religieux.
-
(Par analogie) (Fauconnerie) Espèce de coiffe de cuir dont on couvre la tête et les yeux des oiseaux de leurre
- Paul descend du véhicule, ouvre la porte arrière, détache l'oiseau et lui retire son chaperon, un petit masque de cuir qui bloque la vue et qui permet de tranquilliser le faucon. ? (Vicky Boutin Un fauconnier au service des avions de chasse de Bagotville, radio-canada.ca, 2 décembre 2020)
-
(Architecture) Haut d'une muraille de clôture, fait en forme de toit, en dos d'âne, pour l'écoulement des eaux.
- Aux arêtes des toitures scintillent des chaperons en fer-blanc d'un vif éclat métallique. ? (Théophile Gautier, Ce qu'on peut voir en six jours, 1858, réédition Nicolas Chadun, page 27)
- Au bout de l'avenue, une muraille m'arrêta. Je montai sur une tombe, et quand je fus pendu au chaperon, de l'autre côté du mur, je me laissai aller. La chute fut rude. ? (Émile Zola, La Mort d'Olivier Bécaille, 1879)
- Quand nous longions des jardins, nous voyions les thyrses des lilas rougir au milieu de la verdure tendre du feuillage, et si une brise agitait l'air calme, il nous tombait sur la tête, de dessus le chaperon des vieux murs, des pétales de ravenelles jaunes. ? (Hector Malot, Sans famille, 1878)
- Dans le mur de l'espalier, ils avaient voulu faire un arceau sous lequel on découvrirait la perspective. Comme le chaperon ne pouvait se tenir suspendu, il en était résulté une brèche énorme, avec des ruines par terre. ? (Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Lemerre, Paris, 1881)
- (Histoire) Dessus d'une potence.
- (Histoire, Militaire) Cuir qui préservait de la pluie la détente d'un pistolet.
- (Histoire, Militaire) Petit toit pour couvrir la lumière d'un canon.
- (Imprimerie) (Vieilli) Liasse de feuilles qui était ajoutée au nombre fixé pour l'impression d'un ouvrage.
- (Par extension) Feuilles de passe.
- (Par extension) Égratignure au papier.
- (Imprimerie) (Vieilli) Dessus d'une presse à estampes.
-
(Biologie) Protéine auxiliaire servant à assister d'autres protéines à se replier correctement.
- Les protéines de choc thermique sont des chaperons.
- (Entomologie) Chaperon.
-
(Héraldique) Meuble représentant le vêtement du même nom dans les armoiries. Il est généralement représenté avec un lien autour du cou pour le maintenir fermé et une longue pointe derrière la tête. Il est orienté à dextre. À rapprocher de bonnet phrygien et bonnet albanais.
 Armoiries avec 3 chaperons (sens héraldique)
Armoiries avec 3 chaperons (sens héraldique)- D'argent à la bande de gueules, chargée de trois chaperons d'or, qui est de la famille Harzee du Luxembourg ? voir illustration « armoiries avec 3 chaperons »
- (Technique) Pièce métallique terminant les extrémités de lame de scie et permettant de les fixer et de les tendre sur un bâtit.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Personne âgée ou grave qui accompagne, par convenance, une jeune fille ou une jeune femme dans le monde. Elle a pour chaperon une vieille tante, qui la suit partout. Servir de chaperon. Il se disait d'une Coiffure de tête autrefois commune aux hommes et aux femmes, qui avait un bourrelet sur le haut et une queue pendante par derrière. Il s'est dit aussi d'une Bande de velours, de satin, que les femmes et les filles attachaient sur leur tête. Chaperon en pointe. Il se dit encore par analogie d'un Bourrelet particulier au costume des gens de robe, des docteurs, etc., qui a quelque ressemblance avec l'ancien chaperon et qui consiste en un bourrelet circulaire placé sur l'épaule gauche, d'où pend devant et derrière une bande d'étoffe garnie d'hermine à son extrémité. La couleur du chaperon diffère quelquefois de celle de la robe. Il se dit encore par analogie, en termes de Fauconnerie, de l'Espèce de coiffe de cuir dont on couvre la tête et les yeux des oiseaux de leurre; en termes d'Architecture, il désigne le Haut d'une muraille de clôture, fait en forme de toit, en dos d'âne, pour l'écoulement des eaux.
Littré
-
1Sorte de chape.
Les chaperons étaient autrefois des habits, comme ils le sont encore à présent, servant aux vieilles femmes en de certains pays
, J. B. Thiers, Hist. des perruques, ch. VI. -
2Coiffure à bourrelet et à queue que portaient les hommes et les femmes?; s'est dit aussi d'une bande d'étoffe que les femmes attachaient sur leur tête.
Bien que d'un cabinet sortît un petit c?ur Avec son chaperon?
, Régnier, Sat. X.Quand autour du roi quelqu'un avalait [abaissait] son chaperon, les plus près du roi lui faisaient place, c'était une marque qu'il voulait parler au roi
, Saint-Simon, 73, 198.Si tu voulais, Madeleine, Au lieu de la marjolaine Qui pare ton chaperon, Tu porterais la couronne
, Hugo, Ball. 9.C'était une coiffure de tête qui avait un bourrelet sur le haut et une queue pendante sur l'épaule, que portaient les chevaliers de l'Étoile que le roi Jean institua
, Choisi, Hist. du roi Jean, liv. IV, ch. 2, dans RICHELET.Le chaperon était aussi autrefois une couverture de tête des ecclésiastiques?; mais il y a plus de deux cents ans qu'ils n'en portent plus à l'église
, J. B. Thiers, Hist. des perruques, ch. IV. -
3Bourrelet circulaire à pendants d'étoffe garnis d'hermine que portent sur l'épaule gauche les gens de robe, docteurs, etc.
L'ornement relevé en broderie, qui est au dos d'une chape.
Terme de blason. Ancien habillement de tête en forme de capuchon.
-
4 Fig. Personne âgée ou grave qui accompagne une jeune femme par bienséance, et comme pour répondre de sa conduite?; locution prise de ce que cette personne couvre, protége comme un chaperon. Elle a pour chaperon une vieille tante qui la suit partout.
Monseigneur répondit que lui et une dame d'honneur serviraient bien de chaperons [aux dames]
, Saint-Simon, 275, 218. -
5 Terme de fauconnerie. Cuir dont on coiffe les oiseaux de leurre.
Terme de sellier. Pièce de cuir qui recouvre les fourreaux des pistolets pour les garantir de la pluie.
Terme d'architecture. Disposition en toit d'un mur de clôture pour prévenir les dégradations causées par la pluie.
Terme d'art militaire. Petit toit qu'on place sur la lumière d'un canon.
Terme de charpentier. Flache au droit d'une mortaise.
- 6Boîte de cartier.
- 7 Terme d'agriculture. Fragment qui échappe au fléau et se retrouve lors du vannage.
-
8 Terme d'imprimerie. Feuilles de tirage en surnombre pour remplacer les feuilles gâtées. On dit plutôt aujourd'hui, main de passe.
Dans les imprimeries d'estampes, le dessus de la presse.
Terme de papeterie. Égratignure au papier.
- 9 Terme de botanique. Chaperon de moine, aconit napel.
- 10Les chaperons, nom des gens de Paris qui, au milieu du XIVe siècle, tenaient le parti de Marcel, prévôt des marchands, et s'opposaient à la rentrée du Dauphin.
HISTORIQUE
XIIe s. Parlez à moi, sire au chaperon large
, Li coronemens Looys, 468.
XIIIe s. Moult li avez mal despecié Son chaperon delez la joe
, Ren. 6207. De quel ordre volez vos estre, Qui rouge chaperon avez??
ib. 10415. Et par si grant devocion Faisoient leur confession, Que deux testes avoit ensemble En ung chaperon, ce me semble
, la Rose, 12268. Osteiz vos chaperons, tendeiz les oreilles, regardez mes herbes
, Rutebeuf, 257. Je voi si l'un vers l'autre tendre Qu'en un chaperon a deux testes
, Rutebeuf, 194. Dont [donc] fu li chaperons fors de son chief levés, Si a tiré sa barbe, cent poils en a osté
, Ch. d'Ant. V, 835. Et l'autre m'aporta un chaperon, que je mis en ma teste
, Joinville, 240.
XIVe s. Se nous veons deux testes metre en un caperon, Nous leur dirons que c'est pour faire traïson
, Baud. de Seb. VII, 351. Quant le juges verra devant lui un bricon, Qui male cote aura et mauvais chaperon
, ib. XII, 17. Le faulcon doit avoir ung chaperon de bon cuir, bien faict et bien enfourné, affin qu'il tienne assez à sa teste
, Modus, f° LXXVIII, verso.
XVe s. Et venoient aucunes fois aux murs et aux creneaux et les frottoient et passoient de leurs chaperons par depit
, Froissart, I, I, 186. Quand ils furent là venus, messire Agnos osta son chaperon tout jus, et les salua bellement l'un après l'autre
, Froissart, I, I, 242. Elles ne lui coustoient non plus que s'on les prenoit en la cornette de son chaperon
, Louis XI, Nouv. LXV. Maintenant a trois ans ou environ, qu'une assez bonne aventure advint à un chaperon fourré du Parlement de Paris
, Louis XI, ib. LXVII.
XVIe s. Le chaperon d'une damoiselle
, Rabelais, Garg. I, 13. Il faisoit fort bonne chere à une femme de chambre à chaperon, qu'elle avoit
, Marguerite de Navarre, Nouv. LIX. Mais pensez que ce ne fut pas sans lui donner dronos et chaperon de mesme [la rosser complétement]
, Despériers, Contes, LXII. Il fait bon voir le bec de leurs chapprons antiques
, Du Bellay, J. VI, 35, recto. Faut qu'autour de la trepane [trépan] y ait un chaperon, à fin qu'elle ne puisse passer et couper l'os plus qu'on ne voudra
, Paré, VIII, 20.
Encyclopédie, 1re édition
CHAPERON, s. m. (Hist. mod.) ancienne coëffure ordinaire en France, qui a duré jusqu'aux regnes de Charles V. VI. & VII. sous lesquels on portoit des chaperons à queue, que les docteurs & bacheliers ont retenu pour marque de leurs degrés, & les ont fait descendre de la tête sur les épaules.
Le chaperon fut, selon Pasquier, « un affeublement ordinaire de tête à nos anciens ; chose que l'on peut aisément recueillir par le mot chaperonner, dont nous usons ordinairement encore aujourd'hui pour bonneter, &c. Or, que les anciens usassent de chaperons au lieu de bonnets, nous l'apprenons mêmement de nos annales ; quand Charles V. pendant la prison du roi Jean son pere, étant régent sur la France, à peine put se garantir de la fureur des Parisiens pour un décri des monnoies qu'il fit lors faire ; & eût été en très-grand danger de sa personne, sans un chaperon mi-parti de pers & rouge que Marcel, lors prevôt des marchands, lui mit sur la tête ; & afin que l'on ne se fasse point accroire qu'il n'y eût que les grands & puissans qui portassent le chaperon, Me Alain Chartier en donne avertissement en l'histoire de Charles VII. traitant de l'an 1449 ; où il est dit que le roi, après avoir repris la ville de Roüen, fit crier que tous hommes grands & petits, portassent la croix blanche sur la robe, ou le chaperon. Il finit en disant : depuis petit-à-petit s'abolit cette usance ; premierement entre ceux du menu peuple, & successivement entre les plus grands, lesquels par une forme de mieux séance commencerent de charger petits bonnets ronds, portant lors le chaperon sur les épaules, pour le reprendre toutes & tant de fois que bon leur sembleroit, &c. Et comme toutes choses par traites & successions de tems tombent en non-chaloir, ainsi s'est du tout laissé la coûtume de ce chaperon, & est seulement demeurée pardevers les gens de palais & maîtres-ès-arts, qui encore portent leur chaperon sur les épaules, & leurs bonnets ronds sur leurs têtes ». Voilà un passage assez instructif sur les chaperons d'autrefois, pour éviter au lecteur la peine de plus amples recherches. Cet article est de M. le chevalier de Jaucourt.
On s'en est servi en France jusqu'au regne de Charles VI. où l'on voit que les factions des Armagnacs & des Bourguignons étoient distinguées par le chaperon, & obligeoient même ce foible prince à porter le leur selon qu'elles prédominoient.
Ce chaperon ancien est resté dans l'ordre monastique ; mais dans la suite des tems on lui a fait changer de forme, & il est resté aux docteurs dans quelque faculté que ce soit, & même aux licentiés : cependant avec quelque différence de ceux des licentiés. On l'a fourré ou doublé d'hermine, pour montrer la dignité du doctorat.
Ce nom a passé de-là à de certains petits écussons & autres ornemens funebres, qu'on met sur le devant de la tête des chevaux qui tirent le cercueil dans les pompes funebres ; ceux mêmes qui dans ces sortes de cérémonies représentent les hérauts, ou font d'autres fonctions, ont encore cette sorte de chaperon, mais sans hermine. (a).
Chaperons, (Hist. mod.) nom de factieux. Il y a eu deux factions en France, dont les partisans ont été appellés Chaperons, à cause, dit-on, des chaperons qu'ils portoient. Mais comme c'étoit la mode, & même une mode qui a subsisté jusqu'à Charles VII. lequel fit un commandement à tout homme de porter une croix sur sa robe ou sur son chaperon, il faut que ce mot ait une autre origine qui est inconnue. Quoi qu'il en soit, les premiers factieux de ce nom se formerent sous le regne du roi Jean en 1358 ; ils portoient un chaperon mi-parti de rouge & de bleu. Les seconds parurent en 1413 sous Charles VI : ceux-ci avoient un chaperon blanc, qu'ils offrirent au duc de Guienne. Jean de Troyes, Chirurgien de profession & chef de cette sédition, osa même présenter le chaperon blanc au roi lorsqu'il alloit à Notre-Dame. Voyez Mezeray.
Il s'éleva en Flandres sous le comte Louis, dit de Malle, en 1566, une troisieme faction de chaperons blancs, à cause des impositions excessives qu'on voulut mettre dans le pays, pour rétablir les finances épuisées par les libéralités sans bornes qu'on avoit indistinctement prodiguées. Cet article est de M. le chevalier de Jaucourt.
Chaperon, en Architecture, c'est la couverture d'un mur qui a deux égoûts ou larmiers, lorsqu'il est de clôture, ou mitoyen, & qu'il appartient à deux propriétaires ; mais qui n'a qu'un égoût dont la chûte est du côté de la propriété, quand il appartient à un seul propriétaire. On appelle chaperon en bahut, celui dont le contour est bombé : ces sortes de chaperons sont quelquefois faits de dales de pierre, ou recouverts de plomb, d'ardoise, ou de tuile. On dit chaperonner, pour faire un chaperon. (P)
Chaperon, outil de Cartier, c'est une espece de boîte de bois qui n'a point de couvercle, & à qui il manque un de ses côtés. Cette boîte est posée sur l'établi des coupeurs, & sert à mettre les cartes à mesure que l'ouvrier les a coupées. Voyez la figure de cette boîte sur l'établi de la figure 4. Pl. du Cartier, qui représente le coupeur.
Chaperon, (Eperonn.) on appelle ainsi le fond qui termine l'embouchure à écache, & toutes les autres qui ne sont pas à canon, & qui assemble l'embouchure avec la branche du côté du banquet. Le chaperon est rond aux embouchures à écache, & ovale aux autres. Ce qui s'appelle chaperon dans ces sortes d'embouchures, est appellé fonceau dans celles à canon. Voyez Fonceau, Canon, &c.
Chaperon est aussi le cuir qui couvre les fourreaux de pistolets, pour les garantir de la pluie.
Chaperon, parmi les Horlogers, signifie en général une plaque ronde qui a un canon, & qui se monte ordinairement sur l'extrémité du pivot d'une roue.
Ils appellent plus particulierement chaperon, ou roue de compte, dans les pendules sonnantes, une plaque ronde, fig. 13. Pl. III. de l'Horlogerie, divisée en onze parties inégales ou dents, 2, 3, 4, &c. qui reçoit dans ses entailles l'extrémité de la détente, son usage est de faire sonner à la pendule un nombre de coups déterminés. Voyez l'article Sonnerie, où l'on explique comment cela se fait, & comment on divise cette roue.
Cette piece est tantôt portée par l'extrémité du pivot de la seconde roue qui déborde cette platine, & sur laquelle elle entre à quarré ; & tantôt sur une tige ou un pivot fixé sur cette platine : dans le premier cas, elle tourne avec la seconde roue ; dans le second, un pignon porté sur cette même seconde roue, & qui engrene dans une autre roue adaptée & rivée avec cette piece, la fait tourner. (T)
Chaperon, terme usité dans l'Imprimerie ; c'est un nombre de feuilles ou de mains de papier que l'on ajoûte au nombre que l'on souhaite faire imprimer : elles servent pour les épreuves, la marge, la tierce, & pour remplacer les feuilles défectueuses, celles qui se trouvent de moins sur les rames, & celles qui se gâtent dans le travail de l'impression.
Chaperon, (Fauconn.) morceau de cuir dont on couvre la tête des oiseaux de leurre, pour les affaiter. Voyez Affaisser, & lisez Affaiter ; c'est une faute d'impression. Il y a différens chaperons pour différens oiseaux : on les distingue par des points, depuis le numéro un jusqu'au numéro quatre. Le premier, d'un point, est pour le tiercelet de faucon. L'oiseau qui souffre sans peine le chaperon, s'appelle bon chaperonnier.
Étymologie de « chaperon »
Provenç. capairo?; bas-lat. caparo, capero, capiro?; dérivé de capa (voy. CHAPE).
- Diminutif de chape avec le suffixe -on.
- (Sens 1) Le terme provient du fait que cette personne portait fréquemment un vêtement avec un chaperon pour se couvrir la tête.
chaperon au Scrabble
Le mot chaperon vaut 15 points au Scrabble.
Informations sur le mot chaperon - 8 lettres, 3 voyelles, 5 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot chaperon au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
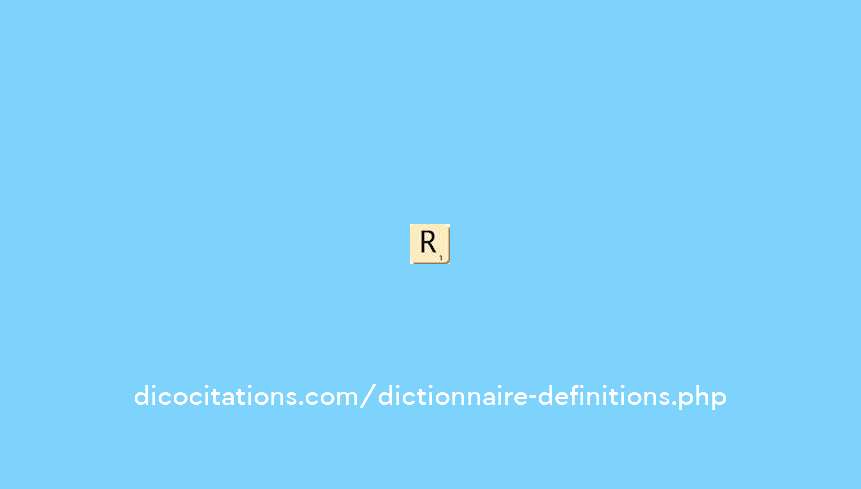
Les rimes de « chaperon »
On recherche une rime en R§ .
Les rimes de chaperon peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en R§
Rimes de hydrox Rimes de divertirons Rimes de remarieront Rimes de soignerons Rimes de électron Rimes de aurons Rimes de pique-niquerons Rimes de craqueront Rimes de marieront Rimes de écarteront Rimes de décriront Rimes de demeureront Rimes de ferrons Rimes de déplorerons Rimes de commanderont Rimes de bougeront Rimes de viendrons Rimes de relaieront Rimes de transporterons Rimes de enrichiront Rimes de explorons Rimes de désignerons Rimes de mobiliserons Rimes de arriverons Rimes de disperserons Rimes de raccourcirons Rimes de cyclotron Rimes de basculeront Rimes de barrons Rimes de romps Rimes de ressusciteront Rimes de cavaleront Rimes de cuiront Rimes de accepteront Rimes de affirmeront Rimes de acquerront Rimes de retireront Rimes de redoubleront Rimes de éclaireront Rimes de hanteront Rimes de piétineront Rimes de expirons Rimes de rouleront Rimes de inventeront Rimes de stimuleront Rimes de expulseront Rimes de coffrons Rimes de fanfaron Rimes de étendrons Rimes de mascaronMots du jour
hydrox divertirons remarieront soignerons électron aurons pique-niquerons craqueront marieront écarteront décriront demeureront ferrons déplorerons commanderont bougeront viendrons relaieront transporterons enrichiront explorons désignerons mobiliserons arriverons disperserons raccourcirons cyclotron basculeront barrons romps ressusciteront cavaleront cuiront accepteront affirmeront acquerront retireront redoubleront éclaireront hanteront piétineront expirons rouleront inventeront stimuleront expulseront coffrons fanfaron étendrons mascaron
Les citations sur « chaperon »
- Jusqu'à présent, je pensais que les jeunes Anglaises étaient des créatures victoriennes, douces et démodées, incapables de faire trois pas sans un valet de pied ou un chaperon. Je crois que mes renseignements n'étaient pas à jour !Auteur : Agatha Christie - Source : Mr Brown (1922)
- Le loup déroule le tapis rouge,
Ce qui reste du Chaperon Rouge.Auteur : Charles de Leusse - Source : Respire (2004) - Cet homme est dangereux, il ne complimente que pour mieux croquer, comme le loup du Petit Chaperon rouge!Auteur : Maurice Denuzière - Source : Louisiane, III - Bagatelle (1981)
- J'éprouve une attirance pour les êtres funestes. C'est un désir enfantin de rencontrer le loup, d'avoir peur. Enfant, je préférais La petite marchande d'allumettes et ses dernières munitions au Chaperon rouge.Auteur : Linda Lê - Source : Dans l'hebdomadaire l'Express, 1999.
- Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857), II, 3
- Nous sommes toutes éreintées, nous, mais qui reconnaîtrait en mademoiselle la duègne qui nous chaperonna ces trois jours?Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Claudine à l'école
- Quand le progrès du progrès aura rendu la conflagration des bibliothèques inévitables, car la quintessence de tous les livres se trouvera nécessairement dans la charte de la perfectibilité, comme elle était dans l’Alcoran, je ne demanderai grâce que pour le Chat Botté, le Chaperon, Peau-d’Âne, et les Mille et Une Nuits ; il ne faut rien de plus en littérature pour le bien-être moral d’un peuple intelligent et sensible. On pourrait excepter Homère en faveur de l’Odyssée, mais il faudrait être impitoyable pour l’Histoire, car il y a, quoiqu’on en dise, des vérités dans l’Histoire : les dates et les noms propres.Auteur : Charles Nodier - Source : Jean-François-les-bas-bleus et autres Contes (1887)
- L'histoire du petit Chaperon Rouge est une grande leçon aux hommes d'action qui portent le petit pot de beurre et ne doivent pas savoir s'il est des noisettes dans les sentiers du bois.Auteur : Anatole France - Source : Le jardin d'Epicure (1894)
Les mots proches de « chaperon »
Chabichou Chablage Chableur Chablis Chabot Chabrol et chabrot Chacal Chaconne Chacun, chacune Chacunière Chafaud Chagrin Chagrin Chagrin, ine Chagrinant, ante Chagrinement Chagriner Chaillant Chaille Chailleux, euse Chaillot ou chaillou Chaîne Chaînette Chaînier ou chaîniste Chaînon Chaintre Chair Chair Chaire Chaise Chalaine Chaland, ande Chaland ou chalan Chalandise Chalcide Chalcidique Chaldaïque Chaldéen, enne Châle Chalet Chaleur Chaleureusement Chaleureux, euse Chalinoptère Châlit Chaloir Chalon Chalosse Chalot ChaloupeLes mots débutant par cha Les mots débutant par ch
cha-cha-cha chabanais Chabanais Chabanne Chabestan Chabeuil chabichou chabler chablis Chablis chaboisseaux Châbons chabot chabots Chabottes Chabottonnes Chabournay Chabrac chabraque Chabreloche Chabrignac Chabrillan Chabris chabrot chacal chacals Chacé Chacenay chachlik chaconne Chacrise chacun chacune Chadeleuf Chadenac Chadenet Chadrac Chadron Chadurie chafaud chafauds Chaffal Chaffaut-Saint-Jurson Chaffois chafouin chafouin chafouine chafouins chafouins chagatte
Les synonymes de « chaperon»
Les synonymes de chaperon :- 1. duègne
2. gouvernante
3. nurse
4. domestique
5. nourrice
6. servante
synonymes de chaperon
Fréquence et usage du mot chaperon dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « chaperon » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot chaperon dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Chaperon ?
Citations chaperon Citation sur chaperon Poèmes chaperon Proverbes chaperon Rime avec chaperon Définition de chaperon
Définition de chaperon présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot chaperon sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot chaperon notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.

