La définition de Harmonique du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Harmonique
Nature : adj.
Prononciation : ar-mo-ni-k'
Etymologie : Provenç. armonic ; espagn. et ital. armonico ; du lat. harmonicus, le grec (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de harmonique de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec harmonique pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Harmonique ?
La définition de Harmonique
Dont toutes les parties concourent à un même but ou effet.
Toutes les définitions de « harmonique »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. T. de Musique. Qui a rapport à l'harmonie. Il se dit aussi, en termes d'Acoustique, de Tons apparentés entre eux, l'un ayant engendré les autres et tous présentant alors entre eux des relations déterminées de hauteur. Sons harmoniques concomitants. Intervalles, rapports harmoniques. Génération harmonique des sons. Les divisions harmoniques du monocorde. Échelle harmonique ou mieux diatonique, La succession des notes de la gamme. Sons harmoniques se dit quelquefois des Sons flûtés qu'on tire d'un instrument par divers procédés. Notes harmoniques, Celles qui forment entre elles des accords consonants. En termes de Mathématiques, on dit que trois nombres sont en proportion harmonique quand le premier est au troisième comme la différence entre le premier et le second est à la différence entre le second et le troisième.
HARMONIQUE s'emploie aussi comme nom masculin pour désigner les sons harmoniques engendrés par le son fondamental. Les harmoniques d'un son. Le son fondamental et ses harmoniques, sont entre eux, pour la fréquence des vibrations, comme les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
Littré
-
1Dont toutes les parties concourent à un même but ou effet.
Le temps est venu qu'il faut remettre les anciens ordres et cette relation harmonique qui doit exister entre un commandement légitime et une obéissance raisonnable
, La Rochefoucauld, Mém. 26.Un ouvrage ne peut faire impression sur l'esprit du lecteur, il ne peut se faire sentir que par la dépendance harmonique des idées
, Buffon, Morceaux chois. p. 5.Terme de l'école fouriériste. Qui appartient à l'harmonie, qui est réglé selon les principes harmoniens.
-
2 Terme d'acoustique. Sons harmoniques, sons produits par la division spontanée d'une corde vibrante, et qui s'accordent avec le son fondamental?; c'est l'octave, la douzième, la double octave, la dix-septième, la dix-neuvième et la triple octave.
On peut donner la raison du plaisir que font les sons harmoniques?: ils consistent dans la proportion du son fondamental aux autres sons
, Buffon, De l'ouïe.Substantivement, au masculin. Un harmonique. Un son et ses harmoniques.
Fig.
?Une tête était mal timbrée, si le son principal qu'elle rendait n'avait dans la société aucun harmonique
, Diderot, Lett. sur les sourds et muets.Substantivement, au féminin. Les harmoniques, les cordes harmoniques.
Échelle harmonique, succession de sons qui s'engendrent suivant des rapports constants.
Terme de musique. Qui appartient à l'harmonie. Marche harmonique.
Sons harmoniques, se dit quelquefois des sons flûtés que l'on tire d'un instrument par divers procédés. Les sons harmoniques se produisent dans les instruments à cordes et à archet en effleurant la corde du doigt, au lieu de la comprimer sur la table du manche comme on fait pour les sons pleins.
Notes harmoniques, notes formant la série des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5? c'est-à-dire une série où la deuxième note est deux fois plus aiguë que la première, la troisième trois fois, et ainsi de suite.
-
3 Terme de mathématique. Division harmonique d'une ligne, division telle que les segments soient dans un rapport non fractionnaire.
Points harmoniques, points d'une droite déterminant des segments qui donnent lieu à une proportion harmonique.
Faisceau harmonique, lignes droites partant d'un même point de l'espace et passant par quatre points harmoniques.
Proportion harmonique, proportion dans laquelle le premier terme est au troisième, comme la différence du premier et du second est à la différence du second et du troisième.
HISTORIQUE
XIVe s. Voix armonique, ce est à dire consonante et melodieuse
, Oresme, Thèse de MEUNIER.
XVIe s. ?Ains fault faire comme les harmoniques et musiciens, en rebouchant tousjours la pointe des adverses par la recordation des prosperes
, Amyot, De la tranq. d'âme, 31.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
HARMONIQUE. Ajoutez?: - REM. Voici une définition plus explicite du terme de mathématique?: Division harmonique d'une droite, division de cette ligne par deux points C et D, situés l'un sur la droite, l'autre sur son prolongement, de telle façon que le rapport des distances du point C aux points A origine de la ligne et B terminaison de la ligne soit le même que le rapport des distances du point D aux mêmes points A et B.
Encyclopédie, 1re édition
HARMONIQUE, adjectif, (Musique.) est ce qui appartient à l'harmonie. Proportion harmonique, est celle dont le premier terme est au troisieme, comme la différence du premier au second, est à la différence du second au troisieme. Voyez Proportion.
Harmonique, pris substantivement & au féminin, se dit des sons qui en accompagnent un autre & forment avec lui l'accord parfait : mais il se dit sur-tout des sons concomitans qui naturellement accompagnent toûjours un son quelconque, & le rendent appréciable. Voyez Son. (S)
L'exacte vérité dont nous faisons profession, nous oblige de dire ici que M. Tartini n'est point le premier auteur de la découverte des sons harmoniques graves, comme nous l'avions annoncé au mot Fondamental. M. Romieu, de la société royale des Sciences de Montpellier, nous a appris que dès l'année 1751, il avoit fait part de cette découverte à sa compagnie dans un mémoire imprimé depuis en 1752, & dont l'existence ne nous étoit pas connue.
Nous ignorons si M. Tartini a eu connoissance de ce mémoire ; mais quoi qu'il en soit, on ne peut refuser à M. Romieu la priorité d'invention. Voici l'extrait de son mémoire.
« Ayant voulu accorder un petit tuyau d'orgue sur l'instrument appellé ton, que quelques-uns appellent diapazon ; & les ayant embouchés tous deux pour les faire résonner ensemble, je fus surpris d'entendre indépendamment de leurs deux sons particuliers, un troisieme son grave & fort sensible ; je haussai d'abord le ton du petit tuyau, & il en résulta un son moins grave : ce son, lorsqu'il est trop bas, paroît maigre & un peu bourdonnant ; mais il devient plus net & plus moëlleux, à mesure qu'il est plus élevé.
» Par plusieurs expériences réitérées long-tems après l'observation de ce son grave, faite il y a environ huit ou neuf ans, & que j'ai communiquées à la compagnie le 29 Avril 1751 ; je trouvai qu'il étoit toûjours l'harmonique commun & renversé des deux sons qui le produisoient ; ensorte qu'il avoit pour le nombre de ses vibrations le plus grand commun diviseur des termes de leur rapport. J'observai qu'il disparoissoit, lorsque ces deux sons formoient un intervalle harmonique ; ce qui ne peut arriver autrement, puisque l'harmonique commun se trouvant alors à l'unisson du son le plus grave de l'accord, il n'en devoit résulter rien de nouveau dans l'harmonie, qu'un peu plus d'intensité.
» L'intensité ou sensibilité des sons harmoniques graves varie extrèmement, ainsi que je m'en suis assûré par un grand nombre d'expériences ; on ne les entend point sur le clavessin ; le violon & le violoncelle les donnent assez foibles ; ils se font beaucoup mieux sentir dans un duo de voix de dessus ; les instrumens à vent, les flûtes & les tuyaux à anche de l'orgue, les rendent bien distinctement à la plus haute octave du clavier, & presque point aux octaves moyennes & basses ; ils réussissent encore mieux, si l'on prend les sons de l'accord dans un plus grand degré d'aigu. C'est ce que j'ai observé avec deux petits flageolets, qui sonnoient à la quintuple octave de l'ut moyen du clavessin & même au-delà ; les sons harmoniques graves y ont paru avec tant de force, qu'ils couvroient presque entierement les deux sons de l'accord.
» Toutes ces différences viennent sans doute de l'intensité particuliere des sons de chaque instrument, & de chaque degré d'élévation, soit du son harmonique grave, soit des sons de l'accord : le clavessin a un son foible, & qui se perd à une petite distance ; aussi est-il en défaut pour notre expérience. Au contraire les instrumens à vent, dans leurs sons aigus, se sont entendre de fort loin ; faut-il donc être surpris qu'ils y soient si propres ? Si leurs sons moyens ou graves ne le sont pas, c'est que leurs harmoniques graves tombent dans un trop grand degré de grave, ou que d'eux-mêmes ils n'ont pas beaucoup d'intensité. Pourquoi enfin les sons de l'accord très-aigus sont-ils absorbés par l'harmonique grave lui-même ? Ne seroit-ce pas que leur perception est confuse, à raison de leur trop grande élévation, tandis que l'harmonique grave se trouve dans un état moyen qui n'a pas cet inconvénient.
» La découverte des sons harmoniques graves, nous conduit à des conséquences très-essentielles sur l'harmonie, où ils doivent produire plusieurs effets. Je vais les exposer aussi brievement qu'il me sera possible, pour ne pas abuser plus longtems de l'attention de cette assemblée.
» Il suit de la nature des harmoniques graves, qui nous est à présent connue, 1°. que dans tout accord à plusieurs sons, il en naît autant d'harmoniques graves, qu'on peut combiner deux à deux les sons de l'accord, & que toutes les fois que l'harmonique grave n'est point à une octave quelconque du plus bas des deux sons, mais à une douzieme, dix-septieme, dix-neuvieme, &c. il résulte par l'addition de cet harmonique, un nouvel accord. C'est ainsi que l'accord parfait mineur donne dans le grave un son portant l'accord de tierce & septieme majeures, accompagné de la quinte, & que l'accord de tierce & septieme mineures, aussi accompagné de la quinte, donne dans le grave un son portant l'accord de septieme & neuvieme, tandis que d'un autre côté l'accord parfait majeur, quand même on le rendroit dissonnant en y ajoûtant la septieme majeure, ne donne jamais par son harmonique grave, aucune nouvelle harmonie.
» 2°. Si l'accord est formé de consonnances qui ne soient point harmoniques, ou de dissonnances même les plus dures ; elles se resolvent en leur fondement, & font entendre dans l'harmonique grave, un son qui fait toûjours avec ceux de l'accord un intervalle harmonique, dont l'agrément est, comme l'on sait, supérieur à tout ce que l'harmonie peut nous faire goûter. La seconde & la septieme majeure donnent, par exemple, ce son à la triple octave du-moins aigu, nous avons l'emploi d'une pareille harmonie dans les airs de tambourin, où le dessus d'un flageolet fort élevé, forme souvent avec la basse un accord doux & agréable, quoique composé de ces deux dissonnances, qui seroient presque insupportables, si elles étoient rapprochées, c'est-à-dire, réduites dans la même octave que la basse.
» 3°. Deux ou plusieurs sons qui, chacun en particulier n'ébranloient dans l'air que les particules harmoniques à l'aigu, & qui ne causoient tout-au-plus qu'un leger frémissement aux particules harmoniques au grave, deviennent capables par leur réunion dans les accords, de mettre ces derniers dans un mouvement assez grand pour produire un son sensible, comme il conste par la présence du son harmonique grave.
» 4°. Si les sons d'un accord quelconque sont éloignés entre eux d'un intervalle harmonique, quoiqu'il n'en naisse aucune nouvelle harmonie ; cependant les vibrations du plus grave en sont beaucoup renforcées, & leur résonnance totale n'en acquiert qu'une plus grande intensité. Il y a longtems qu'on s'est apperçû que les sons les plus graves du jeu appellé bourdon dans l'orgue, & qui sont foibles, reçoivent une augmentation notable, lorsqu'ils font accord avec les sons aigus du même jeu ou d'un autre ».
Il paroît qu'en général, suivant les expériences de M. Romieu, l'harmonique grave est plus bas que suivant celles de M. Tartini. Par exemple, on vient de voir que selon M. Romieu, la seconde majeure, ou ton majeur, donnent l'harmonique grave à la triple octave du son le moins aigu ; selon M. Tartini, ce n'est qu'à la double octave ; & ainsi du reste. A cette différence près, qui n'est pas fort essentielle, eu égard à l'identité des octaves, ces deux auteurs sont d'accord.
M. Romieu ajoûte dans une lettre qu'il nous a fait l'honneur de nous écrire, que la fausse quinte donna pour l'harmonique grave la quintuple octave du son le plus aigu des deux ; question que M. Tartini n'avoit pas résolue, & que nous avions proposée au mot Fondamental. il prétend aussi que la distance où l'on doit être des instrumens n'est point limitée, comme M. Tartini le prétend, sur-tout si on fait l'expérience avec des tuyaux d'orgue. Enfin il est faux, selon M. Romieu, que les harmoniques graves soient toûjours la basse fondamentale des deux dessus, ainsi que le prétend M. Tartini. Pour le prouver, M. Romieu nous a envoyé un duo de Lulli, où il a noté la basse des harmoniques & la fondamentale. Ce duo est du quatrieme acte de Roland : Quand on vient dans ce bocage, &c. Les deux basses different en plusieurs endroits, & les harmoniques introduisent souvent dans la basse, selon M. Romieu, un fondement inusité & contraire à toutes les regles, quoique ce duo par sa simplicité & son chant diatonique soit le plus propre à faire paroître la basse fondamentale. Et ce seroit bien autre chose, ajoûte M. Romieu, si on choisissoit un duo où le genre chromatique dominât. Ce dernier point nous paroît mériter beaucoup d'attention. La question n'est pas absolument de savoir si la basse des harmoniques graves donne une basse fondamentale contraire ou non aux regles reçûes ; mais de savoir si cette basse des harmoniques graves produit une basse plus ou moins agréable que la basse fondamentale faite suivant les regles ordinaires. Dans le premier cas, il faudroit renoncer aux regles, & suivre la basse des harmoniques donnée par la nature. Dans le second cas, il resteroit à expliquer comment une basse donnée immédiatement par la nature, ne seroit pas la plus agréable de toutes les basses possibles. (O)
Wiktionnaire
Nom commun - français
harmonique \a?.m?.nik\ masculin
- Sons harmoniques engendrés par le son fondamental.
- Par rapport à la note écrite, la réalité sonore que celle-ci contribue à 'dénoter' se trouve souvent 'dédiscrétisée', dans un bruissement prolongé ; voir aussi (ou plutôt : entendre aussi) les harmoniques incertains, fluctuants, les timbres 'flageolant', ou encore la subversion du système discret par excellence, le tempérament égal, par des effets micro-intervalliques. ? (Gianmario Borio, L'orizzonte filosofico del comporre nel ventesimo secolo, 2003, pages 77-78)
- Le son fondamental et ses harmoniques, sont entre eux, pour la fréquence des vibrations, comme les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
- La note que l'on entend en premier plan, qui correspond à une certaine fréquence, est accompagnée du même coup, de façon moins audible, par toutes ses fréquences multiples entières, et donc par toutes les notes qui leur correspondent, séparées de la note principale par des intervalles d'octave, puis de quinte, puis de tierce, etc. ; ce sont ces harmoniques qui d'ailleurs servent de repère à l'accordeur de piano. ? (Laurent de Wilde, Monk, 1996, collection Folio, page 147)
-
(Mathématiques) (Traitement du signal) Fonctions périodiques simple qui, additionnées, composent un signal complexe.
- La relation période-luminosité des Céphéides a en fait une certaine dispersion, suivant que la pulsation se fait sur le premier harmonique [...] ou sur le fondamental. ? (Evry Schatzman et Françoise Praderie, Les Étoiles, CNRS Éditions, Savoirs actuels, 1990, page 199)
Adjectif - français
harmonique \a?.m?.nik\ masculin et féminin identiques
- (Musique) Qui a rapport à l'harmonie.
-
(Acoustique) Tons apparentés entre eux, l'un ayant engendré les autres et tous présentant alors entre eux des relations déterminées de hauteur.
- Sons harmoniques concomitants.
- Intervalles, rapports harmoniques.
- Génération harmonique des sons.
- Les divisions harmoniques du monocorde.
- Échelle harmonique ou mieux diatonique, la succession des notes de la gamme.
- Sons harmoniques se dit quelquefois des sons flûtés qu'on tire d'un instrument par divers procédés.
- Notes harmoniques, celles qui forment entre elles des accords consonants.
-
(Par analogie)
- Certainement une Italienne. Veuve d'officier sans doute. Quelle décence dans son geste ! quelle tendresse dans son regard ! Comme son front est pur ! Que ses mains sont intelligentes ! Quelle élégance dans sa mise, pourtant si simple? Lafcadio, quand tu n'entendras plus en ton c?ur les harmoniques d'un tel accord, puisse ton c?ur avoir cessé de battre ! ? (André Gide, Les Caves du Vatican, 1914)
-
(Mathématiques) Trois nombres sont en proportion harmonique quand le quotient entre le premier et le second est égal au quotient entre le second et le troisième.
- On dit que le second est la moyenne harmonique du premier et du troisième.
- (Géométrie) Quatre points distincts alignés A, B, C, D sont en division harmonique si et seulement si .
Trésor de la Langue Française informatisé
HARMONIQUE, adj. et subst.
Relatif à l'harmonie.Harmonique au Scrabble
Le mot harmonique vaut 21 points au Scrabble.
Informations sur le mot harmonique - 10 lettres, 5 voyelles, 5 consonnes, 10 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot harmonique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
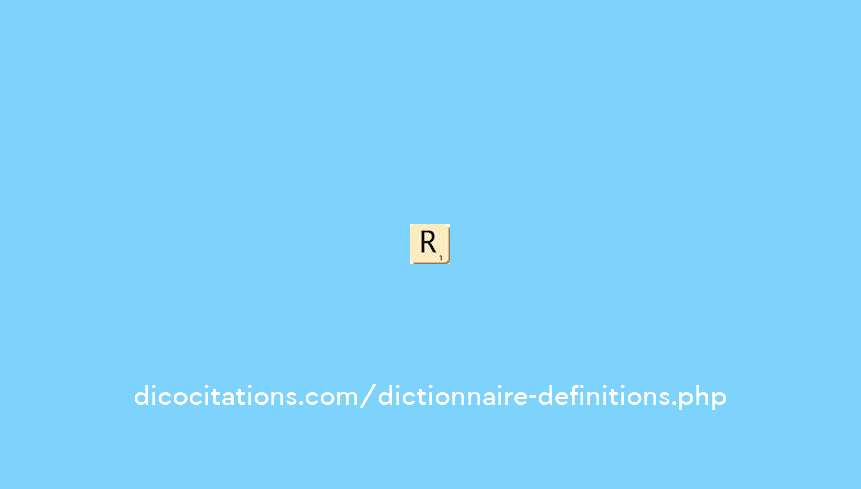
Les mots proches de Harmonique
Harangue Haranguer Harangueur Haras Harassant, ante Harassé, ée Harassement Harasser Harcelage Harcelant, ante Harcelé, ée Harcèlement Harceler Harcèlerie Harde Harde Hardé Harder Hardes Hardi, ie Hardiesse Hardiment Harem Hareng Harengaison Harengère Harengerie Harfang Hargnerie Hargneux, euse Haria Haricot Haricot Haridelle Harmattan Harmonica Harmonie Harmonieux, euse Harmonique Harmoniquement Harmoniser Harmoniste Harnachement Harnacher Harnacheur Harnais ou harnois Haro Harpaille Harpailler (se) Harpe hara-kiri Haramont harangua haranguaient haranguait haranguant harangue harangue harangué haranguée haranguer haranguerais harangues harangués haranguez harari haras harassaient harassant harassant harassante harassantes harassants harasse harassé harassé harassée harassée harassées harassées harassement harassent harasser harassés harassés Haraucourt Haraucourt Haraucourt-sur-Seille Haraumont Haravesnes Haravilliers Haravilliers Harbonnières Harbouey Harcanville harcela harcelai harcelaient harcelais harcelaitMots du jour
Privilégiaire Enjouer Japoniste Entre-toucher (s') Gril Introspectif, ive Saxatile Académisme Argus Replaider
Les citations avec le mot Harmonique
- Il existe en outre une classe d'hommes qui, quoique aussi dysharmoniques que les criminels et les fous, sont indispensables à la société moderne. Ce sont les génies.Auteur : Alexis Carrel - Source : L'Homme, cet inconnu
- Des habitudes aussi simples que lever le bras pour commencer la mesure, pour saisir les notes au vol comme si c'était de papillons de lumière dansant dans l'obscurité, et celle de garder les mains dans un calme attente sur le clavier pour convoquer le miracle de l'accord harmonique, tendaient mystérieusement, jour après jour, à se transformer en petits préceptes de moralité. Auteur : Juan Marsé - Source : Calligraphie des rêves (2011)
- Ni le rêve, ni la rêverie ne sont nécessairement poétiques; ils peuvent l'être: mais des figures formées au hasard ne sont que par hasard des figures harmoniques.Auteur : Paul Valéry - Source : Variété V
- Ce n'est pas là la définition d'une femme. Une femme est un petit animal doux et malin, moitié caprice et moitié raison ; c'est un composé harmonique, où l'on trouve quelquefois bien des dissonances.Auteur : Jean-François Regnard - Source : La Foire Saint-Germain (1695), III, 16
- Sortant de son repos et se distendant jusqu'à l'être, Brahma souffre d'une souffrance qui rend des harmoniques de joie peut-être, mais qui à l'extrémité ultime de la courbe ne s'exprime plus que par un affreux broiement.Auteur : Antonin Artaud - Source : Le Théâtre et son double (1938)
- Ains fault faire comme les harmoniques et musiciens, en rebouchant tousjours la pointe des adverses par la recordation des prosperes.Auteur : Jacques Amyot - Source : De la tranquilité d'âme, 31
- Willett avait compté trente marches lorsqu'il entendit un bruit lointain. Après cela, il arrêta de compter. C'était un cri impie, un sons très bas, insidieux outrage à la nature, comme il ne devrait pas en exister. Parler de mornes gémissements, de pleurs de jugement dernier, de hurlements désespérés de, chœurs tourmentés, de chairs sans âme lacérées par le fouet, ne permettrait pas de décrire la quintessence de son horreur, ni ses harmoniques écœurants jusqu'à l'âme. Auteur : Howard Phillips Lovecraft - Source : L'affaire Charles Dexter Ward
- On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres: les harmoniques de l'oeuvre nous échappent.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : En pèlerin et en étranger (1989)
- De puis Homère, Eschyle et Sophocle, qui représentent la poésie dans sa vitalité, dans sa plénitude et dans son unité harmonique, la décadence et la barbarie ont envahi l'esprit humain.Auteur : Charles Marie René Leconte de Lisle - Source : Poèmes antiques (1852), Préface
- C'est à lui que nous devons cette extension des accords, soit plaqués, soit en arpèges, soit en batterie; ces sinuosités chromatiques et enharmoniques dont ses études offrent de si frappants exemples ...Auteur : Eugène Delacroix - Source : Journal, 28 février 1851
- L'âme de Dieu est mathématique, contrapuntique, harmonique et mélodique. Le diable, envieux et furieux, fait beaucoup de bruit autour pour empêcher qu'on l'entende. Auteur : Philippe Sollers - Source : Grand beau temps. Aphorismes et pensées
- L'anarchie est la reconquête de l'individu, c'est la liberté du développement de l'individu, dans un sens normal et harmonique. On peut la définir d'un mot : l'utilisation spontanée de toutes les énergies humaines, criminellement gaspillées par l'Etat.Auteur : Octave Mirbeau - Source : Combats politiques (1990)
- C'est bien commode, la musique, pour achever de vous convertir. C'est admirablement conçu pour vous rendre cool, sympa, communautaire, harmonique. Ca efface toutes les ombres et les critiques.Auteur : Philippe Muray - Source : L'Empire du Bien (1991)
Les citations du Littré sur Harmonique
- Mettre en parties harmoniques une mélodieAuteur : COUSSEMAKER - Source : l'Art harmonique, p. 180
- Le déchant [dans la musique du moyen âge] était l'art de disposer harmoniquement deux ou plusieurs parties destinées à être chantées ensembleAuteur : COUSSEMAKER - Source : l'Art harmonique, p. 91
- Phrase harmonique dans laquelle une ou plusieurs parties étaient entrecoupées ou interrompues par des silencesAuteur : COUSSEMAKER - Source : l'Art harmonique, p. 83
- Au XIIIe siècle, composition harmonique à deux, trois ou quatre parties, le plus souvent à trois, ayant habituellement pour ténor un fragment de plain-chant, quelquefois un air populaire, avec lequel devaient s'harmoniser les autres parties, selon que le ténor ou l'une des parties servaient de base harmoniqueAuteur : COUSSEMAKER - Source :
- En définitive, on arme le travail contre le capital ; tant mieux, si ces deux puissances sont antagoniques ; mais, si elles sont harmoniques, la lutte est le plus grand des maux qu'on puisse infliger à la sociétéAuteur : FR. BASTIAT - Source : Oeuvr. compl. Paris, 1873, t. II, p. 29
- La viole d'amour a un timbre faible et doux ; elle a quelque chose de séraphique qui tient à la fois de l'alto et des sons harmoniques du violon ; elle convient surtout au style lié, aux mélodies rêveuses, à l'expression des sentiments extatiques et religieux ; M. Meyerbeer l'a placée avec bonheur dans la romance de Raoul au premier acte des HuguenotsAuteur : BERLIOZ - Source : Grand traité d'instrum. et d'orchestr. p. 40
- Il arrive assez souvent dans l'harmonie, que toutes les parties se réunissent sur la même note, et chantent à l'unisson ; or, quand l'unisson est chanté par beaucoup de voix, et attaqué avec une justesse parfaite, les principaux sons harmoniques de la note chantée viennent frapper notre oreille, et, dans ce cas, c'est véritablement de l'harmonie que nous entendonsAuteur : É. CHEVÉ - Source : Méth. élém. d'harmonie, t. I, p. 105
- Le temps est venu qu'il faut remettre les anciens ordres et cette relation harmonique qui doit exister entre un commandement légitime et une obéissance raisonnableAuteur : LAROCHEF. - Source : Mém. 26
- Les trois tetracordes dyatonique, cromatique et enharmoniqueAuteur : ORESME - Source : Thèse de MEUNIER.
- L'univers est l'ensemble de tous les êtres créés ; cet ensemble est systématique ou harmonique ; il ne s'y trouve pas une seule pièce qui n'ait sa raison dans le toutAuteur : BONNET - Source : Paling. XXI, 8
- Il se dit, en Italie, du jeu en sons harmoniques sur le violonAuteur : FÉTIS - Source : Dict. de musique.
- On peut donner la raison du plaisir que font les sons harmoniques : ils consistent dans la proportion du son fondamental aux autres sonsAuteur : BUFF. - Source : De l'ouïe.
- Un ouvrage ne peut faire impression sur l'esprit du lecteur, il ne peut se faire sentir que par la dépendance harmonique des idéesAuteur : BUFF. - Source : Morceaux chois. p. 5
- S'il n'est pas possible de trouver, dans la proportion harmonique, des subdivisions capables d'exprimer les intonations d'une langue telle que la chinoise, qui nous paraît très chantante, où trouverait-on des subdivisions pour une langue presque monotone comme la nôtre ?Auteur : DUCLOS - Source : Mém. act. théâtr. Oeuv. t. IX, p. 351, dans POUGENS.
- Le motet semble dans l'esprit du musicien avoir été une composition dans laquelle on avait la prétention de donner un rôle particulier à chacune des parties dont la réunion devait créer un ensemble harmonique analogue à celui que les artistes modernes sont quelquefois parvenus à produire dans certains trios, quatuors ou choeurs d'opérasAuteur : COUSSEMAKER - Source : l'Art harmonique, p. 60
- ....Ains fault faire comme les harmoniques et musiciens, en rebouchant tousjours la pointe des adverses par la recordation des prosperesAuteur : AMYOT - Source : De la tranq. d'âme, 31
Les mots débutant par Har Les mots débutant par Ha
Une suggestion ou précision pour la définition de Harmonique ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 14h48
H
- Habit - Habitat - Habitude - Haine - Haïr - Hair - Hasard - Hate - Hebergement - Heresie - Heritage - Heroisme - Heros - Heure - Heure - Heureux - Hierarchie - Histoire - Homme - Homme femme - Homme heureux - Homosexualite - Honnête - Honnêteté - Honnêteté - Honneur - Honte - Horizon - Hote - Hotel - Humain - Humanisme - Humanite - Humeur - Humiliation - Humilité - Humilite - Humoristique - Humour - Hypocrisie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur harmonique
Poèmes harmonique
Proverbes harmonique
La définition du mot Harmonique est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Harmonique sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Harmonique présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

