La définition de Tonsuré, ée du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Tonsuré, ée
Nature : part. passé de tonsu
Prononciation : ton-su-ré, rée
Etymologie : Prov. esp. et ital. tonsura ; du lat. tonsura, de tonsum, supin de tondere, tondre.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de tonsuré, ée de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec tonsuré, ée pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Tonsuré, ée ?
La définition de Tonsuré, ée
Toutes les définitions de « tonsuré, ée »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Couronne que l'on fait sur la tête aux clercs, prêtres, moines, etc., en leur rasant les cheveux en rond. Il a fait faire sa tonsure. Porter la tonsure. Il se dit aussi de la Cérémonie de l'Église catholique par laquelle l'évêque introduit un homme dans l'état ecclésiastique et lui donne le premier degré de la cléricature en lui coupant les cheveux au sommet de la tête. Tonsure cléricale. Donner la tonsure. Recevoir la tonsure. Prendre la tonsure, Entrer dans l'état ecclésiastique.
Littré
-
1Cérémonie de l'Église catholique, par laquelle l'évêque, introduisant un homme dans l'état ecclésiastique, lui donne le premier degré de la cléricature en lui coupant une partie des cheveux. Recevoir la tonsure. Lettres de tonsure.
Prendre la tonsure, entrer dans l'état ecclésiastique.
Bénéfice à simple tonsure, bénéfice que l'on peut posséder n'ayant que la tonsure et sans être obligé de prendre les ordres sacrés et de résider sur les lieux.
Fig. Un docteur, un médecin, un avocat à simple tonsure, un docteur un médecin, un avocat qui n'est pas fort habile.
Par extension. Gentilhomme à simple tonsure, un petit gentilhomme, un pauvre gentilhomme (locution vieillie).
Il [le cardinal de Bouillon] trouva un gentilhomme romain fort à simple tonsure, qui, avec de l'argent, s'était fait faire prince par le pape
, Saint-Simon, 53, 140. -
2Couronne que l'on fait sur la tête aux clercs, sous-diacres, diacres, prêtres, etc. en leur rasant des cheveux. Il a fait faire sa tonsure.
Il n'était pas permis [sous Charlemagne] de porter la tonsure sans appartenir à un évêque
, Voltaire, M?urs, 20.
HISTORIQUE
XVe s. Il disposa aussi de ses benefices, qui n'estoient qu'à simple tonsure
, Louis XI, Nouv. LXVII.
XVIe s. Les uns font la premiere ordre de la tonsure clericale, la derniere de l'evesché
, Calvin, Instit. 1179. Il sentoyt ung doulx prurit des ongles et desgourdissement des braz, ensemble tentation vehemente en son esperit de battre ung sergent ou deuz, pourveu que ilz n'eussent tonsure
, Rabelais, IV, 49.
Encyclopédie, 1re édition
TONSURE, s. f. (Hist. ecclés. & Jurisprud.) dans le sens grammatical & littéral, est l'action de couper les cheveux, & de raser la tête.
Dans un sens abstrait, la tonsure est la privation entiere des cheveux, ou une certaine place dessus la tête dont on a rasé les cheveux en rond.
La tonsure totale a toujours été regardée comme une marque d'infamie, tellement qu'en France anciennement lorsqu'on vouloit déclarer un prince incapable de porter la couronne, on le faisoit tondre & raser.
Chez les Romains une des peines de la femme convaincue d'adultere, étoit d'être enfermée dans un monastere après avoir été tondue ; ce qui s'observe encore parmi nous.
La tonsure prise littéralement en matiere ecclésiastique, est une couronne cléricale que l'on fait derriere la tête aux ecclésiastiques en rasant les cheveux de cette place en forme orbiculaire.
Tous les ecclésiastiques séculiers & réguliers doivent porter la tonsure ; c'est la marque de leur état ; celle des simples clercs, qu'on appelle clercs à simple tonsure, c'est-à-dire, qui n'ont d'autre caractere de l'état ecclésiastique que la tonsure, est la plus petite de toutes. A mesure que l'ecclésiastique avance dans les ordres, on fait sa tonsure plus grande ; celle des prêtres est la plus grande de toutes ; si l'on en excepte les religieux, dont les uns ont la tête entierement rasée ; d'autres ont une simple couronne de cheveux plus ou moins large.
La simple tonsure que l'on donne à ceux qui entrent dans l'état ecclésiastique n'est point un ordre, mais une préparation pour les ordres, & pour ainsi dire, un signe de la prise d'habit ecclésiastique ; l'évêque coupe un peu de cheveux avec des ciseaux à celui qui se présente pour être reçu dans l'état ecclésiastique, & le nouveau clerc récite pendant cette cérémonie ces paroles de David : Seigneur, vous êtes ma portion, c'est vous qui me rendrez mon héritage. Ensuite l'évêque met au clerc le surplis en priant le Seigneur de revêtir du nouvel homme celui qui vient de recevoir la tonsure.
Quelques-uns prétendent que l'on coupe les cheveux aux ecclésiastiques en signe d'adoption ; parce qu'en effet anciennement quand on adoptoit quelqu'un, on lui coupoit un flocon de cheveux ; ce que l'on pratiquoit encore du tems de Charles Martel, lequel envoya Pépin son fils à Luitprand roi des Lombards, pour l'adopter, en lui coupant un flocon de ses cheveux, comme c'étoit la coutume alors.
D'autres disent que c'est en signe de sujétion & de soumission à l'Eglise, & à l'instar de ce qui s'observoit de la part des sujets, lesquels pour marque de soumission envers leur prince, étoient obligés de porter leurs cheveux courts, les princes ayant seuls le droit de les porter longs pour marque de leur dignité.
D'autres encore prétendent que la tonsure a été instituée pour honorer l'affront que ceux d'Antioche voulurent faire à S. Pierre en lui coupant les cheveux, ou bien que cette coutume fut empruntée des Nazaréens qui se faisoient raser la tête, ou que cela fut ainsi établi par les apôtres, & notamment par S. Pierre, qui donna le premier exemple de se raser la tête, en mémoire de la couronne d'épine de Notre-Seigneur.
Selon quelques-uns, l'usage de tonsurer les clercs commença vers l'an 80.
Un auteur du viij. siecle, suivi par Baronius, rapporte un decret de l'an 108, qu'il attribue au pape Anicet, qui ordonne aux clercs de couper leurs cheveux en forme de sphere, suivant le précepte de S. Paul, qui ne permet qu'aux femmes de laisser croître leurs cheveux pour leur ornement.
Ce qui est de certain, c'est que cet usage est fort ancien dans l'Eglise ; le concile de Carthage tenu en 398, peut l'avoir eu en vûe, en défendant aux ecclésiastiques de nourrir leurs cheveux.
Cependant M. de Fleury, en son institution au droit ecclésiastique, dit que dans les premiers siecles de l'Eglise il n'y avoit aucune distinction entre les clercs & les laïcs quant aux cheveux ni à l'habit, & à tout l'extérieur : que c'eût été s'exposer sans besoin à la persécution, qui étoit toujours plus cruelle contre les clercs que contre les simples fideles.
Il ajoute que la liberté de l'Eglise n'apporta point de changement à cet égard, & que plus de 100 ans après, c'est-à-dire l'an 428, le pape S. Célestin témoigne que les évêques même n'avoient rien dans leur habit qui les distinguât du peuple.
Tous les chrétiens latins portoient, suivant M. de Fleury, l'habit ordinaire des Romains qui étoit long, avec les cheveux fort courts & la barbe rase ; les Barbares qui ruinerent l'empire, avoient au contraire des habits courts & serrés & les cheveux longs, & quelques uns de grandes barbes.
Les Romains avoient ces peuples en horreur ; & comme alors tous les clercs étoient romains, ils conserverent soigneusement leur habit, qui devint l'habit clérical ; en sorte que quand les Francs & les autres barbares furent devenus chrétiens, ceux qui embrassoient l'état ecclésiastique faisoient couper leurs cheveux, & prenoient des habits longs.
Vers le même tems, plusieurs évêques & les autres clercs, prirent l'habit que les moines portoient alors, comme étant plus conforme à la modestie chrétienne ; & de-là vient, à ce que l'on croit, dit M. de Fleury, la couronne cléricale, parce qu'il y avoit des moines qui par esprit d'humilité se rasoient le devant de la tête pour se rendre méprisables.
Quoi qu'il en soit, la couronne cléricale étoit déjà en usage vers l'an 500, comme le témoigne Grégoire de Tours.
Dans les cinq premiers siecles où la tonsure fut pratiquée, on ne la conféroit qu'avec les premiers ordres ; ce ne fut que vers la fin du vj. siecle, que l'on commença à la conférer séparément, & avant les ordres.
L'évêque est le seul qui puisse donner la tonsure à ses diocésains séculiers & réguliers ; quelques-uns ont avancé que depuis S. Germain évêque d'Auxerre, qui vivoit dans le v. siecle, les évêques conféroient seuls la tonsure.
Mais il est certain que les abbés prétendent aussi avoir le droit de la donner à leurs religieux ; on trouve quelques canons qui autorisent leur prétention, entre autres, le ch. abbates, qui est du pape Alexandre I V. & est rapporté dans le texte, tit. de privilegiis. Mais s'ils ont joui autrefois en France de ce droit, on peut dire qu'ils l'ont perdu par prescription ; les évêques de France s'étant maintenus dans le droit de conférer seuls la tonsure, même aux réguliers.
Pour recevoir la tonsure, il faut avoir été confirmé ; il faut aussi être instruit au-moins des vérités les plus nécessaires au salut ; il faut aussi savoir lire & écrire.
Le concile de Narbonne en 1551, ne demande que l'âge de sept ans pour la tonsure ; celui de Bordeaux en 1624, exige 12 ans ; dans plusieurs dioceses bien réglés, il est défendu de la recevoir avant 14 ans ; mais à quelque âge que ce soit, il faut que celui qui se présente pour être tonsuré, paroisse le faire dans la vûe de servir Dieu plus particulierement, & non par aucune vûe temporelle, comme pour avoir des benefices.
On appelle bénéfices à simple tonsure, ceux que l'on peut posséder sans avoir d'autre qualité que celle de clerc tonsuré. Voyez M. de Fleury, M. d'Héricour, la Combe, & les Mémoires du Clergé. (A)
Wiktionnaire
Nom commun - français
tonsure \t??.sy?\ féminin
-
(Coiffure, Religion) Couronne traditionnellement dessinée sur la tête des clercs, prêtres, moines, etc. de l'Église catholique romaine, en leur rasant les cheveux en rond.
- Il a fait faire sa tonsure. Porter la tonsure.
-
Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente
Avec le Père Duval, la calotte chantante [...]
En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse
Qu'un soir je l'ai surpris aux genoux de ma maîtresse,
Chantant la mélopée d'une voix qui susurre
Tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure ? ? (Georges Brassens, Les trompettes de la renommée, 1962)
-
(Religion) Cérémonie de l'Église catholique par laquelle l'évêque introduit un homme dans l'état ecclésiastique et lui donne le premier degré de la cléricature en lui coupant les cheveux au sommet de la tête.
- Tonsure cléricale. Donner la tonsure. Recevoir la tonsure.
-
(Par analogie) Calvitie affectant le haut du crâne.
- La tuyauterie frémit aux coudes, puis, soudain soulagée de la concurrence par la fermeture du robinet de la cuisine, rote brusquement et le filet que m'octroyait la pomme, aux trous à demi bouchés par le tartre, devient une lance d'eau trop chaude vivement centrée sur mon début de tonsure. ? (Hervé Bazin, Cri de la chouette, Grasset, 1972, réédition Le Livre de Poche, page 7)
- Un moustachu aux dents gâtées, vieilli par sa tonsure, nous installa dans une salle minuscule [...]. ? (Yann Moix, Reims, Grasset, 2021, p. 154)
Trésor de la Langue Française informatisé
TONSURE, subst. fém.
Tonsuré, ée au Scrabble
Le mot tonsuré, ée vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot tonsure--ee - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot tonsuré, ée au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
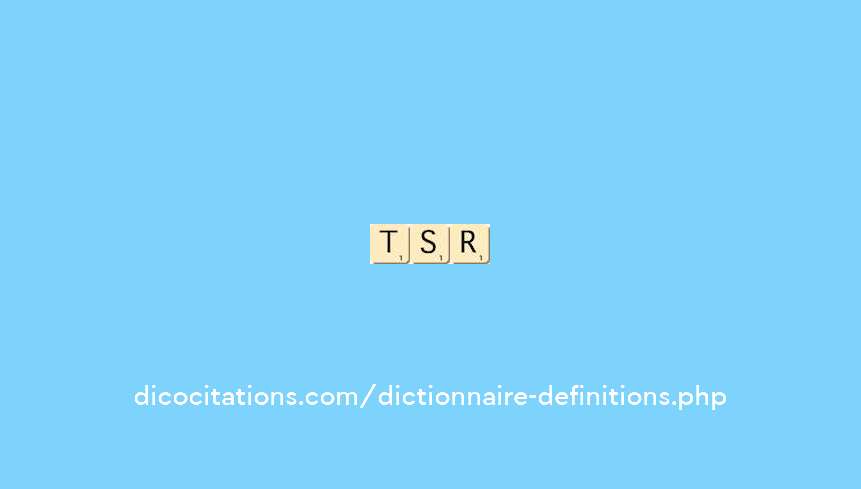
Les mots proches de Tonsuré, ée
Ton Ton Tonal, ale Tonalisation Tonalité Tondaille Tondaison Tondelle Tondeur, euse Tondre Tondu, ue Tonlieu Tonnage Tonnant, ante Tonne Tonneau Tonneler Tonnelet Tonnelet Tonnelier Tonnelle Tonne-mètre Tonner Tonnerre Tonque Tonsille Tonsure Tonsuré, ée Tonsurer Tontine Tonture ton tonal tonale tonalité tonalités tond tondais tondait tondant tonde tondent tondes tondeur tondeuse tondeuses tondit tondons tondrai tondrais tondre tonds tondu tondu tondue tondue tondues tondues tondus tondus toner tong Tonga Tongeren Tongre-Notre-Dame Tongre-Saint-Martin Tongrinne tongs tonic tonicardiaque tonicité tonics tonie tonifiaient tonifiant tonifiant tonifiante tonifiants tonifie tonifient tonifierMots du jour
-
récif cricris autoriseront correctionnelle furetage réarrange iridescent cimiers traînaillons ministères
Les citations avec le mot Tonsuré, ée
Les citations du Littré sur Tonsuré, ée
Les mots débutant par Ton Les mots débutant par To
Une suggestion ou précision pour la définition de Tonsuré, ée ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 20h13
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur tonsuré, ée
Poèmes tonsuré, ée
Proverbes tonsuré, ée
La définition du mot Tonsuré, ée est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Tonsuré, ée sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Tonsuré, ée présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
