La définition de Ton du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Ton
Nature :
Prononciation : ton ; devant une voyelle et une h muette
Etymologie : Picard, ten tin, t'n devant une voyelle ; provenç. tos au nom. sing. et au régime pluriel, ton au régime singulier, ta au féminin, tiei, tei, au nominatif pluriel ; du lat. tuus, qui dérive de tu, tu, toi. Dans l'ancien français tis est le nominatif masculin, ton est le régime ; ti le nominatif pluriel, tes le régime pluriel. Ton représente tuum.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de ton de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec ton pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Ton ?
La définition de Ton
Adj. possessif qui répond au pronom personnel tu, toi. Ton ami, ta femme, tes affaires.
Toutes les définitions de « ton »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
qui répond au pronom personnel Tu, toi. On le met toujours devant le nom ou l'adjectif qui précède le nom. Ton Dieu. Ton père. Ton ami. Ton honneur. Ton seul amour. Il fait au féminin TA. Ta femme. Ta maison. Ta haine. Mais lorsque le nom ou l'adjectif féminin devant lequel il est placé commence par une voyelle ou une h muette, au lieu de ta on dit ton. Ton amitié. Ton habileté. Ton extrême prudence. Il fait au pluriel TES pour les deux genres. Tes parents. Tes amis. Tes affaires. Il s'emploie familièrement pour indiquer des rapports d'habitude, de connaissance, etc. Voilà ton homme. Tu sais ta grammaire.
Littré
-
1Adj. possessif qui répond au pronom personnel tu, toi. Ton ami, ta femme, tes affaires.
Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs
, Corneille, Cid, II, 9.Ton oncle, dis-tu, l'assassin, M'a guéri d'une maladie
, Boileau, Épigr. XX. -
2 Par un solécisme qui s'est introduit au XIVe siècle et qui dès lors a pris force d'usage, ton, au masculin, précède les noms et les adjectifs féminins qui commencent par une voyelle ou par une h muette. Ton heureuse audace.
Quoique ton ennemie, Je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie
, Corneille, Cid, III, 4.L'ancienne langue disait ta et élidait l'a, comme dans l'article la?; t'ame, t'espée.
- 3Ton, ta, tes placés devant les adverbes comparatifs font superlatif. Ton plus fidèle ami.
HISTORIQUE
XIe s. Qu'il devendra, jointes ses mains, tis homs [ton homme]
, Ch. de Rol. XX. Dame, dist ele, jo i ai si grant perte! Ore vivrai en guise de turtrele?; Quant n'ai tun filz, ensemble ot tei voil estre
, St Alexis, XX.
XIIIe s. Vilain, fist Renart, je n'ai cure De tes poucins?; qu'il soient ton
, Ren. 5332. Garde ton cor, panse de t'ame
, Fabl. et contes anc. t III, p. 46.
XIVe s. Et s'il y a femme qui gise [soit en couches], Soit tantost ton enseigne mise Sur le sommet de la maison
, Machaut, p. 115. La quarte branche de ire si est quant par ton ire tu as esmeu Dieu par jurer
, Ménagier, I, 3.
XVe s. Amis, t'amour me contraint
, Chartier, ?uv. p. 773.
XVIe s. ? quand jamais elle ne t'escriroit, Ja pour cela t'amour ne periroit
, Marot, I, 325. Pour ton amour j'ay souffert tant d'ennuis
, Marot, III, 331.
Encyclopédie, 1re édition
TON, s. m. (Hist. nat. & Médec. pratiq.) c'est le nom que les habitans du Brésil ont donné à un insecte assez semblable à la puce par la couleur & par la maniere dont il saute, mais communément beaucoup plus petit, égalant à peine en grosseur un grain de sable. Jean Heurnius le pere, pour exprimer sa petitesse, l'appelle une idée d'animal ; le Brésil n'est pas le seul pays où l'on en trouve, il est répandu dans presque toutes les îles d'Amérique ; & c'est avec raison que Lerius pense que c'est le même insecte qui est connu dans les îles espagnoles sous le nom de nigua. (Hist. du Brésil, chap. ij.) Les tons habitent ordinairement les terreins sablonneux, & surtout ceux qui sont plantés en canne à sucre, & de-là s'élancent sur les passans, attaquent principalement ceux qui ont les piés nuds, se nichent dans la peau & entre les ongles, & y excitent une maladie que les naturels du pays appellent aussi ton. Les François ont donné à ces insectes le nom de chiques ; c'est sous ce nom que M. de Rochefort les décrit & détaille les effets de leur piquure dans son histoire naturelle & morale des îles Antilles. Voyez Chiques. Pour le completer, nous ajouterons ici quelques particularités sur l'espece d'affection qui suit l'entrée de ces animaux dans la peau, & sur les remedes que l'expérience a consacrés comme plus efficaces.
Les piés ne sont pas les seules parties du corps qu'ils attaquent ; souvent ils se glissent entre les ongles des doigts de la main ; & Lerius assure avoir vu aux aisselles & dans d'autres parties molles des marques de leur invasion ; deux jours après que cet insecte a pénétré la peau, le malade y ressent une démangeaison qui dans quelques heures devient si insupportable, qu'il ne peut s'empêcher de se gratter continuellement & avec force, ce qui vraissemblablement contribue à accélerer la formation d'une petite pustule livide ; elle est accompagnée d'une tumeur de la grosseur de la tête d'une épingle, qui bientôt augmente avec des douleurs très-vives jusqu'à celle d'un pois ; on apperçoit alors l'insecte au milieu de la tumeur, qui s'étend quelquefois tout-à-l'entour. Si dans ces entrefaites on n'apporte pas au mal un remede efficace, la tumeur se termine par la gangrene qui fait des progrès plus ou moins rapides ; l'insecte multiplie prodigieusement, & se répand par ce moyen dans les diverses parties du corps où il occasionne les mêmes symptomes ; on a vu des personnes qui faute de secours avoient perdu totalement l'usage des piés & des mains. Thomas Vander Guychten, dont Otho Heurnius donne l'histoire, qu'on trouve dans le quatrieme volume de la Bibliotheque pratique de Manget, liv. XVII. p. 643 & suiv. fut obligé par la maladresse des chirurgiens qui le traitoient, de se faire couper un ou deux doigts du pié qui étoient entierement gangrenés ; & ce ne fut que par les soins long-tems continués de Heurnius, célebre médecin, que les progrès de la gangrene furent arrêtés, & que ce malade obtint une guérison complette.
Le secours le plus approprié & dont l'effet est le plus prompt, est, suivant tous les Historiens, l'extraction du ton. Cette opération est très-douloureuse, mais en même tems immanquable ; les Brésiliens & les Negres la font avec une adresse singuliere & un succès constant, dès qu'ils s'apperçoivent par la tumeur de l'entrée de l'insecte. On tire dans le pays une huile rouge, épaisse, d'un fruit qu'on appelle couroy, qui passe aussi pour très propre à guérir cette maladie ; on l'applique en forme de baume sur les parties où l'insecte est entré ; on vante encore beaucoup l'efficacité des feuilles du tabac, surtout imbibées de suc de citron très-acide ; mais quels que soient les effets de ces différens remedes, il est beaucoup plus prudent de ne pas se mettre dans le cas de les éprouver, & il ne faut que peu d'attention pour y parvenir ; on n'a qu'à ne jamais marcher piés nuds, porter des bas & des gants de peau, se laver souvent & observer en un mot une très-grande propreté. M. de Rochefort conseille aussi dans la même vue d'arroser les appartemens qu'on occupe, avec de l'eau salée.
Ton, (Prose & Poésie.) couleurs, nuances du style, langage qui appartient à chaque ouvrage.
Il y a 1°. le ton du genre : c'est par exemple, du comique ou du tragique ; 2°. le ton du sujet dans le genre : le sujet peut être comique plus ou moins ; 3°. le ton des parties ; chaque partie du sujet a outre le ton général, son ton particulier : une scène est plus fiere & plus vigoureuse qu'une autre : celle-ci est plus molle, plus douce : 4°. le ton de chaque pensée, de chaque idée : toutes les parties, quelque petites qu'elles soient, ont un caractere de propriété qu'il faut leur donner, & c'est ce qui fait le poëte ; sans cela, cur ego poëta salutor. On bat souvent des mains, quand dans une comédie on voit un vers tragique, ou un lyrique dans une tragédie. C'est un beau vers, mais il n'est point où il devroit être.
Il est vrai que la comédie éleve quelquefois le ton, & que la tragédie l'abaisse ; mais il faut observer que quelque essor que prenne la comédie, elle ne devient jamais héroïque. On n'en verra point d'exemple dans Moliere. Il y a toujours quelque nuance du genre qui l'empêche d'être tragique. De même quand la tragédie s'abaisse, elle ne descend pas jusqu'au comique. Qu'on lise la belle scène où Phedre paroît désolée, le style est rompu, abattu, si j'ose m'exprimer ainsi ; c'est toujours une reine qui gémit.
Ce que nous venons de dire du ton en poésie, s'applique également à la prose. Il y a chez elle le ton simple ou familier, le ton médiocre & le ton soutenu, selon le genre de l'ouvrage, le sujet dans le genre & les parties du sujet. Enfin le ton ou le langage d'un conte, d'une lettre, d'une histoire, d'une oraison funebre, doivent être bien différens. Voyez Style. (D. J.)
Ton, (Art oratoire.) inflexion de voix : on a parlé des différentes qualités du ton dans la prononciation & la déclamation, aux mots Prononciation & Déclamation. (D. J.)
Ton, s. m. (Mus.) Ce mot a plusieurs sens en Mus. 1°. Il se prend d'abord pour un intervalle qui caractérise le système & le genre diatonique. Voyez Intervalle. Il y a deux sortes de tons ; savoir le ton majeur dont le rapport est de 8 à 9, & qui résulte de la différence de la quarte à la quinte ; & le ton mineur dont le rapport est de 9 à 10, & qui est la différence de la tierce mineure à la quarte. La génération du ton majeur & celle du ton mineur se trouve également à la seconde quinte ré en commençant par ut ; car la quantité dont ce ré surpasse l'octave du premier ut, est justement dans le rapport de 8 à 9, & celle dont ce même ré est surpassé par le mi tierce majeure de cette octave, est dans le rapport de 9 à 10.
2°. On appelle ton, le degré d'élévation que prennent les voix, ou sur lequel sont montés les instrumens pour exécuter de la musique. C'est en ce sens qu'on dit dans un concert que le ton est trop haut ou trop bas. Dans les églises, il y a le ton du ch?ur pour le plein-chant ; il y a, pour la musique, ton de chapelle & ton d'opéra ; ce dernier n'a rien de fixe, mais est ordinairement plus bas que l'autre qui se regle sur l'orgue.
3°. On fait encore porter le même nom de ton à un instrument qui sert à donner le ton de l'accord à tout un orchestre : cet instrument, que quelques-uns appellent aussi choriste, est un sifflet, qui, au moyen d'une maniere de piston gradué, par lequel on alonge ou raccourcit le tuyau à volonté, vous représente toujours à-peu-près le même son sous la même division. Mais cet à-peu-près qui dépend des variations de l'air, empêche qu'on ne puisse s'assurer d'un ton fixe qui soit toujours le même. Peut-être, depuis que le monde existe, n'a-t-on jamais concerté deux fois exactement sur le même ton. M. Diderot a donné les moyens de perfectionner le ton ; c'est-à-dire, d'avoir un son fixe avec beaucoup plus de précision, en remédiant aux effets des variations de l'air. Voyez Son fixe.
4°. Enfin, ton se prend pour le son de la note, ou corde principale qui sert de fondement à une piece de musique, & sur lequel on dirige l'harmonie, la mélodie & la modulation sur les tons des anciens. Voyez Mode.
Comme notre système moderne est composé de douze cordes ou sons différens, chacun de ces sons peut servir de fondement à un ton, & ce son fondamental s'appelle tonique. Ce sont donc déjà douze tons ; & comme le mode majeur & le mode mineur sont applicables à chaque ton, ce sont vingt-quatre modes dont notre musique est susceptible. Voyez Mode.
Ces tons different entre eux par les divers degrés d'élévation du grave à l'aigu qu'occupent leurs toniques. Ils different encore par les diverses altérations produites dans chaque ton par le tempérament ; de sorte que sur un clavessin bien accordé, une oreille exercée reconnoît sans peine un ton quelconque dont on lui fait entendre la modulation, & ces tons se reconnoissent également sur des clavessins accordés plus haut ou plus bas les uns que les autres ; ce qui montre que cette connoissance vient du-moins autant des diverses modifications que chaque ton reçoit de l'accord total, que du degré d'élévation que sa tonique occupe dans le clavier.
De-là naît une source de variétés & de beautés dans la modulation. De-là naît une diversité & une énergie admirable dans l'expression. De-là naît, en un mot, la faculté d'exciter des sentimens différens avec des accords semblables frappés en différens tons. Faut-il du grave, du majestueux ? l'f ut fa, & les tons majeurs par bémol l'exprimeront noblement. Veut-on animer l'auditeur par une musique gaie & brillante, prenez a-mi la majeur, d-la ré, en un mot, les tons majeurs par dièse. C-sol ut mineur porte la tendresse dans l'ame, f-ut fa mineur va jusqu'au lugubre & au desespoir. En un mot, chaque ton, chaque mode a son expression propre qu'il faut savoir connoître ; & c'est-là un des moyens qui rendent un habile compositeur, maître en quelque maniere des affections de ceux qui l'écoutent ; c'est une espece d'équivalent aux modes anciens, quoique fort éloigné de leur énergie & de leur variété.
C'est pourtant de cette agréable diversité que M. Rameau voudroit priver la musique, en ramenant, autant qu'il est en lui, une égalité & une monotonie entiere dans l'harmonie de chaque mode, par sa regle du tempérament, regle déjà si souvent proposée & abandonnée avant lui. Selon cet auteur, toute l'harmonie en seroit plus parfaite : il est certain cependant qu'on ne peut rien gagner d'un côté, par sa méthode, qu'on ne perde tout autant de l'autre. Et quand on supposeroit que la pureté de l'harmonie y profiteroit de quelque chose, ce que nous sommes bien éloignés de croire, cela nous dédommageroit-il de ce qu'elle nous feroit perdre du côté de l'expression ? Voyez Tempérament. (S)
Tons de l'église, (Musique.) ce sont des manieres déterminées de moduler le plein-chant sur divers sons fondamentaux, & selon certaines regles admises dans toutes les églises où l'on pratique le chant grégorien.
On compte ordinairement huit tons réguliers, dont il y en a quatre authentiques & quatre plagaux. On appelle tons authentiques, ceux où la finale occupe à-peu-près le plus bas degré du chant ; mais si le chant descend jusqu'à trois degrés plus bas que la finale, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on appelle en Musique la dominante ; alors le ton est plagal : on voit qu'il n'y a pas grand mystere à ces mots scientifiques.
Les quatre tons authentiques ont leur finale à un degré l'un de l'autre, selon l'ordre des quatre notes ré, mi, fa, sol ; ainsi le premier ton de ces tons répondant au mode dorien des Grecs, le second répond au phrygien, le troisieme à l'éolien, & non pas au lydien, comme a dit M. l'abbé Brossard, & le dernier au mixo lydien. C'est S. Miroclet, évêque de Milan, ou selon l'opinion la plus reçue, S. Ambroise qui vers l'an 370, choisit ces quatre tons pour en composer le chant de l'église de Milan, & c'est ce qu'on croit le choix & l'approbation de ces deux grands hommes qui ont fait donner à ces quatre tons le nom d'authentiques.
Comme les sons employés dans ces quatre tons n'occupoient pas tout le disdiapason ou les quinze cordes de l'ancien système, S. Grégoire forma le projet de les employer toutes par l'addition des quatre nouveaux tons qu'on appelle plagaux, qui ont les mêmes finales que les précédens, & qui reviennent proprement à l'hypodorien, à l'hypophrygien, à l'hypoéolien & à l'hypomixolydien ; d'autres attribuent à Guy d'Arezzo l'invention de ce dernier.
C'est de-là que ces quatre tons authentiques ont chacun un ton plagal pour leur servir de collatéral ou supplément ; de sorte qu'après le premier ton qui est authentique, vient le second qui est son plagal, le troisieme authentique, le quatrieme plagal, & ainsi de suite. Ce qui fait que ces modes ou tons authentiques s'appellent aussi impairs & les plagaux pairs, eu égard à leur ordre dans la série des tons.
La connoissance du ton authentique ou plagal est essentielle pour celui qui donne le ton du ch?ur ; car s'il a à entonner dans un ton plagal, il doit prendre la finale à-peu-près dans le medium de la voix ; mais si le ton est authentique, la même finale doit être prise dans le bas. Faute de cette observation, on exposeroit les voix à se forcer, ou à n'être pas entendues.
Quelquefois on fait dans un même ton des transpositions à la quinte ; ainsi au-lieu de ré dans le premier ton, on aura pour finale le si pour le mi, l'ut pour le fa, & ainsi de suite ; mais si l'ordre de ces sons ne change pas, le ton ne change pas non plus, & ces transpositions ne se font que pour la commodité des voix : ce sont encore des observations à faire par l'organiste ou le chantre qui donne le ton.
Pour approprier autant qu'il est possible, l'intonation de tous ces tons à l'étendue d'une seule voix, les Organistes ont cherché les tons de la musique les plus propres à correspondre à ceux-là. Voici ceux qu'ils ont établis : on auroit pu les réduire encore à une moindre étendue, en mettant à l'unisson la plus haute corde de chaque ton, ou si l'on veut, celle qu'on rebat le plus, & qu'on appelle dominante, en terme de plein-chant. Mais on n'a pas trouvé que l'étendue de tous ces tons ainsi reglés excédoit celle de la voix humaine ; ainsi on n'a pas jugé à-propos de diminuer encore cette étendue par des transpositions qui se seroient trouvées à la fin plus difficiles & moins harmonieuses que celles qui sont en usage.
| Premier ton, | ré mineur. | |
| Second ton, | sol mineur. | |
| Troisieme ton, | la mineur ou mieux sol mineur. | |
| Quatrieme ton, | la mineur finissant sur la dominante, par cadence réguliere. | |
| Cinquieme ton, | ut mineur, ou mieux ré majeur. | |
| Sixieme ton, | fa majeur. | |
| Septieme ton, | ré majeur. | |
| Huitieme ton, | sol majeur, c'est-à-dire, faisant peu sentir le ton d'ut. |
Au reste, les tons de l'église ne sont point asservis aux lois des tons de la Musique ; il n'y est point question de médiante ni de note sensible, & on y laisse les semi tons où ils se trouvent dans l'ordre naturel de l'échelle, pourvu seulement qu'ils ne produisent ni tri-tons ni fausse-quintes sur la tonique. (S)
Ton, (Lutherie.) instrument dont les Musiciens le servent pour trouver & donner le ton sur lequel on doit exécuter une piece de musique ; c'est une espece de flûte à bec représentée, Planche de Lutherie, figure 27. 8. laquelle n'a point de trous pour poser les doigts, mais seulement une ouverture E par laquelle on souffle, & une autre ouverture D qui est la lumiere & par où le son de l'instrument sort ; on fait entrer par le trou de la patte C une espece de piston ABC ; la partie AB de ce piston sert de poignée pour la pouvoir tenir & enfoncer à volonté : la tige BC est graduée par de petites marques ou lignes c d e f g, a b c qui répondent aux notes de la musique ; ensorte que si on enfonce le piston jusqu'à une de ces marques, par exemple, jusqu'à 9 qui répond à sol, l'instrument rendra alors un son qui sera la quinte du premier son qu'il rend, lorsque la premiere marque c ou c sol ut est à l'extrémité du corps DC de l'instrument. La formation du son dans le ton se rapporte à celle du son dans les tuyaux bouchés de l'orgue. Voyez l'article Bourdon de 16 piés & les figures.
Ton, (Marine.) c'est la partie du mât qui est comprise entre les barres de hune & le chouquet, & où s'assemblent par en-haut le bout du tenon du mât inférieur avec le mât supérieur, & cela par le moyen du chouquet ; & par en-bas, le pié du mât supérieur avec le tenon du mât inférieur, par le moyen d'une cheville de fer appellée clé.
Ton, (Peinture.) nom qui convient en peinture à toutes sortes de couleurs & à toutes sortes de teintes, soit qu'elles soient claires, brunes, vives, &c. Voyez Teinte. On dit tons clairs, tons bruns, tons vifs ; ces couleurs ne sont pas de même ton.
Ce terme a néanmoins une acception particuliere lorsqu'on y joint l'épithete de beau, de bon. Alors il signifie que les objets sont bien caractérisés par la couleur, relativement à leur position, & que de la composition de leurs tons résulte une harmonie satisfaisante. Vilains, mauvais tons, signifient que de leur assemblage résulte le contraire.
Ton, s. m. (Rubanerie.) c'est une grosse noix percée de plusieurs trous dans sa rondeur, & traversée de deux cordes qui tiennent de part & d'autre au métier, elle sert à bander ces deux cordes par une cheville ou bandoir qu'on enfonce dans un de ces trous, & qui mene la noix à discrétion. (D. J.)
Wiktionnaire
Adjectif - ancien français
ton \Prononciation ?\ masculin
- Ton, à toi.
Nom commun 1 - français
ton \t??\ masculin
-
Son d'une certaine fréquence.
- Sans prévenir, il se mit à chanter, opératiquement, dans le registre ténor et en italien, même si Kit savait parfaitement que Reef n'avait aucune oreille, et était incapable de chanter en entier For He's a Jolly Good Fellow sans changer de ton. ? (Thomas Pynchon, Contre-jour, traduit de l'anglais (USA) par Claro, Le Seuil, 2014)
- Qualité de la voix.
- Caradou, le clairon, incorrigible espiègle, lance sur un ton de commandement : « L'ennemi est en fuite. [?] » ? (Pierre Audibert, Les Comédies de la Guerre, 1928, pages 32-33)
- ? Une femme saine et forte comme sont ces Américaines vous fera oublier tout cela, répétait le docteur sur tous les tons. ? (Pierre Drieu La Rochelle, Le Feu follet (1931))
- Non, laisse? Fous-nous la paix ! lui ordonna-t-elle d'un ton rogue. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
-
(Musique) Espace entre certaines notes.
- Il y a un ton entre do et ré, mais un demi-ton entre mi et fa.
-
(En particulier) Gamme, nom de la première note de la gamme dont la musique est formée.
- Chacun d'ailleurs chantait dans un autre ton que son voisin. ? (Berlioz, Souvenirs de voyage, 1869, page 30)
- (Linguistique) Hauteur et modulation d'un son, typiquement d'une syllabe, comme trait phonologique.
-
Manière de s'exprimer.
- Bien qu'il n'eût pu comprendre un seul mot de ce qui avait été dit, Bert éprouva un choc en remarquant le ton qu'avait pris l'homme. ? (H.G. Wells, La Guerre dans les Airs, 1908, traduit par Henry-D. Davray & B. Kozakiewicz, p. 247, Mercure de France, 1921)
- Le ton péremptoire et l'expression allusive me glacèrent. J'eus le pressentiment d'une discussion immédiate et violente. ? (Jean Rogissart, Hurtebise aux griottes, L'Amitié par le livre, Blainville-sur-Mer, 1954, p. 142)
- Malgré sa corpulence excessive, l'autorité de M. Hector sur ses subordonnés n'est guère contestable. Il la doit surtout à sa placidité étudiée, au ton solennel et ampoulé qu'il affecte en s'exprimant [?] ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Ce n'est pas pour ta pomme, Boutros, déclara-t-elle sur un ton de mépris et en traduisant son prénom en arabe. ? (Stefanàkis Dimitris, Jours d'Alexandrie, Éditions La Martinière, 2013)
-
(Colorimétrie) Niveau de luminosité d'une couleur de base.
- Différents tons de rouge.
- (Cartographie) Caractère d'une couleur associé à la couleur qui produit sur l'?il une sensation lumineuse de niveau élevé[1].
Adjectif possessif - français
ton \t??\, \t??.n?\ (devant une voyelle)
- Adjectif possessif dont le possesseur est la deuxième personne du singulier et le possédé est masculin singulier.
- N'oublie pas ton passeport.
- As-tu pensé à prendre ton livre ?
- Ton manteau est joli.
- Adjectif possessif dont le possesseur est la deuxième personne du singulier et le possédé est féminin singulier. Forme supplétive de ta utilisée pour effectuer une liaison obligatoire avec le mot suivant qui commence par une voyelle ou un h muet.
- Une ville, ta ville ; une île, ton île ; une habitation, ton habitation.
- Une maison, ta maison, ton immense maison.
Trésor de la Langue Française informatisé
TON1, TA, TES, adj. poss.
[Déterm. du subst. qui a d'une part une fonction d'actualisation comparable à celle de l'art. le et qui, d'autre part, renvoie à la pers. à laquelle qqn dit « tu ». Comme déterm., il s'accorde en genre et en nombre avec le subst. du syntagme nom. Le fém. ta est remplacé par ton devant voy. ou h non aspiré: ton amie, ton humeur]TON2, subst. masc.
MÉD., vx. [Corresp. à tonique1] ,,État de rénitence et d'élasticité de chaque tissu organique dans l'état de santé`` (Littré-Robin 1865). Synon. tension, tonicité, tonus.Un muscle non contracté manifeste son état d'orgasme par ce qu'on a appelé le ton musculaire (E. Perrier, Philos. zool. av. Darwin, 1884, p. 77).TON3, subst. masc.
TON4, subst. masc.
MAR. ,,Partie supérieure, carrée, d'un bas-mât, au-dessus du capelage, et que capelle le chouquet par son trou carré. Un mât à pible n'a pas de ton`` (Merrien 1958).Ton au Scrabble
Le mot ton vaut 3 points au Scrabble.
Informations sur le mot ton - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ton au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
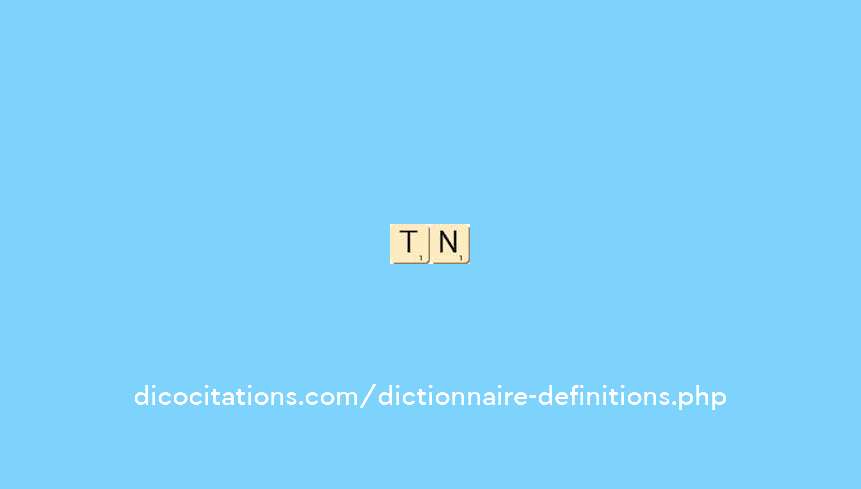
Les mots proches de Ton
Ton Ton Tonal, ale Tonalisation Tonalité Tondaille Tondaison Tondelle Tondeur, euse Tondre Tondu, ue Tonlieu Tonnage Tonnant, ante Tonne Tonneau Tonneler Tonnelet Tonnelet Tonnelier Tonnelle Tonne-mètre Tonner Tonnerre Tonque Tonsille Tonsure Tonsuré, ée Tonsurer Tontine Tonture ton tonal tonale tonalité tonalités tond tondais tondait tondant tonde tondent tondes tondeur tondeuse tondeuses tondit tondons tondrai tondrais tondre tonds tondu tondu tondue tondue tondues tondues tondus tondus toner tong Tonga Tongeren Tongre-Notre-Dame Tongre-Saint-Martin Tongrinne tongs tonic tonicardiaque tonicité tonics tonie tonifiaient tonifiant tonifiant tonifiante tonifiants tonifie tonifient tonifierMots du jour
-
sprays toute-puissance merveilleux focaux abandonné tranchant fuient containeur résolutions emménageons
Les citations avec le mot Ton
- Les boutons d'or remontaient jusqu'au col.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Ce à quoi tu te tiens, ce sur quoi tu t'appuies, c'est là véritablement ton Dieu.Auteur : Martin Luther - Source : Sans référence
- Je ne dis pas de retrancher les idées, mais d'adoucir comme ton celles qui sont secondaires. Pour cela, il faut les reculer, c'est-à-dire les rendre plus courtes et les écrire au style indirect.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Ernest Feydau, 28 décembre 1858
- Monsieur,
Je m'excuse pour le retard a Tony, mais on a fait la fête hier avec la victoire de l'OM. Vous qui aimé le foot vous devez comprendre.
Sur ce bon courage pour se matin. Moi je retourne me couché.Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les retards - N'avoir qu'une seule volonté à laquelle on rattache tonte sa vie et qui ne change ni à chaque minute, ni à chaque homme, voilà ce qu'il y a de plus essentiel en ce monde.Auteur : Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul - Source : Pensées extraites de tous les ouvrages de Johann Paul Friedrich Richter dit Jean-Paul
- J'avais cessé de l'appeler maman. Ça s'était fait comme ça, tout seul, sans intention, sans décision. Peu à peu. Ça n'avait pas été prémédité. Au début, la fréquence du mot avait baissé. Comme s'il n'était plus nécessaire. Ensuite, il avait pris une tonalité gênante. Il était devenu bizarre, décalé. Puis il avait disparu. Totalement. Il m'était devenu impossible de le prononcer. Auteur : Christine Angot - Source : Un amour impossible (2015)
- Grand Dieu, qui fait briller sur la voûte étoilée
Ton trône glorieux.Auteur : Jean Racine - Source : Poésies diverses - Rien n'était vacant et ouvert, accueillant au piéton comme les routes de la France occupée.Auteur : Julien Gracq - Source : Lettrines II (1974)
- Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songes - Planant sous les rideaux inconnus du remords.Auteur : Stéphane Mallarmé - Source : Poésies (1898)
- A Sainte-Cunégonde le tonnerre, - Annonce un deuxième hiver.Auteur : Dictons - Source : 3 mars
- Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, - quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort.Auteur : Edgar Allan Poe - Source : Histoires extraordinaires (1845)
- Laboure ton champ chaque année: il fructifiera tous les ans.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 30 novembre 1901
- Pardonne ma franchise et ma sincérité
Quand au coeur, si tu veux, mettons le de côté
Évitons les amours aux lentes agonies
Et disons gentiment, toi et moi, c'est finiAuteur : Jacques Demy - Source : Les Demoiselles de Rochefort (1967) - Je veux dire que le monde entier est moins intéressant qu'avant. Il y a de plus en plus de gens à avoir suffisamment d'études ou de culture pour qu'on puisse s'étonner qu'ils soient si cons. Auteur : Alice Zeniter - Source : Juste avant l'oubli (2015)
- A la saint Georges,
Sème ton orge;
A la saint Marc,
Il est trop tard.
A saint Barnabé,
La faux au pré;
En juillet,
Faucille au poignet.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Docteur, je bafoue la science gentilhomme, je déchire mon nom prêtre, je fais du missel un oreiller de luxure, je crache au visage de mon Dieu ! Tout cela pour toi, enchanteresse ! Pour être plus digne de ton enfer : et tu ne veux pas du damné !Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Il y a deux sortes de bergers parmi les pasteurs de peuples: ceux qui s'intéressent au gigot et ceux qui s'intéressent à la laine. Aucun ne s'intéresse aux moutons.Auteur : Henri Rochefort - Source : Sans référence
- Les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais au moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le petit bourgeois qui les mangera.Auteur : Octave Mirbeau - Source : La Grève des électeurs (1902)
- Ilz n'userent plus de desguisement ny ne controuverent plus de desfaittes, pour la reverence de Caton.Auteur : Jacques Amyot - Source : Caton d'Utique, 80
- Quand on cesse d'avoir faim, cela s'appelle satiété. Quand on cesse d'être fatigué, cela s'appelle repos. Quand on cesse de souffrir, cela s'appelle réconfort. Cesser d'avoir soif ne s'appelle pas.
La langue dans sa sagesse a compris qu'il ne fallait pas créer d'antonyme à la soif. Auteur : Amélie Nothomb - Source : Soif (2019)
- Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent; nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l'habitude.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 3, I, Des jugements
- Il y avait des matins où je me sentais tellement seule que j'imaginais descendre du troisième étage, choisir quelqu'un dans la rue, n'importe qui, et lui demander : Voudrais-tu être mon meilleur ami ?, sur le ton du Petit Prince s'adressant au Renard.Auteur : Christine Orban - Source : N'oublie pas d'être heureuse (2009)
- J'ai toujours aimé cette grande liberté de ton chez les Anglais. Ils ne se poussent pas du col et font ce qu'ils disent. Ne sont pas agités comme nous pouvons l'être. Ils ne doutent jamais de leur légitimité.Auteur : Olivier de Kersauson - Source : Ocean's Songs (2008)
- Mais ce souffle d'amour, ce baiser que j'envie,
Sur tes lèvres encor je n'ose le ravir;
Accordé par ton coeur, il doublera ma vie.
Ton sommeil se prolonge, et tu me fais mourir:
Je n'ose le ravir.Auteur : Marceline Desbordes-Valmore - Source : Poésies (1830), Romances, Le Réveil - Si tu veux donner par savoir,
Que ton don ne passe ton pouvoir.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
Les citations du Littré sur Ton
- Cette cordelette métallique est recouverte de deux couches de gutta-percha, et d'un guipage de coton goudronnéAuteur : J. GAVARRET - Source : Monit. univ. 26 mai 1867, p. 631, 6e col.
- Le long de ton échine Je grimperai premièrementAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. III, 5
- Le signifiant trouva sa charrue, où il print un baston que l'en appelle cureurAuteur : DU CANGE - Source : curata.
- Le grand colosse, à ce coup estonné, D'un sault horrible alla bruncher par terreAuteur : DU BELLAY - Source : V, 9, verso.
- Et tous les peuples furent étonnés d'une délivrance si miraculeuseAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- En 1772, l'État devait six cent trois tonnes d'or, ou 90 450 000 livresAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. V, 9
- Trop de longueur et trop de brièveté du discours l'obscurcit ; trop de vérité nous étonneAuteur : Blaise Pascal - Source : Pens. I, 1, éd. HAVET.
- [Chez Milton] on se bat dans le ciel à coups de canon ; encore cette imagination est-elle prise de l'AriosteAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Épopée.
- Grand journal, journal à grand format, qui s'occupe de politique et qui paraît tous les jours.... Vous ôtez une proie Au feuilleton méchant qui bondissait de joie, Et d'avance poussait des rires infernaux Dans l'antre qu'il se creuse au bas des grands journauxAuteur : Victor Hugo - Source : les Voies intérieures, XXII
- Ce sénateur breton demanda à Destin des nouvelles d'Angélique, et lui témoigna d'avoir du déplaisir de ce qu'elle n'était point retrouvéeAuteur : Paul Scarron - Source : Rom. com. II, 8
- Tout doucement venait Lamotte-Houdard, Lequel disait d'un ton de papelard : Ouvrez, messieurs, c'est mon Oedipe en proseAuteur : Voltaire - Source : Temple du goût.
- Et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galantAuteur : Molière - Source : Sgan. 22
- Les fleuves étonnés remontent vers leur source, Les astres de la nuit interrompent leur courseAuteur : J. B. ROUSS. - Source : Cantate, Circé.
- Le petit homme [Coulanges] chanta, et fit un vrai plaisir à l'abbé de Marsillac, qui admirait et tâtonnait ses paroles avec des tons et des manières si semblables à celles de son père [M. de la Rochefoucauld] qu'on en était touchéAuteur : Madame de Sévigné - Source : 10 janv. 1689
- Son cher Birton et un autre débauché de la même trempeAuteur : Voltaire - Source : Jenni, 6
- M'endormais-je un peu sur ma chaise, Il entonnait la MarseillaiseAuteur : BÉRANG. - Source : Homme rouge.
- Oswald était étonné de cette mobilité qui faisait succéder l'une à l'autre des impressions si différentesAuteur : STAËL - Source : Corinne, X, 4
- L'Alhambra ! l'Alhambra, palais que les génies Ont doré comme un rêve et rempli d'harmonies, Forteresse aux créneaux festonnés et croulantsAuteur : Victor Hugo - Source : Orient. XXXI
- Les gresles, tonnerres et tempestes, et tout le bruit qui se faict en l'air ne trouble ni ne touche les corps superieurs et celestes, mais seulement les inferieurs et caduquesAuteur : CHARRON - Source : ib. I, 30
- Que de choses depuis Varron, que Varron a ignorées ! ne nous suffirait-il pas même de n'être savants que comme Platon ou comme Socrate ?Auteur : LA BRUY. - Source : XII
- S'il voulait être de la mascarade, à la charge de mener Mlle d'HamiltonAuteur : HAMILT. - Source : Gramm. 7
- Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importanceAuteur : Molière - Source : l'Av. III, 6
- Tous ces vers biberons ne veulx desavouer, Advortons que j'ay faits en ma jeune allegresse, Quoyque je n'eusse lors une ame beuveresseAuteur : J. LE HOUX - Source : Vau de Vire, 41
- Et, sous un faux semblant de libéralité, Soûler et ma vengeance et ton aviditéAuteur : Corneille - Source : Médée, IV, 1
- Les sacremens de la nouvelle loy justifient et conferent grace, si nous n'y mettons object [obstacle] ou empeschement de peché mortelAuteur : CALV. - Source : Instit. 1037
Les mots débutant par Ton Les mots débutant par To
Une suggestion ou précision pour la définition de Ton ? -
Mise à jour le jeudi 12 février 2026 à 16h36
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur ton
Poèmes ton
Proverbes ton
La définition du mot Ton est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Ton sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Ton présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

