Définition de « onze »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot onze de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur onze pour aider à enrichir la compréhension du mot Onze et répondre à la question quelle est la définition de onze ?
Une définition simple :
Approchant : onzain, onzième, onzièmement
Définitions de « onze »
Trésor de la Langue Française informatisé
ONZE, adj. et subst. masc. inv.
Wiktionnaire
Adjectif numéral - ancien français
onze \Prononciation ?\
-
Onze.
- Onze anz aveit quant ele m'ot ? (Le Roman de Thèbes, édition de Constans, page 460, tome I. Nous avons pris la variante onze donnée en bas de la page.)
Nom commun - français
onze \??z\ masculin et féminin identiques invariable
-
(Au masculin) Nombre 11, entier naturel après dix.
- Ils étaient onze.
- Dans ce cadran, le onze n'est pas bien marqué.
- (Par métonymie) Chose portant le numéro onze.
-
(Au masculin) (Avec le) Onzième jour du mois.
- Le onze du mois.
- (Football) Équipe de football, qui comporte 11 joueurs.
Adjectif numéral - français
onze \??z\ pluriel
-
(Antéposé) Dix plus un, adjectif numéral cardinal correspondant au nombre 11.
- Il a onze ans.
- Il est onze heures.
-
(Postposé) Onzième.
- Le roi Louis XI.
- Page onze.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui se compose de dix unités plus une et qui suit immédiatement le nombre dix. Ils étaient onze. Onze chevaux. Onze francs. Il est onze heures. Quoique ce mot commence par une voyelle, il arrive, en certains cas, qu'on prononce et qu'on écrit sans élision l'article, la préposition ou la particule qui le précède. De onze enfants qu'ils étaient, il en est mort dix. De vingt, il n'en est resté que onze. Quand il est précédé d'un mot qui finit par une consonne, on ne prononce pas cette consonne. Vers les onze heures. Il est quelquefois employé pour Onzième. Le roi Louis onze. Page onze. Chapitre onze.
ONZE est aussi nom masculin. Onze multiplié par deux. Dans ce cadran, le onze n'est pas bien marqué. Le onze du mois. Dans l'Histoire grecque, les Onze, Officiers publics d'Athènes qui étaient chargés de l'exécution des sentences criminelles.
Littré
-
1Nombre qui contient dix et un. Onze heures. Onze personnes. Onze cents. Onze mille.
On peut parier 11556 contre 93 ou 124 2/9 contre 1, qu'un enfant de onze ans vivra un an de plus
, Buffon, Prob. de la vie, ?uv. t. X, p. 288.Il va chercher midi où il n'y a qu'onze heures, se dit d'un écornifleur?; locution qui provient de l'usage ancien de dîner à midi.
Les onze mille vierges, voy. VIERGE.
- 2Se dit pour onzième. Page onze. Louis onze, qu'on écrit Louis XI.
-
3 S. m. Onze multiplié par deux.
Pour le loto on peut avoir occasion d'écrire (sans s)?: les onze sont peu marqués.
-
4Le onzième. Le onze du mois. J'ai reçu des lettres du onze.
S. m. pl. Les onze, officiers publics d'Athènes qui étaient chargés de l'exécution des sentences criminelles.
REMARQUE
1. On dit?: j'ai reçu une lettre du onze, et non de l'onze?; nous sommes au onze, et non à l'onze.
2. La prononciation de onze comme s'il était précédé d'une aspiration vient de la tendance du vieux français à faire précéder d'une h les mots monosyllabiques ou du moins les mots à une seule syllabe sonore, commençant par une voyelle?: haut, huit, huile, huître, etc.
HISTORIQUE
XIe s. Onze millies chevaliers [ils] peuvent estre
, Ch. de Rol. CCXX.
XIIe s. Or m'eslisez onze de vos barons
, Ronc. p. 40.
XVIe s. L'inegalité entre le cours du soleil et celuy de la lune est de onze jours
, Amyot, Numa, 31. On m'appelloit l'amant des onze mille? Qui tous les jours en aymoit deux ou trois
, Le quatrième des bigarrures du seigneur des Accords, Paris, 1608, 2e partie, p. 43.
Encyclopédie, 1re édition
1. ONZE, (Arithm.) c'est dans notre système de numération le premier nombre de la seconde décade, ou celui qui suit immédiatement la racine dix de notre échelle arithmétique ; il s'exprime par deux unités. Il est nombre premier, & le sixieme de cet ordre.
2. Puisque neuf (voyez son article) tire certaines propriétés de sa proximité en-deçà de la racine de notre échelle arithmétique ; il étoit naturel de penser que onze en a d'analogues, qu'il doit tirer de sa proximité en-delà de la même racine : mais, comme elles ne sont pas si exposées en vûe, elles avoient jusqu'ici échappé aux observateurs. Ce sont, pour le nombre & pour le fonds, précisément les mêmes que celles de neuf, si ce n'est qu'elles se manifestent en sens contraire, comme cela devoit être. Dans le développement qu'on en va faire, on aura soin de rapprocher chacune de celle qui lui correspond pour le nombre neuf, afin de faire mieux connoître ce qu'elles ont de commun & en quoi elles différent.
Au reste, tout ce que nous dirons de onze doit s'entendre de tout autre , c'est-à-dire (r représentant la racine d'une échelle arithmétique quelconque), de tout nombre qui occupe respectivement le même rang dans son échelle particuliere, que notre 11 occupe dans la sienne. Je dis notre 11, parce que 11 est l'expression numérique de commune à toutes les échelles.
3 Premiere propriété. La division par 11 de tout multiple de 11 peut se réduire à une simple soustraction : en voici la pratique.
Soit 4708 (multiple de II) proposé à diviser par 11.
| Ecrivez 0 au-dessous du chiffre qui exprime les unités, & dites : qui de 8 paie 0, reste 8, écrivez 8 à la gauche du 0 que vous avez posé. | 4 7 0 8 | |
| 4 2 8 0 |
Puis dites : qui de 0, ou (en empruntant) qui de 10 paie 8, reste 2 ; écrivez 2 à la gauche du 8.
Enfin dites : non, qui de 7, mais (à cause de l'emprant) qui de 6 paie 2, reste 4 ; écrivez 4 à la gauche du 2...& tout est fait : car 4 ? 4 = 0 montre que l'opération est consommée. De sorte que négligeant le 0 final, le reste 428 est le quotient cherché.
Pour la preuve ; additionnez ensemble les chiffres du nombre inférieur, les prenant deux à deux, chacun successivement avec celui qui le précéde vers la gauche, jusqu'au dernier qui s'emploie tout seul, n'en ayant point au-delà avec qui s'apparier : la somme doit vous rendre le nombre supérieur, s'il ne s'est point glissé d'erreur dans l'opération.
4. La raison de cette pratique deviendra sensible, si l'on fait attention que tout multiple de 11 peut être conçu, comme le résultat d'une addition. En effet, . Ce que l'on peut disposer ainsi
| 4280 | s. | |
| + | 428 | m. |
| 4708 | j. |
Nommant s le nombre supérieur, m celui du milieu, j l'inférieur ; il suit de la disposition des chiffres que le dernier de m est le même que le pénultieme de s, le pénultieme de m le même que l'antépénultieme de s, &c.
Maintenant le nombre j étant proposé à diviser par 11, il est clair (construction) que le quotient cherché est le nombre m. Mais (encore par construction) j = s + m ; d'où m = j ? s : & voilà la soustraction qu'il est question de faire ; mais comment y procéder, puisque s, élément nécessaire, n'est point connu ?
Au moins en connoît-on le dernier chiffre, qui est toujours 0 : on peut donc commencer la soustraction. Cette premiere opération donnera le dernier chiffre m, = (suprà) au pénultieme de s ; celui-ci fera trouver le pénultieme de m, = à l'antépénultieme de s ; & ainsi de l'un en l'autre, le chiffre dernier trouvé de m étant celui dont on a besoin dans s pour continuer l'opération.
L'addition qui sert ici de preuve à la regle est, si l'on veut y faire attention, précisément la même qui a formé le multiple : il n'est donc pas étonnant qu'elle le rende. C'est au fonds s qu'on ajoute à m : or s + m = j. Il est vrai que s & m sont mêlés ensemble & fondus dans le même nombre ; mais l'opération même les démêle.
5. La division par 11 de tout multiple de 11, aussi bien que la division par 9 de tout multiple de 9, peut donc se reduire à une simple soustraction : mais elle se fait pour l'un & pour l'autre en sens contraires. Elle est pour
Là le premier 0 (qui est comme la clé de l'opération) se place au-dessus du multiple : ici il se place au-dessous.
6. Avant que d'énoncer la seconde propriété, j'avertis que la dénomination de chiffres pairs & de chiffres impairs y est relative au rang que chacun occupe dans une suite d'autres chiffres, sans nul égard à sa valeur propre. Ainsi (supposant qu'on compte de gauche à droite) dans 2176, 2 & 7 sont les chiffres impairs, 1 & 6 les chiffres pairs.
7. Seconde propriété. En tout multiple de 11, si l'on fait séparément la somme des chiffres pairs & celle des impairs, ou ces deux sommes sont égales, ou leur différence est un multiple de 11 ... comme réciproquement tout nombre, tel que la somme des chiffres pairs y soit égale à celle des impairs, ou que leur différence soit un multiple de 11, exprime lui-même un multiple de 11 ; c'est ce qu'on voit d'abord.
| en | .... | où | &c. |
| en | .... | où |
De même si l'on écrit au hasard une suite de chiffres en nombre quelconque, pourvû seulement que la somme des chiffres pairs y soit égale à celle des impairs, ou que leur différence soit un multiple de 11, comme 77, 90904, &c. on est assuré que le nombre résultant se divise exactement par 11.
8. Pour démontrer la proposition directe, il suffit de substituer dans la figure du n°. 4, au lieu des chiffres qui s'y trouvent, les indéterminées a, b, c, qui les représentent d'une maniere générale : on aura
| a. | b. | c. | * | (L'astérisque tient ici la place du 0, qu'on n'a point voulu mêler avec des lettres, crainte d'équivoque. | |
| + | ... | a. | b. | c. | |
|
|
|||||
| a. | a.+b. | b.+c. | c. | ||
On voit que la somme des termes pairs est exactement la même que celle des impairs ; & que ce sera la même chose, en quelque nombre qu'on veuille supposer les lettres de la quantité à multiplier : c'est une suite nécessaire de la formation du multiple.
Un seul point pourroit causer quelque scrupule ; les deux termes extrèmes, sont simples, ou ne contiennent qu'une seule lettre. Cette circonstance, il est vrai, ne peut tirer à conséquence, quand l'un des deux appartient à la somme des pairs, & l'autre à celle des impairs, comme dans l'exemple présent ; on voit bien qu'il en doit résulter le même nombre de lettres de part & d'autre. Mais quand tous les deux se trouvent du même côté (comme il arrive toutes les fois que les termes du multiple sont en nombre impair), il semble que ce côté doit pécher par défaut .... au contraire, c'est précisément ce qui conserve l'égalité. Car, les termes du multiple étant en nombre impair, il y a nécessairement un côté qui a un terme de plus que l'autre, & comme c'est toujours le côté des impairs (auquel d'ailleurs appartiennent les deux extrèmes), il se trouve que deux termes simples figurent vis-à-vis d'un double ; c'est ce qu'on voit en cet autre exemple :
| a. | b. | * | |
| + | ... | a. | b. |
|
|
|||
| a. | a.+b. | b. | |
9. Il paroît résulter de cette démonstration, que les deux sommes devroient toujours être égales : ce qui n'est pas pourtant. Mais on doit faire attention que, quand la somme de deux chiffres (représentés ici par deux lettres) excéde 9, on renvoie une unité au chiffre de la gauche, ne retenant pour celui sur lequel on opere que l'excès de cette somme au-dessus de 10. Celui-ci y perd donc 10, tandis que son voisin y gagne 1 : la différence doit donc être ou 11.
Comme en faisant la somme des différentes colonnes, il peut arriver que le renvoi d'une unité au chiffre de la gauche ait lieu plusieurs fois ; s'il se fait constamment au profit des chiffres de même nom, soit pairs, soit impairs, il est visible que la différence des deux sommes ne sera plus simplement 11, mais un multiple de 11, déterminé par le nombre même des renvois.
Si les renvois se font partie au profit des chiffres pairs, partie au profit des impairs, ou ils sont en nombre égal de part & d'autre, & alors, tout se trouvant compensé, l'égalité rigoureuse se maintient entre les deux sommes : ou ils ne le sont pas, & alors le multiple de 11 qui constitue la différence est déterminé par la différence des deux nombres qui expriment celui des renvois faits au profit des chiffres de différent nom.
10. Au reste, sur l'inspection seule du nombre proposé à multiplier par 11, il est aisé de déterminer combien il y aura de renvois dans l'addition qui sert à cet effet ; & par une suite de juger quel rapport auront entr'elles dans le multiple même la somme des chiffres pairs & celle des impairs ; si elles seront égales, ou (dans le cas d'inégalité) de quel multiple de 11 elles différeront. Pour cela, appariant successivement chacun des chiffres du nombre proposé avec celui qui le précéde vers la gauche, autant de fois que la somme de deux chiffres pris de cette maniere excédera 9, autant il y aura de renvois (s'entend que, quand il y a renvoi d'une somme précédente, il faut augmenter d'une unité la somme subséquente). On verra donc au premier coup d'?il que pour 435, il n'y aura point de renvoi, & conséquemment que dans le multiple les deux sommes seront égales ; que pour 8264, il y en aura deux, qui étant l'un & l'autre au profit des chiffres de même nom (ce qu'on reconnoît encore par la disposition des chiffres) donneront pour la différence des deux sommes dans le multiple 11×2 ou 22, &c.
11. Pour démontrer la proposition inverse (voyez le n°.7.) qu'un nombre quelconque, conditionné comme il y est dit, soit représenté généralement par , & qu'on y applique la méthode de soustraction exposée, n°.3 : il se résoudra en deux quantités, & , dont l'une est décuple de l'autre. Il en étoit donc la somme : mais la somme de deux semblables quantités est un multiple de 11.
Ce raisonnement paroît encore ne conclure que pour le cas d'égalité entre les deux sommes? mais si la différence est 11 ou l'un de ses multiples, en appliquant la soustraction, il y aura des emprunts à faire sur les termes excédens au profit des défaillans, plus ou moins, selon le multiple. Chaque emprunt fera perdre une unité à l'excédent, & augmentera de 10 le défaillant ; ce qui fera évanouir la différence, & ramenera les choses au cas d'égalité .... Ce défaut apparent dans la démonstration ne provient donc que de sa généralité même, & de ce qu'elle est antérieure au choix de toute méthode particuliere de calculer.
12. En tout multiplie soit de 9, soit de 11, si l'on fait séparément la somme des chiffres pairs & celle des impairs ; c'est (pour 9) la somme totale de ces deux sommes qui est un multiple de 9 : & (pour 11) c'est leur différence, quand elles différent, qui est un multiple de 11.
Troisieme propriété. Si l'on renverse l'ordre des chiffres qui expriment un nombre quelconque, la différence & la somme du nombre direct & du nombre renversé, sont des multiples de 11 ; la différence, quand les chiffres du nombre proposé sont en nombre impair ; la somme, quand ils sont en nombre pair. Par exemple,
| : | or |
| : | or |
sans reste, parce que le nombre des chifres de 826 est impair ; 82 est pair.
La démonstration dépend des deux propositions suivantes.
14. Lemme I. La différence & la somme de deux puissances quelconques de la même racine sont des multiples de cette racine augmentée de l'unité ; la différence, quand celle des exposans des deux puissances est un nombre pair : la somme, quand la différence des exposans des deux puissances est un nombre impair. Pour la preuve, voyez l'article Exposant.
Lemme II. (Par chiffres correspondans il faut entendre deux chiffres pris en un nombre quelconque à égale distance du milieu chacun de son côté ; comme sont d'abord les extrèmes, puis les deux les plus voisins de ceux-ci, &c).
15. En tout nombre, la différence des exposans des deux puissances de 10 (ou plus généralement de r), qui y déterminent la valeur relative de deux chiffres correspondans quelconques, est d'un nom différent de celui du nombre total des chiffres ; c'est-à-dire paire quand celui-ci est impair, & réciproquement.
En effet, que & représentent la valeur relative des deux chiffes extrèmes a & b d'un nombre quelconque, dont le nombre total des chiffres (voyez Échelle arithmétique), sera par conséquent ; il est évident que est d'un nom différent de . Il n'est pas moins clair que, pour tous autres deux chiffres correspondans tirés par ordre du même nombre, sera dans le même ordre m?2, m?4, m?6, &c. suivant une progression arithmétique dont 2 est la différence : chaque terme y sera donc de même nom que le premier m, & par une suite d'un nom différent de .
16. Cela posé, quand on renverse l'ordre des chiffres qui expriment un nombre quelconque, on ne fait qu'échanger la valeur relative des chiffres correspondans ; en sorte que & deviennent & . Maintenant si l'on ôte cette seconde quantité de la premiere, ou si on les ajoute ensemble, on aura (toute déduction faite, & supposant a>b & m>n), la différence & la somme ; mais s'il s'agit de la différence, le 2d facteur (& par une suite le produit même) est (lemme I.) un multiple de r + 1 ou de 11, quand est pair ; & est pair (lemme II.) quand les chiffres du nombre proposé sont en nombre impair.
Pareillement, s'il s'agit de la somme, le 2d facteur est (lemme I.) multiple de r + 1 ou de 11, quand est impair ; & est impair (lemme II.), quand les chiffres du nombre pris pour exemple sont en nombre pair.
La troisieme propriété se trouve donc prouvée dans ses deux parties. Car ce qui vient d'être dit de deux chiffres correspondans, s'applique de soi-même à la somme de tant de chiffres pareils, pris ainsi deux-à-deux qu'on voudra. Elle aura la même propriété qu'affectent tous & chacun des élémens dont elle est formée.
17. Reste une difficulté. Tout le raisonnement qu'on vient de voir, porte sur la correspondance des chiffres : mais quand le nombre en est impair, celui du milieu se trouve isolé & sans correspondant ..... D'abord cette difficulté ne peut regarder la somme, dont la propriété n'a lieu que quand les chiffres du nombre proposé sont en nombre pair. Elle s'évanouira même pour la différence, si l'on sait attention que le chiffre du milieu, occupant dans le nombre renversé le même rang qu'il occupoit dans le nombre direct, la soustraction le fait disparoitre, & qu'ainsi il n'y a aucun compte à en tenir.
18. Dans le renversement des chiffres, la différence & la somme du nombre direct & du nombre renversé sont des multiples de 9 & de 11 ; la différence seule pour 9, mais dans tous les cas : la différence aussi bien que la somme pour 11, mais chacune respectivement dans un seul cas ; celle-là quand les chiffres du nombre pris pour exemple sont en nombre impair ; celle-ci quand ils sont en nombre pair.
19. Il est clair que tout sous-multiple de ou de 11, participera aux mêmes propriétés qu'on vient de démontrer pour même. C'est ce qu'on ne peut faire voir dans notre échelle, parce que notre 11, comme nombre premier, n'a point de sous-multiple : mais on le pourroit faire pour 2 & pour 4, sous-multiples de 8 (l'11 de l'échelle septenaire) ; pour, &c.
Conclusion. 20. Le nombre 9 n'est donc plus seul en possession des propriétés qui l'ont rendu si célebre ; & s'il se trouve que 11 en jouit aussi pleinement que lui, quoique d'une maniere différente ; on peut donc,
1°. Juger au premier coup d'?il si un nombre proposé est multiple de 11.
2°. S'il l'est, & qu'il s'agisse d'en venir à la division actuelle, on la peut faire au moyen d'une très simple soustraction.
3°. S'il ne l'est pas, au moins peut-on, sans en venir à l'opération, voir de combien il en differe, & connoître le reste qu'on obtiendroit par la division ; ce qui souvent est tout ce qu'on a intérêt de savoir..... En effet, après avoir fait la somme des chiffres pairs & celle des impairs, & en avoir ôté 11 autant de fois qu'il se peut ; nommant R la différence des deux restes, celui que laissera la division sera R même, si l'excès appartient à l'ordre de chiffres dont le dernier fait partie, & 11?R dans l'autre cas : ainsi 2819 laissera 3, & 28190 laissera 11?3 ou 8. Cet article est de M. Rallier des Ourmes. Voyez Neuf.
Étymologie de « onze »
Bourguig. onge?; du lat. undecim, de unus, un, et decem, dix.
- Du latin undecim (« un et dix »).
onze au Scrabble
Le mot onze vaut 13 points au Scrabble.
Informations sur le mot onze - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot onze au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
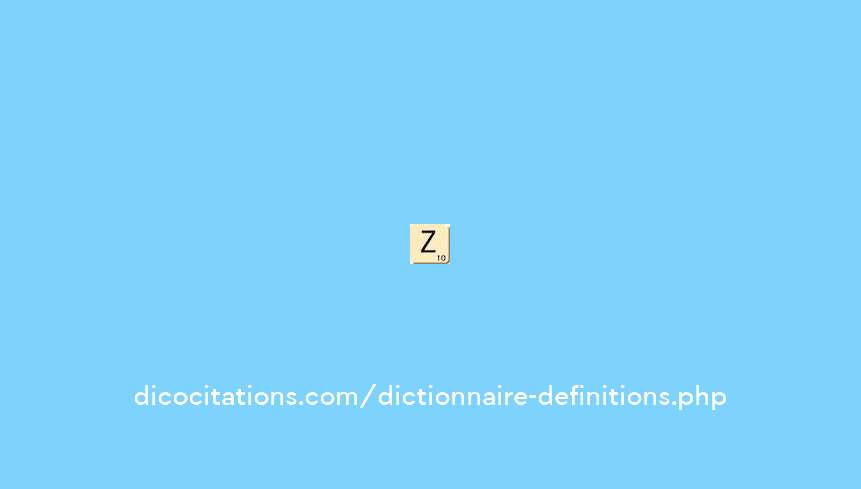
Les rimes de « onze »
On recherche une rime en §Z .
Les rimes de onze peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en §z
Rimes de gonzes Rimes de songes Rimes de bronze Rimes de serviette-éponge Rimes de éponges Rimes de bronze Rimes de gonze Rimes de songent Rimes de longe Rimes de prolonges Rimes de longent Rimes de prolonge Rimes de ronges Rimes de prolongent Rimes de demi-mensonge Rimes de allonges Rimes de bonzes Rimes de allonge Rimes de axonge Rimes de tissu-éponge Rimes de longes Rimes de songes Rimes de plonge Rimes de bronzent Rimes de oronges Rimes de bronze Rimes de rallonges Rimes de éponge Rimes de bronzes Rimes de éponge Rimes de rallongent Rimes de quatre-vingt-onze Rimes de éponges Rimes de allongent Rimes de onze Rimes de replonge Rimes de bonze Rimes de serviettes-éponges Rimes de rongent Rimes de épongent Rimes de plonges Rimes de mensonges Rimes de plongent Rimes de rallonges Rimes de prolonge Rimes de mi-songe Rimes de prolonges Rimes de onze Rimes de replonges Rimes de piquouzesMots du jour
gonzes songes bronze serviette-éponge éponges bronze gonze songent longe prolonges longent prolonge ronges prolongent demi-mensonge allonges bonzes allonge axonge tissu-éponge longes songes plonge bronzent oronges bronze rallonges éponge bronzes éponge rallongent quatre-vingt-onze éponges allongent onze replonge bonze serviettes-éponges rongent épongent plonges mensonges plongent rallonges prolonge mi-songe prolonges onze replonges piquouzes
Les citations sur « onze »
- Un champ de mille ans, compte plus de onze cents maîtres.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne.Auteur : Molière - Source : Les Précieuses ridicules (1659), 1, La grange
- Pour avoir du succès, soyez bronzé, vivez dans un immeuble chic (même si vous êtes dans la cave), faites vous voir dans les restaurants élégants (même si vous ne prenez qu'une boisson) et, si vous empruntez, empruntez beaucoup.Auteur : Aristote Socrate Onassis - Source : Sans référence
- Mil huit cent onze! - O temps où des peuples sans nombre - Attendaient prosternés sous un nuage sombre - Que le ciel eût dit oui!.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Chants du crépuscule (1835)
- Entendez les bruyantes cloches d'alarme - cloches de bronze !
Quelle histoire de terreur dit maintenant leur turbulence !
Dans l'oreille saisie de la nuit comme elles crient leur effroi !
Trop terrifiées pour parler, elles peuvent seulement crier !!Auteur : Walter Moers - Source : La cité des livres qui rêvent (2006) - Les routiers anglais ont le bras droit qui est bronzé.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le tour du chat en 365 jours (2006)
- Les statues ne font que nommer l'oubli. On n'est jamais plus mort qu'en bronze.Auteur : Alexandre Vialatte - Source : Chroniques de La Montagne
- L'idéal de l'acteur américain, c'est Gandhi. Un mec mince, bronzé et connu dans le monde entier.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- Tout à coup, vers onze du soir, dring, un coup de sonnette.Auteur : Jean Dutourd - Source : Les Horreurs de l'amour (1963)
- Ne me vantez point le caractère de N...: c'est un homme dur, inébranlable, appuyé sur une philosophie froide, comme une statue de bronze sur du marbre.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Le poli. Donner le poli. C'est là ce qui exige du temps. Et plus ce qu'on dit est neuf, plus il faut du temps et de soins pour donner le poli. - Le poli conserve les livres, le marbre et le bronze. Il s'oppose à leurs rouilles.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 2
- Si le temps, le sixième jour de la lune, se comporte comme le quatrième jour ou comme le cinquième jour, il se comportera de même, neuf fois sur douze dans le premier cas, et onze fois sur douze dans le second, pendant toute la lune.Auteur : Victor Hugo - Source : Les travailleurs de la mer (1866)
- C'est là que j'ai compris : une aubergine, ça se traite comme une bimbo sur la plage. On la déshabille, on la tartine d'huile et on la laisse bronzer à petit feu, à son rythme. Auteur : Anne Percin - Source : Comment (bien) rater ses vacances (2010)
- Regarde cette femme ! n'est-ce pas abominable de penser que ce bijou, que cette perle née pour être belle, admirée, fêtée et adorée, a passé onze ans de sa vie à donner des héritiers au comte de Mascaret ?Auteur : Guy de Maupassant - Source : Mouche (1890)
- Une gonzesse qui pouffe n'est pas loin du paf, comme dit mon pauvre cher Béru.Auteur : Frédéric Dard - Source : San-Antonio, A prendre ou à lécher (1980)
- À l’époque, des gamins de onze ans – et des gamines pour celles qui avaient eu la chance de suivre des études jusque-là – savaient lire, écrire et compter. Ce n’est plus toujours le cas aujourd’hui, même pour des gosses plus âgés. Auteur : Eric Dupond-Moretti - Source : Le dictionnaire de ma vie (2016)
- Il n'y eut aucun azyle consacré à la virginité en Asie; les Chinois et les Japonois seuls ont des bonzesses; mais qui sait si elles sont absolument inutiles?Auteur : Voltaire - Source : Essai sur les moeurs (1756), Des ordres religieux
- J'ai toujours trouvé la sculpture assommante, mais au moins les bronzes ont l'air de quelque chose, tandis que les bustes de marbre ressemblent toujours à un cimetière.Auteur : Ernest Hemingway - Source : L'Adieu aux armes (1929)
- L'homme doit s'applaudir d'être frivole; s'il ne l'était pas, il sécherait de douleur en pensant qu'il est né pour un jour entre deux éternités, et pour souffrir onze heures au moins sur douze.Auteur : Voltaire - Source : Le Sottisier
- Oui, mais il n'y a pas que sa mère, il ne faut pas nous raconter des craques. Il y a une donzelle, une cascadeuse de la pire espèce, qui a plus d'influence sur lui.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Le Côté de Guermantes (1921-1922)
- Le bronzage, encore un truc qu'est pas pour moi, ça. Si vous voulez mon avis, rien n'est plus triste qu'un postérieur pâle dans un ensemble bronzé. C'est comme un coin de Flandres corporel perdu dans une Côte d'Azur anatomique.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- Sa main de fer, son visage de bronze, son activité sombre et brusque à la fois, nous comprimaient tous, femme, enfants, commis et domestiques, sous son despotisme sauvage.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Curé de village
- On voit que dans ce poème le poète raconte n'importe quoi pour séduire la gonzesse.Auteur : Perles du Bac - Source : Brèves de copies de bac (2013)
- Ce prêtre bronzé d'abord à des expéditions de brigands, plus tard missionnaire à travers les peuplades sauvages.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Madame Gervaisais (1869)
- Et ta mère? lui demanda Julie.
- Remariée, ma mère, rien que pour me vexer. A soixante et onze ans!
- Ca, alors... dit Coco Vatard. C'est débecquetant.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Julie de Carneilhan
Les mots proches de « onze »
Onzaine Onze OnzièmeLes mots débutant par onz Les mots débutant par on
Onzain onze onze Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek Onze-Lieve-Vrouw-Waver onzième onzième
Les synonymes de « onze»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot onze dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « onze » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot onze dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Onze ?
Citations onze Citation sur onze Poèmes onze Proverbes onze Rime avec onze Définition de onze
Définition de onze présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot onze sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot onze notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.



























