La définition de Donc du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Donc
Nature : conj.
Prononciation : don ou donk, suivant les cas : on pronon
Etymologie : Provenç. donc, dunc, doncas, alors, donc ; catal. doncs ; anc. espagn. doncas ; anc. ital. dunqua ; ital. mod. dunque ; pays de Come, donch ; vénitien, donca. Ce mot présente des difficultés. On trouve dans de très anciens textes ad tunc pour alors ; Diez en tire adonc, ce qui en effet explique la substitution, dans toutes les langues romanes, du d au t de tunc ; et il regarde adonc comme la forme primitive, et donc comme une abréviation par aphérèse de la première voyelle. Cela est très satisfaisant pour le sens, donc a yant eu évidemment la signification d'alors, et le passage d'alors à donc se comprenant sans peine. Mais, sans parler du retranchement de l'a initial dans le français, qui en offre si peu d'exemples avérés, les formes en as, doncas, en a, dunqua, en e, dunque, ne se prêtent pas à la dérivation de tunc, tandis qu'elles se prêtent à la dérivation de unquam, ce mot ayant donné unca, unqua, oncas, onke ; de sorte que, quant à la forme, donc serait de-unquam ; mais alors c'est le sens qui fait difficulté. Ces deux alternatives étant posées, on peut penser pourtant que cet adverbe composé de-unquam a pris la signification d'alors et les significations subséquentes, comme l'adverbe composé de-usque a pris le sens de jusque.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de donc de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec donc pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Donc ?
La définition de Donc
Sert à marquer la conclusion qu'on tire d'un raisonnement. Vous avez fait une faute, il faut donc la réparer. Il se plaint, on l'a donc maltraité.
Toutes les définitions de « donc »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
qui sert à marquer la conclusion d'un raisonnement. Je pense, donc je suis. On l'emploie également pour marquer toute autre espèce d'induction, pour exprimer qu'une chose est ou doit être la conséquence, le résultat d'une autre, qu'elle a lieu en conséquence d'une autre. Ainsi donc vous refusez. Vous êtes donc bien décidé. Il faut donc vous obéir. Vous serez donc toujours le même. Vous voyez donc bien que j'avais raison. Donc, vous vous trompez! Votre père est donc arrivé. Ils partirent donc secrètement. Il sert encore à marquer une sorte d'étonnement, la surprise que l'on éprouve d'une chose à laquelle on ne s'attendait point. J'étais donc destiné à lui survivre! Voilà donc tout le fruit que j'ai retiré de mes soins! Qu'avez-vous donc? Que dit-il donc là? Qu'ai-je donc fait pour que vous me traitiez de la sorte? Quoi donc! il me résisterait? Allons donc! Il sert aussi à rendre plus pressante une demande, une injonction. Dites-nous donc comment la chose s'est passée. Répondez donc. Donnez-moi donc cela.
Littré
-
1Sert à marquer la conclusion qu'on tire d'un raisonnement. Vous avez fait une faute, il faut donc la réparer. Il se plaint, on l'a donc maltraité.
Je pense, donc Dieu existe, car ce qui pense en moi je ne le dois point à moi-même
, La Bruyère, XVI. -
2Exprime, en général, qu'une chose est ou doit être la conséquence d'une autre.
Donc un nouveau labeur à tes armes s'apprête
, Malherbe, II, 12.Donc votre aîeul Pompée au ciel a résisté Quand il a combattu pour notre liberté
, Corneille, Cinna, II, 1.Donc jusqu'à l'oublier je pourrais me contraindre
, Corneille, ib. IV, 3. - 3Sert souvent de simple transition pour revenir au sujet après une digression.
-
4Sert à marquer une sorte d'étonnement, la surprise que l'on éprouve d'une chose à laquelle on ne s'attendait point.
Ô sort, voilà donc de tes coups?? Et je n'ai donc vaincu que pour dépendre d'elle??
Racine, Androm. I, 2.Je suis donc un témoin de leur peu de puissance??
Racine, ib. II, 2.Mais pourquoi donc ces pleurs, ces regrets, cette fuite??
Voltaire, Zaïre, III, 7.Qu'est-ce donc que l'amour?? a-t-il donc tant d'empire??
Voltaire, Orphel. III, 4. - 5Sert aussi à rendre plus pressante une demande, une injonction. Dites donc ce qu'il y a. Gare donc?!
- 6 Ironiquement, allons donc?! marque d'incrédulité, de défi. Lui, oser prendre la parole en cette occasion?; allons donc?!
REMARQUE
1. Et donc qui se disait au commencement du XVIIe siècle, et que Vaugelas admet encore, n'est plus usité.
2. Donques est une forme ancienne, encore employée par Molière, et que la poésie pourrait se permettre. Donques, si le pouvoir de parler m'est ôté, Pour moi, j'aime autant perdre aussi l'humanité
, Molière, le Dép. II, 7. Donques votre lumière a donné de l'ombrage, Donc vous êtes couvert d'un éternel nuage
, Mairet, Sophon. V, 9.
HISTORIQUE
Xe s. Dunc, ço dixit, si fut Jonas
, Fragm. de Valenc. p. 468.
XIe s. Dunc [il] rendra le chatel [l'avoir]
, Lois de Guill. 4. Heli qui dunc [alors] ert [était] evesques
, Rois, 2. Pechet fereit qui dunc lui fesist plus
, Ch. de Rol. XVI.
XIIe s. Donc die, et nous l'orons [ouïrons]
, Ronc. p. 22. Qui m'ira donc mes angardes faisans??
ib. p. 34. Diex?! que ferai?? dirai lui [à elle] mon courage?? Irai-je lui dont s'amour demander??
Quesnes, Romancero, p. 83. Et quant j'ai mis en lui [elle] m'entencion, Dont ne doi-je chanter, se de lui [elle] non
, Couci, II. Donques ai-je toute joie enhaïe
, ib. ?Diex?! i faudrai-je donc?? Oïl, par Dieu, tels est ma destinée, Et tel destin m'ont doné li felon
, ib. VI. Se fins amis ?Doit joie avoir pour servir leaument, Dont doi-je bien par droit estre joieus
, ib. VII. Qui dont veïst le duc sur un cheval gascon Poindre parmi les rues?
, Sax. VIII. Quant l'aurez salué, don lui dites coment Guiteclins de Sassogne envers nous entreprent
, ib. XX.
XIIIe s. Se vous voulez la serve par no [notre] conseil mener, Dont ne lui faites mie du cor la vie oster
, Berte, XCVII.
XVIe s. Qui est celuy doncques si inhumain, Qu'en tout ennuy ne loue ce bon Pere??
Marot, I, 297. Qui dira donc, qu'un seul cas fortuit Soit entre nous, il n'est pas bon chrestien
, Marot, I, 299. Quelqu'un donc me disoit l'aultre jour que?
, Montaigne, I, 158. Le premier doncques qu'il desfeit fut un voleur nommé Periphetes
, Amyot, Thés. 10.
Wiktionnaire
Adverbe - ancien français
donc \Prononciation ?\
- Variante de dont.
Conjonction de coordination - français
donc \d??k\ ou \d??\
-
Marque la conclusion d'un raisonnement.
- Je pense, donc je suis.
- Marque l'induction, exprime qu'une chose est ou doit être la conséquence, le résultat d'une autre, qu'elle a lieu en conséquence d'une autre.
- Ainsi donc vous refusez.
- Vous êtes donc bien décidé.
- Il faut donc vous obéir.
- Vous serez donc toujours le même.
- Vous voyez donc bien que j'avais raison.
- Donc, vous vous trompez !
- Ils partirent donc secrètement.
- Marque d'étonnement, de surprise.
- J'étais donc destiné à lui survivre !
- Voilà donc tout le fruit que j'ai retiré de mes soins !
- Qu'avez-vous donc ?
- Que dit-il donc là ?
- Qu'ai-je donc fait pour que vous me traitiez de la sorte ?
- Quoi donc! il me résisterait ?
- Mais où est donc passée ma carte bleue ?
- ? Allons donc ! il partait, le lundi, de Preignac pour ses affaires et ne quittait Bordeaux que le samedi soir. Votre pauvre mère, toute seule, devait supporter tante Félicia. ? (François Mauriac, Le Mystère Frontenac, 1933, réédition Le Livre de Poche, page 24)
- Rend plus pressante une demande, une injonction.
- Dites-nous donc comment la chose s'est passée.
- Répondez donc.
- Donnez-moi donc cela.
- Renforce une phrase.
- ? Qu'elles sentent donc bon ! ? (Colette, Sido, 1930, Fayard, page 25)
Trésor de la Langue Française informatisé
DONC, conj., adv. et particule.
Conjonction, adverbe et particule de coordination, dont la place est assez mobile dans la phrase, et qui sert tantôt à relier logiquement une phrase ou une proposition à une autre, tantôt à renforcer une phrase, une proposition ou un mot.Donc au Scrabble
Le mot donc vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot donc - 4 lettres, 1 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot donc au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
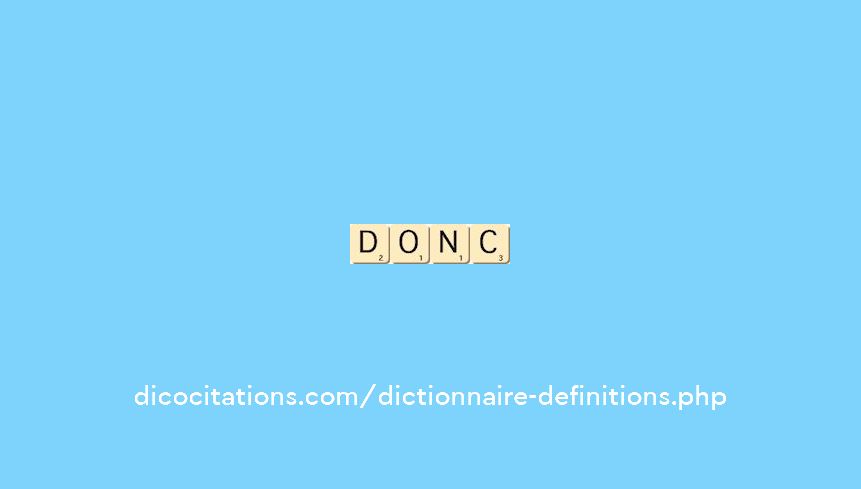
Les mots proches de Donc
Don Donataire Donateur, trice Donation Donc Dondaine Dondon Donjon Don juan Don-juanique Donnant, ante Donné, ée Donné Donnée Donnée Donner Donneur, euse Don-quichottisme Dont Donzelle don Don dona doña donat donateur donateurs donatien donatienne donation donations donatrice Donazac donc Donceel Donchery Doncières Doncourt-aux-Templiers Doncourt-lès-Conflans Doncourt-lès-Longuyon Doncourt-sur-Meuse dondaine dondaines Dondas dondon dondons dong Dongelberg Donges dôngs Donjeux Donjeux donjon Donjon donjons donjuanesque donjuanisme Donk donna donnai donnaient donnais donnait donnâmes donnant donnant donnant-donnant donnas donnassent donnâtMots du jour
-
store rus transitions recouds homologation télépathiquement mystagogie polonais sternal milliardaire
Les citations avec le mot Donc
- Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de lumière.Auteur : La Bible - Source : Epîtres de saint Paul, aux Romains, XIII, 12
- La femme et l'homme, pour être bons, ont donc besoin des mêmes choses, savoir, de la justice et de la sagesse.Auteur : Platon - Source : Ménon
- Dis donc, Mora, il est bath c'te wagon? - Tu parles d'un sliping!Auteur : Blaise Cendrars - Source : Moravagine (1926)
- Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?Auteur : Pierre Corneille - Source : Le Cid (1636) - Vous êtes une femme, donc moins qu'un homme, et vous êtes noire, donc moins que rien.Auteur : Tania de Montaigne - Source : Noire: La vie méconnue de Claudette Colvin
- L'amour donc en général est l'inclination qui fait désirer à chacun de posséder toujours ce qui lui parait bon.Auteur : Platon - Source : Le Banquet
- Pour des êtres de notre espèce, tu le sais, l'erreur est pire que le crime. Je vais donc faire effort pour t'expliquer ma conception de la philosophie nietzschéenne en ce qui te concerne : le surhomme est exempté des lois ordinaires qui gouvernent le commun des hommes. Rien de ce qu'il peut faire ne l'engage, à l'exception cependant du seul crime qu'il puisse commettre : faire une erreur.Auteur : Meyer Levin - Source : Crime (1958)
- Ce n'est pas une grève qui résout les problèmes, on ne fait pas une grève contre un virus. Je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, donc moi j'en appelle à la fois au sang-froid, à l'unité de la nation autour de son école, à ne pas confondre les sujets, on est en campagne présidentielle, certains opposants essaient d'en faire un thème.Auteur : Jean-Michel Blanquer - Source : Sur BFM-TV, le mardi 11 janvier 2022
- Je suis un enfant de la violence, donc un adulte de la paix.Auteur : Philippe Fragione, dit Akhenaton - Source : Rencontre avec le rappeur Akhenaton, Le Monde, par Sandrine Blanchard, 20/06/2021
- Mais tu connais donc pas l'gros Charles,
L'chemisier d'la ru'Saint-Martin!
Tu sais don'pas à qui qu'tu parles?
J'suis dans l'Bottin.Auteur : Aristide Louis Armand Bruand, dit Aristide Bruant - Source : Sur la route, J'suis dans l'Bottin - La noblesse du métier d'écrivain est dans la résistance à l'oppression, donc au consentement à la solitude.Auteur : Albert Camus - Source : Le premier homme (1994)
- Etant farouchement attaché à ma liberté de pensée et de création, je ne veux rien recevoir, ni du pouvoir actuel, ni d'aucun autre pouvoir politique quel qu'il soit. C'est donc avec la plus grande fermeté que je refuse cette médaille.Auteur : Jacques Tardi - Source : Communiqué envoyé à l'AFP, après avoir refusé la Légion d'honneur début 2013.
- Je voyais donc l'imagination à sa naissance, l'imagination qui n'est que naissance, car elle n'est que le premier état de toutes nos idées. C'est pourquoi tous les dieux sont au passé.Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Histoire de mes pensées (1936)
- Aujourd’hui, c’est donc les temples, et demain, c’est Syracuse, après-demain Raguse. N’oublie pas, nous nous étions promis Savoca. Toute personne normalement constituée, qui se rend en Sicile, visite Savoca. Auteur : Yves Ravey - Source : Taormine (2022)
- Tu ne comprends donc pas que tout ce que vous mettez sur Internet y est pour l'éternité et que la notion de vie privée n'existe pas pour ces gens-là ? Ils s'en tapent de votre vie privée. Et même pis : ils ont bien l'intention de faire du fric avec. Auteur : Bernard Minier - Source : Une putain d'histoire (2015)
- On répète pour 99: - Un euro, c'est 6,50 francs; - Deux euros, c'est donc 13 francs; - Trois zéro, c'est la prochaine défaite du PSG...Auteur : Laurent Ruquier - Source : Il faut savoir changer de certitudes (1999)
- Je ne suis pas comme vous accrochée à Internet donc j'aime bien voir des choses qui se passent à la surface de la terre.Auteur : Agnès Varda - Source : Lors du "Women In Motion", le 3 juillet 2018
- ... n'écris donc pas, si tu n'excelles et, pour exceller, écris peu.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 1
- Le petit Robert a une dimension historique qui plus est, rien ne doit sortir. Les enfants disaient « t'es un bouffon », ils disent maintenant « t'es un bolos », donc nous gardons les deux!Auteur : Alain Rey - Source : Interview Le Journal du Dimanche, le 22 mai 2015
- Si vous n'avez pas d'opinions politiques, prenez donc les miennes.Auteur : Edgar Faure - Source : Sans référence
- Il y aura un moment terriblement narcissique, ça frisera même l'onanisme. Je veux un livre moral, donc il y aura de l'onanisme, qui est une pratique éminemment morale, c'est un retour sur soi.Auteur : Jean-Louis Bory - Source : Le Pied (1977)
- Etait-ce donc la société qui déterminait ce qui était convenable ou pas?Auteur : Jostein Gaarder - Source : Le monde de Sophie (1991)
- Est-ce donc nuire aux gens que de leur donner la liberté d'esprit?Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Les Mouches (1943)
- Un philosophe est donc quelqu'un qui reconnaît comprendre fort peu de chose et qui en souffre.Auteur : Jostein Gaarder - Source : Le monde de Sophie (1991)
- Ce que fait un homme c'est comme si tous les hommes le faisaient. Il n'est donc pas injuste qu'une désobéissance dans un jardin ait pu contaminer l'humanité; il n'est donc pas injuste que le crucifiement d'un seul juif ait suffi à la sauver.Auteur : Jorge Luis Borges - Source : La forme de l'épée
Les citations du Littré sur Donc
- Mais de sa canne enfin il te bourrait, Et tu gagnas, sans mot dire, la porte. - Eh donc ! mon cher, quand j'agis de la sorte, Je croyais bien que le fat me suivaitAuteur : PONS DE VERDUN - Source : les Excuses
- Philisbourg est pris, ma chère enfant, votre fils se porte bien ; je n'ai qu'à tourner cette phrase de tous côtés, car je ne veux point changer de discours ; vous apprendrez donc par ce billet que votre enfant se porte bien, et que Philisbourg est prisAuteur : Madame de Sévigné - Source : 475
- Adoncques dresserent un grand boys, on quel pendirent une selle d'armes, ung chanfrain de cheval....Auteur : François Rabelais - Source : Pant. II, 27
- Voilà donc le séjour d'un peuple, et le murmure De ces innombrables essaims Que la terre produit et dévore à mesureAuteur : LAMART. - Source : Harm. I, 10
- [Le duc d'Anjou] s'en vint mettre le siege devant la ville et le chastel de Lourdes ; adonc se douta grandement le comte de Foix du duc d'Anjou, pour ce que il le vouloit voir de si prèsAuteur : Jean Froissard - Source : II, III, 9
- Il faut donc l'achever [la raison]Auteur : Blaise Pascal - Source : édit. Cousin.
- Bacon a donc eu bien raison de dire que nous avions besoin d'un novum organum, et que non-seulement nous avions besoin de créer cet organe tout nouveau, mais que....Auteur : DE TRACY - Source : Logique, Disc. prélim.
- Qu'ils viennent donc sur moi prouver leur zèle impieAuteur : Jean Racine - Source : Iphig. V, 3
- Voilà doncques jusques où je me sens coulpable de ceste premiere partie que je disois estre au vice de la presumptionAuteur : MONT. - Source : III, 67
- Quel jour mêlé d'horreur vient effrayer mon âme ! Tout mon sang de colère et de honte s'enflamme ; J'étais donc le jouet.... ciel, daigne m'éclairer ! Un moment sans témoins cherchons à respirerAuteur : Jean Racine - Source : Esth. III, 4
- Ce n'est donc pas son intention de detracter en rien qui soit de la vraye foy ; mais declairer combien estoyent ineptes tels baveurs, de tant attribuer à une vaine apparence de foyAuteur : CALVIN - Source : ib. 642
- Quelle est donc cette pompe où s'adressent tes pas ?Auteur : Voltaire - Source : Alz. II
- Me voilà donc le confident de mes deux bonnes gens et le médiateur de leurs amours ! bel emploi pour un gouverneurAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Ém. V
- Cet organe des dieux est-il donc infaillible ?Auteur : Voltaire - Source : Oed. IV, 1
- Rentrez donc, Rosine, cet homme paraît avoir du vinAuteur : BEAUMARCH. - Source : Barb. de Sév. II, 12
- Si fit adonc en ce temps de celui qui puis fut le roi de France, la plus belle cure dont on pust ouïr parlerAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 70
- Passons donc une même canonicité à ces livres contestés ou non contestésAuteur : BOSSUET - Source : Projet.
- La vie m'a été donnée comme une faveur ; je puis donc la rendre lorsqu'elle ne l'est plusAuteur : Montesquieu - Source : Lett. pers. 76
- Je suis donc un témoin de leur peu de puissance ?Auteur : Jean Racine - Source : ib. II, 2
- Tous ces passages ensemble [des psaumes et des prophètes] ne peuvent être dits de la réalité ; tous peuvent être dits de la figure ; donc ils ne sont pas dits de la réalité, mais de la figureAuteur : Blaise Pascal - Source : ib. XVI, 6
- La construction de craindre, suivi de que et d'un verbe, est le subjonctif ; il faut donc se garder d'imiter ces phrases de Fénelon : Je crains bien que tous ces petits sophistes grecs achèveront de corrompre les moeurs romainesAuteur : FÉN. - Source : Dial. des morts, n° 37
- Leur vaillance luy vint adonc fort à propos, et luy fut très salutaireAuteur : AMYOT - Source : Agés. 27
- Je finirai donc en cet endroit, plus par discrétion que par faute de matièreAuteur : BALZ. - Source : liv. I, lett. 9
- Le voilà donc mort, ce grand ministre [Louvois], cet homme si considérable, qui tenait une si grande placeAuteur : Madame de Sévigné - Source : Lett à de Coulanges, 26 juillet 1691
- Quant aux corps morts qui s'eslevent sur l'eaue, c'est adonc qu'ils sont ja cadavereux et rempli d'airAuteur : PARÉ - Source : III, 660
Les mots débutant par Don Les mots débutant par Do
Une suggestion ou précision pour la définition de Donc ? -
Mise à jour le vendredi 13 février 2026 à 00h55
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur donc
Poèmes donc
Proverbes donc
La définition du mot Donc est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Donc sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Donc présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
