La définition de Tartare du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Tartare
Nature : s. m.
Prononciation : tar-ta-r'
Etymologie : Lat. Tartarus.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de tartare de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec tartare pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Tartare ?
La définition de Tartare
Terme de mythologie. Nom que les poëtes donnent au lieu où les coupables sont tourmentés dans les enfers (avec un T majuscule).
Toutes les définitions de « tartare »
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
tartare \Prononciation ?\ féminin
- Variante de tartaire.
Nom commun - français
tartare \ta?.ta?\ masculin
-
(Cuisine) (Par ellipse) (Absolument) Steak tartare.
- Rares sur les marchés, disponibles surtout dans les magasins bio, elles ne sont jamais au centre de l'assiette, si ce n'est la laitue de mer mélangée à d'autres dans une salade ou un tartare.? (Ces légumes venus de la mer par JP Géné pour Le Monde le 16 août 2016)
Adjectif - français
tartare \ta?.ta?\ masculin et féminin identiques
- Relatif aux Tartares.
- La race turque a joué un grand rôle dans les conquêtes tartares. ? (Jean-Jacques Ampère, La Chine et les travaux d'Abel Rémusat, Revue des Deux Mondes, 1832, tome 8)
Littré
- Terme de mythologie. Nom que les poëtes donnent au lieu où les coupables sont tourmentés dans les enfers (avec un T majuscule).
C'était une opinion établie dès le troisième siècle, que Jésus était descendu dans l'Adès, dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d'Enfer
, Voltaire, Dict. phil. Symbole.
Encyclopédie, 1re édition
TARTARE, s. m. (Mytholog.) lieu du supplice des tyrans & des coupables des plus grands crimes. C'est l'abîme le plus profond sous la terre. Le mot ??????????? se trouve dans Plutarque pour geler ou trembler de froid ; & d'autres auteurs, comme Hésiode, s'en sont aussi servi dans ce sens, parce qu'ils pensoient, que qui dit le primum obscurum dans la nature, dit aussi le primum frigidum.
Homere veut que cette prison ne soit pas moins éloignée des enfers en profondeur, que les enfers le sont du ciel. Virgile ajoute qu'elle est fortifiée de trois enceintes de murailles, & entourée du Phlégéton, torrent impétueux, dont les ondes enflammées entraînent avec fracas les débris des rochers ; une haute tour défend cette affreuse prison, dont la grande porte est soutenue par deux colonnes de diamans, que tous les efforts des mortels & toute la puissance des dieux ne pourroient briser ; couverte d'une robe ensanglantée, Tisiphone est assise nuit & jour à la porte de cette prison terrible, qui retentit de voix gémissantes, de cruels coups de fouet & d'un bruit affreux de chaînes. Mais je suis bien ridicule de ne pas laisser parler le prince des poëtes dans son beau langage.
Sub rupe sinistrâ
M?nia lata videt triplici circumdata muro :
Quæ rapidus flammis ambit torrentibus amnis
Tartareus Phlegeton, torquetque sonantia saxa ;
Porta adversa ingens, solidoque adamante columnæ
Vis ut nulla virûm, non ipsi exscindere ferro
C?licolæ valeant : stat ferrea turris ad auras.
Tisiphoneque sedens, palla succincta cruentâ,
Vestibulum insomnis servat noctesque diesque,
Hinc exaudiri gemitus, & sæva sonare
Verbera ; tùm stridor ferri, tractæque catenæ.
Constitie Æneas, strepitumque exterritus hausit.
Un de nos poëtes lyriques s'est aussi surpassé dans la description du tartare ; lisons-la.
Qu'entens-je ! le tartare s'ouvre,
Quels cris ! quels douloureux accens !
A mes yeux la flamme y découvre
Mille supplices renaissans.
Là sur une rapide roue,
Ixion dont le ciel se joue,
Expie à jamais son amour.
Là le c?ur d'un géant rebelle
Fournit une proie éternelle
A l'avide faim d'un vautour.
Autour d'une tonne percée
Se lassent ces nombreuses s?urs,
Qui sur les freres de Lincée
Vengerent de folles terreurs ;
Sur cette montagne glissante
Elevant la roche roulante,
Sisiphe gémit sans secours ;
Et plus loin cette onde fatale
Insulte à la soif de Tantale,
L'irrite, & le trahit toujours.
Si l'on trouvoit dans toutes les odes de M. de la Motte le feu & la verve qui brillent dans celle-ci, elles auroient eu plus d'approbateurs ; mais c'est Milton qui a le mieux réussi de tous les modernes dans la peinture du tartare. Elle glace d'effroi, & fait dresser les cheveux de ceux qui l'a lisent.
Selon l'opinion commune, il n'y avoit point de retour, ni de grace à espérer pour ceux qui étoient une fois précipités dans le tartare : Platon néanmoins n'embrasse pas tout-à-fait ce sentiment. Ceux, dit-il, qui ont commis ces grands crimes, mais qui ne sont pas sans remede, comme ceux qui sont coupables d'homicide, mais qui en ont eu ensuite du regret, ceux là sont nécessairement précipités dans le tartare ; & après y avoir séjourné une année, un flot les en retire ; & lors ils passent par le Cocyte, ou le Péryphlégéton, delà ils vont au lac Acherusia, où ils appellent par leur nom ceux qu'ils ont tués, & les supplient instamment de souffrir qu'ils sortent de ce lac, & de leur faire la grace de les admettre en leur compagnie. S'ils peuvent obtenir d'eux cette faveur, ils sont d'abord délivrés de leurs maux, sinon ils sont de nouveau rejettés dans le tartare ; ensuite une autre année ils reviennent au fleuve, comme ci-devant, & réiterent toujours leurs prieres, jusqu'à ce qu'ils aient fléchi ceux qu'ils ont offensés. C'est la peine établie par les juges.
Quelques mythologistes croient que l'idée du tartare, a été formée sur le Tartesse des anciens, qui étoit une petite île à l'embouchure du Bétis, aujourd'hui Guadalquivir en Espagne : mais c'est plutôt du fameux labyrinte d'Egypte qu'est tirée la prison du tartare, ainsi que toute la fable des enfers. (Le chevalier de Jaucourt.)
Tartares ou Tatars, (Géogr. mod.) peuples qui habitent presque tout le nord de l'Asie. Ces peuples sont partagés présentement en trois nations différentes ; savoir, 1°. les tartares ainsi nommés ; 2°. les Callmoucks ; 3°. les Moungales : car les autres peuples payens dispersés par toute la Sibérie, & sur les bords de la mer Glaciale, sont proprement des peuples sauvages, séparés, quoique descendant des anciens Tartares.
Les Tartares particulierement ainsi nommés, professent tous le culte mahométan, quoique chez la plûpart ce culte tient beaucoup plus du paganisme, que du mahométisme. Tous les Tartares se subdivisent en plusieurs nations, qu'il importe de faire connoître : les principales sont.
1°. Les Tartares Barabinskoi ; 2°. les Tartares Baskirs, & ceux d'Uffa ; 3°. les Tartares de Budziack. 4°. les Tartares Calmoucks ; 5°. les Tartares de la Casatschia Orda ; 6°. les Tartares de la Crimée ; 7°. les Tartares Circasses ; 8°. les Tartares du Daghestan ; 9°. les Tartares Koubane ; 10°. les Tartares Moungales ; 11°. les Tartares Nogais ; 12°. les Tartares Telangouts ; 13°. les Tartares Tonguses ; 14°. les Tartares de la grande Boucharie. 15°. Enfin les Tartares Usbecks.
Les Tartares Barabinskoi, sont des peuples payens de la grande Tartarie. Ils habitent le désert de Baraba, qui s'étend entre Tara & Tomskoi ; ils demeurent dans des huttes creusées en terre, avec un toit de paille, soutenu par des pieux élevés de trois piés ; cette nation est tributaire du czar.
Les Tartares Baskirs, ou de Baskain & d'Uffa, occupent la partie orientale du royaume de Casan, & les Tartares d'Uffa occupent la partie méridionale. Les uns & les autres sont grands & robustes ; ils ont le teint un peu basané, les cheveux noirs, & les sourcils fort épais ; ils portent une robe longue de gros drap blanc, avec une espece de capuchon attaché dont ils se couvrent la tête en hiver. Les femmes sont habillées à la façon des paysanes de Russie, sur-tout depuis qu'ils sont soumis à cette couronne ; leur langue est un mélange de langue tartare & russienne. Quoiqu'ils observent encore la circoncision, & quelques autres cérémonies mahométanes, ils n'ont plus aucune connoissance de l'alcoran, & n'ont par conséquent ni moullhas, ni mosquées ; ensorte que leur religion tient beaucoup du paganisme, chez ceux qui n'ont pas embrassé le culte grec. Comme le pays qu'ils habitent est situé entre les 52 d. 30. de longitude, & le 57. d. de latitude ; ce pays est fertile en grains, en fruits, en miel & en cidre. Aussi les Tartares Baskirs & d'Uffa, sement de l'orge, de l'avoine & d'autres grains, habitent dans des villages bâtis à la maniere de Russie, & se nourrissent de leur bétail & de la chasse.
Les Tartares de Budziack, habitent vers le rivage occidental de la mer Noire, entre l'embouchure du Danube & la riviere de Bog. Quoique ces Tartares soient une branche de ceux de la Crimée, & qu'ils en aient la religion & les coutumes, cependant ils vivent indépendans de la Porte, & du chan de la Crimée. Ils n'obéissent qu'à des murses, chefs des différens ordres qui composent leur corps. Ils font même quelquefois des incursions sur les terres des Turcs, & se retirent chez eux après le pillage. On dit que leur nation peut faire environ trente mille hommes.
Les Tartares Callmoucks, occupent une grande partie du pays qui est entre le Mongul & le Wolga. Ils sont divisés en plusieurs hordes particuliers, qui ont chacune leur aucoes, ou chan, à part. Les Callmoucks n'ont point d'habitation fixe, mais seulement des tentes de feutre, avec lesquelles ils campent & décampent en un instant. Ils se mettent en marche au printems, le long des pâturages, sur les bords du Wolga, & menent avec eux quantité de chameaux, de b?ufs, de vaches, de chevaux, de moutons & de volailles. Ils viennent de cette maniere en forme de caravanes à Astracan, avec toutes leurs familles pour y commercer. Ils échangent leurs bestiaux pour du blé, du cuivre, du fer, des chauderons, des couteaux, des ciseaux, du drap, de la toile, &c.
Les Callmoucks sont robustes & guerriers. Ils y en a toujours un corps dans les troupes du czar, suivant le traité d'alliance fait avec eux, & ce corps monte à environ six mille hommes.
Les Tartares de la Casatschia Orda, sont une branche des Tartares mahométans, qui habitent dans la partie orientale du pays de Turkestan, entre la riviere de Jemba & celle de Sirth. Ils ont la taille moyenne, le teint fort brûlé, de petits yeux noirs brillans & la barbe épaisse. Ils coupent leurs cheveux qu'ils ont extrêmement forts & noirs, à quatre doigts de la tête, & portent des bonnets ronds d'un empan de hauteur, d'un gros drap ou feutre noir, avec un bord de pelleterie ; leur habillement consiste dans une chemise de toile de coton, des culottes de peau de mouton, & dans une veste piquée de cette toile de coton, appellée kitaiha par les Russes ; mais en hiver ils mettent par-dessus ces vestes une longue robe de peau de mouton, qui leur sert en été de matelats ; leurs bottes sont fort lourdes & faites de peau de cheval, de sorte que chacun peut les façonner lui-même ; leurs armes sont le sabre, l'arc & la lance, car les armes à feu sont jusqu'à présent fort peu en usage chez eux.
Ils sont toujours à cheval, en course, ou à la chasse, laissant le soin de leurs troupeaux & de leurs habitations à leurs femmes, & à quelques esclaves. Ils campent pour la plûpart sous des tentes ou hutes, vers les frontieres des Callmoucks & la riviere de Jemba, pour être à portée de butiner. Dans l'été ils passent fort souvent les montagnes des Aigles, & viennent faire des courses jusque bien avant dans la Sibéric, à l'ouest de la riviere d'Irtis.
Les Cara-Kalpaks, qui habitent la partie occidentale du pays de Turkestan, vers les bords de la mer Caspienne, sont les fideles alliés & parens des Tartares de la Casatschia Orda, & les accompagnent communément dans leurs courses, lorsqu'il y a quelque grand coup à faire.
Les Tartares de la Casatschia-Orda, font profession du culte mahométan, mais ils n'ont ni alcoran, ni moulhas, ni mosquées, ensorte que leur religion se réduit à fort peu de chose. Ils ont un chan qui réside ordinairement en hiver dans la ville de Taschkant, & qui en été va camper sur les bords de la riviere de Sirth, & les frontieres des Callmoucks ; mais leurs murses particuliers qui sont fort puissans, ne laissent guere de pouvoir de reste au chan. Ces Tartares peuvent armer tout-au-plus trente mille hommes, & avec les Cara-kalpaks cinquante mille, tous à cheval.
Les Tartares de la Crimée sont présentement partagés en trois branches, dont la premiere est celle des Tartares de la Crimée ; la seconde, celle des Tartares de Budziach ; & la troisieme celle des Tartares Koubans. Les Tartares de la Crimée sont les plus puissans de ces trois branches ; on les appelle aussi les Tartares de Perékop, ou les Tartares Saporovi, à cause que par rapport aux Polonois qui leur donnent ce nom, ils habitent au-delà des cataractes du Borysthène.
Ces Tartares occupent à-présent la presqu'île de la Crimée, avec la partie de la terre ferme au nord de cette presqu'île, qui est séparée par la riviere de Samar de l'Ukraine, & par la riviere de Mius du reste de la Russie. Les Tartares de la Crimée sont ceux de tous les Tartares mahométans qui ressemblent le plus aux Calmoucks, sans être néanmoins si laids ; mais ils sont petits & fort quarrés ; ils ont le tein brûlé, des yeux de porc peu ouverts, le tour du visage plat, la bouche assez petite, des dents blanches comme de l'ivoire, des cheveux noirs qui sont rudes comme du crin, & fort peu de barbe. Ils portent des chemises courtes de toile de coton, & des caleçons de la même toile ; leurs culottes sont fort larges & faites de quelque gros drap ou de peau de brebis ; leurs vestes sont de toile de coton, piquée, à la maniere des caffetans des Turcs ; & au-dessus de ces vestes ils mettent un manteau de feutre, ou de peau de brebis.
Leurs armes sont le sabre, l'arc, & la flèche. Leurs chevaux sont vilains & infatigables. Leur religion est la mahométane. Leur souverain est un chan allié de la porte Ottomane, & dont le pays est sous la protection du grand-seigneur. C'est dans la ville de Bascia-Sarai, située vers le milieu de la presqu'île de Crimée, que le chan fait ordinairement sa résidence. La partie de la terre ferme au nord de Perékop, est occupée par des hordes de Tartares de la Crimée, qui vivent sous des huttes, & se nourrissent de leur bétail, lorsqu'ils n'ont point occasion de brigander.
Les tartares de ce pays passent pour les plus aguerris de tous les Tartares. Ils sont presque toujours en course, portant avec eux de la farine d'orge, du biscuit, & du sel pour toute provision La chair de cheval & le lait de jument font leurs délices. Il coupent la meilleure chair de dessus les os, par tranches, de l'épaisseur d'un pouce, & les rangent également sur le dos d'un autre cheval, sous la selle, & en observant de bien serrer la sangle, & ils font ainsi leur chemin. Au bout de trois ou quatre lieues ils levent la selle, retournent les tranches de leur viande, remettent la selle comme auparavant, & continuent leur traite. A la couchée le ragoût se trouve tout prêt ; le reste de la chair qui est à l'entour des os se rôtit à quelques bâtons, & se mange sur-le-champ au commencement de la course.
Au retour du voyage, qui est souvent d'une centaine de lieues & davantage, le chan prend la dixme de tout le butin, qui consiste communément en esclaves ; le murse de chaque horde en prend autant sur la part qui peut revenir à ceux qui sont sous son commandement, & le reste est partagé également entre ceux qui ont été de la course. Les Tartares de la Crimée peuvent mettre jusqu'à quatre-vingt mille hommes en campagne.
Les Tartares Circasses habitent au nord-ouest de la mer Caspienne, entre l'embouchure de la riviere de Wolga & la Géorgie. Le peuple qui est présentement connu sous le nom des Circasses, est une branche des tartares mahométans. Du-moins les Circasses conservent-ils jusqu'aujourd'hui la langue, les coutumes, les inclinations, & même l'extérieur des Tartares, nonobstant qu'on puisse s'appercevoir facilement qu'il doit y avoir bien du sang des anciens habitans du pays mêlés chez eux, parmi celui des Tartares.
Il y a beaucoup d'apparence que les Tartares Circasses, aussi-bien que les Daghestans, sont de la postérité de ceux d'entre les Tartares qui furent obligés, du tems que les sofis s'emparerent de la Perse, de se retirer de ce royaume pour aller gagner les montagnes qui sont au nord de la province de Schirvan, d'où les Perses ne les pouvoient pas chasser si facilement, & où ils étoient à portée d'entretenir correspondance avec les autres tribus de leur nation, qui étoient pour-lors en possession des royaumes de Casan & d'Astracan.
Les Tartares Circasses sont assez laids, & presque toutes leurs femmes sont très-belles. En été elles ne portent qu'une simple chemise d'une toile de coton, fendue jusqu'au nombril, & en hiver elles ont des robes semblables à celles des femmes russiennes : elles se couvrent la tête d'une sorte de bonnet noir qui leur sied fort bien ; elles portent autour du cou plusieurs tours de perles de verre noir, pour faire d'autant mieux remarquer les beautés de leur gorge ; elles ont un tein de lys & de rose, les cheveux & les plus beaux yeux noirs du monde.
Les Tartares Circasses se font circoncire, & observent quelques autres cérémonies mahométanes ; mais la religion grecque commence à faire beaucoup de progrès dans leur pays. Ils habitent en hiver dans des villages, & ont pour maisons de chetives chaumieres ; en été ils vont camper la plûpart du tems dans les endroits où ils trouvent de bons pâturages, savoir vers les frontieres du Daghestan & de la Georgie, où le pays est fort beau, & fertile en toutes sortes de légumes & de fruits. C'est de la partie montueuse de la Circassie que viennent les chevaux circasses, tant estimés en Russie, pour leur vîtesse, la grandeur de leurs pas, & la facilité de les nourrir.
Les Circasses ont des princes particuliers de leur nation auxquels ils obéissent, & ceux-ci sont sous la protection de la Russie, qui possede Terki, capitale de tout le pays : les Circasses peuvent faire une vingtaine de mille hommes armés.
Les Tartares du Daghestan s'étendent en longueur depuis la riviere de Bustro, qui tombe dans la mer Caspienne, à 43d. 20?. de latitude jusqu'aux portes de la ville de Derbent ; & en largeur, depuis le rivage de la mer Caspienne, jusqu'à six lieues de la ville d'Erivan. Le pays est par-tout montueux, mais il ne laisse pas d'être d'une grande fertilité dans les endroits où il est cultivé.
Ces Tartares sont les plus laids de tous les Tartares mahométans. Leur tein est fort basané, & leur taille au-dessous de la médiocre est très-renforcée ; leurs cheveux sont noirs & rudes comme des soies de cochon ; leurs chevaux sont fort petits, mais lestes à la course, & adroits à grimper les montagnes ; ils ont de grands troupeaux de bétail, dont ils abandonnent le soin à leurs femmes & à leurs esclaves, tandis qu'ils vont chercher à voler dans la Circassie & dans la Géorgie, des femmes & des enfans, qu'ils exposent en vente à Derbent, à Erivan, & à Tifflis.
Ils obéissent à divers petits princes de leur nation qui prennent le nom de sultans, & qui sont tout aussi voleurs que leurs sujets ; ils nomment leur grand chan schemkal, dont la dignité est élective. Ce schemkal réside à Boinac. Tout barbares que sont les Tartares Daghestans, ils ont un excellent usage pour le bien de leur pays, savoir que personne ne se peut marier chez eux, avant que d'avoir planté dans un certain endroit marqué, cent arbres fruitiers, d'où vient qu'on trouve par-tout dans les montagnes du Daghestan, de grandes forets d'arbres fruitiers de toute espece.
Ces mêmes montagnes, dont ils connoissent seuls les sentiers, ont servi à conserver jusqu'ici les Tartares Daghestans dans l'indépendance des puissances voisines ; cependant la forteresse de Saint-André que les Russes ont bâtie dans le c?ur de leur pays, sur le bord de la mer Caspienne, entre Derbent & Terki, non seulement les tient en bride, mais porte bien la mine de les contraindre un jour à l'obéissance de la Russie, d'autant plus que toutes leurs forces ne montent guere qu'à quinze ou vingt mille hommes.
Les Tartares Koubans habitent au sud de la ville d'Assof, vers les bords de la riviere de Koucan, qui a sa source dans la partie du mont Caucase, que les Russes appellent Turki-Gora, & vient se jetter dans le Palus Méotide, à 46d. 15?. de latitude au nord-est de la ville de Daman.
Ces Tartares sont encore une branche de ceux de la Crimée, & étoient autrefois soumis au chan de cette presqu'île ; mais présentement ils ont leur chan particulier, qui est d'une même famille avec les chans de la Crimée. Il ne reconnoît point les ordres de la Porte, & se maintient dans une entiere indépendance, par rapport à toutes les puissances voisines. La plus grande partie de ces tartares ne subsistent que de ce qu'ils peuvent piller sur leurs voisins, & fournissent aux Turcs quantité d'esclaves circasses, géorgiennes & abasses, qui sont fort recherchées.
C'est pour couvrir le royaume de Casan contre les invasions de ces Tartares, que le czar Pierre a fait élever un grand retranchement qui commence auprès de Zarista sur le Wolga, & vient aboutir au Don, vis-à-vis la ville de Twia. Lorsque les Tartares de la Crimée ont quelques grands coups à faire, les Koubans ne manquent pas de leur prêter la main : ils peuvent former ensemble trente à trente-cinq mille hommes.
Les Tartares Moungales, Mogoules, ou Mungales, occupent la partie la plus considérable de la grande Tartarie, que nous connoissons maintenant sous le nom du pays des Moungales. Ce pays, dans l'état où il est à présent, est borné à l'est par la mer orientale, au sud par la Chine, à l'ouest par le pays des Callmoucks, & au nord par la Sibérie. Il est situé entre les 40 & 50 degrés de latitude, & les 110 & les 150 degrés de longitude ; en sorte que le pays des Moungales n'a pas moins de quatre cens lieues d'Allemagne de longueur, & environ 150 de largeur.
Les Moungales qui habitent à-présent ce pays, sont les descendans de ceux d'entre les Mogoules, qui après avoir été pendant plus d'un siecle en possession de la Chine, en furent rechassés par les Chinois vers l'an 1368 ; & comme une partie de ces fugitifs s'étant sauvée par l'ouest, vint s'établir vers les sources des rivieres de Jéniséa & Sélinga, l'autre partie s'en étant retirée par l'est, & la province de Léaotung, alla s'habituer entre la Chine & la riviere d'Amur.
On trouve encore à l'heure qu'il est deux sortes de Moungales, qui sont fort différens les uns des autres, tant en langue & en religion, qu'en coutumes & manieres ; savoir les Moungales de l'ouest, qui habitent depuis la Jéniséa jusque vers les 134 degrés de longitude, & les Moungales de l'est, q
Trésor de la Langue Française informatisé
TARTARE, adj. et subst.
Tartare au Scrabble
Le mot tartare vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot tartare - 7 lettres, 3 voyelles, 4 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot tartare au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
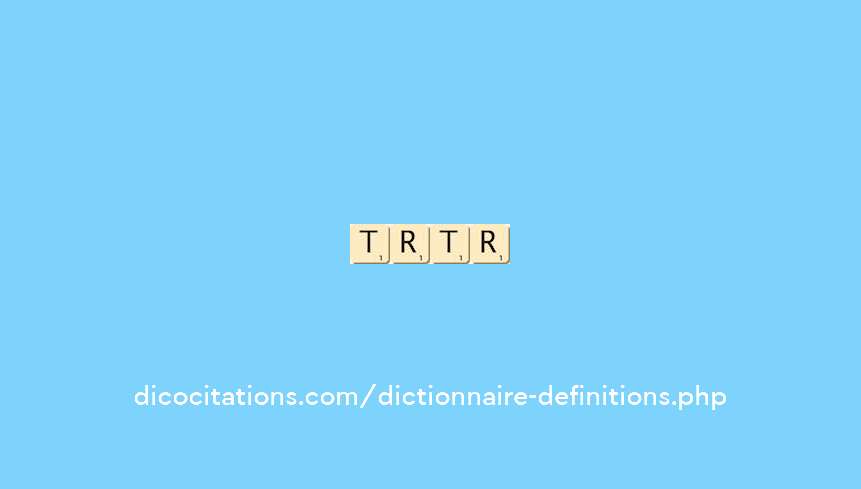
Les mots proches de Tartare
Tarabiscoté, ée Tarabusté, ée Tarabuster Tarantaise Tarantass Tarare Taraud Tard Tardement Tarder Tardif, ive Tardivement Tardiveté Tare Tarentelle Tarentule Tarer Targe Targette Targuer Tari, ie Taricheute Tarière Tarif Tarin Tarir Tarissable Taro Tarole Tarots Tarpéienne Tarse Tartare Tartare Tartareux, euse Tartariforme Tartarisé, ée Tarte Tartelette Tartine Tartouillade Tartouiller Tartouilleur Tartre Tartreux, euse Tartufe Tartuferie Tartufier tar tara Tarabel tarabiscot tarabiscotages tarabiscoté tarabiscotée tarabiscotée tarabiscotées tarabiscotés tarabiscotés tarabustait tarabuste tarabusté tarabustent tarabuster tarabustèrent tarabustes tarabustés Taradeau tarama tarare Tarare Tarascon Tarascon-sur-Ariège Tarasteix taratata taraud taraudaient taraudait taraudant taraude taraudé taraudée taraudées taraudent tarauder taraudèrent taraudés tarauds tarbais tarbais Tarbes Tarbes Tarbes Tarbes Tarbes Tarbes tarbouche tarbouifMots du jour
-
purifications cadet papouillez trente-quatre palais ressuscitée commanderies biner structures étreintes
Les citations avec le mot Tartare
- Les champs, foulés du pied des chevaux, montraient que les Tartares y avaient passé, et de ces barbares on pouvait dire ce que l'on a dit des Turcs: «Là où le Turc passe, l'herbe ne repousse jamais!»Auteur : Jules Verne - Source : Michel Strogoff (1876)
- Aussi, voyant qu'il ne pouvait rien apprendre de relatif à l'invasion tartare, écrivit-il sur son carnet: «Voyageurs d'une discrétion absolue. En matière politique, très durs à la détente.»Auteur : Jules Verne - Source : Michel Strogoff (1876)
- Les dieux n'aiment pas celui qui, se faisant violence, force les portes du Tartare. Ils ne trouveraient pas un semblable courage dans la mollesse de leurs coeurs éternels.Auteur : Giacomo, comte Leopardi - Source : Canti, Brutus le Jeune
- On racontait d'horribles atrocités commises par les envahisseurs, pillage, vol, incendie, meurtres. C'était le système de la guerre à la tartare.Auteur : Jules Verne - Source : Michel Strogoff (1876)
- Ceux qui ont voyagé dans les steppes du Tartare, disent : « Revenir aux terres cultivées, à la complexité et l'agitation de la civilisation nous oppressait et nous suffoquait, l'air semblait nous manquer, et nous nous sentions à tout moment sur le point de mourir d'asphyxie. » Quand je veux me recréer, je cherche le bois le plus sombre, le plus épais et le plus interminable, et, pour les citadins, le plus lugubre marécage. J'entre dans un marais comme en un lieu sacré - un sanctum sanctorum- Il y a la force, la moelle de la Nature.Auteur : Henry David Thoreau - Source : De la marche (1862)
- Douste-Blazy, il est chiraquin au sein de l'UDF... C'est un peu comme manger un tartare de boeuf au sein d'une assemblée de végétariens.Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses voisins.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Emile ou De l'éducation (1762)
- Les Parthes laissent croistre leurs cheveux à la mode des Tartares, sans les agencer ny peigner aucunement.Auteur : Jacques Amyot - Source : Crassus, 45
- Sur la grande place, transformée en camp que gardaient de nombreuses sentinelles, deux mille Tartares bivouaquaient en bon ordre.Auteur : Jules Verne - Source : Michel Strogoff (1876)
- Cependant, Alcide Jolivet avait fait comprendre à son confrère qu'il ne pouvait quitter Tomsk sans avoir pris quelque crayon de cette entrée triomphale des troupes tartares.Auteur : Jules Verne - Source : Michel Strogoff (1876)
- De cinquante gueules noirâtres béant, l'énorme Hydre plus hideuse encore à l'intérieur réside. Alors le Tartare même deux fois autant se dévoile profond, deux fois autant plonge dessous les ombres.Auteur : Virgile - Source : L'Enéide, VI
Les citations du Littré sur Tartare
- Les choses iront si mal que les Turcs et les Tartares conquerront toute Grece et convertiront à leur loiAuteur : Jean Froissard - Source : II, III, 25
- À la seconde, au plus tard à la troisième génération, les Tartares, les Turcs, les Persans, les Européens mêmes prennent la nonchalance indienneAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. V, 34
- Tout allait bien, quand leur emplette, En passant par certains endroits, Remplis d'écueils et fort étroits Et de trajet fort difficile, Alla toute emballée au fond des magasins Qui du Tartare sont voisinsAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XII, 7
- Les Tartares ont conquis deux fois la Chine, et ils la tiennent encore sous leur obéissanceAuteur : Montesquieu - Source : Lett. pers. 81
- Vainqueur des Turcs et des Tartares, il [Pierre le Grand] voulut accoutumer son peuple à la gloire comme aux travaux ; il fit entrer à Moscou son armée sous des arcs de triomphe, au milieu des feux d'artifice....Auteur : Voltaire - Source : Russie, I, 8
- Les Ukraniens, qu'on nomme Cosaques, sont un ramas d'anciens Roxelans, de Sarmates, de Tartares réunisAuteur : Voltaire - Source : Russ. I, 1
- C'est de temps immémorial la coutume des Tartares de porter plus de cordes que de cimeterres, pour lier les malheureux qu'ils surprennentAuteur : Voltaire - Source : Russie, II, 1
- Il [le duc de Russie] conduisait le tribut à pied devant l'ambassadeur tartare, se prosternait à ses pieds, lui présentait du lait à boire ; et, s'il en tombait sur le cou du cheval de l'ambassadeur, le prince était obligé de le lécherAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 119
- Son tartare vint me dire qu'il m'attendait à onze heuresAuteur : DIDER. - Source : Lett. à Mlle Voland, 18 oct. 1769
- Prenez deux livres de tartare c'est à dire lye de bon vin qui adhere contre les tonneauxAuteur : PARÉ - Source : XXIV, 39
- Le sang tartare s'est mêlé d'un côté avec les Chinois et de l'autre avec les Russes orientauxAuteur : BUFF. - Source : Hist. nat. Hom. Oeuv. t. V, p. 20
- Ils [les criminels du Tartare] ont horreur d'eux-mêmes, et ils ne peuvent non plus se délivrer de cette horreur que de leur propre natureAuteur : FÉN. - Source : Tél. XVIII
- Les auteurs d'une terrible histoire universelle prétendent que tous les Américains sont une colonie de TartaresAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Population.
- Clous de cuivre à cabochon, dont nos tapissiers se servent, et que les Tartares emploient pour mettre à l'entour de leurs sellesAuteur : DE PEYSSONNEL - Source : Comm. de la mer Noire, I, 329
- La mort a prêté le catafalque d'un empereur romain à la dépouille d'un TartareAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, IV, II, 3
- Il était aisé que la maltôte romaine tombât d'elle-même dans la monarchie des Francs ; c'était un art très compliqué et qui n'entrait ni dans les idées ni dans les plans de ces peuples simples ; si les Tartares inondaient aujourd'hui l'Europe, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nousAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXX, 13
- Le reste [de l'armée], dans une proportion effrayante, ressemblait à une horde de Tartares, après une heureuse invasion ; c'était, sur trois ou quatre files d'une longueur infinie, une confusion de calèches, de caissons, de riches voitures et de chariots de toute espèceAuteur : SÉGUR - Source : ib. IX, 1
- En repassant la grande muraille, ils [les Tartares] retombèrent dans la barbarie, et vécurent dans leurs déserts aussi grossiers qu'ils en étaient sortisAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. V, 17
- Lequel renfort serviroit beaucoup, mesmement pour l'oposer aux Tartares, si les Turcs les faisoyent donner dans les païs des chrestiens, pour faire diversionAuteur : LANOUE - Source : 440
- ....Il faut toujours punir ; Tout regorge dans le TartareAuteur : LAMOTTE - Source : Fabl. II, 20
- Les Turcs habitaient autrefois au delà du Taurus et de l'Immaüs, et bien loin, dit-on, de l'Araxe ; ils étaient compris parmi ces Tartares que l'antiquité nommait ScythesAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 53
- Et si, en beuvant, quelque goutte en tumboit sur le crin de leurs chevaux [chez les Tartares], il estoit tenu de la leicher avec la langueAuteur : MONT. - Source : I, 367
- C'était une opinion établie dès le troisième siècle, que Jésus était descendu dans l'Adès, dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d'EnferAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Symbole.
- Les kalpaks, ou bonnets à la tartare, et les caftans ou vestes rembourrées de coton...Auteur : DE PEYSSONNEL - Source : Traité sur le commerce de la mer Noire, I, 62
- Dès qu'un homme comme notre conquérant tartare [dans l'Orphelin de la Chine] a dit : j'aime, il n'y a plus pour lui de nuancesAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 8 sept. 1754
Les mots débutant par Tar Les mots débutant par Ta
Une suggestion ou précision pour la définition de Tartare ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 08h33
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur tartare
Poèmes tartare
Proverbes tartare
La définition du mot Tartare est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Tartare sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Tartare présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
