La définition de Syllabe du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Syllabe
Nature : s. f.
Prononciation : sil-la-b'
Etymologie : Provenç. sillaba ; espagn. silaba ; ital. sillaba ; du lat. syllaba, qui vient du grec, syllabe, du grec, prendre avec, du grec, avec, et du grec, prendre.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de syllabe de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec syllabe pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Syllabe ?
La définition de Syllabe
Son produit par une seule émission de voix, et qui se compose soit d'une voyelle seule, soit de voyelles et de consonnes.
Toutes les définitions de « syllabe »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Voyelle ou réunion de lettres qui se prononcent par une seule émission de voix. Rois et Lois sont des mots d'une syllabe. Dans le mot Avoir, A fait une syllabe, et Voir en fait une autre. Un mot d'une, de deux, de trois syllabes. Un vers de douze syllabes, de dix syllabes. Il appuie sur toutes les syllabes. Il n'en a pas perdu une syllabe. J'ai dit mot pour mot, syllabe pour syllabe ce que vous m'avez ordonné. Je n'y ai pas manqué d'une syllabe.
Littré
-
1Son produit par une seule émission de voix, et qui se compose soit d'une voyelle seule, soit de voyelles et de consonnes.
Vous vous souvenez du vieux pédagogue de la cour et qu'on appelait autrefois le tyran des mots et des syllabes
, Guez de Balzac, Socr. chrét. X.Ceux qui se sont figuré que l'Académie n'était qu'une troupe d'esprits bourrus qui ne faisaient autre chose que de combattre sur les syllabes, introduire des mots nouveaux, en proscrire d'autres?
, Pellisson, Hist. de l'Acad. III.Des villes que tu prends les noms durs et barbares N'offrent de toutes parts que syllabes bizarres
, Boileau, Épît. IV.Le nouveau Cicéron, tremblant, décoloré, Cherche en vain son discours sur sa langue égaré?; En vain, pour gagner temps, dans ses transes affreuses, Traîne d'un dernier mot les syllabes honteuses?; Il hésite, il bégaye
, Boileau, Lutr. VI.Le défaut le plus ordinaire et qu'on doit éviter avec plus de soin, c'est de ne point appuyer sur les dernières syllabes, et de laisser tomber sa voix à la fin des périodes
, Rollin, Traité des Ét. VI, 2° part. II, 3.Une syllabe dure gâte une pensée heureuse
, Voltaire, Dict. phil. Art poét.Dix syllabes par vers mollement arrangées Se suivaient avec art, et semblaient négligées
, Voltaire, Trois manières.La syllabe est un son complet qui est quelquefois composé d'une seule lettre, mais pour l'ordinaire de plusieurs?; d'où vient qu'on lui a donné le nom de syllabe, comprehensio, assemblage
, Duclos, ?uv. t. IX, p. 19.L'Alhambra?!? Forteresse aux crénaux festonnés et croulants, Où l'on entend la nuit de magiques syllabes
, Hugo, Orient. 31.Syllabe longue, celle où la voix se prolonge?; syllabe brève, celle où elle passe vite.
Les syllabes longues ou brèves n'ont aucune durée fixe, pas même de rapport déterminé entre leur durée
, Diderot, le Neveu de Rameau.Syllabe pure, celle qui ne renferme qu'une seule voyelle.
Syllabe mixte ou composée, celle qui renferme une diphthongue ou une triphthongue.
Syllabe directe, celle qui n'a qu'une consonne au commencement.
Syllabe inverse, celle qui n'a qu'une consonne à la fin.
Syllabe close ou fermée, celle où la voyelle est entre deux consonnes.
-
2 Par extension, mot, parole.
Il n'y a point d'âmes, fussent-elles de fer ou de bronze? qui puissent tenir contre les moindres syllabes de Jésus-Christ
, Guez de Balzac, Socr. chrét. II.Il ne dit pas une syllabe, il ne répondit pas une syllabe, il ne dit absolument rien, ne répondit absolument rien.
Je n'y changerai pas une syllabe, je n'y changerai rien.
Lépine?: Me donnez-vous votre dernier mot?? - Lisette?: Je n'y changerai pas une syllabe
, Marivaux, le Legs, SC. 3.Je n'en oublierai pas une syllabe, je répéterai les paroles sans y rien omettre.
Retiendrez-vous bien tout cela?? - Je n'en oublierai pas une syllabe
, Dancourt, les Agiot. II, 3.
HISTORIQUE
XIVe s. Comme les letres sont parties des sillabes et les sillabes des diccions
, Oresme, Éth. 253.
XVIe s. Syllabe, c'est un son entier, et peult estre d'une seule letre, comme d'une voyelle, peult aussi estre de plusieurs letres, voyelles ou consonnes
, P. Ramus, dans LIVET, Gramm. franç. p. 205.
Encyclopédie, 1re édition
SYLLABE, s. f. M. Duclos, dans ses remarques sur le ch. iij. de la I. partie de la grammaire générale, distingue la syllabe physique de la syllabe usuelle. « Il faut observer, dit-il, que toutes les fois que plusieurs consonnes de suite se font sentir dans un mot, il y a autant de syllabes réelles (ou physiques), qu'il y a des consonnes qui se font entendre, quoiqu'il n'y ait point de voyelle écrite à la suite de chaque consonne ; la prononciation suppléant alors un e muet, la syllabe devient réelle pour l'oreille, au lieu que les syllabes d'usage ne se comptent que par le nombre des voyelles qui se font entendre, & qui s'écrivent? Par exemple, le mot armateur est de trois syllabes d'usage, & de cinq réelles, parce qu'il faut suppléer un e muet après chaque r ; on entend nécessairement a-re-ma-teu-re ».
M. Maillet de Boullay, secrétaire pour les belles-lettres de l'académie royale des belles-lettres, sciences & arts de Rouen, dans le compte qu'il rendit à sa compagnie, des remarques de M. Duclos & du supplément de M. l'abbé Fromant, dit, en anonçant le même chapitre dont je viens de parler : « Nous ne pouvons le mieux commencer, qu'en adoptant la définition de l'abbé Girard, cité par M. Fromant. Suivant cette définition, qui est excellente, & qui nous servira de point fixe, la syllabe est un son simple ou composé, prononcé avec toutes ses articulations, par une seule impulsion de voix. Examinons sur ce principe le système adopté par M. Duclos. »
Qu'il me soit permis de faire observer à M. du Boullay, qu'il commence sa critique par une vraie pétition de principe : adopter d'abord la définition de l'abbé Girard, pour examiner d'après elle le système de M. Duclos, c'est s'étayer d'un préjugé pour en déduire des conséquences qui n'en seront que la répétition sous différentes formes. Ne seroit-on pas aussi bien fondé à adopter d'abord le système de M. Duclos pour juger ensuite de la définition de l'abbé Girard ; ou plutôt ne vaut-il pas mieux commencer par examiner la nature des syllabes en soi, & indépendamment de tout préjugé, pour apprécier ensuite le système de l'un & la définition de l'autre ?
Les élémens de la voix sont de deux sortes, les sons & les articulations. Le son est une simple émission de la voix, dont la forme constitutive dépend de celle du passage que lui prête la bouche. Voyez Son, Gramm. L'articulation est une explosion que reçoit le son, par le mouvement subit & instantanée de quelqu'une des parties mobiles de l'organe. Voyez H. Il est donc de l'essence de l'articulation, de précéder le son qu'elle modifie, parce que le son une fois échapé, n'est plus en la disposition de celui qui parle, pour en recevoir quelque modification que ce puisse être : & l'articulation doit précéder immédiatement le son qu'elle modifie, parce qu'il n'est pas possible que l'expression d'un son soit séparée du son, puisque ce n'est au fond rien autre chose que le son même sortant avec tel degré de vîtesse acquis par telle ou telle cause.
Cette double conséquence, suite nécessaire de la nature des elémens de la voix, me semble démontrer sans réplique.
1°. Que toute articulation est réellement suivie d'un son qu'elle modifie, & auquel elle appartient en propre, sans pouvoir appartenir à aucun son précédent ; & par conséquent que toute consonne est ou suivie ou censée suivie d'une voyelle qu'elle modifie, sans aucun rapport à la voyelle précédente : ainsi, les mots or, dur, qui passent pour n'être que d'une syllabe, sont réellement de deux sons, parce que les sons o & u une fois échapés, ne peuvent plus être modifiés par l'articulation r, & qu'il faut supposer ensuite le moins sensible des sons, que nous appellons e muet, comme s'il y avoit o-re, du-re.
2°. Que si l'on trouve de-suite deux ou trois articulations dans un même mot, il n'y a que la derniere qui puisse tomber sur la voyelle suivante, parce qu'elle est la seule qui la précede immédiatement ; & les autres ne peuvent être regardées en rigueur que comme des explosions d'autant d'e muets inutiles à écrire parce qu'il est impossible de ne pas les exprimer, mais aussi réels que toutes les voyelles écrites : ainsi, le mot françois scribe, qui passe dans l'usage ordinaire pour un mot de deux syllabes, a réellement quatre sons, parce que les deux premieres articulations s & k supposent chacune un e muet à leur suite, comme s'il y avoit se-ke-ri-be ; il y a pareillement quatre sons physiques dans le mot sphinx, qui passe pour n'être que d'une syllabe, parce que la lettre finale x est double, qu'elle équivaut à s, k, & que chacune de ces articulations composantes suppose après elle l'e muet, comme s'il y avoit se-phinke-se.
Que ces e muets ne soient supprimés dans l'orthographe, que parce qu'il est impossible de ne pas les faire sentir quoique non écrits, j'en trouve la preuve non-seulement dans la rapidité excessive avec laquelle on les prononce, mais encore dans des faits orthographiques, si je puis parler ainsi. 1°. Nous avons plusieurs mots terminés en ment, dont la terminaison étoit autrefois précédée d'un e muet pur, lequel n'étoit sensible que par l'alongement de la voyelle dont il étoit lui-même précédé, comme ralliement, éternuement, enrouement, &c. aujourd'hui on supprime ces e muets dans l'orthographe, quoiqu'ils produisent toujours l'alongement de la voyelle précédente, & l'on se contente, afin d'éviter l'équivoque, de marquer la voyelle longue d'un accent circonflexe, ralliment, éternûment, enroûment. 2°. Cela n'est pas seulement arrivé après les voyelles, on l'a fait encore entre deux consonnes, & le mot que nous écrivons aujourd'hui soupçon, je le trouve écrit souspeçon avec l'e muet, dans le livre de la précellence du langage françois, par H. Estiene, (édit. 1579.) Or il est évident que c'est la même chose pour la prononciation, d'écrire soupeçon ou soupçon, pourvu que l'on passe sur l'e muet écrit, avec autant de rapidité que sur celui que l'organe met naturellement entre p & ç, quoiqu'il n'y soit point écrit.
Cette rapidité, en quelque sorte inappréciable de l'e muet ou scheva, qui suit toujours une consonne qui n'a pas immédiatement après soi une autre voyelle, est précisément ce qui a donné lieu de croire qu'en effet la consonne appartenoit ou à la voyelle précédente, ou à la suivante, quoiqu'elle en soit séparée : c'est ainsi que le mot âcre se divise communément en deux parties, que l'on appelle aussi syllabes, savoir a-cre, & que l'on apporte également les deux articulations k & r à l'e muet final : au contraire, quoique l'on coupe aussi le mot arme en deux syllabes, qui sont ar-me, on rapporte l'articulation r à la voyelle a qui précede, & l'articulation m à l'e muet qui suit : pareillement on regarde le mot or comme n'ayant qu'une syllabe, parce qu'on rapporte à la voyelle o l'articulation r, faute de voir dans l'écriture & d'entendre sensiblement dans la prononciation, une autre voyelle qui vienne après & que l'articulation puisse modifier.
Il est donc bien établi, par la nature même des élémens de la voix, combinée avec l'usage ordinaire de la parole, qu'il est indispensable de distinguer en effet les syllabes physiques des syllabes artificielles, & de prendre des unes & des autres les idées qu'en donne, sous un autre nom, l'habile secrétaire de l'académie françoise : par-là son systême se trouve justifié & solidement établi, indépendamment de toutes les définitions imaginables.
Celle de l'abbé Girard va même se trouver fausse d'après ce systême, loin de pouvoir servir à le combattre. C'est, dit-il, (vrais princip. tom. l. disc. I. pag. 12.) un son, simple ou composé, prononcé avec toutes ses articulations, par une seule impulsion de voix. Il suppose donc que le même son peut recevoir plusieurs articulations, & il dit positivement, pag. 11, que la voyelle a quelquefois plusieurs consonnes attachées à son service, & qu'elle peut les avoir à sa tête ou à sa suite : c'est précisément ce qui est démontré faux à ceux qui examinent les choses en rigueur ; cela ne peut se dire que des syllabes usuelles tout au plus, & encore ne paroît-il pas trop raisonnable de partager comme on fait les syllabes d'un mot, lorsqu'il renferme deux consonnes de suite entre deux voyelles. Dans le mot armé, par exemple, on attache r à la premiere syllabe, & m à la seconde, & l'on ne fait guere d'exception à cette regle, si ce n'est lorsque la seconde consonne est l'une des deux liquides l ou r, comme dans â-cre, ai-gle.
« Pour moi, dit M. Harduin, secretaire perpétuel de l'académie d'Arras, rem. div. sur la prononc. pag. 56. je ne vois pas que cette distinction soit appuyée sur une raison valable ; & il me paroîtroît beaucoup plus régulier que le mot armé s'épellât a-rmé? Il n'y a aucun partage sensible dans la prononciation de rmé ; & au contraire on ne sauroit prononcer ar, sans qu'il y ait un partage assez marqué : l'e féminin qu'on est obligé de suppléer pour prononcer l'r, se fait bien moins sentir & dure bien moins dans rmé que dans ar. En un mot, chaque son sur lequel on s'arrête d'une maniere un peu sensible, me paroît former & terminer une syllabe ; d'où je conclus qu'on fait distinctement trois syllabes en épellant ar-mé, au lieu qu'on n'en fait pas distinctement plus de deux, en épellant a-rmé. Ce qui se pratique dans le chant peut servir à éclaircir ma pensée. Supposons une tenue de plusieurs mesures sur la premiere syllabe du mot charme ; n'est-il pas certain qu'elle se fixe uniquement sur l'a, sans toucher en aucune maniere à l'r, quoique dans les paroles mises en musique, il soit d'usage d'écrire cette r immédiatement après l'a, & qu'elle se trouve ainsi séparée de l'm par un espace considérable ? N'est-il pas évident, nonobstant cette séparation dans l'écriture, que l'assemblage des lettres rme se prononce entierement sous la note qui suit la tenue ?
Une chose semble encore prouver que la premiere consonne est plus liée avec la consonne suivante qu'avec la voyelle précédente, à laquelle, par conséquent, on ne devroit pas l'unir dans la composition des syllabes : c'est que cette voyelle & cette premiere consonne n'ont l'une sur l'autre aucune influence directe, tandis que le voisinage des deux consonnes altere quelquefois l'articulation ordinaire de la premiere ou de la seconde. Dans le mot obtus, quoiqu'on y prononce foiblement un e féminin après le b, il arrive que le b contraint par la proximité du t, se change indispensablement en p, & on prononce effectivement optus.... Ainsi l'antipathie même qu'il y a entre les consonnes b, t, [ parce que l'une est foible & l'autre forte ], sert à faire voir que dans obtus elles sont plus unies l'une à l'autre, que la premiere ne l'est avec l'o qui la précede.
J'ajoute que la méthode commune me fournit elle-même des armes qui favorisent mon opinion. Car, 1°. j'ai déja fait remarquer que, selon cette méthode, on épelle â-cre & E-glé : on pense donc du moins qu'il y a des cas où deux consonnes placées entre deux voyelles, la premiere a une liaison plus étroite avec la seconde, qu'avec la voyelle dont elle est précédée. 2°. La même méthode enseigne assurément que les lettres st appartiennent à une même syllabe dans style, statue : pourquoi ? en seroit-il autrement dans vaste, poste, mystere ? [ On peut tirer la même conséquence de pseaume, pour rapsodie ; de spécieux, pour aspect, respect, &c. de strophe, pour astronomie ; de Ptolomée, pour aptitude, optatif, &c. C'est le système même de P. R. dont il va être parlé. ] 3°. Voici quelque chose de plus fort. Qu'on examine la maniere dont s'épelle le mot axe, on conviendra que l'x tout entier est de la seconde syllabe, quoiqu'il tienne lieu des deux consonnes c, s, & qu'il représente conséquemment deux articulations. Or si ces deux articulations font partie d'une même syllabe dans le mot axe, qu'on pourroit écrire ac se, elles ne sont pas moins unies dans accès, qu'on pourroit écrire acsès : & dès qu'on avoue que l'a seul fait une syllabe dans accès, ne doit-on pas reconnoître qu'il en est de même dans armé & dans tous les cas semblables ?
» Dom Lancelot, dans sa méthode pour apprendre la langue latine, connue sous le nom de Port-Royal, (traité des lettres, ch. xiv. §. iij.) établit, sur la composition des syllabes, un système fort singulier, qui, tout différent qu'il est du mien, peut néanmoins contribuer à le faire valoir. Les consonnes, dit-il, qui ne se peuvent joindre ensemble au commencement d'un mot, ne s'y joignent pas au milieu ; mais les consonnes qui se peuvent joindre ensemble au commencement d'un mot, se doivent aussi joindre au milieu ; & Ramus prétend que de faire autrement, c'est commettre un barbarisme. Il est bien sûr que si la jonction de telle & telle consonne est réellement impossible dans une position, elle ne l'est pas moins dans une autre. M. D. Lancelot fait dépendre la possibilité de cette jonction d'un seul point de fait, qui est de savoir s'il en existe des exemples à la tête de quelques mots latins. Ainsi, suivant cet auteur, pastor doit s'épeller pa-stor, parce qu'il y a des mots latins qui commencent par st ; tels que stare, stimulus : au contraire arduus doit s'épeller ar-duus, parce qu'il n'y aucun mot latin qui commence par rd. La regle seroit embarrassante, puisqu'on ne pourroit la pratiquer sûrement, à moins que de connoître & d'avoir présens à l'esprit tous les mots de la langue qu'on voudroit épeller. Mais d'ailleurs s'il n'y a point eu chez les Latins de mot commençant par rd, est-ce donc une preuve qu'il ne pût y en avoir ? Un mot construit de la sorte seroit-il plus étrange que bdellium, Tmolus, Ctesiphon, Ptolomæus ? »
A ces excellentes remarques de M. Harduin, j'en ajouterai une, dont il me présente lui-même le germe. C'est que pour établir la possibilité de joindre ensemble plusieurs consonnes dans une même syllabe, il ne suffiroit pas de consulter les usages particuliers d'une seule langue, il faudroit consulter tous les usages de toutes les langues anciennes & modernes ; & cela même seroit encore insuffisant pour établir une conclusion universelle, qui ne peut jamais être fondée solidement que sur les principes naturels. Or il n'y a que le méchanisme de la parole qui puisse nous faire connoître d'une maniere sûre les principes de sociabilité ou d'incompatibilité des articulations, & c'est conséquemment le seul moyen qui puisse les établir. Voici, je crois, ce qui en est.
1°. Les quatre consonnes constantes m, n, l, r, peuvent précéder ou suivre toute consonne variable, foible ou forte, v, f, b, p, d, t, g, q, z, s, j, ch.
2°. Ces quatre consonnes constantes peuvent également s'associer entre elles, mn, nm, ml, lm, mr, rm, nl, ln, nr, rn, lr, rl.
3°. Toutes les consonnes variables foibles peuvent se joindre ensemble, & toutes les fortes sont également sociables entre elles.
Ces trois regles de la sociabilité des consonnes sont fondées principalement sur la compatibilité naturelle des mouvemens organiques, qui ont à se succéder pour produire les articulations qu'elles représentent : mais il y a peut-être peu de ces combinaisons que notre maniere de prononcer l'e muet écrit ne puisse servir à justifier. Par exemple, dg se fait entendre distinctement dans notre maniere de prononcer rapidement, en cas de guerre, comme s'il y avoit en-ca-dguer-re ; nous marquons jv dans les cheveux, que nous prononçons comme s'il y avoit léjveu, &c. c'est ici le cas où l'oreille doit dissiper les préjugés qui peuvent entrer par les yeux, & éclairer l'esprit sur les véritables procédés de la nature.
4°. Les consonnes variables foibles sont incompatibles avec les fortes. Ceci doit s'entendre de la prononciation, & non pas de l'écriture qui devroit toujours être à la vérité, mais qui n'est pas toujours une image fidele de la prononciation. Ainsi nous écrivons véritablement obtus, où l'on voit de suite les consonnes b, t, dont la premiere est foible & la seconde forte ; mais, comme on l'a remarqué ci-dessus, nous prononçons optus, en fortifiant la premiere à cause de la seconde. Cette pratique est commune à toutes les langues, parce que c'est une suite nécessaire du méchanisme de la parole.
Il paroît donc démontré que l'on se trompe en effet dans l'épellation ordinaire, lorsque de deux consonnes placées entre deux voyelles on rapporte la premiere à la voyelle précédente, & la seconde à la voyelle suivante. Si, pour se conformer à la formation usuelle des syllabes, on veut ne point imaginer de schéva entre les deux consonnes, & regarder les deux articulations comme deux causes qui concourent à l'explosion du même son ; il faut les rapporter toutes deux à la voyelle suivante, par la raison qu'on a déja alléguée pour une seule articulation, qu'il n'est plus tems de modifier l'explosion d'un son quand il est déja échappé.
Quant à ce qui concerne les consonnes finales, qui ne sont suivies dans l'écriture d'aucune voyelle, ni dans la prononciation d'aucun autre son que de celui de l'e muet presque insensible, l'usage de les rapporter à la voyelle précédente est absolument en contradiction avec la nature des choses, & il semble que les Chinois en ayent apperçu & évité de propos délibéré l'inconvénient ; dans leur langue, tous les mots sont mono-syllabes, ils commencent tous par une consonne, jamais par une voyelle, & ne finissent jamais par une consonne. Ils parlent d'après la nature, & l'art ne l'a ni enrichie, ni défigurée. Osons les imiter, du-moins dans notre maniere d'épeller ; & de même qu'il est prouvé qu'il faut épeller charme par cha-rme, accès par a-ccès, circonspection par circon-spe-cti-on, séparons de même la consonne finale de la voyelle antécédente, & prononçons à la suite le schéva presque insensible pour rendre sensible la consonne elle-même : ainsi acteur s'épellera a-cteu-r, Jacob sera Ja-co-b, cheval sera che-va-l, &c.
On sent bien que cette maniere d'épeller doit avoir beaucoup plus de vérité que la maniere ordinaire, qu'elle est plus simple, & par conséquent plus facile pour les enfans à qui on apprend à lire. Il n'y auroit à craindre pour eux que le danger de rendre trop sensible le schéva des consonnes, qui ne sont suivies d'aucune voyelle écrite ; mais outre la précaution de ne pas imprimer le schéva propre à la consonne finale, un maître intelligent saura bien les prévenir là-dessus, & les amener à la prononciation ferme & usuelle de chaque mot : ce sera même une occasion favorable de leur faire remarquer qu'il est d'usage de regarder la consonne finale comme faisant syllabe avec la voyelle précédente, mais que ce n'est qu'une syllabe artificielle, & non une syllabe physique.
Qu'est-ce donc qu'une syllabe physique ? C'est un son sensible prononcé naturellement en un seul coupde voix. Telles sont les deux syllabes du mot a-mi : chacune d'elles est un son a, i : chacun de ces sons est sensible, puisque l'oreille les distingue sans les confondre : chacun de ces sons est prononcé naturellement, puisque l'un est une simple émission spontanée de la voix, & que l'autre est une émission accélérée par une articulation qui le précede, comme la cause précede naturellement l'effet ; enfin chacun de ces sons est prononcé en un seul coup de voix, & c'est le principal caractere des syllabes.
Qu'est-ce qu'une syllabe artificielle ? C'est un son sensible prononcé artificiellement avec d'autres sons insensibles en un seul coup de voix. Telles sont les deux syllabes du mot trom-peur : il y a dans chacune de ces syllabes un son sensible, om dans la premiere, eu dans la seconde, tous deux distingués par l'organe qui les prononce, & par celui qui les entend : chacun de ces sons est prononcé avec un schéva insensible ; om, avec le schéva que suppose la premiere consonne t, laquelle consonne ne tombe pas immédiatement sur om, comme la seconde consonne r ; eu, avec le schéva que suppose la consonne finale r, laquelle ne peut naturellement modifier eu comme la consonne p qui précede : chacun de ces sons sensibles est prononcé artificiellement avec son schéva en un seul coup de voix ; puisque la prononciation naturelle donneroit à chaque schéva un coup de voix distinct, si l'art ne la précipitoit pour rendre le schéva insensible ; d'où il résulteroit que le mot trompeur, au-lieu des deux syllabes artificielles trom-peur auroit les quatre syllabes physiques te-rom-peu-re.
Il y a dans toutes les langues des mots qui ont des syllabes physiques & des syllabes artificielles : ami a deux syllabes physiques ; trompeur a deux syllabes artificielles ; amour a une syllabe physique & une artificielle. Ces deux sortes de syllabes sont donc également usuelles ; & c'est pour cela que j'ai cru ne devoir point, comme M. Duclos, opposer l'usage à la nature, pour fixer la distinction des deux especes que je viens de définir : il m'a semblé que l'opposition de la nature & de l'art étoit plus réelle & moins équivoque, & qu'une syllabe usuelle pouvoit être ou physique ou artificielle ; la syllabe usuelle, c'est le genre, la physique & l'artificielle en sont les especes.
Qu'est-ce donc enfin qu'une syllabe usuelle, ou simplement une syllabe ? C'est, en supprimant des définitions précédentes les caracteres distinctifs des especes, un son sensible prononcé en un seul coup de voix.
Il me semble que l'usage universel de toutes les langues nous porte à ne reconnoître en effet pour syllabes, que les sons sensibles prononcés en un seul coup de voix : la meilleure preuve que l'on puisse donner, que c'est ainsi que toutes les nations l'ont entendu, & que par conséquent nous devons l'entendre ; ce sont les syllabes artificielles, où l'on a toujours reconnu l'unité syllabique, nonobstant la pluralité des sons réels que l'oreille y apperçoit ; lieu, lien, leur, voilà trois syllabes avouées telles dans tous les tems, quoique l'on entende les deux sons i, eu dans la premiere, les deux sons i, en dans la seconde, & dans la troisieme le son eu avec le schéva que suppose la consonne r ; mais le son prépositif i dans les deux premieres, & le schéva dans la troisieme sont presque insensibles malgré leur réalité, & le tout dans chacune se prononce en un seul coup de voix, d'où dépend l'unité syllabique.
Il n'est donc pas exact de dire, comme M. Duclos, (loc. cit.) que nous avons des vers qui sont à-la-fois de douze syllabes d'usage, & de vingt-cinq à trente syllabes physiques. Toute syllabe physique usitée dans la langue en est aussi une syllabe usuelle, parce qu'elle est un son sensible prononcé en un seul coup de voix ; par conséquent on ne trouvera jamais dans nos vers plus de syllabes physiques que de syllabes usuelles. Mais on peut y trouver plus de sons physiques que de sons sensibles, & de-là même plus de sons que de syllabes ; parce que les syllabes artificielles, dont le nombre est assez grand, renferment nécessairement plusieurs sons physiques ; mais un seul est sensible, & les autres sont insensibles.
On divise communément les syllabes usuelles, ou par rapport au son, ou par rapport à l'articulation.
Par rapport au son, les syllabes usuelles sont ou incomplexes ou complexes.
Une syllabe usuelle incomplexe est un son unique, qui n'est pas le résultat de plusieurs sons élémentaires, quoiqu'il y ait d'ailleurs quelque schéva supposé par quelque articulation : telles sont les premieres syllabes des mots, a-mi, ta-mis, ou-vrir, cou-vrir, en-ter, plan-ter.
Une syllabe usuelle complexe est un son double, qui comprend deux sons élémentaires prononcés distinctement & consécutivement, mais en un seul coup de voix : telles sont les premieres syllabes des mots oi-son, cloi-son, hui-lier, tui-lier.
Par rapport à l'articulation, les syllabes usuelles sont ou simples ou composées.
Une syllabe usuelle simple est un son unique ou double, qui n'est modifié par aucune articulation : telles sont les premieres syllabes des mots a-mi, ou-vrir, en-ter, oi-son, hui-lier.
Une syllabe usuelle composée est un son unique ou double, qui est modifié par une ou par plusieurs articulations : telles sont les premieres syllabes des mots ta-mis, cou-vrir, plan-ter, cloi-son, tui-lier.
Pour terminer cet article, il reste à examiner l'origine du nom de syllabe. Il vient du verbe grec ??????????, comprehendo ; R. R. ???, cùm ; & ???????, prehendo, capio : de-là vient le nom ???????, syllabe. Priscien & les grammairiens latins qui l'ont suivi, ont tous pris ce mot dans le sens actif : syllaba, dit Priscien, est comprehensio litterarum, comme s'il avoit dit, id quod comprehendit litteras. Mais 1°. cette pluralité de lettres n'est nullement essentielle à la nature des syllabes, puisque le mot a-mi a réellement deux syllabes également nécessaires à l'intégrité du mot, quoique la premiere ne soit que d'une lettre. 2°. Il est évidemment de la nature des syllabes, telle que je viens de l'exposer, que le comprehensio des Latins & le ??????? des Grecs doivent être pris dans le sens passif, id quod uno vocis impulsu comprehenditur ; ce qui est exactement conforme à la définition de toutes les especes de syllabes, & apparemment aux vues des premiers nomenclateurs. (E. R. M. B.)
Syllabe, (Versif. franç.) comme le nombre des syllabes fait la mesure des vers françois, il seroit à souhaiter qu'il y eût des regles fixes & certaines pour déterminer le nombre des syllabes de chaque mot ; car il y a des mots douteux à cet égard, & il y en a même qui ont plus de syllabes en vers qu'en prose ; les noms qui se terminent en ieux, en iel, en ien, en ion, en ier, &c. causent beaucoup d'embarras à ceux qui se piquent d'exactitude : odieux, précieux, sont de trois syllabes, & cependant cieux, lieux, dieux, n'ont qu'une syllabe. De même, fiel, miel, bien, mien, sont monosyllabes, mais dans lien, ancien, magicien, académicien, musicien, la terminaison en ien est de deux syllabes. Dans les mots fier, altier, métier, la rime en ier est d'une seule syllabe, & de deux dans bouclier, ouvrier, meurtrier & fier quand il est verbe. Toutes ces différences demandent une application particuliere pour ne s'y pas tromper, & ne pas faire un sollécisme de quantité. En général, il faut consulter l'oreille, qui doit être le principal juge du nombre des syllabes, & pour lors la prononciation la plus douce & la plus naturelle doit être préférée. Mourgues. (D. J.)
Syllabe, s. f. en Musique, ???????, est, au rapport de Nicomaque, le nom que donnent quelquefois les anciens à la consonance de la quarte, qu'ils appelloient communément diatessaron. Voyez Diatessaron.
Wiktionnaire
Nom commun - français
syllabe \si.lab\ ou \sil.lab\ féminin
-
(Linguistique) Voyelle ou réunion de phonèmes qui se prononcent par une seule émission de voix.
- Et sa voix alors prenait une intonation dolente et uniforme, enflant les mots, appuyant indéfiniment sur les syllabes. Cela m'agaçait beaucoup. ? (Octave Mirbeau, Contes cruels : La Chanson de Carmen (1882))
- Et de fait ce trait qui est particulier à la physionomie de notre versification est d'autant plus important que, notre langue ne comportant pas de syllabes longues et brèves aussi tranchées que le latin, par exemple, la clausule du vers risquerait de passer parfois inaperçue. ? (Paul Desfeuilles, Dictionnaire de rimes; précédé d'un petit traité de versification française, Paris : Garnier frères, s.d.(impr.1933), p.X)
-
? Bonjour ! dit-il.
Il avait une façon de moduler les deux syllabes de son salut si bien qu'on n'en remarquait pas d'abord la brièveté et qui lui permettait de ne nommer personne. ? (Jean Rogissart, Hurtebise aux griottes, L'Amitié par le livre, Blainville-sur-Mer, 1954) - La syllabe française est vocalique : il y a autant de syllabes que de voyelles. Le nombre de syllabes varie selon le maintien des [?] muets ou instables. ? (Nicole Derivery, La phonétique du français, Éditions du Seuil, 1997)
- Eux qui adoraient les anglicismes, les voilà ébranlés par deux petites syllabes de rien du tout, « me » « too ».? (Raphaëlle Bacqué, Patrick Poivre d'Arvor, Nicolas Hulot, Gérard Louvin? Retour sur l'âge d'or des intouchables de TF1, Le Monde, 19 janvier 2022)
- (Linguistique) Qui représente des syllabes.
Trésor de la Langue Française informatisé
SYLLABE, subst. fém.
Syllabe au Scrabble
Le mot syllabe vaut 18 points au Scrabble.
Informations sur le mot syllabe - 7 lettres, 2 voyelles, 5 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot syllabe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
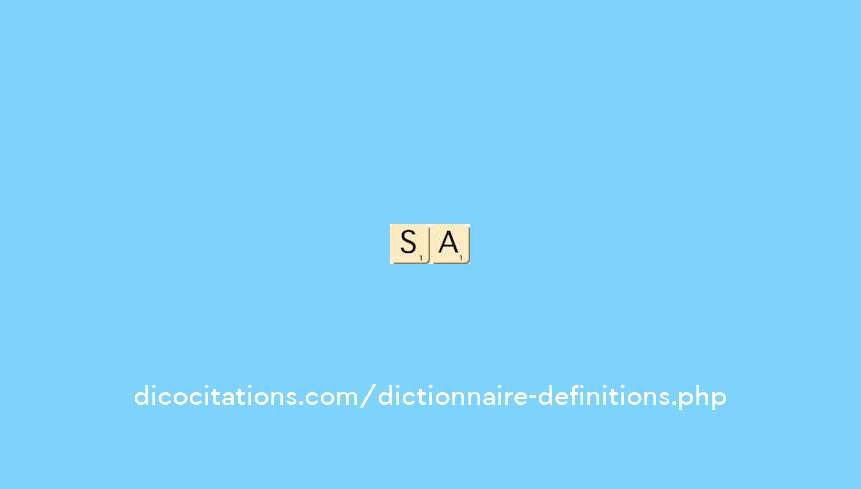
Les mots proches de Syllabe
Syllabaire Syllabe Syllaber Syllabique Syllabisme Syllepse Syllogiser Syllogisme Syllogistique Sylphe, ide Sylvain Sylvanesque Sylves Sylvestre Sylvicole Sylvie syllabe syllabes syllabus syllepse syllogisme syllogismes syllogistique syllogistiques sylphes sylphide sylphides sylvain sylvain sylvaine sylvains Sylvains-les-Moulins sylvaner Sylvanès sylve sylvestre sylvestre sylvestres sylviane sylvianne sylviculture sylvie sylvieMots du jour
Aiguiser Barbe Guerroyeur Typophotographique Arrosement Champi, isse Brique Balletant Réitérable Pressément
Les citations avec le mot Syllabe
- Le pou, le rat, obstinés et précis, organisés, habités d'un seul but comme des monosyllabes, l'un et l'autre n'ayant pour objectif que ronger votre chair ou pomper votre sang, de vous exterminer chacun à sa manière...Auteur : Jean Echenoz - Source : 14 (2012)
- En poursuivant le rêve que je viens d'atteindre sans le saisir, je pensais avoir murmuré des syllabes qui lui donnaient sa vérité : ô Afrique noire, j'aimais l'évocation de ta puissance énorme et sombre, embrasée d'un éternel soleil, et mon désir centré sur l'unité d'un nom appelait un seul être qui n'aurait eu qu'un seul visage.
En t'approchant, j'ai fait comme partout au monde, j'en ai vu mille, et chacun d'eux en masquait mille autres… Sans doute je n'oublierai jamais le premier accostage à travers les barres écumeuses de l'Atlantique ni le premier sommeil sur le sable. Auteur : Anita Conti - Source : Géants des mers chaudes (1957)
- Les pays arabes vont de karim en syllabeAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Il y a un rythme dans chaque phrase, donc une musique. Chaque syllabe y prend sa place. C'est un automatisme: quand je lis un texte, je ne lis pas, je le chante dans ma tête. C'est naturel, j'associe toute phrase à un tempo.Auteur : Alain Bashung - Source : Sans référence
- La notion d'intelligence est-elle obscène? Ou cinq syllabes échorchent-elles à ce point les lèvres pour que les contemporains dotés d'un QI convenable soient seulement estimés malins ou futés?Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- C'est beau, la vie. Quand on la retourne et qu'on la voit à fond, quand on voit ce qui est, il y a de quoi tomber à genoux. Ce qui est ! Ces trois syllabes ! La vie est certainement quelque chose d'extraordinaire. Plus extraordinaire que le génie.Auteur : Henry de Montherlant - Source : Service inutile (1935), Avant-propos
- Pan! La même syllabe pour le dieu de la Nature et le coup de fusil qui le blesse.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Demain, puis demain, puis demain glisse à petits pas de jour en jour jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps ; et tous nos hiers n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse.Auteur : William Shakespeare - Source : Macbeth (1605)
- Mais le phénomène de la réputation est une affaire délicate. L'ascension sur un mot et la chute sur une syllabe.Auteur : Don DeLillo - Source : Cosmopolis (2003)
- La différence peut-être la plus marquée entre la prosodie de la langue française et celle des langue grecque et latine, différence que l'abbé d'Olivet paraît n'avoir pas assez connue, c'est la quantité de syllabes communes que renferme la première.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, d'Olivet
- Demain, et demain, et demain! C'est ainsi que, à petits pas, nous nous glissons de jour en jour jusqu'à la dernière syllabe du temps inscrit sur le livre de notre destinée.Auteur : William Shakespeare - Source : Macbeth (1605)
- Si d'aucuns avaient pensé qu'avec le temps et le mûrissement des civilisations les langues s'allongeraient, gagneraient en signification et en syllabes, voilà tout le contraire : elles avaient raccourci, rapetissé, s'étaient réduites à des collections d'onomatopées et d'exclamations, au demeurant peu fournies, qui sonnaient comme cris et râles primitifs, ce qui ne permettait aucunement de développer des pensées complexes et d'accéder par ce chemin à des univers supérieursAuteur : Boualem Sansal - Source : 2084 : la fin du monde (2015)
- Quand j'écris, j'ai toute la langue française avec moi dans l'oreille. Simplement, j'essaie d'être au plus près de la parole. On ne prononce pas tout, dans la parole, ni toutes les lettres, ni toutes les syllabes. C'est une affaire très minutieuse, pas du tout sauvage, qui prend en compte toute la langue, son histoire, ses confins, les autres langues avec lesquelles elle a été en contact, ses diverses accentuations. Auteur : Pierre Guyotat - Source : Interview pour Télérama 3138 - Propos recueillis par Nathalie Crom le 05/03/2010.
- Quand la femme se marie, elle dit: «Oui». C'est la dernière fois qu'elle prononce une phrase d'une syllabe.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.» La grande chance de cette nunucherie a été de se limiter à douze syllabes. Les prosateurs, eux, font toujours trop long.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Tour Eiffel cesse de me dévisager comme ça
Si je t'offre un sonnet en vers de quatorze syllabes
(Un mètre assidûment cultivé par Jacques Réda)
Ce n'est pas pour que tu me toises de cet oeil de crabe.Auteur : Jacques Roubaud - Source : La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le coeur des humains (1999) - Un idiot se peint en trois syllabes ; mais ses fautes sont innumérables.Auteur : Manon, dite Madame Roland - Source : Mémoires de Madame Roland (1986)
- Demain, demain, demain, se glisse ainsi à petits pas d'un jour à l'autre, jusqu'à la dernière syllabe du temps inscrit ; et tous nos hiers n'ont travaillé, les imbéciles, qu'à nous abréger le chemin de la mort poudreuse.Auteur : William Shakespeare - Source : Macbeth (1605)
- Mon mot préféré est Luciférienne. Lucifer est un mot magnifique, au vu de l'harmonie des syllabes, son sens premier est excellent, porteur de lumière. Introduire la féminité dans le diabolisme me plaît !Auteur : Alain Rey - Source : Interview Le Journal du Dimanche, le 22 mai 2015
- Le pourquoi navré de l'amour
Est tout ce que l'amour peut dire
De deux syllabes sont bâtis
Les plus vastes coeurs qui se brisent.Auteur : Emily Dickinson - Source : Quatrains et autres poèmes brefs (2000) - - As-tu déjà entendu parler de la diérèse ?
- Ça me dit quelque chose, réponds Ronan innocemment. C'est une chance parce que, sans la diérèse, il n'y a pas de poésie. On ne prononce pas audacieux comme tu l'as fait, mais audaci-eux. Quatre syllabes. Pas mendiant. Mais mendi-ant. Trois syllabes.
- Mais ça fait bizarre, ricana Ronan.
- Oui monsieur, c'est de la poésie ! s'enflamma Jeanson. C'est artificiel ! Si les gens veulent t'entendre parler comme dans la vie, ils ne vont pas au théâtre, ils restent chez eux. Maintenant, tu recommences et tu soignes ces diérèses.
- Quand Don Juan descendit…
- Non, Monsieur. Tu sors et tu nous refais une entrée. (…) L'alexandrin, c'est quatorze pieds, les douze du vers et les deux sur lesquels tu te tiens.Auteur : Marie-Aude Murail - Source : 3 000 façons de dire je t' aime (2013) - La vie de la vraie littérature est beaucoup plus puissante. C'est l'unique possibilité de toucher à la vie. C'est aussi, à l'opposé, l'obligation pour l'écrivain de créer la vie dans un sens bouleversant, de dégager la vie dans chaque syllabe, une vie qui n'était pas disponible, pas touchable ailleurs. Auteur : Paul Nizon - Source : Interview de Paul Nizon par Catherine Argand (Lire), publié le 01/06/1997
- Le désespoir de parler naît avec les syllabes.Auteur : François Cariès - Source : Aux pieds du vent du Nord (1982)
- Matérialisme: prononcer ce mot avec horreur en appuyant sur chaque syllabe.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Que tu es long à venir
Vieux serviteur de Dieu,
O ami entre tous les amis
Qui me délivrera de ma peine.
O syllabe dans le vent,
O bruit léger de pas,
O main dans la nuit,
Que tu es long à venir.Auteur : Patrick Henry Pearse - Source : Que tu es long à venir !
Les citations du Littré sur Syllabe
- Autrefois la valeur des notes n'était pas réglée sur la notion de la mesure, c'est-à-dire sur une division mathématique du temps ; elle se rapportait à la quantité des syllabes, à la prosodie ou rhythme poétique ; et, selon que le rhythme qui en résultait était ternaire ou binaire, les valeurs étaient également ternaires ou binaires, parfaites dans le premier cas, imparfaites dans le second casAuteur : J. D'ORTIGUE - Source : Dict. de plain-chant, valeur.
- Que si l'on chante gloi-reu, cette désinence acquiert tous les droits des voyelles.... et par conséquent on pourra fredonner sur la dernière syllabe de gloi-reuAuteur : D'OLIVET - Source : Prosodie française.
- Ce travail même qui nous est commun, ce dictionnaire qui de soi-même semble une occupation si sèche et si épineuse, nous y travaillons avec plaisir : tous les mots de la langue, toutes les syllabes nous paraissent précieuses, parce que nous les regar dons comme autant d'instruments qui doivent servir à la gloire de notre auguste protecteurAuteur : Jean Racine - Source : Disc. à la réception de l'abbé Colbert
- Il n'y a point d'âmes, fussent-elles de fer ou de bronze.... qui puissent tenir contre les moindres syllabes de Jésus-ChristAuteur : BALZ. - Source : Socr. chrét. II
- Cette facilité que nous reconnaissons [chez les oiseaux qui parlent] à nous fournir leur voix et haleine si souple et si maniable, pour la former et l'astreindre à certain nombre de lettres et de syllabes, tesmoigne qu'ils ont un discours au dedans qui les rend ainsi disciplinables et volontaires à apprendreAuteur : MONT. - Source : II, 172
- Ceux qui se sont figuré que l'Académie n'était qu'une troupe d'esprits bourrus qui ne faisaient autre chose que de combattre sur les syllabes, introduire des mots nouveaux, en proscrire d'autres...Auteur : PELLISSON - Source : Hist. de l'Acad. III
- En vain pour gagner temps, dans ses transes affreuses, [un orateur] Traîne d'un dernier mot les syllabes honteusesAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. VI
- Le nouveau Cicéron, tremblant, décoloré, Cherche en vain son discours sur sa langue égaré ; En vain, pour gagner temps, dans ses transes affreuses, Traîne d'un dernier mot les syllabes honteuses ; Il hésite, il bégayeAuteur : BOILEAU - Source : Lutr. VI
- Qu'un nombre assez borné de syllabes radicales puisse produire l'immensité des mots nécessaires....Auteur : DESTUTT TRACY - Source : Instit. Mém. scienc. mor. et pol. t. I, p. 415
- Le défaut le plus ordinaire et qu'on doit éviter avec plus de soin, c'est de ne point appuyer sur les dernières syllabes, et de laisser tomber sa voix à la fin des périodesAuteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. VI, 2° part. II, 3
- Mais dans le XVIIe siècle, on s'en servait devant une consonne, et on le faisait de deux syllabes : Que j'aie peine aussi d'en sortir par aprèsAuteur : Molière - Source : l'Étour. III, 5, 7
- Du temps qu'on les appeloit [les gens de loi] pragmaticiens en retenant l'origine du mot, les choses alloient autrement ; mais depuis qu'on leur a retranché une syllabe de leur nom en les appellant praticiens, ils ont bien sçu se recompenser de ce retranchement sur les bourses de ceux qui n'en pouvoient maisAuteur : H. EST. - Source : Apol. d'Hérod. p. 242, dans LACURNE
- Seuls les Égyptiens, peuple éminemment philosophe, avaient conçu le principe simplificateur et fécond de l'alphabétisme, qui décompose la syllabe et en représente par des signes distincts la consonne et la voyelleAuteur : FR. LENORMANT - Source : Manuel d'histoire anc. de l'Orient, t. III, p. 108, 4e édition.
- Il n'y a presque point de mots dont la sévérité de cette dame ne veuille retrancher ou la tête ou la queue, pour les syllabes déshonnêtes qu'elle y trouveAuteur : Molière - Source : Critique, 6
- Consonance est quand eschet mesme termination d'une ou plusieurs syllabes en divers carmesAuteur : BOISSIÈRE - Source : Poétique, p. 235, dans LACURNE
- À ce moyen il aime gens lettrez, En grec, latin, et françoys bien estrez à diviser d'hystoire ou theologie [trois syllabes]Auteur : JEHAN BOUCHET - Source : Epistre responsive à Rabelays (à la suite de l'Épître de Rabelais).
- La pensée, tant qu'elle n'est que dans notre esprit, sans aucun égard à l'énonciation, n'a besoin ni de bouche, ni de langue, ni du son des syllabesAuteur : DU MARSAIS - Source : Oeuvres, t. v, p. 5
- Mais le plus beau projet de notre académie.... C'est le retranchement de ces syllabes sales Qui dans les plus beaux mots produisent des scandalesAuteur : Molière - Source : Femm. sav. III, 2
- L'auteur a compris sous la dénomination générale d'ïambes toute satire d'un sentiment amer et d'un mouvement lyrique ; cependant ce titre n'appartient réellement qu'aux vers satiriques composés à l'instar de ceux d'André Chénier ; le mètre employé par ce grand poëte n'est pas précisément l'ïambe des anciens, mais quelque chose qui en rappelle l'allure franche et rapide : c'est le vers de douze syllabes, suivi d'un vers de huit, avec croisement de rimes ; cette combinaison n'était pas inconnue à la poésie française, l'élégie s'en était souvent servie, mais en forme de stances ; c'est ainsi que Gilbert a exhalé ses dernières plaintesAuteur : BARBIER - Source : Iambes.
- Il y avait un démon appelé Titivillus le vétilleux, qui apportait tous les matins en enfer un plein sac des syllabes que les moines avaient passées dans leur psalmodie de la nuitAuteur : LE CLERO - Source : Hist. litt. de la Fr. t. XXIV, p. 282
- Vieux pédagogue de la cour, appelé le tyran des mots et des syllabes, et qui s'appelait lui-même le grammairien à lunettes et à cheveux gris.... qui traite gravement l'affaire des gérondifs et des participes, comme si c'était celle de deux peuples voisins l'un de l'autre et jaloux de leurs frontièresAuteur : BALZ. - Source : Socrate chrét. X.
- Vous vous souvenez du vieux pédagogue de la cour et qu'on appelait autrefois le tyran des mots et des syllabesAuteur : BALZ. - Source : Socr. chrét. x.
- Quand on aurait décidé qu'il faut prononcer les syllabes prochain, qui ne voit que, n'ayant point été expliquées, chacun de vous voudra jouir de la victoire ?Auteur : Blaise Pascal - Source : Prov. I
- Elle [l'Académie] m'approuvera sans doute quand je dis que fuir est d'une seule syllabe, quoiqu'on ait décidé autrefois qu'il était de deuxAuteur : Voltaire - Source : Lett. Duclos, 25 déc. 1761
- Ceste balade est moitié leonime et moitié sonant, si comme il appert par monde, par onde, par homme, par Romme, qui sont plaines syllabes et entieres ; et les autres sonans tant seulement où il n'a point entiere sillabe, si comme clamer et oster, où il n'a que demie sillabe, ou si comme seroit presentement et innocent ; et ainsi es cas semblables puet estre congneu qui est leonime ou sonnantAuteur : E. DESCH. - Source : l'Art de dicter et faire chansons, etc. dans Poésies mss. f° 396
Les mots débutant par Syl Les mots débutant par Sy
Une suggestion ou précision pour la définition de Syllabe ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 18h10

- Sacrifice - Sacrilege - Sage - Sagesse - Sagesse_populaire - Saint_Valentin - Salete - Sante - Santé - Sante - Satisfaction - Satyre - Savant - Savoir - Savoir_vivre - Scandale - Scepticisme - Science - Scrupule - Sculpture - Secret - Secte - Seigneur - Sein - Semblable - Sens - Sensibilite - Sentiment - Separation - Séparation - Serenite - Sérénité - Sérieux - Service - Servitude - Seul - Seule - Sexe - Sexologie - Sexualite - Silence - Simplicite - Sincère - Sincerite - Sincérité - Singe - Snob - Sobre - Sociabilite - Societe - Sociologie - Sodomie - Soi_même - Soleil - Solitude - Solution - Sommeil - Sondage - Songe - Sot - Sottise - Soucis - Souffrance - Souffrir - Soulage - Soupçon - Sourire - Souvenir - Specialiste - Spectacle - Sport - Stabilite - Star - Statistiques - Stimulation - Stress - Style - Subjonctif - Succes - Suggestion - Suicide - Superflu - Superiorite - Supermarche - Superstition - Supplice - Survie - Suspicion - Systeme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur syllabe
Poèmes syllabe
Proverbes syllabe
La définition du mot Syllabe est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Syllabe sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Syllabe présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
