La définition de Causer du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Causer
Nature : v. n.
Prononciation : kô-zé
Etymologie : Provenç. chausar, causciar, reprocher, disputer ; espagn. causar, faire un procès ; du latin causari, faire un procès, d'où disputer, reprocher, et simplement, causer. Diez et d'autres étymologistes font intervenir l'ancien haut allemand chôzôn, allemand moderne kosen ; mais le latin suffit à la forme et au sens du mot roman.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de causer de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec causer pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Causer ?
La définition de Causer
S'entretenir familièrement. Ils causent ensemble. De quoi causent-ils ? Nous causerons de cette affaire.
Toutes les définitions de « causer »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Être cause de, occasionner. Il a pensé causer un grand malheur. Causer du dommage. Causer la guerre. Causer de la joie. Causer de la douleur, du chagrin. Causer du scandale.
Littré
- Être cause, occasionner.
Qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage, Égratigné quelqu'un, causé quelque dommage
, La Fontaine, Fabl. III, 18.Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, C'est l'acheter trop cher?
, La Fontaine, ib. IV, 13.Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui
, La Fontaine, ib. IV, 8.Cela causa leur malheur
, La Fontaine, ib. IV, 6.Le trop superbe équipage Peut souvent en un passage Causer du retardement
, La Fontaine, ib. IV, 6.Vous savez ses malheurs, vous les avez causés
, Racine, Iphig. III, 4.Je veux l'attendre ici?; les chagrins qu'il me cause M'occuperont assez tout le temps qu'il repose
, Racine, Brit. I, 1.Si Dieu n'a rien en lui-même par où il puisse causer en nous les volontés libres
, Bossuet, Libr. arb. 3.
HISTORIQUE
XIVe s. ?en la maniere que aucuns le disoient et se causoient [se fondaient sur] de ce que la fin est melleur que n'est la generacion de la fin
, Oresme, Eth. 220.
XVe s. Nostre roy est le seigneur du monde qui le moins a causé [été cause] de user de ce mot de dire?: J'ai privilege de lever sur mes subgectz ce que il me plaist
, Commines, V, 18.
XVIe s. Elle monstre que toutes ces choses sont causées [fondées] en Jesus Christ, comme en estant le fondement
, Calvin, Instit. 1066. Au moyen de quoi, lui fut facile de causer [motiver] son voyage là dessus
, Despériers, Contes, V. Il mourut d'une apoplexie que ce coup luy causa
, Montaigne, I, 74. Cela m'a causé me restraindre de trop grande liberalité
, Palissy, 11. Donnant à entendre que??: langaige causé [développé comme cause et motif] et contenu en ladicte ordonnance
, Carloix, VIII, 3.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. CAUSER. Ajoutez?:Cela insinue beaucoup en causant comme petit-fils de Sa Majesté [en donnant pour motif de la décision le titre de petit-fils], Saint-Simon, t. VIII, p. 194, éd. Chéruel.
Wiktionnaire
Verbe - français
causer \ko.ze\ transitif 1er groupe (voir la conjugaison)
-
Être cause de ; occasionner, provoquer.
- On doit, sans perdre un instant, extirper la tumeur : opération qui exige la main d'un anatomiste, et qui. n'est pas sans danger pour celui qui la pratique, l'inoculation de l'ichor gangreneux pouvant causer la mort. ? (Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, 1831, page 423)
- Les assaillants, amplement pourvus d'explosifs, causèrent, tant à Berlin qu'en Franconie, des dommages énormes. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 411 de l'édition de 1921)
- Vous ne vous engagerez toujours pas sans m'en parler, et nous verrons bien si vous aurez le c?ur de me causer du chagrin. ? (Comtesse de Ségur, L'Auberge de l'Ange-Gardien, 1888)
- S'entretenir familièrement avec quelqu'un ; faire la conversation.
- [?] deux femmes et un homme, assis sur des sièges grossièrement taillés à coups de hache, causaient à voix basse. ? (Gustave Aimard, Les Trappeurs de l'Arkansas, Éditions Amyot, Paris, 1858)
- Pendant que Sophie était assise auprès de madame Necker, son tuteur causait debout avec le comte de Morvelle, dans l'embrasure d'une croisée. ? (Julie de Quérangal, Philippe de Morvelle, Revue des Deux Mondes, T.2,4, 1833)
- Sur deux sièges contigus sont assis Fulk Ephrinell et miss Horatia Bluett. Ils causent en crayonnant des chiffres. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre VI, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
- Ils causèrent au coin du feu ; l'intérieur plut sans doute à l'abbé, car il se mit à l'aise. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)
-
(Familier) Parler trop, parler inconsidérément.
- Ne lui dites que ce que vous voudrez que tout le monde sache, car il aime à causer.
- Parler avec malignité.
- N'allez pas si souvent dans cette maison, on en cause.
causer transitif indirect 1er groupe (voir la conjugaison)
-
(Populaire) Parler à quelqu'un.
- Dis ! C'est à moi que tu causes ?
- Eh, je t'ai pas causé !
Trésor de la Langue Française informatisé
CAUSER1, verbe trans.
Être à l'origine de, avoir pour effet quelque chose (l'effet désigne généralement un dommage).CAUSER2, verbe.
Causer au Scrabble
Le mot causer vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot causer - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot causer au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
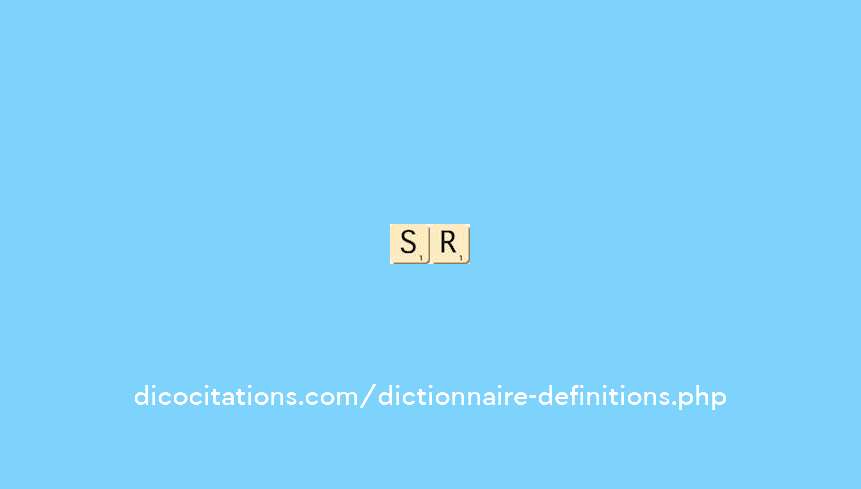
Les mots proches de Causer
Caucasique Cauchemar Cauchois, oise Caudebec Causalité Causant, ante Causant, ante Cause Causé, ée Causefinalier Causer Causer Causerie Causette Causeur, euse Causse Caussetière Caustique Caut, caute Cautèle Cauteleusement Cauteleux, euse Cautement Cautère Cautérisation Cautérisé, ée Cautériser Caution Cautionner Caubeyres Caubiac Caubios-Loos Caubon-Saint-Sauveur Caubous Caubous Caucalières caucasien caucasien caucasienne caucasienne caucasiens caucasiens caucasique cauchemar cauchemardais cauchemarde cauchemardé cauchemarder cauchemardes cauchemardesque cauchemardesques cauchemardeuse cauchemardeuses cauchemardeux cauchemars Cauchie cauchois cauchoise cauchoises Cauchy-à-la-Tour Caucourt caudal caudale caudales Caudan caudebec Caudebec-en-Caux Caudebec-lès-Elbeuf Caudebronde Caudecoste Caudéran Caudeval Caudiès-de-Conflent Caudiès-de-Fenouillèdes caudillo caudines Caudrot Caudry CauffryMots du jour
-
cognitives tenaillée reproduisez prétentiarde douanier guillemot attribueront cloisonnement prostatectomie ras
Les citations avec le mot Causer
- Quelle supériorité de la parole écrite, du livre sur la causerie! Les plus mauvais livres, les plus légers, les plus vides, sont encore les cordes qui fixent le terrain, l'arène de la vérité.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Journal tome 1, septembre 1859
- Puisses-tu ne rien faire dans ta vie qui te causera de la crainte si cela est connu du voisin.Auteur : Epicure - Source : Sentences vaticanes, 70
- Il faut être doux avec loulou - Elle comprend tout - Elle aime bien causer - Ne s'rait-ce que pour se reposer - Ell' dit tout est dérisoir' - mais faut garder l'espoir - Mêm' s'y a dans not' petit' vie - Moins de Dimanch's que de lundis.Auteur : Pierre Perret - Source : Doux avec Loulou
- Un simple pion peut causer la perte d'un roi.Auteur : Juliette Benzoni - Source : Le Jeu de l'amour et de la mort, Un homme pour le Roi (1999)
- Je vous aimais… l'amour n'est pas, peut-être,
Au fond du coeur totalement éteint,
Mais devant vous je le fais disparaître,
Je ne veux pas vous causer de chagrin.Auteur : Alexandre Pouchkine - Source : Je vous aimais... - On a beau faire: jusqu'à un certain âge, - et je ne sais pas lequel, - on n'éprouve aucun plaisir à causer avec une femme qui ne pourrait pas être une maîtresse.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 30 août 1889
- Faire causer, c'est le talent le plus rare; c'est bien plus difficile que de parler soi-même.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 17 février 1904
- Les temps changent. Les gens ne pensent plus au lendemain, ni même à la semaine suivante. Ils ne s'inquiètent pas des embêtements qu'ils vont causer à leur famille ou à l'état quand ils mourront. Y a plus d'amour-propre, de nos jours... Auteur : Arthur Upfield - Source : Chausse-trappe (1951)
- ... le dedans et le dehors ne peuvent pas être séparés sans causer de grands dommages à la vérité.Auteur : Paul Auster - Source : Moon Palace
- L'avocat aime causer et il défend sa cause.Auteur : Claude Schnerb - Source : L'Humour vert (sous le pseudonyme de Claude Sergent), Éditions Buchet-Chastel, (1964)
- Il était bien rare que sous l'excitation du vin, de la causerie, il n'attrapât pas son ancien camarade.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Manette Salomon (1867)
- Une petite étincelle négligée peut causer un vaste incendie.Auteur : Proverbes chinois - Source : Proverbe
- Un balayeur est fier de causer avec le cocher d'une voiture de maître.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 2 juin 1909
- Les mots peuvent causer de la confusion et créer des «enchevêtrements»; mais l'absence de mots engendre une obscurité totale.Auteur : Aldous Huxley - Source : Les portes de la perception (1954)
- Je me divertis autant à causer avec vous, que je laboure avec les autres.Auteur : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné - Source : Lettres (1646-1696), 1er décembre 1675
- Deux choses peuvent causer beaucoup de peine; un ami chagrin, et un ennemi joyeux.Auteur : Jean-Benjamin de Laborde - Source : Pensées et Maximes (1791)
- ... Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu (1918)
- Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une minute.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919)
- Après tout, l'amour est un bon maître : la fortune ne saurait nous causer autant de peines qu'il nous fait goûter de plaisirs.Auteur : Abbé Prévost - Source : Manon Lescaut
- Louer ou censurer ce que tu ne comprends pas peut causer préjudice.Auteur : Léonard de Vinci - Source : Pensées de LÉONARD DE VINCI dans toutes ses oeuvres - Leonardo Da Vinci - Frammenti letterari e filosofici Copertina rigida – 1979 di Edmondo Solmi
- Dans le plaisir à deux on peut échanger ses pensées. Dans la masturbation on sait jamais à qui causer.Auteur : Pierre Perret - Source : Papa-Maman
- Le serment d'Hippocrate demande au médecin de ne pas causer de tort. En finance, je pense que les modèles conventionnels et leurs «corrections» les plus récentes violent ce serment.Auteur : Benoît Mandelbrot - Source : Une approche fractale des marchés: risquer, perdre et gagner (2005)
- Aux gens tristes, malades et qui veulent s'étrangler, faites prendre le matin en boisson la racine de mandragore à une dose moindre qu'il ne faudrait pour causer le délire.Auteur : Hippocrate - Source : Des lieux dans l'homme
- A la fin, elle a dit d'un ton pénétré : Vivre, en fait, c'est causer du tort à quelqu'un...Auteur : Hiromi Kawakami - Source : Les Années douces (2000)
- J'ai quelquefois entendu M. Thiers causer avec feu de cette affaire du général [...] « L'injustice, disait-il un jour avec énergie, est une mère qui n'est jamais stérile, et qui produit des enfants dignes d'elle. »Auteur : Charles-Augustin Sainte-Beuve - Source : Causeries du lundi
Les citations du Littré sur Causer
- Toute couchée et toute à votre aise, vous causerez avec moiAuteur : Madame de Sévigné - Source : à Mme de Grignan, 1684
- La manière dont il [le médecin Monjot] accorde en peu de mots l'immatérialité de l'âme avec le pouvoir qu'a la matière d'altérer ses fonctions et de causer le délireAuteur : Blaise Pascal - Source : Lett. à Mme de Sablé, déc. 1660
- Je servirai de mon mestier La mere Dieu en son moustier ; Li autre servent de causer ; Et je servirai de tumer [danser]Auteur : DU CANGE - Source : tombare.
- Si vos opinions paraissaient tout à coup dans leur dernier excès, elles causeraient de l'horreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoutume doucement les hommes et en ôte le scandaleAuteur : Blaise Pascal - Source : Prov. XIII
- Si Dieu n'a rien en lui-même par où il puisse causer en nous les volontés libresAuteur : BOSSUET - Source : Libr. arb. 3
- Le duc d'Orléans régent daigna un jour causer avec moi au bal de l'Opéra ; il me fit un grand éloge de RabelaisAuteur : Voltaire - Source : Lett. Mme du Deffant, 13 oct. 1759
- Nous rougissons avec raison de voir les marchés publics établis dans des rues étroites, étaler la malpropreté, répandre l'infection et causer des désordres continuelsAuteur : Voltaire - Source : Pol. et lég. Embell. de Paris.
- Le détail causerait un imbroglio qui ferait tout abandonnerAuteur : BOSSUET - Source : Lett. quiét. 160
- Le trop superbe équipage Peut souvent en un passage Causer du retardementAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. IV, 6
- On redresse les esprits, à force de causer et de faire entendre la raisonAuteur : ID. - Source : 15 déc. 1684
- Mais à quoi sert Bacchus, qu'à causer des querelles, Affaiblir les plus sains, enlaidir les plus belles ?Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Filles de Min.
- Mais par l'effet d'un rare aveuglement Qui fait bien voir que, quoi qu'on soit princesses, On peut parfois causer des maladresses....Auteur : DUMOURIEZ - Source : Richardet, II, 11
- Le duc de Nemours dit, il y a quelques jours, à un des Seize qui parloit du roi de Navarre : Il n'y a plus que les sots qui ne voient bien comment il faut oster cette queue, et cela en sortant d'un conseil où on avoit estimé les conditions du fils aisné de Lorraine ; Vitri, en sortant du mesme conseil, en jurant et despitant la causerie : Il vaut bien mieux, dit-il, servir le brave huguenotAuteur : D'AUB. - Source : Hist. III, 293
- Afin de l'entre-croiser à la maniere de plombs des vitres, et de causer en cest endroit des quarrés vuides en rhombe ou lozangeAuteur : O. DE SERRES - Source : 744
- La peau, se retirant sur elle-même, fera dresser les cheveux, dont elle enferme la racine, et causera ce mouvement qu'on appelle horreurAuteur : BOSSUET - Source : Conn. II, 12
- L'usage des figures demande beaucoup de discernement et de prudence ; elles servent comme de sel et d'assaisonnement au discours, pour relever le style, pour éviter une façon de parler vulgaire et commune, pour prévenir le dégoût que causerait une ennuyeuse uniformitéAuteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. III, 3
- De mauvais air corrompu, de pourceaulx, Font en maint lieu causer l'epidemieAuteur : EUST. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 350, dans LACURNE
- Sa leçon se fera tantost par devis [causerie], tantost par livreAuteur : MONT. - Source : I, 174
- Dans ce grand décri de l'idolâtrie, que commençaient à causer dans toute l'Asie les prédications de saint PaulAuteur : BOSSUET - Source : Hist. univ. II, 12
- Croyez-vous que les terribles ravages qu'elle [la guerre] a causés dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir soient suffisamment compensés par ces guenilleux avantages-là ?Auteur : DIDEROT - Source : Entret. avec la maréch. de***.
- Dans cette belle délibération où il s'agissait de réformer les abus du gouvernement, un des principaux règlements que Mécénas proposa à Auguste fut d'empêcher les nouveautés dans la religion, qui ne manquaient pas de causer de dangereux mouvements dans les ÉtatsAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 12
- Je doute que cette journée toute remontée, qui ôte tout le commerce de manger et de causer les soirs, puisse plaire à Mme de CoulangesAuteur : Madame de Sévigné - Source : 25 juin 1690
- Et plus causer et jargonner Qu'une vieille qui teilleAuteur : BASSELIN - Source : LVIII
- Nous ne saurions peindre l'émotion que nous causèrent ces chants religieuxAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, III, V, 3
- Le trop superbe équipage Peut souvent en un passage Causer du retardementAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. IV, 6
Les mots débutant par Cau Les mots débutant par Ca
Une suggestion ou précision pour la définition de Causer ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 06h39
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur causer
Poèmes causer
Proverbes causer
La définition du mot Causer est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Causer sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Causer présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
