La définition de Caustique du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Caustique
Nature : adj.
Prononciation : kô-sti-k'
Etymologie : Causticus, en grec, brûler.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de caustique de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec caustique pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Caustique ?
La définition de Caustique
Terme de médecine. Qui brûle, qui corrode. Remède, substance caustique. Potasse caustique.
Toutes les définitions de « caustique »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui est mordant dans la moquerie, dans la satire. Homme caustique. Humeur caustique. Propos caustique. En termes de Médecine, il signifie Qui est brûlant, corrosif en parlant des substances qui ont la propriété de brûler ou de désorganiser, par leur action chimique, les matières animales. Remède caustique. De la potasse caustique. Il est aussi nom masculin. La pierre infernale est un caustique. Employer les caustiques.
CAUSTIQUE, nom féminin, désigne, en termes de Physique, la Courbe sur laquelle concourent les rayons successivement réfléchis ou rompus par une surface. Caustique par réflexion. Caustique par réfraction.
Littré
-
1 Terme de médecine. Qui brûle, qui corrode. Remède, substance caustique. Potasse caustique.
S. m. Un caustique. Employer les caustiques.
-
2 Fig. Qui fait sur l'âme une impression comparée à celle que fait un caustique sur le corps. Langage caustique.
Dans le sexe j'ai peint la piété caustique
, Boileau, Sat. X.Sénèque le père fut d'une humeur caustique
, Diderot, Ess. s. Claude, liv. II.Par extension, dans le même sens, en parlant des personnes. Elle est trop caustique, elle emporte la pièce. Homme caustique.
Le caustique Boileau, que l'envie de critiquer et l'étude ont rendu versificateur
, Boileau, Esquisse en prose de la Sat. IX. - 3 S. m. Terme de métier. Substance qui procure plus d'adhérence à une autre substance, dans la peinture en badigeon.
SYNONYME
CAUSTIQUE, MORDANT, SATIRIQUE. Caustique est ce qui brûle?; mordant est ce qui mord?; satirique est ce qui fait la satire. Avoir l'esprit satirique, c'est avoir l'esprit disposé à voir le mauvais côté des choses, à chercher ce qu'elles peuvent avoir de blâmable ou de ridicule, et à le mettre en relief. Avoir l'esprit caustique, c'est appliquer une espèce de fer chaud sur ce qui est dit ou fait?; on peut être caustique sans avoir l'esprit satirique?; avoir l'esprit mordant, c'est enfoncer les dents et s'acharner. Le caustique effleure la peau?; le mordant y pénètre?; on peut donc être caustique sans être mordant.
Encyclopédie, 1re édition
CAUSTIQUE, adj. pris subst. (Chimie.) Ce nom a été donné a certains dissolvans, dont on a évalué l'action par leur effet sur le corps animal, qu'ils affectent à peu-près de la même façon que le feu, ou les corps actuellement ignés ou brûlans. Cette action est une vraie dissolution (Voyez Menstrue) ; car les caustiques proprement dits, sont de vrais dissolvans des substances animales. Les alkalis fixes, sur-tout animés par la chaux (Voyez Pierre à cautere), les alkalis volatils, la chaux vive, attaquent ces substances très-efficacement, & se combinent avec elles. Les acides minéraux concentrés, & les sels métalliques surchargés d'acide (comme le sublimé corrosif, le beurre d'antimoine, le vitriol, les crystaux de lune, &c.) les attaquent & les décomposent. Voyez Lymphe.
Quelques sucs résineux, comme ceux de quelques convolvulus, du toxicodendron, des tithymales, & quelques baumes très-visqueux, comme la poix de Bourgogne, les huiles essentielles vives, ne sont pas des caustiques proprement dits. Ces substances n'agissent sur l'animal vivant que par irritation ; elles peuvent enflammer les parties, les mortifier même assez rapidement : mais c'est comme sensibles que ces parties sont alors affectées, & non pas comme solubles.
C'est appliquer un cautere sur une jambe de bois, dit-on communément pour exprimer l'inutilité d'un secours dont on essaye. Un medecin diroit tout aussi volontiers, & plus savamment, sur la jambe d'un cadavre, puisque la bonne doctrine sur l'action des remedes est fondée sur le jeu des parties, sur leur mobilité, leur sensibilité, leur vie ; les remedes n'opéreroient rien sur le cadavre, disent la plûpart des auteurs de matiere médicale. Ces auteurs ont raison pour plusieurs remedes ; pour la plûpart même : mais ils se trompent pour les vrais caustiques. On feroit aussi-bien une escarre sur un cadavre que sur un corps vivant.
L'opération par laquelle on prépare ou tane les cuirs, n'est autre chose que l'application d'un caustique léger à une partie morte, dont il dissout & enleve les sucs lymphatiques, les humeurs, en épargnant les fibres ou parties solides ; mais qui détruiroit ces solides même à la longue, ou si on augmentoit la dose, ou l'intensité du dissolvant.
La préparation des mumies d'Egypte ne différoit de celle de nos cuirs, que par le dissolvant que les embaumeurs Egyptiens employoient. Nos Taneurs se servent de la chaux ; c'étoit le natron qui étoit en usage chez les Egyptiens. Voyez l'extrait du Mémoire de M. Rouelle sur les mumies, lû à l'assemblée publique de l'Académie des Sciences du mois de Novembre 1750. dans le Mercure de Janvier 1751. [Cet article est de M. Venel.]
L'usage des caustiques, en Medecine, est de manger les chairs fongueuses & baveuses ; ils penétrent même dans les corps durs & calleux, fondent les humeurs, & sont d'un usage particulier dans les abscès & les apostumes, pour consumer la matiere qui est en suppuration, & y donner une issue ; & servent aussi quelquefois à faire une ouverture aux parties, dans les cas ou l'incision seroit difficile à pratiquer ou dangereuse.
Les principaux médicamens de cette classe sont l'alun brûlé, l'éponge, les cantharides & autres vésicatoires, l'orpiment, la chaux-vive, le vitriol, les cendres de figuier, le frêne, la lie de vin, le sel de la lessive dont on fait le savon, le mercure sublimê, le précipité rouge, &c. Voyez chacune de ces substances à leur article propre.
Les crystaux de lune & la pierre infernale, composés d'argent & d'esprit de nitre, deviennent caustiques par ce mêlange. Voyez Crystal, Argent, &c. (N)
Caustique, s. f. dans la Géométrie transcendante, est le nom que l'on donne à la courbe que touchent les rayons réflechis ou réfractés par quelqu'autre courbe. Voyez Courbe. Si une infinité de rayons de lumiere infiniment proches tombent sur toute l'étendue d'une surface courbe, & que ces rayons soient supposés réfléchis ou rompus suivant les lois de la réflexion & de la réfraction, la suite des points de concours des rayons réflechis ou rompus infiniment proches, formera un polygone d'une infinité de côtés ou une courbe qu'on appelle caustique ; cette courbe est touchée par les rayons réflechis ou rompus, puisque ces rayons ne sont que le prolongement des petits côtés de la caustique.
Chaque courbe a ses deux caustiques ; ce qui fait diviser les caustiques en catacaustiques & diacaustiques ; les premieres sont formées par réflexion, & les autres par réfraction.
On attribue ordinairement l'invention des caustiques à M. Tschirnhausen ; il les proposa à l'académie des Sciences en l'année 1682 ; elles ont cette propriété remarquable, que lorsque les courbes qui les produisent sont géométriques, elles sont toujours rectifiables.
Ainsi la caustique formée des rayons réflechis par un quart de cercle, est égale aux du diametre. Cette rectification des caustiques a été antérieure au calcul de l'infini, qui nous a fourni celle de plusieurs autres courbes. Voy. Rectification. L'académie nomma un comité pour examiner ces nouvelles courbes ; il étoit composé de MM. Cassini, Mariotte, & de la Hire, qui révoquerent en doute la description ou génération que M. Tschirnhausen avoit donnée de la caustique par réflexion du quart de cercle : l'auteur refusa de leur découvrir sa méthode, & M. de la Hire persista à soûtenir qu'on pouvoit en soupçonner la génération de fausseté. Quoi qu'il en soit, M. Tschirnhausen la proposoit avec tant de confiance, qu'il l'envoya aux actes de Leipsic, mais sans démonstration. M. de la Hire a fait voir depuis dans son traité des Epicycloïdes, que M. Tschirnhausen s'étoit effectivement trompé dans la description de cette caustique. On trouve dans l'Analyse des infiniment petits de M. le marquis de l'Hopital, une méthode pour déterminer les caustiques de réflexion & de réfraction d'une courbe quelconque, avec les propriétés générales de ces sortes de courbes, que le calcul des infiniment petits rend très-aisées à découvrir & à entendre.
Le mot caustique vient du Grec ????, je brûle ; parce que les rayons étant ramassés sur la caustique en plus grande quantité qu'ailleurs, peuvent y brûler, si la caustique est d'une fort petite étendue. Dans les miroirs paraboliques, la caustique des rayons paralleles à l'axe est un point, qu'on nomme le foyer de la parabole.
Dans les miroirs sphériques d'une étendue de 20 à 30 degrés, la caustique des rayons paralleles à l'axe est d'une très-petite étendue, ce qui rend les miroirs sphériques & paraboliques capables de brûler. Voyez Ardent, Parabole, Foyer, &c.
Si plusieurs rayons partent d'un point, & tombent sur une surface plane, les rayons réfléchis prolongés se réuniront en un point ; & pour trouver ce point, il n'y a qu'à mener du point d'où les rayons partent une perpendiculaire à la surface plane, prolonger cette perpendiculaire jusqu'à ce que la partie prolongée lui soit égale, & le point cherché sera à l'extrémité de cette partie prolongée. Voyez Miroir.
Cette proposition peut faire naître sur les caustiques une difficulté capable d'arrêter les commençans, & qu'il est bon de lever ici. On sait que dans la Géométrie des infiniment petits, une portion de courbe infiniment petite est regardée comme une ligne droite, dont la tangente est le prolongement. Supposons donc un petit côté de courbe prolongé en tangente, & imaginons deux rayons infiniment proches, qui tombent sur ce petit côté ; il semble, d'après ce que nous venons de dire, que pour trouver le point de concours des rayons réflechis, il suffise de mener du point d'où les rayons partent, une perpendiculaire à cette tangente, & de prolonger cette perpendiculaire d'une quantité égale. Cependant le calcul & la méthode de M. de l'Hopital font voir que l'extrémité de cette perpendiculaire n'est pas un point de la caustique. Comment donc accorder tout cela ? le voici. En considérant la petite portion de courbe comme une ligne droite, il faudroit que les perpendiculaires à la courbe, tirées aux deux extrémités du petit côté, fussent exactement paralleles, comme elles le seroient si la surface totale au lieu d'être courbe étoit droite ; or cela n'est pas : les perpendiculaires concourent à une certaine distance, & forment par leur concours ce qu'on appelle le rayon de la développée. Voyez Développée. Ainsi il faut avoir égard à la position de ces perpendiculaires concourantes pour déterminer la position des rayons réflechis, & par conséquent leur point de concours, qui est tout autre que si la surface étoit droite. En considérant une courbe comme un polygone, les perpendiculaires à la courbe ne doivent pas être les perpendiculaires aux côtés de la courbe ; ce sont les lignes qui divisent en deux également l'angle infiniment obtus que forment les petits côtés ; autrement au point de concours de deux petits côtés il y auroit deux perpendiculaires, une pour chaque côté. Or cela ne se peut, puisqu'à chaque point d'une courbe il n'y a qu'une perpendiculaire possible. Les rayons incidens & réflechis doivent faire avec la perpendiculaire des angles égaux. D'après cette remarque sur les perpendiculaires, on peut déterminer les caustiques en regardant les courbes comme polygones ; & on ne trouvera plus aucune absurdité ni contradiction apparente entre les principes de la Géométrie de l'infini. V. Différentiel, Infini, &c. (O)
Wiktionnaire
Adjectif - français
caustique \kos.tik\ masculin et féminin identiques
-
(Médecine) Qui est brûlant, corrosif, en parlant des substances qui ont la propriété de brûler ou de désorganiser les matières vivantes.
- La cantharide est un remède caustique.
-
(Chimie) Qui est brûlant, corrosif.
- Les savons sont généralement caustiques et renferment un excès d'alcali libre. On admet qu'ils agissent par leur alcali pour saponifier les corps gras. ? (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
- On emploie aussi, pour détruire les mauvaises herbes, certains engrais caustiques comme le crud ammoniac, la sylvinite spéciale, la cyanamide : [?]. ? (Les Mauvaises herbes et leur destruction, dans Almanach de l'Agriculteur français - 1932, p. 84, éditions La Terre nationale)
- Qui est cinglant, blessant dans la plaisanterie ou la satire.
- Mais il était poète aussi et la poésie, à cette époque d'absolutisme et de barbarie, était chose dangereuse lorsqu'on avait l'esprit aussi caustique que Thierrat. ? (Gustave Fraipont; Les Vosges, 1923)
Nom commun 2 - français
caustique \kos.tik\ féminin
-
(1751) (Optique, Physique) Courbe sur laquelle concourent les rayons successivement réfléchis ou rompus par une surface.
- Caustique par réflexion. Caustique par réfraction.
Nom commun 1 - français
caustique \kos.tik\ masculin
-
Matière brûlante, corrosive.
- La soude est un caustique. Employer les caustiques.
Trésor de la Langue Française informatisé
CAUSTIQUE1, adj.
CAUSTIQUE2, subst. fém.
PHYS. Courbe sur laquelle concourent les rayons successivement réfléchis ou rompus par une surface. Caustique par réflexion. Caustique par réfraction (Ac. 1798-1932).Caustique au Scrabble
Le mot caustique vaut 18 points au Scrabble.
Informations sur le mot caustique - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot caustique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
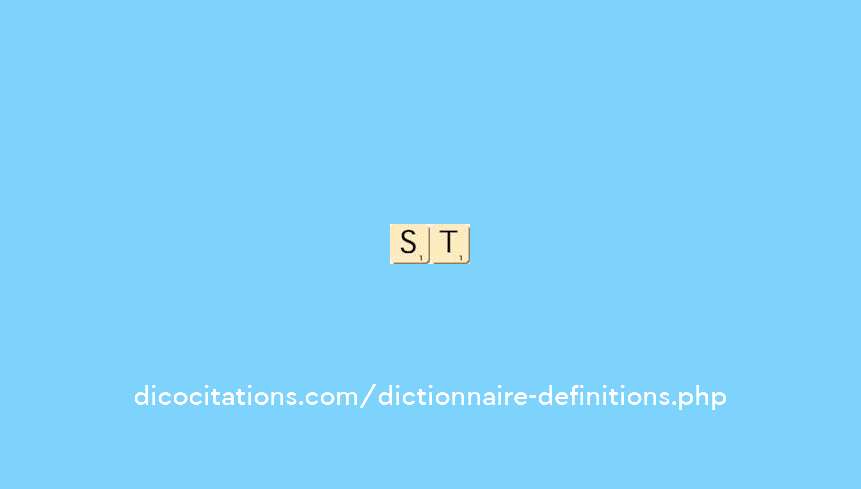
Les mots proches de Caustique
Caucasique Cauchemar Cauchois, oise Caudebec Causalité Causant, ante Causant, ante Cause Causé, ée Causefinalier Causer Causer Causerie Causette Causeur, euse Causse Caussetière Caustique Caut, caute Cautèle Cauteleusement Cauteleux, euse Cautement Cautère Cautérisation Cautérisé, ée Cautériser Caution Cautionner Caubeyres Caubiac Caubios-Loos Caubon-Saint-Sauveur Caubous Caubous Caucalières caucasien caucasien caucasienne caucasienne caucasiens caucasiens caucasique cauchemar cauchemardais cauchemarde cauchemardé cauchemarder cauchemardes cauchemardesque cauchemardesques cauchemardeuse cauchemardeuses cauchemardeux cauchemars Cauchie cauchois cauchoise cauchoises Cauchy-à-la-Tour Caucourt caudal caudale caudales Caudan caudebec Caudebec-en-Caux Caudebec-lès-Elbeuf Caudebronde Caudecoste Caudéran Caudeval Caudiès-de-Conflent Caudiès-de-Fenouillèdes caudillo caudines Caudrot Caudry CauffryMots du jour
-
piétineront pliure irrigue complétait puissances vanneries ratatinée insupportent écrabouillons intracérébrale
Les citations avec le mot Caustique
- Des petits trains bleus, grenat et bruns aux boiseries encaustiquées emportent dans les vallées un peuple de varappeurs, d'Anglais à herbier, de courses d'école.Auteur : Jacques Chessex - Source : Portrait des Vaudois (1969)
- J'ai la langue bien pendue et j'ai beaucoup de facilité à dire des gros mots français, pas ceux de ma langue d'origine ! Et si je suis caustique, c'est avec bon coeur !Auteur : Wouter Otto Levenbach, dit Dave - Source : A L'AFP, 2019
- L'homme caustique n'est pas encore méchant ; mais il n'a plus qu'un pas à faire, et il est difficile qu'il ne le fasse pas tôt ou tard.Auteur : Guillaume Charles Antoine Pigault de l'Espinoy, dit Pigault-Lebrun - Source : L'Homme à projets (1807)
- Les remarques de l'abbé d'Olivet déplurent surtout à un satirique (l'abbé Desfontaines) plus fameux que célèbre, et plus caustique que juste.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Synonymes
- L'espoir est un poison. L'espoir vous brûlera de l'intérieur. L'espoir est un verre de soude caustique. Auteur : Iain Levison - Source : Arrêtez-moi là ! (2011)
- En conversation, il gravait le mot. Il avait le style lapidaire, et même lapidant, car il était né caustique, et les pierres qu'il jetait dans le jardin des autres atteignaient toujours quelqu'un.Auteur : Jules Amédée Barbey d'Aurevilly - Source : Les Diaboliques (1874)
- Ils prirent un couloir, puis un escalier qui embaumait l'encaustique.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- Nous aimerions faire en sorte que les dessins continuent à être pertinents, caustiques, dérangeants, mais je ne veux pas y lire de la haine. Il faut éviter de faire des dessins agressifs contre la croyance.Auteur : Jean Plantureux, dit Plantu - Source : Dans Le Nouvel Obs, 7 février 2006
Les citations du Littré sur Caustique
- Mes pères, dit le caustique magistrat [le premier président Harlay] en s'adressant aux premiers [jésuites], il faut vivre avec vous, et se tournant vers les oratoriens : et mourir avec vousAuteur : DUCLOS - Source : Oeuv. t. V, p. 57
- Il [milord Tirconel, ambassadeur] a le discours serré et caustique, je ne sais quoi de franc que les Anglais ont, et que les gens de son métier n'ont guèreAuteur : Voltaire - Source : Lett. Mme Denis, 12 janv. 1751
- Non-seulement il tire du roulement d'une courbe sur elle-même une roulette ou cycloïdale décrite à la manière ordinaire par un point fixe de la courbe mobile, mais encore la caustique par réflexion, et, de plus, deux courbes dont il appelle la première antidéveloppée, la seconde péricaustiqueAuteur : FONTEN. - Source : Bernoulli.
- Je lui trouve de l'esprit et de la gaieté, mais il est caustique et persifleurAuteur : GENLIS - Source : Mères rivales, t. I, p. 9, dans POUGENS
- L'inustion étant le caractère distinctif de l'encaustique des anciensAuteur : DIDER - Source : Peint. en cire, Oeuvr. t. XV, p. 355, dans POUGENS
- Aucuns appliquent une herbe caustique, nommée pied-decorbin, qui engendre sur le lieu une vessieAuteur : O. DE SERRES - Source : 950
- Non-seulement il tire du roulement d'une courbe sur elle-même une roulette ou cycloïdale décrite à la manière ordinaire par un point fixe de la courbe mobile, mais encore la caustique par réflexion, et de plus deux courbes, dont il appelle la première antidéveloppée, la seconde péricaustiqueAuteur : FONTEN. - Source : Bernoulli.
- Elle qui, dans son enjouement, Sans être obscure ni caustique, Saurait bien faire une réplique Aux rébus de vos campagnards, Qu'on voit à leur style rustique, N'avoir rien lu que des RonsardsAuteur : Guillaume Amfrye de Chaulieu - Source : Lett. à d'Hamilt.
- Les remarques de l'abbé d'Olivet déplurent surtout à un satirique [l'abbé Desfontaines] plus fameux que célèbre, et plus caustique que justeAuteur : D'ALEMB. - Source : dans LAFAYE, Synon.
- On ne doit pas confondre avec les mouvements que produit l'irritabilité, ces changements purement chimiques que l'application des caustiques fait éprouver à toutes les parties molles des corps organisésAuteur : CONDORCET - Source : Haller.
- Un Tabarin mordant, caustique et rustre, Devient par elle un sénateur illustreAuteur : J. B. ROUSS. - Source : Allég. I, 1
- Dans le sexe j'ai peint la piété caustiqueAuteur : BOILEAU - Source : Sat. X.
- Les autres pyrotiques [caustiques] sont septiques ; c'est à dire putrefactifs, autrement aussi dits vesicatifs, qui pourrissent la chair au dedans, et eslevent le cuir en vessieAuteur : PARÉ - Source : XXV, 18
- Et toujours avec lui sera Muse goguenarde et caustique, Qui, tandis que fat il sera, Sans cesse les chansonneraAuteur : CHAULIEU - Source : Au cheval. de Bouill.
- D'un caustique quatrain barbouiller mon tombeauAuteur : Guillaume Amfrye de Chaulieu - Source : Épître à Lafare.
- Vous croyez, en votre humeur caustique, En agir avec moi comme avec l'as de pique ?Auteur : REGNARD - Source : le Joueur, III, 11
- C'est presque un cercle académique, Me disait maint esprit caustiqueAuteur : BÉRANG. - Source : Acad. et Caveau.
- Medicament pyrotique, c'est à dire caustique et corrosifAuteur : PARÉ - Source : XXV, 18
- Sénèque le père fut d'une humeur caustiqueAuteur : DIDER. - Source : Ess. s. Claude, liv. II
Les mots débutant par Cau Les mots débutant par Ca
Une suggestion ou précision pour la définition de Caustique ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 14h59
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur caustique
Poèmes caustique
Proverbes caustique
La définition du mot Caustique est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Caustique sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Caustique présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

