Définition de « pus »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot pus de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur pus pour aider à enrichir la compréhension du mot Pus et répondre à la question quelle est la définition de pus ?
Une définition simple : (fr-inv|py) pus (m)
Définitions de « pus »
Trésor de la Langue Française informatisé
POUVOIR1, verbe trans.
PUS, subst. masc.
PATHOL. Exsudat pathologique apparaissant à un point infecté de l'organisme, d'aspect plus ou moins liquide et visqueux, de couleur variable allant du jaunâtre au verdâtre, et contenant du sérum, des leucocytes polynucléaires, des microbes, des hématies, des cellules du tissu atteint. Globules, sérum du pus; poche, écoulement de pus; pus (qui coule) d'un abcès, d'une plaie, d'un ulcère; pus fétide, sanguinolent; faire sortir le pus d'un abcès; former du pus; infecté de pus. Dans le cheval (...) un grand sac membraneux, placé au côté de l'arrière-bouche (...) dans quelques circonstances, se remplit de pus (Cuvier,Anat. comp., t. 2, 1805, p. 492):Wiktionnaire
Nom commun - français
pus \py\ masculin
-
(Médecine) Matière liquide, épaisse, blanchâtre, qui se forme dans les abcès, qui sort des plaies et des ulcères.
- Le cryptocoque est cultivable à 38°, en ensemençant, avec du pus aseptique d'abcès, de la gélose au crottin de cheval recouverte d'une macération de ganglions du même animal : [?]. ? (G. Marotel, Parasitologie vétérinaire, J.-B. Baillière & fils, 1927, page 520)
- Le pus présent dans les lésions d'actinobacillose est un pus blanc laiteux, inodore, visqueux, renfermant des grains parfois difficiles à observer. L'écrasement du pus entre lame et lamelle permet de mieux visualiser les grains [?]. ? (J.P. Euzéby, Abrégé de Bactériologie Générale et Médicale à l'usage des étudiants de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, chap. « Actinobacillus »,)
- (Sens figuré) ? Au loin, il y avait de ces champignons qui érigent un gland glueux de pus verdâtre ou qui s'affaissent, flasques, comme des éponges pourries aux puanteurs de charognes. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Avoir la faculté, être en état de. Pouvoir marcher. Je pourrais sortir. Je ne puis vous répondre. Je ne peux pas dormir. Il n'a pu réussir dans cette affaire. Quand le pronom je doit suivre le verbe, on préfère puis à peux. Puis-je vous être utile? Sauve qui peut, Se sauve qui pourra, se tire du péril qui pourra. Le cri de sauve qui peut se fit entendre. Prov., Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! Si la jeunesse avait de l'expérience et que la vieillesse eût de la force!
POUVOIR s'emploie au subjonctif présent par une manière de vœu, de souhait. Puisse le ciel vous donner de longs jours! Puissiez-vous réussir dans vos projets! Puissent vos projets réussir! Puisse-t-il arriver bientôt!
POUVOIR se dit encore pour marquer la possibilité de quelque événement, de quelque dessein. Un accident pourrait arriver. Cela se peut faire. Cela pourrait bien être. Cela se peut. Cela ne se peut pas. Il pourrait bien en mourir. Il s'emploie impersonnellement soit seul, soit avec le pronom Se, dans cette acception. Il se peut que votre projet réussisse. Il pourra venir un temps meilleur. Il pourra, il pourrait arriver que... Il se pourrait que... Peut-être. Voyez cette expression à son rang alphabétique.
POUVOIR s'emploie aussi transitivement et signifie Avoir l'autorité, le crédit, le moyen, la faculté, etc., de faire. Vous pouvez tout sur lui, sur son esprit. Si je puis quelque chose pour votre service, je m'y emploierai avec joie. C'est un homme qui peut beaucoup dans l'affaire dont il s'agit. Je ne puis rien en cela. Il peut tout ce qu'il veut. Je ne puis pas y aller. On ne peut plus, on ne peut mieux, Il n'est pas possible de faire ou d'être plus, de faire ou d'être mieux. Il est on ne peut plus aimable. Il s'y conduisit on ne peut mieux. N'en pouvoir plus, N'en plus pouvoir, Être dans un accablement causé soit par la vieillesse, soit par la maladie, soit par la fatigue, le travail, la faim, la soif, ou encore par la souffrance morale, l'inquiétude, le chagrin. Je n'en puis plus. Il est fatigué à n'en pouvoir plus. Il est accablé de travail, il n'en peut plus. Je n'en puis plus de soif, de lassitude. Quand il est arrivé chez lui, il n'en pouvait plus. J'ai trop souffert, je n'en puis plus. Après tout ce qu'il a enduré, il n'en peut plus. Ce cheval n'en peut plus. N'en pouvoir mais, Ne pouvoir plus ou N'y rien pouvoir. Je suis désolé de ce qui arrive : je n'en peux mais, je n'en puis mais.
Littré
- Terme de médecine. Humeur morbide sans analogue dans l'état sain, caractérisée par des globules spéciaux, et se produisant d'ordinaire par l'effet d'une inflammation.
Quand l'abcès était caché, on se croyait sain et propre?; quand il crève, on sent l'infection du pus
, Fénelon, t. XVIII, p. 421.Pus louable, pus de bonne qualité.
Fig.
On disait du roi qu'il tirait le sang de tous ses sujets sans distinction, qu'il en exprimait jusqu'au pus
, Saint-Simon, 284, 108.
Encyclopédie, 1re édition
PUS, s. m. (Chirurg.) matiere liquide, épaisse, blanchâtre, qui s'engendre dans les abscès, ou qui sort des plaies & des ulceres. La formation du pus, & son écoulement sont connus sous le nom de suppuration. Elle est louable lorsque le pus est de bonne qualité, d'une couleur uniforme, & sans mauvaise odeur. La suppuration est putride lorsque les sucs qui forment le pus sont viciés par quelque cause que ce soit. Voyez Putride & Purulent.
Il n'y a que les tissus cellulaires qui suppurent. La suppuration est une terminaison d'un engorgement inflammatoire. Voyez Inflammation. C'est l'action violente des arteres qui conjointement avec la chaleur extraordinaire qu'elle excite dans la partie, qui brise les vaisseaux, & mêle le sang, la lymphe & les sucs graisseux qui se produisent sous la forme de pus. A l'égard de celui qui est fourni par les plaies & les ulceres, il n'est pas difficile de voir comment la nature produit cette liqueur, qu'on dit ne ressembler à aucune de celles du corps. Son excrétion me paroît un effet tout simple & tout naturel de la solution de continuité.
Le pus est produit par l'action organique des chairs qui forment le fonds de la plaie ; mais ce n'est qu'un simple écoulement proportionné à la quantité des cellules graisseuses qui sont ouvertes dans la surface de la plaie. Ce n'est pas une sécrétion nouvelle dans la partie, comme on a pu le croire ; mais une excrétion des sucs qui, sans la solution de continuité, seroient déposés dans les cellules de la membrane adipeuse, & y auroient été modifiés différemment. On ne connoît, dira-t-on, dans nos humeurs aucun suc qui soit de la nature du pus ? mais nous ne connoissons pas plus dans la masse générale la plûpart des liqueurs particulieres qui sont filtrées dans différens couloirs. Y reconnoissons-nous la salive & la mucosité du nez ; y distinguons-nous le suc pancréatique & l'humeur spermatique, &c ? On ne connoît ces humeurs qu'après qu'elles ont été formées & séparées dans les couloirs que la nature a destinés pour leur fonction. Le fond d'une plaie ne peut pas former un nouveau genre d'organe secrétoire, c'est-à-dire un organe composé & destiné à un genre particulier de secrétion. Le pus n'est donc que la liqueur qui auroit été filtrée & déposée dans les cellules de la membrane adipeuse, & qui s'écoule à-peu-près sous la même forme qu'elle auroit eue dans l'état naturel. Des sucs huileux mêlés intimement à une humeur séreuse qui leur sert de véhicule, & avec des sucs muqueux & lymphatiques, dont on ne peut savoir la proportion, forment le mélange que nous appellons pus dans les plaies & dans les ulceres. Voyez les indications curatives des plaies qui suppurent & des ulceres au mot Détersif, & au mot Ulcere ; sur la régénération des chairs, voyez l'article Incarnation. (Y)
Étymologie de « pus »
- Du latin pus.
Lat. pus?; grec, ????, de ???, ????, pourrir?; sanscr. puy, puer.
pus au Scrabble
Le mot pus vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot pus - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot pus au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
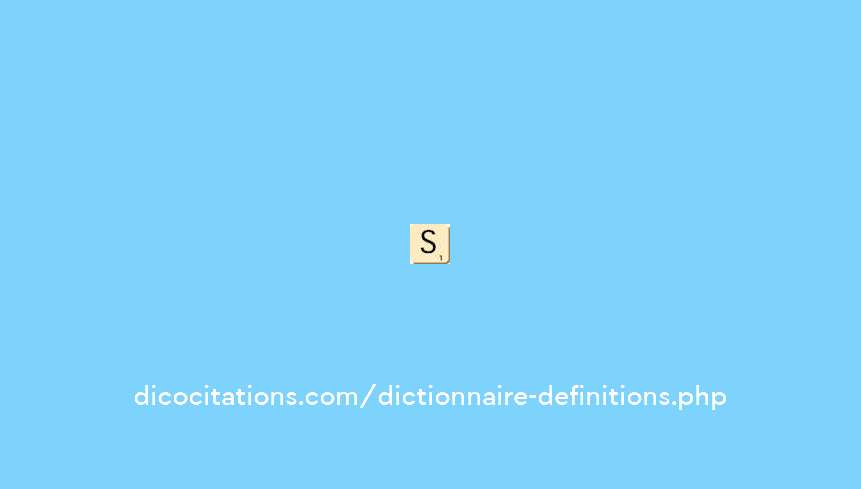
Les rimes de « pus »
On recherche une rime en PY .
Les rimes de pus peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en py
Rimes de corrompu Rimes de rompue Rimes de conspue Rimes de put Rimes de corrompus Rimes de préciputs Rimes de repu Rimes de corrompu Rimes de pût Rimes de pus Rimes de interrompue Rimes de rompu Rimes de interrompues Rimes de pus Rimes de lippus Rimes de crépu Rimes de repue Rimes de corrompue Rimes de lippues Rimes de corrompue Rimes de corrompu Rimes de pue Rimes de interrompues Rimes de crépus Rimes de interrompus Rimes de rompues Rimes de corrompus Rimes de pues Rimes de trapu Rimes de corrompues Rimes de ininterrompu Rimes de pus Rimes de ininterrompus Rimes de rompus Rimes de corrompues Rimes de crépue Rimes de crépues Rimes de puent Rimes de corrompus Rimes de trapue Rimes de repues Rimes de lippue Rimes de ininterrompue Rimes de lippu Rimes de interrompue Rimes de rompues Rimes de rompue Rimes de repus Rimes de rompus Rimes de rompuMots du jour
corrompu rompue conspue put corrompus préciputs repu corrompu pût pus interrompue rompu interrompues pus lippus crépu repue corrompue lippues corrompue corrompu pue interrompues crépus interrompus rompues corrompus pues trapu corrompues ininterrompu pus ininterrompus rompus corrompues crépue crépues puent corrompus trapue repues lippue ininterrompue lippu interrompue rompues rompue repus rompus rompu
Les citations sur « pus »
- La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule.Auteur : Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Source : Principes de la philosophie du droit (1818)
- À Port-Soudan, le crépuscule obéissait à un rituel immuable. Un bref instant les toits, les ombrelles légères des arbres, les rinceaux des palmes, comme portés à incandescence par la chaleur accumulée du jour, laissaient fuser des flammes où dansaient les couleurs les plus violentes d'oxydes et de sulfures. Ce paroxysme semblait rendre fous les charognards dont les patientes orbes soudain se précipitaient, se mêlaient, se heurtaient. Des grappes d'oiseaux
clabaudeurs roulaient dans le ciel, des tourbillons de plumes ensanglantées tombaient lentement sur la ville comme un voile de suie.Auteur : Olivier Rolin - Source : Port-Soudan (1992)
- Leurs entretiens s'allongeaient comme les crépuscules.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Le Matelot (1893)
- Il n'y eut pas un ouvrier de la ville que je pusse faire démarrer de l'antichambre ou de l'escalier.Auteur : Paul-Louis Courier - Source : Lettres
- Ah! qu'on a de peine à briser les noeuds qui lient nos coeurs à la terre! et qu'il est sage de la quitter aussitôt qu'ils sont rompus!Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Julie, ou la Nouvelle Héloïse (1761)
- Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne
Qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau
Et triste, j'erre après un rêve vague et beau,
Par les champs où la sève immense se pavane.Auteur : Stéphane Mallarmé - Source : Poésies (1898), Renouveau - Si nous pouvions en économie politique, laisser de côté cette terminologie damnée de la valeur, de la richesse, du revenu, du capital, mots si gros de vie latente mais si corrompus par le péché originel!Auteur : Miguel de Unamuno - Source : L'essence de l'Espagne (1895)
- Oh! quel farouche bruit font dans le crépuscule - Les chênes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule! - Les chevaux de la Mort se mettent à hennir - Et sont joyeux car l'âge éclatant va finir...Auteur : Victor Hugo - Source : Toute la lyre (1888)
- Le vol noir des regrets tourne à notre crépuscule, autour de l'âme, comme les papillons autour des lampes. Auteur : Pierre Aguétant - Source : Le coeur secret (1921)
- La fatigue aidant, je ne pus dormir ma nuit.Auteur : Anatole France - Source : Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881)
- Rameau nous a donné non la meilleure musique dont il fût capable, mais la meilleure que nous pussions supporter.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Sans référence
- La rumeur, c'est le glaive merdeux souillé de germes épidermiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. Elle se profile à peine au sortir des égouts pour vomir ses miasmes poisseux aux brouillards crépusculaires des hivers bronchiteux.Auteur : Pierre Desproges - Source : Chroniques de la haine ordinaire (2004)
- Une nuit, je vous écrivais continuellement des lettres dans un état de demi-sommeil, je ressentais cela comme des petits coups de marteau ininterrompus.Auteur : Franz Kafka - Source : Lettre, à Felice Bauer
- Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, une voix familière leur répète de l'aube au crépuscule: «Ne faites pas les malins.»Auteur : Emmanuel Mounier - Source : Dans la Revue Esprit, mars 1950
- Les coeurs les plus corrompus ne peuvent croire au mal qu'en le faisant reposer sur un intérêt quelconque : le mal inutile et sans cause répugne comme une anomalie.Auteur : Alexandre Dumas - Source : Le comte de Monte-Cristo (1845-1846)
- On sait que le crépuscule, quelle qu'en soit la cause, commence le matin et finit le soir, quand le soleil est à 18 degrés au-dessous de l'horizon.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Bernoulli
- Amitié, doux repos de l'âme, crépuscule charmant des coeurs...Auteur : Alphonse de Lamartine - Source : Sans référence
- La beauté de l'ennui
Dans la nuit qui bourdonne
A la galeuse féerie
Des crépuscules d'automne.Auteur : Hubert-Félix Thiéfaine - Source : Scandale Mélancolique (2005), Scandale mélancolique - Après le crépuscule, les vers luisants pensent: «Nous avons donné la lumière au monde!»Auteur : Proverbes sanskrits - Source : Proverbes
- La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule, qui met chaque objet en valeur.Auteur : Albert Camus - Source : L'Eté (1954)
- Dans le désert au crépuscule, on s'assoit sur une dune, on ne voit rien, on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en vous.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Le Petit Prince (1943)
- L'inconvénient de mon métier est qu'il faut être en bon état, sinon on pose problème au rôle ou aux producteurs pusillanimes.Auteur : Jean-Paul Belmondo - Source : Mille vies valent mieux qu'une (2016)
- On ne peut que rêver dans les crépuscules de la mauvaise foi sur la réalité positive du mystère.Auteur : Simone de Beauvoir - Source : Le Deuxième Sexe (1949)
- Le doute est le crépuscule de l'esprit; mais il y a le crépuscule qui annonce le jour et la lumière, et celui qui n'est que le jour s'évanouissant dans les ténèbres.Auteur : Charles Dollfus - Source : De la Nature humaine (1868)
- Douceur du soir! Douceur de la chambre sans lampe! - Le crépuscule est doux comme une bonne mort - Et l'ombre lentement qui s'insinue et rampe - Se déroule en pensée au plafond. Tout s'endort.Auteur : Georges Rodenbach - Source : Le Règne du Silence
Les mots proches de « pus »
Pus Puséysme Puséyste Pusillanime Pusillanimement Pusillanimité Pustule Pustuleux, euseLes mots débutant par pus Les mots débutant par pu
pus pus pus Pusey Pusignan Pusignan pusillanime pusillanimes pusillanimité Pussay Pussay pusse Pussemange pussent pusses pussiez Pussigny Pussy pustule pustules pustuleuse pustuleux Pusy-et-Épenoux
Les synonymes de « pus»
Les synonymes de pus :- 1. ichor
2. sanie
3. suppuration
4. humeur
synonymes de pus
Fréquence et usage du mot pus dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « pus » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot pus dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Pus ?
Citations pus Citation sur pus Poèmes pus Proverbes pus Rime avec pus Définition de pus
Définition de pus présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot pus sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot pus notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 3 lettres.
