Définition de « verbal »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot verbal de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur verbal pour aider à enrichir la compréhension du mot Verbal et répondre à la question quelle est la définition de verbal ?
Une définition simple : (fr-accord-al|verb|v??.b) verbal (m)
Approchant : , déverbal, verbalement, verbaliser, verbalisme
Définitions de « verbal »
Trésor de la Langue Française informatisé
VERBAL, -ALE, -AUX, adj.
Wiktionnaire
Adjectif - français
verbal \v??.bal\ masculin
- Qui est relatif aux mots, au langage (écrit ou oral).
- Dans un contexte de communication, on peut distinguer le message verbal (qui passe par les mots) du message para-verbal et non-verbal (qui passe, lui, par ce qu'il y a autour des mots : mimiques, gestes, intonations de voix et prosodie, position du corps, etc.).
- Qui a lieu, qui se fait de vive voix, et non par écrit.
- Promesse verbale.
- Ordre verbal.
-
(Grammaire) Qui a rapport au verbe.
- Désinence verbale.
- Forme verbale.
- Substantif verbal, ? voir déverbal.
- Adjectif verbal, Participe présent employé adjectivement et qui est soumis aux règles de l'accord.
Littré
-
1Qui n'est que de vive voix et non par écrit. Des ordres verbaux.
Il n'y a point de promesse de mariage verbale ni par écrit
, Patru, Plaidoyer 11.On a prétendu que le connétable de Montmorency fut disgracié par le roi, pour lui avoir conseillé de se contenter de la promesse verbale de Charles-Quint
, Voltaire, M?urs, 125.Ne donnez à votre élève aucune espèce de leçon verbale?; il n'en doit recevoir que de l'expérience
, Rousseau, Ém. II.Antithèse verbale, antithèse qui consiste seulement dans les mots, et non dans la pensée.
Critique verbale, critique qui ne s'attache qu'aux mots.
Rapport verbal, se dit, dans les sociétés savantes, d'un rapport écrit, lorsqu'il ne doit pas être suivi d'une décision, et qu'il n'est reçu que comme renseignement.
Terme de diplomatie. Note verbale, se dit d'une note donnée à un ambassadeur, à un cabinet étranger, par écrit à la vérité, mais sans signature et sans un caractère pleinement officiel.
-
2 Terme de grammaire. Qui est de la nature du verbe, qui tient au verbe. Action est un substantif verbal.
Adjectif verbal, participe présent pris adjectivement, et soumis aux règles de l'accord.
Les adjectifs verbaux qualifient par un attribut d'événement, c'est-à-dire par une qualité accidentelle et survenue qui paraît être l'effet d'une action qui se passe ou qui s'est passée dans la chose?; tels sont rampant, dominant, liant, caressant
, Dumarsais, ?uv. t. IV, p. 108.Racines verbales, voy. PRÉDICATIF.
-
3Procès-verbal, acte dans lequel un officier de justice ou autre personne ayant qualité a constaté un fait et toutes ses circonstances. Un procès - verbal d'apposition de scellés. Dresser un procès-verbal, des procès-verbaux. Dresser procès-verbal.
J'aurais regret d'être obligé d'écrire, Et de vous voir couché dans mon procès-verbal
, Molière, Tart. v, 4.Fig.
L'histoire de l'Europe est devenue un immense procès-verbal de contrats de mariage
, Voltaire, M?urs, 74.Faire un procès-verbal à quelqu'un, constater par procès-verbal qu'il a commis quelque infraction. Faire un procès-verbal à un débitant pour avoir fraudé les droits.
On dit quelquefois simplement un verbal. Le verbal en fait foi.
Un verbal fourmillant de fautes d'orthographe
, Daru, Épît. à mon sans-culotte. -
4Procès-verbal, se dit aussi du narré, par écrit, de ce qui s'est passé dans une séance, dans une cérémonie, etc. Lisez le procès-verbal de la dernière séance.
On le dit aussi du résumé des actes et des délibérations d'un corps. Le procès-verbal des séances de l'assemblée nationale.
Fig.
Il m'a promis de vous regarder, de vous manier, et de me faire un procès-verbal de votre aimable personne
, Sévigné, 442. -
5Verbal d'opinions, s'est dit pour vote à haute voix, opposé à scrutin secret.
Dans toutes les questions de ce genre, le verbal d'opinions arme l'homme contre l'intérêt, rend chaque individu plus fort par lui-même en l'isolant, et l'oblige à ne consulter que son propre v?u, puisqu'il ne pourrait pas le cacher, pour ainsi dire, sous celui des autres
, Mirabeau, Collection, t. I, p. 80.
HISTORIQUE
XIVe s. Telle cognoissance verballe que ung vassal selon les droitz humains doit faire à son seigneur
, le Songe du Vergier, II, 79.
XVe s. Nous sommes verbaux, et appetons les paroles plus que les choses
, Chartier, le Curial, p. 397.
XVIe s. Les dissentions des sectes philosophiques en ce cas sont verbales
, Montaigne, I, 69. L'ignorance pure estoit bien plus salutaire et plus sçavante que n'est cette science verbale et vaine
, Montaigne, I, 398. Fermeté plus verbale qu'essentielle
, Montaigne, II, 211.
Encyclopédie, 1re édition
VERBAL, le, adj. (Gram.) qui est dérivé du verbe. On appelle ainsi les mots dérivés des verbes ; & il y a des noms verbaux & des adjectifs verbaux. Cette sorte de maux est principalement remarquable dans les langues transpositives, comme le grec & le latin, à cause de la diversité des régimes.
J'ai démontré, si je ne me trompe, que l'infinitif est véritablement nom : voyez Infinitif ; mais c'est, comme je l'ai dit, un nom verbe, & non pas un nom verbal : je pense qu'on doit seulement appeller noms verbaux ceux qui n'ont de commun avec le verbe que le radical représentatif de l'attribut, & qui ne conservent rien de ce qui constitue l'essence du verbe, je veux dire, l'idée de l'existence intellectuelle, & la susceptibilité des tems qui en est une suite nécessaire. Il est donc évident que c'est encore la même chose du supin que de l'infinitif ; c'est aussi un nom-verbe, ce n'est pas un nom verbal. Voyez Supin.
Par des raisons toutes semblables, les participes ne sont point adjectifs verbaux ; ce sont des adjectifs-verbes, parce qu'avec l'idée individuelle de l'attribut qui leur est commune avec le verbe, & qui est représentée par le radical commun, ils conservent encore l'idée spécifique qui constitue l'essence du verbe, c'est-à-dire, l'idée de l'existence intellectuelle caractérisée par les diverses terminaisons temporelles. Les adjectifs verbaux n'ont de commun avec le verbe dont ils sont dérivés, que l'idée individuelle mais accidentelle de l'attribut.
En latin les noms verbaux sont principalement de deux sortes : les uns sont terminés en io, gén. ionis, & sont de la troisieme déclinaison, comme visio, actio, tactio ; les autres sont terminés en us, gén. ûs, & sont de la quatrieme déclinaison, comme visus, pactus, actus, tactus. Les premiers expriment l'idée de l'attribut comme action, c'est-à-dire, qu'ils énoncent l'opération d'une cause qui tend à produire l'effet individuel désigné par le radical ; les seconds expriment l'idée de l'attribut comme acte, c'est-à-dire qu'ils énoncent l'effet individuel désigné par le radical sans aucune attention à la puissance qui le produit : ainsi visio c'est l'action de voir, visus en est l'acte ; pactio signifie l'action de traiter ou de convenir, pactus exprime l'acte ou l'effet de cette action ; tactio, l'action de toucher ou le mouvement nécessaire pour cet effet, tactus, l'effet même qui résulte immédiatement de ce mouvement, &c. Voyez Supin.
Il y a encore quelques noms verbaux en um, gén. i, de la seconde déclinaison, dérivés immédiatement du supin, comme les deux especes dont on vient de parler ; par exemple, pactum, qui doit avoir encore une signification différente de pactio & de pactus. Je crois que les noms de cette troisieme espece désignent principalement les objets sur lesquels tombe l'acte, dont l'idée tient au radical commun : ainsi pactio exprime le mouvement que l'on se donne pour convenir ; pactus, l'acte de la convention, l'effet du mouvement que l'on s'est donné ; pactum, l'objet du traité, les articles convenus. C'est la même différence entre actio, actus & actum.
Les adjectifs verbaux sont principalement de deux sortes, les uns sont en ilis, comme amabilis, flebilis, facilis, odibilis, vincibilis ; les autres en undus, comme errabundus, ludibundus, vitabundus, &c. Les premiers ont plus communément le sens passif, & caractérisent surtout par l'idée de la possibilité, comme si amabilis, par exemple, vouloit dire par contraction ad amari ibilis, en tirant ibilis de ibo, &c. Les autres ont le sens actif, & caractérisent par l'idée de la fréquence de l'acte, comme si ludibundus, par exemple, signifioit sapè ludere ou continuo ludere solitus.
Il peut se trouver une infinité d'autres terminaisons, soit pour les noms, soit pour les adjectifs verbaux : voyez Vossii anal. ij. 32. & 33. mais j'ai cru devoir me borner ici aux principaux dans chaque genre ; parce que l'Encyclopédie ne doit pas être une grammaire latine, & que les especes que j'ai choisies suffisent pour indiquer comment on doit chercher les différences de signification dans les dérivés d'une même racine qui sont de la même espece ; ce qui appartient à la grammaire générale.
Mais je m'arreterai encore à un point de la grammaire latine qui peut tenir par quelque endroit aux principes généraux du langage. Tous les grammairiens s'accordent à dire que les noms verbaux en io & les adjectifs verbaux en undus prennent le même régime que le verbe dont ils sont dérivés. C'est ainsi, disent-ils, qu'il faut entendre ces phrases de Plaute (Amphitr. I. iij.) quid tibi hanc curatio est rem ? (Aulul. III. Redi.) sed quid tibi nos tactio est ? (Trucul. II. vij.) quid tibi hanc auditio est, quid tibi hanc notis est ? Cette phrase de T. Live (xxv.) Hanno vitabundus castra hostium consulesque, loco edito castra posuit ; & celles-ci d'Apulée, carnificem imaginabundus, mirabundi bestiam. Les réflexions que j'ai à-proposer sur cette matiere paroîtront peut-être des paradoxes : mais comme je les crois néanmoins conformes à l'exacte vérité, je vais les exposer comme je les conçois : quelque autre plus habile ou les détruira par de meilleures raisons, ou les fortifiera par de nouvelles vues.
Ni les noms verbaux en io, ni les adjectifs verbaux en undus, n'ont pour régime direct l'accusatif.
1°. On peut rendre raison de cet accusatif, en suppléant une préposition : curatio hanc rem, c'est curatio propter hanc rem ; nos tactio, c'est in nos ou super nos tactio ; hanc auditio, hanc notio, c'est ergà hanc auditio, circà hanc notio ; vitabundus castra consulesque, suppl. propter ; carnificem imaginabundus, suppl. in (ayant sans cesse l'imagination tournée sur le bourreau) ; mirabundi bestiam, suppl. propter. Il n'y a pas un seul exemple pareil que l'on ne puisse analyser de la même maniere.
2°. La simplicité de l'analogie qui doit diriger partout le langage des hommes, & qui est fixée immuablement dans la langue latine, ne permet pas d'assigner à l'accusatif une infinité de fonctions différentes ; & il faudra bien reconnoître néanmoins cette multitude de fonctions diverses, s'il est régime des prépositions, des verbes relatifs, des noms & des adjectifs verbaux qui en sont dérivés ; la confusion sera dans la langue, & rien ne pourra y obvier. Si l'on veut s'entendre, il ne faut à chaque cas qu'une destination.
Le nominatif marque un sujet de la premiere ou de la troisieme personne : le vocatif marque un sujet de la seconde personne : le génitif exprime le complément déterminatif d'un nom appellatif : le datif exprime le complément d'un rapport de fin : l'ablatif caractérise le complément de certaines prépositions : pourquoi l'accusatif ne seroit-il pas borné à désigner le complément des autres prépositions ?
Me voici arrêté par deux objections. La premiere, c'est que j'ai consenti de reconnoître une ablatif absolu & indépendant de toute préposition : voyez Gérondif : la seconde, c'est que j'ai reconnu l'accusatif lui-même, comme régime du verbe actif relatif ; voyez Infinitif. L'une & l'autre objection doit me faire conclure que le même cas peut avoir différens usages, & conséquemment que j'étaie mal le système que j'établis ici sur les régime des noms & des adjectifs verbaux.
Je réponds à la premiere objection, que, par rapport à l'ablatif absolu, je suis dans le même cas que par rapport aux futurs : j'avois un collegue, aux vues duquel j'ai souvent dû sacrifier les miennes : mais je n'ai jamais prétendu en faire un sacrifice irrévocable ; & je désavoue tout ce qui se trouvera dans le VII. tome n'être pas d'accord avec le système dont j'ai répandu les diverses parties dans les volumes suivans.
On suppose (art. Gérondif) que le nom mis à l'ablatif absolu n'a avec les mots de la proposition principale aucune relation grammaticale ; & voilà le seul fondement sur lequel on établit la réalité du prétendu ablatif absolu. Mais il me semble avoir démontré (Régime, art. 2.) l'absurdité de cette prétendue indépendance, contre M. l'abbé Girard, qui admet un régime libre : & je m'en tiens, en conséquence, à la doctrine de M. du Marsais, sur la nécessité de n'envisager jamais l'ablatif, que comme régime d'une préposition. Voyez Ablatif & Datif.
Pour ce qui est de la seconde objection, que j'ai reconnu l'accusatif comme régime du verbe actif relatif ; j'avoue que je l'ai dit, même en plus d'un endroit : mais j'avoue aussi que je ne le disois que par respect pour une opinion reçue unanimement, & pensant que je pourrois éviter cette occasion de choquer un préjugé si universel. Elle se présente ici d'une maniere inévitable ; je dirai donc ma pensée sans détour : l'accusatif n'est jamais le régime que d'une préposition ; & celui qui vient après le verbe actif relatif, est dans le même cas : ainsi amo Deum, c'est amo ad Deum ; doceo pueros grammaticam, c'est dans la plénitude analytique doceo ad pueros circà grammaticam, &c. voici les raisons de mon assertion.
1°. L'analogie, comme je l'ai déjà dit, exige qu'un même cas n'ait qu'une seule & même destination : or l'accusatif est indubitablement destiné, par l'analogie latine, à caractériser le complément de certaines prépositions ; il ne doit donc pas sortir de cette destination, surtout si l'on peut prouver qu'il est toujours possible & raisonnable d'ailleurs de l'y ramener. C'est ce que je vais faire.
2°. Les grammairiens ne prétendent regarder l'accusatif comme régime que des verbes actifs, qu'ils appellent transitifs, & que je nomme relatifs avec plusieurs autres : ils conviennent donc tacitement que l'accusatif désigne alors le terme du rapport énoncé par le verbe ; or tout rapport est renfermé dans le terme antécédent, & c'est la préposition qui en est, pour ainsi dire, l'exposant, & qui indique que son complément est le terme conséquent de ce rapport.
3°. Le verbe relatif peut être actif ou passif : amo est actif, amor est passif ; l'un exprime le rapport inverse de l'autre : dans amo Deum, le rapport actif se porte vers le terme passif Deum ; dans amor à Deo, le rapport passif est dirigé vers le terme actif Deo : or Deo est ici complément de la préposition à, qui dénote en général un rapport d'origine, pour faire entendre que l'impression passive est rapportée à sa cause ; pourquoi, dans la phrase active, Deum ne seroit-il pas le complément de la préposition ad, qui dénote en général un rapport de tendance, pour faire entendre que l'action est rapportée à l'objet passif ?
4°. On supprime toujours en latin la préposition ad, j'en conviens ; mais l'idée en est toujours rappellée par l'accusatif qui la suppose, de même que l'idée de la préposition à est rappellée par l'ablatif, lorsqu'elle est en effet supprimée dans la phrase passive, comme compulsi siti pour à siti. D'ailleurs cette suppression de la proposition dans la phrase active n'est pas universelle : les Espagnols disent amar à Dios, comme les Latins auroient pu dire amare ad Deum, (être en amour pour Dieu), & comme nous aurions pu dire aimer à Dieu. Eh, ne trouvons-nous pas l'équivalent dans nos anciens auteurs ? Et pria a ses amis que cil roulet fut mis sur son tombel (que cette inscription fût mise sur son tombeau) : Dict. de Borel, verb. roulet. Que dis-je ? nous conservons la préposition dans plusieurs phrases, quand le terme objectif est un infinitif ; ainsi nous disons j'aime à chasser, & non pas j'aime chasser, quoique nous disions sans préposition j'aime la chasse ; je commence à raconter, J'apprends à chanter, quoiqu'il faille dire, je commence un récit, j'apprends la musique.
Tout semble donc concourir pour mettre, dans la dépendance d'une préposition l'accusatif qui passe pour régime du verbe actif relatif : l'analogie latine des cas en sera plus simple & plus informe ; la syntaxe du verbe actif sera plus rapprochée de celle du verbe passif, & elle doit l'être, puisqu'ils sont également relatifs, & qu'il s'agit également de rendre sensible de part & d'autre la relation au terme conséquent ; enfin les usages des autres langues autorisent cette espece de syntaxe, & nous en trouvons des exemples jusques dans l'usage présent de la nôtre.
Je ne prétends pas dire que, pour parler latin, il faille exprimer aucune préposition après le verbe actif ; je veux dire seulement que, pour analyser la phrase latine, il faut en tenir compte, & à plus forte raison après les noms & les adjectifs verbaux. (E. R. M. B.)
Verbal, (Gram. & Jurisprud.) est ce qui se dit de vive voix & sans être mis par écrit.
On appelle cependant procès-verbal un acte rédigé par écrit, qui contient le rapport ou relation de quelque chose ; mais on l'appelle verbal, parce que cet écrit contient le récit d'une discussion qui s'est faite auparavant verbalement ; en quoi le procès-verbal differe du procès par écrit, qui est une discussion où tout se déclare par écrit. Voyez Procès.
Appel verbal est celui qui est interjetté d'une sentence rendue à l'audience : on l'appelle verbal, parce qu'anciennement il falloit appeller de la sentence illico, sur le champ, ce qui se faisoit devant le juge.
Requête, verbale ; on a donné ce nom à certaines requêtes d'instruction, qui se faisoient autrefois en jugement & de vive voix ; on les a depuis rédigées par écrit pour débarrasser l'audience de cette foule de requêtes qui consumoient tout le tems sans finir aucune cause. (A)
Étymologie de « verbal »
Prov. et esp. verbal?; it. verbale?; du lat. verbalis, de verbum, parole (voy. VERBE).
- Du latin verbalis.
verbal au Scrabble
Le mot verbal vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot verbal - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot verbal au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
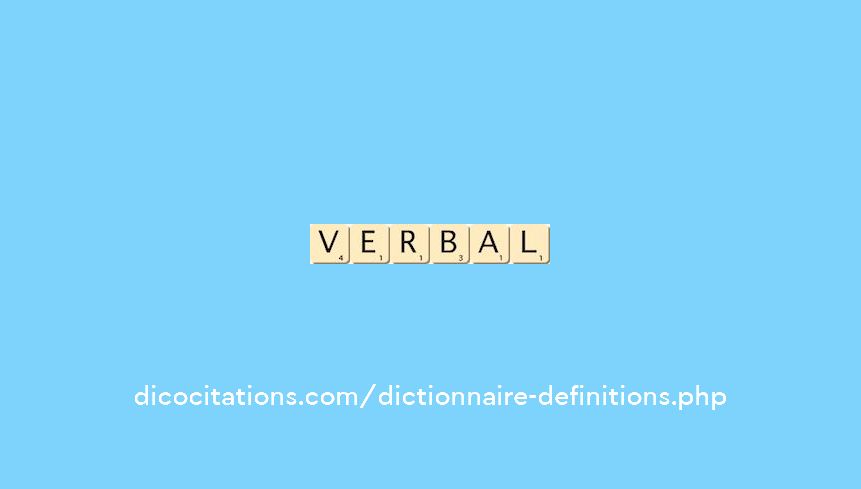
Les rimes de « verbal »
On recherche une rime en AL .
Les rimes de verbal peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en al
Rimes de patronal Rimes de acrocéphale Rimes de hiatale Rimes de collégiale Rimes de navales Rimes de royales Rimes de spéciales Rimes de humoral Rimes de vitales Rimes de spectral Rimes de pectoral Rimes de occidental Rimes de triennale Rimes de déballent Rimes de quetzal Rimes de atonal Rimes de choral Rimes de protal Rimes de inégale Rimes de Fize-le-Marsal Rimes de spectrale Rimes de sandales Rimes de bestiale Rimes de curial Rimes de professoral Rimes de transcontinentale Rimes de brinquebale Rimes de familiales Rimes de dévoile Rimes de hormonales Rimes de radiales Rimes de convivial Rimes de lacrymale Rimes de horizontale Rimes de timbales Rimes de crotales Rimes de Cantal Rimes de infinitésimal Rimes de subtropicales Rimes de virale Rimes de sénatoriales Rimes de ornementale Rimes de labiale Rimes de amygdale Rimes de commerciales Rimes de sororales Rimes de animal Rimes de ducal Rimes de sidéral Rimes de trachéalMots du jour
patronal acrocéphale hiatale collégiale navales royales spéciales humoral vitales spectral pectoral occidental triennale déballent quetzal atonal choral protal inégale Fize-le-Marsal spectrale sandales bestiale curial professoral transcontinentale brinquebale familiales dévoile hormonales radiales convivial lacrymale horizontale timbales crotales Cantal infinitésimal subtropicales virale sénatoriales ornementale labiale amygdale commerciales sororales animal ducal sidéral trachéal
Les citations sur « verbal »
- Non qu'il eust ainsi soigneusement fait ce procès verbal de toute son administration pour approuver sa foy et faire cognoistre sa loyauté.Auteur : Jacques Amyot - Source : Caton d'Utique, 52
- Toute notre expérience de la peinture comporte en fait une considérable partie verbale. Nous ne voyons jamais les tableaux seuls, notre vision n'est jamais pure vision.Auteur : Michel Butor - Source : Les mots dans la peinture (1969)
- Ce qui est répugne à l'étreinte verbale et l'expérience intime ne nous en dévoile rien au-delà de l'instant privilégié et inexprimable. D'ailleurs, l'être lui-même n'est qu'une prétention du Rien.Auteur : Emil Cioran - Source : Précis de décomposition (1949), Adieu à la philosophie
- On ne pense pas sans mots, et cependant les mots trahissent la pensée. Toute expression verbale d'un fait concret devient de la métaphysique.Auteur : Remy de Gourmont - Source : Promenades philosophiques (1904-1928)
- Anna détestait les transports en commun. Elle considérait le métro comme la quintessence du malaise urbain. Un lieu de non-vie où s'expriment les facettes les plus sombres de l'être humain, de l'indifférence à la violence verbale ou physique. Anna avait toujours pensé que si Goethe avait été parisien, il aurait situé l'enfer de Dante sur la ligne Auteur : Nicolas Tackian - Source : Quelque part avant l'enfer
- C'était une véritable religion, le silence, chez cet homme. On appelle ça de la pudeur mais cela relève plutôt de la constipation verbale. Auteur : Virginie Despentes - Source : Vernon Subutex, Tome 3 (2017)
- Les incontinents qui se soulagent contre un mur sont sévèrement verbalisés mais on a décoré les grossiums qui ont introduit le porno sur les petits écrans.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Les affrontements, au sein de cette communauté, consistaient en des rituels dénués de violence physique. Il s'agissait de joutes verbales, de luttes dansées, de jeux d'adresse intellectuelle. Auteur : Léonora Miano - Source : La saison de l'ombre (2013)
- C'est la qualité de la communication verbale et non verbale qui nourrira l'amour, qui amplifiera les rêves et donnera aux désirs leur puissance et leur ampleur.Auteur : Jacques Salomé - Source : Eloge du couple (1998)
- A partir d'une certaine heure, la nuit, les paroles n'ont plus d'importance. Ce sont juste des choses vagues qui meublent le silence. Des cadavres de mots. Des estasses verbales.Auteur : Franz-Olivier Giesbert - Source : L'Immortel (2007)
- Le papier, la rédaction, le procès-verbal, est à la naissance de toute idée. Pas de papier, pas d'idée. Le verbe hisse l'idée comme l'humus hisse le petit pois. Un acte sans papier et c'est un petit pois de plus qui meurt dans le monde.Auteur : Frédérique Audouin-Rouzeau, dite Fred Vargas - Source : Pars vite et reviens tard (2001)
- L'auteur de lieux communs cède à la puissance des mots, au verbalisme, à l'emprise du langage, et le reste.Auteur : Jean Paulhan - Source : Les Fleurs de Tarbes ou La terreur dans les Lettres (1936-1941)
- Au zoo, le léopard longe son enclos et te contemple au travers de barreaux ou derrière un fossé infranchissable en méprisant ton infériorité, ton besoin d'installer entre lui et toi une barrière. En cet instant, chacun sait de quoi il retourne car, pour être non verbal, le message n'en est pas moins clair: le léopard est le prédateur et tu es la proie, et ton sentiment de supériorité et de sécurité, tu ne le dois, humain que tu es, qu'à cette barrière. Face à la cage du léopard, ce sentiment se teinte de honte, devant la puissance hautaine de l'animal, sa morgue, sa piètre estime de ta personne. Auteur : William Landay - Source : Défendre Jacob (2012)
- Dresser un procès-verbal fort circonstancié de tout ce que nous faisons.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Lucien Leuwen (1834-1835)
- Je suis excédé par ce travail de pion. Il exaspère en moi ce besoin de logique verbale à quoi mon esprit n'est déjà que trop enclin.Auteur : André Gide - Source : Journal 1889-1939, 22 décembre 1917
- Un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit.Auteur : Samuel Goldwyn - Source : Sans référence
- Aubergine : plante vénéneuse, agressive et verbalisante proliférant sur les trottoirs urbains.Auteur : Pierre Bordage - Source : Mort d'un clone (2012)
- Il n'y a pas que la violence physique qui pose problème. La violence verbale marque probablement encore davantage.Auteur : Josef Schovanec - Source : Je suis à l'Est (2012)
- La véritable et sincère amitié verbale profondément superficielle est celle sur laquelle on peut absolument compter quand on n'a strictement besoin de rien.Auteur : Pierre Dac - Source : Avec mes meilleures pensées (Anthologie de Jacques Pessis) (2010)
- Supposer aux autres verbalement et avec un air de confiance, les vertus dont on a besoin en eux, afin qu'ils se les donnent au moins en apparence et pour le moment.Auteur : Marie-Jean Hérault de Séchelles - Source : Théorie de l'ambition
- Si vous voulez, voici ce que je suis prêt d'admettre: je ne suis moi-même rien d'autre qu'un chercheur d'aventures verbales.Auteur : Vladimir Nabokov - Source : Le Don (1992)
- La qualité de l'expression verbale est d'être claire sans être banale.Auteur : Aristote - Source : Poétique
- Les blessures les plus graves sont celles qu'on ne verbalise jamais, celles qu'on garde inscrites au fond de son âme pendant toute son existence. Auteur : Nicolas Tackian - Source : Quelque part avant l'enfer
- Pour vivre avec un traumatisme, il faut l'affronter, le verbaliser, l'accepter.Auteur : Michel Bussi - Source : Maman a tort
- Les livres peuvent vous aider à mieux vous aimer, mais écrire ou exprimer verbalement vos sentiments, ou même simplement leur prêter une oreille attentive, constitue déjà un grand pas dans la bonne direction.Auteur : John Gray - Source : Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus (1992)
Les mots proches de « verbal »
Ver Véracité Véraison Verbal, ale Verbalement Verbalisateur Verbaliser Verbe Verbération Verbeux, euse Verbiage Verbiager Verbosité Verchère Ver-coquin Verdal Verdâtre Verdelet, ette Verderet Verderie Verderon Verdet Verdeur Verdi, ie Verdict Verdier Verdir Verdissage Verdissant, ante Verdissement Verdiste Verdoyant, ante Verdoyer Verdure Verdurier Véreux, euse Verge Vergé, ée Vergée Vergelet Vergenne Verger Vergeté, ée Vergeter Vergette Vergeture Verglacer Verglas Vergne VergogneLes mots débutant par ver Les mots débutant par ve
ver ver Ver Ver-lès-Chartres Ver-sur-Launette Ver-sur-Mer Vérac vérace véraces véracité véranda vérandas Véranne Vérargues Véraza verbal verbale verbalement verbales verbalisation verbalise verbalisé verbalisée verbaliser verbalisez verbalisme verbaliste verbatim verbaux verbe Verberie verbes verbeuse verbeuses verbeux verbiage Verbiesles verbosité verbosités Vercel-Villedieu-le-Camp Verchain-Maugré Verchaix Verchamp Vercheny Verchers-sur-Layon Verchin Verchocq Vercia Verclause Vercoiran
Les synonymes de « verbal»
Les synonymes de verbal :- 1. amende
2. contravention
3. réparation
4. sanction
5. peine
6. astreinte
7. réforme
8. infraction
9. entorse
10. constat
11. rapport
12. relation
13. rendu
- 1. oral
2. formel
3. parlé
synonymes de verbal
Fréquence et usage du mot verbal dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « verbal » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot verbal dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Verbal ?
Citations verbal Citation sur verbal Poèmes verbal Proverbes verbal Rime avec verbal Définition de verbal
Définition de verbal présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot verbal sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot verbal notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
