Définition de « aube »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot aube de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur aube pour aider à enrichir la compréhension du mot Aube et répondre à la question quelle est la définition de aube ?
Une définition simple : Département français (10)
Définitions de « aube »
Trésor de la Langue Française informatisé
AUBE1, subst. fém.
AUBE2, subst. fém.
AUBE3, subst. fém.
TECHNOL. ,,Planches fixées à la circonférence de la roue d'un moulin à eau, et sur lesquelles vient s'exercer immédiatement l'impulsion du fluide qui les chasse l'une après l'autre, ce qui produit la rotation de cette roue`` (Chesn. 1857). Roues à aubes. Cf. aubage :Wiktionnaire
Nom commun 3 - français
aube \ob\ féminin
-
Planche fixée à la circonférence d'une roue de moulin à eau ou d'un bateau à vapeur et sur laquelle s'exerce l'action du liquide.
- Les aubes d'un moulin.
- Roue à aubes.
- Un bateau à aubes.
- La courbe des aubes se raccorde tangentiellement avec la circonférence de la roue. ? (Jean-Victor Poncelet, Mémoire sur les roues hydrauliques à aubes courbes, mues par-dessous, 1827)
- Par analogie, pale, ailette d'un compresseur ou d'une turbine.
- Les aubes d'une turbine de turboréacteur d'avion sont soumises à de fortes sollicitations.
Nom commun 2 - français
aube \ob\ féminin
-
(Habillement) Vêtement religieux de toile blanche serré aux reins par un cordon.
- Une file de religieux en aube, le père prieur en tête, sortit de la sacristie et se dirigea vers la porte de l'église. ? (Joris-Karl Huysmans, L'Oblat)
- Dans le tohu-bohu de la sacristie m'échoyai l'honneur d'aider le prêtre à se vêtir des ornements. Je présentais l'amict, l'aube, l'étole. Je veillais à la pose de la chasuble. ? (Yanny Hureaux, Bille de chêne : Une enfance forestière, Jean-Claude Lattès, 1996)
Nom commun 1 - français
aube \ob\ féminin
-
Clarté qui blanchit l'orient au moment précédant le lever du soleil, ce moment lui-même.
- Au réveil, dans les premières blancheurs de l'aube apparaît un fleuve qui tourne sous ses fumées matinales [?] ? (Hippolyte Taine, Voyage en Italie, vol. 2, 1866)
- Dès l'aube, tout Tarascon était sur pied, encombrant le chemin d'Avignon. ? (Alphonse Daudet, Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon)
- Souvent, la nuit, par les beaux clairs de lune, il se levait et restait à l'affût jusqu'à l'aube. ? (Octave Mirbeau, Contes cruels : Mon oncle)
- Ils attendent l'aube stoïquement, devant un café-crème ou, favorisés par la chance, font parfois la rencontre d'un compatriote qui leur paie à souper. ? (Francis Carco, Images cachées, Éditions Albin Michel, Paris, 1928)
- Enfin, l'aube, une aube splendide, mauve comme en plein été, nous fouetta. La détente fut délicieuse. ? (Dieudonné Costes & Maurice Bellonte, Paris-New-York, 1930)
- Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter qu'il ne se passe rien. ? (Henri Alleg, La Question, 1957)
- Il est expédient de bifurquer à faux pour dérouter les pillards qui braconnent les tenderies dès l'aube, avant le propriétaire. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
-
(Figuré) Commencement, début.
- L'éducation moyenne atteignait un niveau extraordinaire, et, à l'aube du XXe siècle, on trouvait relativement peu de gens, dans l'Europe occidentale, qui ne sussent lire et écrire. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 407 de l'édition de 1921)
- D'ailleurs, à quelques signes, on pourrait croire que l'aube de la sincérité commence à poindre. ? (Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture)
- (Littérature) Poésie lyrique du Moyen Âge (« alba ») ayant pour thème la séparation au point du jour de deux êtres qui s'aiment.
Littré
-
1Premier blanchissement de l'horizon, au point du jour. L'aube du jour, l'aube matinale ou simplement l'aube.
Et du temple déjà l'aube blanchit le faîte
, Racine, Athal. I, 1.Terme de pêche. Sardines d'aube, sardines que l'on prend à la pêche du matin.
L'aube des mouches, l'heure de midi.
- 2 Terme de marine. Le temps qui s'écoule entre le souper de l'équipage et le moment où se prend le premier quart.
HISTORIQUE
XIe s. Par main [matin] en l'albe, si com li jurz esclaire
, Ch. de Rol. LII.
XIIe s. En mer se mettent quand l'aube est esclarée
, Ronc. p. 118. Peu ai-je eü, En la chambre [de ma dame], de joie?; Trop m'a neü [nui] L'aube qui me guerroie
, Romancero, p. 68. Si cume la clarted de l'albe est bele et clere, quant li soleilz lieved par matin
, Rois, 211.
XIIIe s. Devant l'aube aparant, ains qu'il fut ajourné
, Berte, X. Renart conmence à apeler [le loup], Qu'ileuques ne volt plus ester, Que jà estoit l'aube crevée
, Ren. 1175. Tu ies? Aube qui le jor nos amainne
, Rutebeuf, II, 13. Aussi comme l'aube du jour aparoit, nous nous atirames [préparâmes] de touz poins
, Joinville, 224.
XVe s. À l'aube du jour
, Froissart, I, I, 150.
XVIe s. Dès l'aube du jour
, Amyot, Comment refrén. la colère, 41. Au tiers jour, à l'aube des mouches, nous apparut une isle triangulaire
, Rabelais, Pant. IV, 9.
Encyclopédie, 1re édition
AUBE, s. f. vétement de lin ou de toile blanche qui descend jusqu'aux talons, & que le prêtre porte à l'autel par-dessus ses habits ordinaires & sous sa chasuble ; le diacre, soûdiacre & les induts, sont aussi en aube sous leurs dalmatiques.
Autrefois les ecclésiastiques portoient des aubes ou tuniques blanches au lieu de surplis. Voyez Surplis. On croit que dans la primitive Eglise, c'étoit leur vêtement ordinaire. Depuis on voit qu'il étoit ordonné aux clercs de la porter pendant le Service divin seulement. Concile de Narbon. can. 12.
Dans les statuts de Riculphe, évêque de Soissons, donnés en 889, il défend aux clercs de se servir dans les sacrés mysteres, de l'aube qu'ils portent ordinairement ; ce qui prouve que jusques-là les ecclésiastiques portoient toûjours une aube sur leur tunique pour marque de leur état ; c'est pourquoi il en falloit une particuliere pour l'autel, afin qu'elle fût plus propre. Fleury, Hist. eccles. tom. XI. (G)
Aube, en Marine, c'est l'intervalle du tems qui s'écoule depuis le souper de l'équipage jusqu'à ce qu'on prenne le premier quart. Voyez Quart. (Z)
Aube, s. f. (Hydraul.) les aubes sont par rapport aux moulins à eau, & aux roues que l'eau fait mouvoir, ce que sont les aîles des moulins à vent ; ce sont des planches fixées à la circonférence de la roue, & sur lesquelles s'exerce immédiatement l'impulsion du fluide, qui les chasse les unes après les autres, ce qui fait tourner la roue. Voyez Palette. (O)
* Si l'on considere que la vîtesse de l'eau n'est pas la même à différentes profondeurs, & plusieurs autres circonstances, on conjecturera que le nombre & la disposition les plus favorables des aubes sur une roue, ne sont pas faciles à déterminer. 1°. Le nombre des aubes n'est pas arbitraire : quand une aube est entierement plongée dans l'eau, & qu'elle a la position la plus avantageuse pour être bien frappée, qui est naturellement la perpendiculaire au fil de l'eau, il faut que l'aube qui la suit & qui vient prendre sa place, ne fasse alors qu'arriver à la surface de l'eau, & la toucher ; car pour peu qu'elle y plongeât, elle déroberoit à la premiere aube une quantité d'eau proportionnée, qui n'y feroit plus d'impression ; & quoique cette quantité d'eau fît impression sur la seconde aube, celle qui seroit perdue pour la premiere ne seroit pas remplacée par-là ; car l'impression sur la premiere eût été faite sous l'angle le plus favorable, & l'autre ne peut l'être que sous un angle qui le soit beaucoup moins. On doit donc faire en sorte qu'une aube étant entierement plongée dans l'eau, elle ne soit nullement couverte par la suivante ; & il est visible que cela demande qu'elles ayent entr'elles un certain intervalle ; & comme il sera le même pour les autres, il en déterminera le nombre total.
Les aubes attachées chacune par son milieu à un rayon d'une roue qui tourne, ont deux dimensions, l'une parallele, l'autre perpendiculaire à ce rayon ; c'est la parallele que j'appellerai leur hauteur ; si la hauteur est égale au rayon de la roue, une aube ne peut donc plonger entierement, que le centre de la roue, ou de l'arbre qui la porte, ne soit à la surface de l'eau ; & il est nécessaire qu'une aube étant plongée perpendiculairement au courant, la suivante, qui ne doit nullement la couvrir, soit entierement couchée sur la surface de l'eau, & par conséquent fasse avec la premiere un angle de 90 degrés ; ce qui emporte qu'il ne peut y avoir que quatre aubes : d'où l'on voit que le nombre des aubes sera d'autant plus grand que leur largeur sera moindre. Voici une petite table calculée par M. Pitot, du nombre & de la largeur des aubes.
Nombre des aubes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Largeur des aubes, le rayon étant de 1000, 1000, 691, 500, 377, 293, 234, 191, 159, 134, 114, 99, 86, 76, 67, 61, 54, 49.
2°. Il faut distinguer deux sortes d'aubes : celles qui sont sur les rayons de la roue, & dont par conséquent elles suivent la direction selon leur largeur ; celles qui sont sur des tangentes tirées à différens points de la circonférence de l'arbre qui porte la roue, ce qui ne change rien au nombre : les premieres s'appellent aubes en rayons ; les secondes, aubes en tangentes.
L'aube en rayon & l'aube en tangente entrent dans l'eau & en sortent en même tems, & elles y décrivent par leur extrémité un arc circulaire, dont le point de milieu est la plus grande profondeur de l'eau à laquelle l'aube s'enfonce. On peut prendre cette profondeur égale à la largeur des aubes. Si on conçoit que l'aube en rayon arrive à la surface de l'eau, & par conséquent y est aussi inclinée qu'elle puisse, l'aube en tangente qui y arrive aussi, y est nécessairement encore plus inclinée ; & de-là vient que quand l'aube en rayon est parvenue à être perpendiculaire à l'eau, l'aube en tangente y est encore inclinée, & par conséquent en reçoit à cet égard, & en a toûjours jusque-là moins reçû d'impression. Il est vrai que cette plus grande partie de l'aube en tangente a été plongée ; ce qui sembleroit pouvoir faire une compensation : mais on trouve au contraire que cette plus grande partie plongée reçoit d'autant moins d'impression de l'eau, qu'elle est plus grande par rapport à la partie plus petite de l'aube en rayon plongée aussi ; & cela à cause de la différence des angles d'incidence. Jusques-là l'avantage est pour l'aube en rayon.
Ensuite l'aube en tangente parvient à être perpendiculaire à l'eau : mais ce n'est qu'après l'aube en rayon ; le point du milieu de l'arc circulaire qu'elles décrivent est passé ; l'aube en rayon aura été entierement plongée, & l'aube en tangente ne le peut plus être qu'en partie ; ce qui lui donne du desavantage encore, dans ce cas même qui lui est le plus favorable. Ainsi l'aube en rayon est toûjours préférable à l'aube en tangente.
3°. On a pensé à donner aux aubes la disposition des ailes à moulin à vent, & l'on a dit : ce que l'air fait, l'eau peut le faire ; au lieu que dans la disposition ordinaire des aubes, elles sont attachées à un arbre perpendiculaire au fil de l'eau, ici elles le sont à un arbre parallele à ce fil. L'impression de l'eau sur les aubes disposées à l'ordinaire, est inégale d'un instant à l'autre : sa plus grande force est dans le moment où une aube étant perpendiculaire au courant, & entierement plongée, la suivante va entrer dans l'eau, & la précédente en sort. Le cas opposé est celui où deux aubes sont en même tems également plongées. Depuis l'instant du premier cas, jusqu'à l'instant du second, la force de l'impression diminue toûjours ; & il est clair que cela vient originairement de ce qu'une aube pendant tout son mouvement y est toûjours inégalement plongée. Mais cet inconvénient cesseroit à l'égard des aubes mises en ailes de moulin à vent ; celles-ci étant tout entieres dans l'air, les autres seroient toûjours entierement dans l'eau. Mais on voit que l'impression doit être ici décomposée en deux forces ; l'une parallele, & l'autre perpendiculaire au fil de l'eau ; & qu'il n'y a que la perpendiculaire qui serve à faire tourner. Cette force étant appliquée à une aube nouvelle, qu'on auroit faite égale en eût face à une autre posée selon l'ancienne maniere, il s'est trouvé que l'aube nouvelle qui reçoit une impression constante, en eût reçû une un peu moindre que n'auroit fait l'aube ancienne dans le même cas.
D'ailleurs, quand on dit que la plus grande vîtesse que puisse prendre une aube ou aile mûe par un fluide, est le tiers de la vîtesse de ce fluide, il faut entendre que cette vîtesse réduite au tiers est uniquement celle du centre d'impulsion, ou d'un point de la surface de l'aube où l'on conçoit que se réunit toute l'impression faite sur elle. Si le courant fait trois piés en une seconde, ce centre d'impulsion fera un pié en une seconde ; & comme il est nécessairement placé sur le rayon de la roue, il y aura un point de ce rayon qui aura cette vîtesse d'un pié en une seconde. Si ce point étoit l'extrémité du rayon qui seroit, par exemple, de dix piés, auquel cas il seroit au point d'une circonférence de soixante piés, il ne pourroit parcourir que soixante piés, ou la roue qui porte les aubes ne pourroit faire un tour qu'en soixante secondes, ou en une minute. Mais si ce même centre d'impression étoit posé sur son rayon à un pié de distance du centre de la roue & de l'arbre, il parcourroit une circonférence de six piés, ou feroit un tour en six secondes ; & par conséquent la circonférence de la roue feroit aussi son tour dans le même tems, & auroit une vîtesse dix fois plus grande que dans le premier cas : donc moins le centre d'impression est éloigné du centre de la roue, plus la roue tourne vîte. Quand une surface parallélogrammatique mûe par un fluide tourne autour d'un axe immobile auquel elle est suspendue, son centre d'impression est, à compter depuis l'axe, aux deux tiers de la ligne qui la divise en deux selon sa hauteur. Si la roue a dix piés de rayon, l'aube nouvelle qui est entierement plongée dans l'eau, & dont la largeur ou hauteur est égale au rayon, a donc son centre d'impression environ à six piés du centre de la roue. Il s'en faut beaucoup que la largeur ou hauteur des aubes anciennes ne soit égale au rayon, & par conséquent leur centre d'impression est toûjours plus éloigné du centre de la roue ; & cette roue ne peut tourner que plus lentement. Mais cet avantage est détruit par une compensation presqu'égale : dans le mouvement circulaire de l'aube, le point immobile ou point d'appui est le centre de la roue ; & plus le centre d'impression auquel toute la force est appliquée est éloigné de ce point d'appui, plus la force agit avantageusement, parce qu'elle agit par un long bras de levier. Ainsi quand une moindre distance du centre d'impression au centre de la roue fait tourner la roue plus vîte, & fait gagner du tems, elle fait perdre du côté de la force appliquée moins avantageusement, & cela en même raison : d'où il s'ensuit que la position du centre d'impression est indifférente. La proposition énoncée en général eût été fort étrange ; & on peut apprendre par beaucoup d'exemples à ne pas rejetter les paradoxes sur leur premiere apparence. Si l'on n'a pas songé à donner aux ailes de moulin à vent la disposition des aubes, comme on a songé à donner aux aubes la disposition des ailes de moulin, c'est que les ailes de moulin étant entierement plongées dans le fluide, son impression tendroit à renverser la machine, en agissant également sur toutes ses parties en même tems, & non à produire un mouvement circulaire dans quelques-unes. Voyez l'Histoire de l'Académ. & les Mém. ann. 1729. pag. 81. 253. 365. ann. 1725. p. 80. & suiv.
Au reste, le problème pour la solution duquel on vient de donner d'après M. Pitot quelques principes, demanderoit une physique très-exacte, & une très subtile géométrie, pour être résolu avec précision.
En premier lieu, l'effort du fluide contre chaque point de l'aîle dépend de deux choses ; de la force d'impulsion du fluide, & du bras de levier par lequel cette force agit : ces deux choses varient à chaque point de l'aîle. Le bras de levier est d'autant plus grand, que le point de l'aîle est plus éloigné du centre de rotation ; & à l'égard de la force d'impulsion, elle dépend de la vîtesse respective du fluide par rapport au point de l'aile ; or cette vîtesse respective est différente à chaque point : car en supposant même que la vîtesse absolue du fluide soit égale à tous les points de l'aîle, la vîtesse des points de l'aîle est plus grande ou plus petite, selon qu'ils sont plus loin ou plus près du centre de rotation. Il faut donc prendre l'impulsion du fluide sur chaque point de l'aîle (ce qui demande encore quelqu'attention pour ne point se tromper) & multiplier par cette impulsion le bras de levier, ensuite intégrer. Dans cette intégration même il y a des cas singuliers où l'on doit prendre des précautions que la Géométrie seule ne suffit pas pour indiquer. V. le traite des Fluides, Paris 1744, art. 367.
En second lieu, quand on a trouvé ainsi l'effort du fluide contre l'aube, il ne faut pas croire que la Physique ne doive altérer beaucoup ce calcul : 1°. les lois véritables de l'impulsion des fluides sont encore très-peu connues : 2°. quand une aîle est suivie d'une autre, le fluide qui est entre deux n'agit pas librement sur celle des deux qui précede, parce qu'il est arrêté par son impulsion même sur la suivante. Toutes ces circonstances dérangent tellement ce calcul, d'ailleurs très-épineux sans cela même, que je crois qu'il n'y a que l'expérience seule qui soit capable de résoudre exactement le probleme dont il s'agit.
Une des conditions que doit avoir une roue chargée d'aubes, c'est de tourner toujours uniformément ; & pour cela, il faut qu'elle soit telle que dans quelque situation que ce soit de la roue, l'effort du fluide contre toutes les aubes ou parties d'aubes actuellement enfoncées soit nul, c'est-à-dire, que la somme des efforts positifs pour accélérer la roue, soit égale à la somme des efforts négatifs pour la retarder. Ainsi le probleme qu'il faudroit d'abord résoudre, ce seroit de savoir quel nombre d'aubes il faut donner, pour que dans quelque situation que ce soit de la roue, l'effort du fluide soit nui. Il y ici deux inconnues, la vîtesse de la roue, & le nombre d'aubes ; & la condition de la nullité de l'effort devroit donner une équation entre la vîtesse de la roue & le nombre des aubes, quelle que fût la situation de la roue : c'est un problème qui paroît digne d'exercer les Géometres. On pourroit ensuite tracer une courbe, dont les abscisses exprimeroient le nombre des roues, & les ordonnées la vitesse ; & la plus grande ordonnée de cette courbe donneroit la solution du probleme. Je ne donne ici pour cela que des vûes fort générales, & assez vagues : mais quand la solution de ce probleme seroit possible mathématiquement, ce que je n'ai pas suffisamment examiné, je ne doute pas que les considérations physiques ne l'altérassent beaucoup, & peut-être même ne la rendissent tout-à-fait inutile. (O)
* Aube, (Géog.) riviere de France qui a sa source à l'extrémité méridionale du bois d'Auberive, traverse une partie de la Champagne, & se jette dans la Seine.
Étymologie de « aube »
Provenç. et espagn. alba?; portug. alva?; ital. alba?; de albus, blanc (voy. ALBUM).
- (Nom 1) (1080) Du latin alba « de couleur blanche », l'aube étant le moment où le ciel blanchit. ? voir albus
- (Nom 2) (fin XIe siècle) Du latin alba, « tunique blanche ».
- (Nom 3) (1283) « Planchette reliant les arçons de la selle ». Ancien français alve (1080), puis auve, issu du latin al?pa « soufflet, claque, gifle », primitivement « paume de la main ». La forme aube paraît être due à une confusion avec les précédents. À rapprocher du vieux catalan àlep, roumain arip?, calabrais álipa et ligurien d'Oneglia oarva « volet, battant »[1].
Aube au Scrabble
Le mot aube vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot aube - 4 lettres, 3 voyelles, 1 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot aube au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
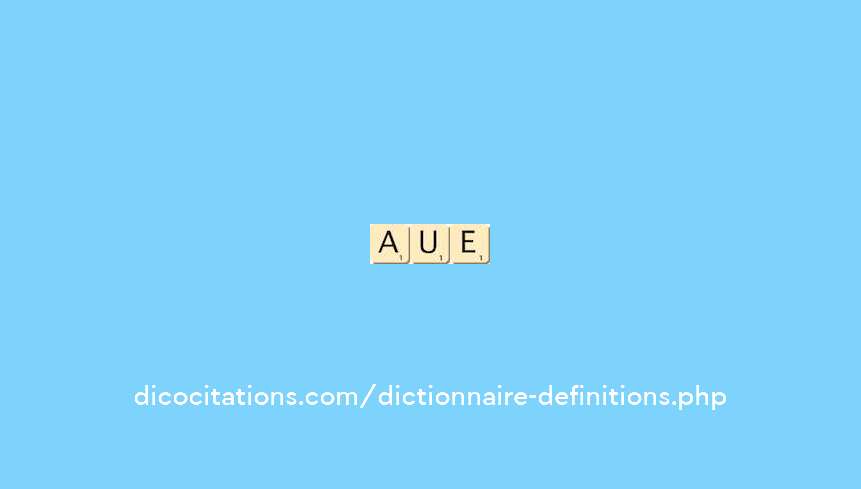
Les rimes de « aube »
On recherche une rime en OB .
Les rimes de aube peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Ob
Rimes de snobs Rimes de aube Rimes de snobs Rimes de xénophobes Rimes de probes Rimes de daubes Rimes de agoraphobe Rimes de xénophobe Rimes de scrub Rimes de poisson-globe Rimes de robes Rimes de microbes Rimes de xénophobes Rimes de lob Rimes de claustrophobe Rimes de agoraphobes Rimes de lobe Rimes de snobent Rimes de englobent Rimes de aube Rimes de globes Rimes de job Rimes de jacob Rimes de gobes Rimes de gobent Rimes de agoraphobe Rimes de claustrophobe Rimes de taube Rimes de xénophobe Rimes de bobs Rimes de globe Rimes de snob Rimes de homophobes Rimes de jobs Rimes de aubes Rimes de zobs Rimes de dérobent Rimes de microbe Rimes de snob Rimes de Lobbes Rimes de lobes Rimes de snobe Rimes de Aube Rimes de homophobe Rimes de lobs Rimes de adobe Rimes de anglophobes Rimes de dérobe Rimes de hydrophobe Rimes de englobeMots du jour
snobs aube snobs xénophobes probes daubes agoraphobe xénophobe scrub poisson-globe robes microbes xénophobes lob claustrophobe agoraphobes lobe snobent englobent aube globes job jacob gobes gobent agoraphobe claustrophobe taube xénophobe bobs globe snob homophobes jobs aubes zobs dérobent microbe snob Lobbes lobes snobe Aube homophobe lobs adobe anglophobes dérobe hydrophobe englobe
Les citations sur « aube »
- Ponctuation: les points d'exclamation de la pluie, la virgule des herbes, les points de suspension du brouillard, la parenthèse de midi, le point final du soir, l'alinéa de l'aube.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Chaque fois que l'aube paraît, le mystère est là tout entier.Auteur : René Daumal - Source : Poésie noire et poésie blanche (1954)
- J'ai faim de tes cheveux, de ta voix, de ta bouche, sans manger je vais par les rues, et je me tais, sans le soutien du pain, et dès l'aube hors de moi je cherche dans le jour le bruit d'eau de tes pas.Auteur : Pablo Neruda - Source : La Centaine d'amour (1995)
- Tu es ma joie et mon soleil.
Ma nuit, mes jours, mes aubes claires.
Tu es partout car tu es dans mon coeur.
Tu es partout car tu es mon bonheur.Auteur : Édith Piaf - Source : Tu es partout (1943) - Où saint Arnould va, saint Aubert ne va pas.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours.Auteur : Romain Gary - Source : La Promesse de l'aube (1960)
- A chaque auberge me saluait une faim, devant chaque source m'attendait une soif - une soif devant chacune, particulière.Auteur : André Gide - Source : Les Nourritures terrestres (1897), I, 3
- L'aube, prémisse d'un jour éclatant et béni des dieux, ne dispensera jamais de la recherche à l'aveuglette des pantoufles sous le lit.Auteur : Denis Langlois - Source : Le Hasard sonne toujours une fois (2006)
- Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, et j'ai prié jusqu'à l'aube. C'était comme un grand murmure de l'âme. Cela me faisait penser à l'immense rumeur des feuillages qui précède le lever du jour. Quel jour va se lever en moi? Dieu me fait-il grâce?Auteur : Georges Bernanos - Source : Journal d'un curé de campagne (1936)
- L'on sait, depuis Flaubert et Bloy, qu'il n'est idée ni phrase «reçue» où la bêtise ne coudoie la méchanceté.Auteur : Jean Paulhan - Source : Les Fleurs de Tarbes ou La terreur dans les Lettres (1936-1941)
- II y aura toujours un couple frémissant
Pour qui ce matin-là sera l'aube première
II y aura toujours l'eau le vent la lumière
Rien ne passe après tout si ce n'est le passant.Auteur : Louis Aragon - Source : Les Yeux et la Mémoire - Lire et réfléchir sur ce qu'il avait lu lui avait toujours plu ; c'est pourquoi les deux pièces étaient pleines à craquer de livres. Il était capable d'en attaquer un le soir et de le finir à l'aube, sans interruption. Et heureusement, il n'y avait pas de danger qu'on vienne l'appeler dans la nuit pour un crime de sang. Va savoir pourquoi, les meurtres, les fusillades, les bagarres violentes survenaient toujours dans la journée. Auteur : Andrea Camilleri - Source : La première enquête de Montalbano (2004)
- Le point-virgule s'est imposé, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'idée du flux de conscience, de l'instabilité mentale, de la saisie qui ne raconte pas. Ce n'est pas le point-virgule de Flaubert.Auteur : Patrick Chamoiseau - Source : L'Empreinte à Crusoé (2012)
- Comme il est avéré depuis l'aube de l'humanité, rare est l'homme fort suffisamment fort pour ignorer les larmes d'une femme ...Auteur : Tom Wolfe - Source : Bloody Miami
- Le slogan de Flaubert: j'apelle bourgeois quiconque pense bassement.Auteur : André Gide - Source : Journal, 22 août 1937
- Si Flaubert avait écrit Madame Bovary cette année, l'ultime chapitre décrirait sans doute Charles, veuf inconsolable, réécoutant inlassablement le dernier message enregistré par Emma sur le répondeur de son portable.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Ce serait peut-être une définition de l'amour, celle de Flaubert: la curiosité. Être soudain, tellement curieux de quelqu'un, fou curieux. Connaître l'autre, co-naître, naître au monde avec lui, tel est l'unique projet. La phrase la plus éloignée de l'amour, ce ne serait pas je te hais, mais je ne veux pas te savoir.Auteur : Camille Laurens - Source : L'Amour, roman (2004)
- Jeunes amours, si vite épanouies,
Vous êtes l'aube et le matin du coeur.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Contemplations (1856) - A l'aube, il s'endormit, le menton baissé sur la poitrine comme un pantin disloqué, les traits tirés, vieilli soudain, quitté par l'énergique frénésie qui l'agitait dans la journée et la soirée. Je lus sur son visage las que ne parcourait aucun frémissement, l'essentielle qualité qui le distinguait des autres hommes : il était bon. Mieux encore, c'était un juste, perdu sur la terre où il ne rencontrait que de rares semblables. Et, miracle, cette bonté n'avait jamais altéré l'acuité de son regard, la lucidité de son intelligence. Auteur : Michel Déon - Source : Un taxi mauve (1973)
- La grand-mère lui avait toujours dit que le bonheur était comme la promesse de l'aube, si l'on s'en tient à la promesse sans s'obstiner à vouloir deviner ce qu'on aurait envie qu'elle révèle à l'avance. Auteur : Franck Bouysse - Source : Grossir le Ciel (2014)
- Les États-Unis ressemblent à une auberge espagnole. […] Rien n’est, en effet, plus facile que de découvrir tout et son contraire, les attitudes les plus libérales et les plus conservatrices, les valeurs profondes de la démocratie et la persécution des minorités, la richesse acquise par le mérite et par le travail en même temps que la pauvreté la plus insupportable. Auteur : André Kaspi - Source : Comprendre les États-Unis aujourd’hui, André Kaspi, éd. Perrin, 2008
- Je me souviens d'une autre année
C'était l'aube d'un jour d'avril
J'ai chanté ma joie bien-aimée
Chanté l'amour à voix virile
Au moment d'amour de l'année.Auteur : Guillaume Apollinaire - Source : Alcools (1913), la Chanson du Mal-Aimé - Mais le chagrin est revenu avec l'aube du matin,
Et la voix dans mon oreille rêveuse s'est évanouie.Auteur : Thomas Campbell - Source : The Soldier's Dream - L'incorruptible adhérence de ceux qui se sont aimés dès l'aube de la vie.Auteur : Victor Hugo - Source : L'Homme qui rit (1869)
- Maille à maille se fait l'haubergeon.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
Les mots proches de « aube »
Aubade Aubain Aubaine Aube Aube Aube Aubépine Auberge Aubergine Aubier Aubifoin Aubin Aubour Aubron Auburnien, ienneLes mots débutant par Aub Les mots débutant par Au
aubade aubadent Aubagnan Aubagne Aubagne Aubagne aubain aubaine Aubaine aubaines Aubais Aubange Aubarède Aubas Aubazat Aubazines aube aube Aube Aube Aube Aubechies Aubéguimont Aubel Aubenas Aubenas-les-Alpes Aubenasson Aubencheul-au-Bac Aubencheul-aux-Bois Aubenton Aubepierre-Ozouer-le-Repos Aubepierre-sur-Aube Aubépin aubépine aubépines Auberchicourt Aubercourt aubère aubère aubères auberge Aubergenville auberges aubergine aubergine aubergines aubergiste aubergistes Aubérive Auberive
Les synonymes de « aube»
Les synonymes de Aube :- 1. ailette
2. lame
3. aurore
4. potron
synonymes de Aube
Fréquence et usage du mot Aube dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « aube » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot Aube dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Aube ?
Citations aube Citation sur aube Poèmes aube Proverbes aube Rime avec Aube Définition de Aube
Définition de Aube présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot Aube sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot Aube notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 4 lettres.
