Définition de « harpe »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot harpe de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur harpe pour aider à enrichir la compréhension du mot Harpe et répondre à la question quelle est la définition de harpe ?
Une définition simple : (fr-rég|a?p) harpe (f)
Expression : (fig) (popu) Il est parent du roi David, et joue de la harpe, se dit d’un filou, par un jeu de mots entre harpe et harper. : Quauraient fait de plus des filous ? Tu sais donc jouer de la harpe ? — (J. Moreau, Suite du Virgile travesti, XII.)
Définitions de « harpe »
Trésor de la Langue Française informatisé
HARPE1, subst. fém.
HARPE2, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
harpe \Prononciation ?\ féminin
-
(Musique) Harpe.
-
que hum fait en harpe e en rote ? (Lais, Marie de France, f. 125r, 2e colonne de ce manuscrit de 1275-1300)
-
que hum fait en harpe e en rote ? (Lais, Marie de France, f. 125r, 2e colonne de ce manuscrit de 1275-1300)
Nom commun - français
harpe (h aspiré)\a?p\ féminin
-
(Musique) Cordophone à cordes pincées, que l'on tient debout, reposant par terre, garni de cordes verticales de longueur décroissante, que l'on pince avec les doigts.
- Jouer de la harpe.
- Pincer de la harpe.
- Joueur de harpe.
- Accompagnement de harpe.
- Clef de harpe.
- Les pédales d'une harpe.
- Au son de la harpe.
- Un autre instrument pincé, qui, depuis cinq à six ans est fort fêté à Paris, c'est la harpe, surtout telle qu'elle est travaillée à présent, c'est-à-dire avec des pédales qui la rendent chromatique. ? (Dictionnaire des arts et métiers Luthier, 1767)
- En ces derniers temps, surtout pendant notre séjour à Pau, mon maître m'avait fait travailler la harpe, et je commençais à ne pas trop mal jouer quelques morceaux qu'il m'avait appris. Il y avait entre autres une canzonetta napolitaine que je chantais en m'accompagnant de la harpe et qui me valait toujours des applaudissements. ? (Hector Malot, Sans famille, Dentu E., 1887, pages 1-347)
- Quant à la harpe, l'instrument qui a le plus de cordes à son arc, c'est une grande coquette hypocrite qui, sous des dehors édifiants sert surtout à faire valoir la main, le bras, la taille, le cou, la jambe, le pied, voire le soulier. ? (Conférence sur les instruments de musique, Le Cri catalan (Perpignan) du 15 juillet 1911, p.1)
- Chez les anciens Juifs, instrument de musique triangulaire et portatif avec des cordes graduellement décroissantes.
- Toutes les fois que l'esprit malin envoyé du Seigneur se saisissait de Saül, David prenait sa harpe et en jouait ; et Saül en était soulagé. ? (Louis-Isaac Lemaistre de Sacy, Bible, Rois, I, XVI, 23)
- Ainsi nous, quand nous donnons une harpe à David, ce n'est que par conjecture ; ils [les Juifs] avaient des instruments à huit et à dix cordes. ? (Fleury, M?urs des Israél., tit. XV, 2e par. page 193, dans Pougens)
- Nous avons laissé nos harpes près des fleuves de Babylone, jouet des tyrans, mépris des gentils. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
-
(Figuré) La poésie religieuse, sans doute par allusion à la harpe de David et à ses psaumes.
-
Ah ! Si jamais ton luth [de Byron], amolli par les pleurs,
Soupirait sous tes doigts l'hymne de tes douleurs?
Jamais, jamais l'écho de la céleste voûte,
Jamais ces harpes d'or que Dieu lui-même écoute,
Jamais des séraphins les ch?urs mélodieux
De plus divins accords n'auraient ravi les cieux. ? (Alphonse de Lamartine, Méd., I, 2) - Ma harpe fut souvent de larmes arrosée. ? (Alphonse de Lamartine, ib. II, 5)
-
Ah ! Si jamais ton luth [de Byron], amolli par les pleurs,
- Se dit quelquefois de la poésie en général, comme tout autre instrument de musique.
-
Tremble, mol et faible la harpe,
Crains l'avenir où je t'attends ;
Mon âpre luth vaincra ta harpe,
Mes vers durs dureront longtemps. ? (Lebrun, Épigr. C'est Lemierre, poète fort dur, qui est censé parler)
-
Tremble, mol et faible la harpe,
- (Zoologie) Nom vulgaire d'un poisson, la triple lyre de Linné (océan Atlantique, Méditerranée).
- Coquille univalve.
- (Architecture) Appareillage d'un mur servant au raccord entre des constructions par la disposition de pierres superposées alternativement posées en saillies et en creux destinées à permettre ultérieurement de prolonger solidement la statique d'une muraille à construire. (Note : on parle alors d'une harpe d'attente) ; (Note : On dit aussi un arrachement).
- (Maçonnerie) Structure d'un angle de mur ou les éléments qui le constituent (pierres, brique, etc.) sont maçonnés en alternance de manière à rendre l'ensemble plus solide.
- Griffe d'un chien (vénerie).
-
(Héraldique) Meuble représentant l'instrument de musique du même nom dans les armoiries. À rapprocher de claricorde, guitare, luth, lyre, vièle et violon.
 Armoiries avec une harpe (sens héraldique)
Armoiries avec une harpe (sens héraldique)- D'azur à la harpe d'or, au chef d'argent chargé de trois grappes de raisin de gueules, qui est de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes du Vaucluse ? voir illustration « armoiries avec une harpe »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Instrument de musique garni de cordes verticales, de grandeur graduellement décroissante, que l'on pince avec les deux mains. Jouer de la harpe. Pincer de la harpe. Joueur de harpe. Accompagnement de harpe. Clef de harpe. Les pédales d'une harpe. Au son de la harpe. On représente souvent David jouant de la harpe. Harpe éolienne. Voyez ÉOLIEN.
Littré
-
1Chez les anciens Juifs, instrument de musique triangulaire et portatif avec des cordes graduellement décroissantes.
Toutes les fois que l'esprit malin envoyé du Seigneur se saisissait de Saül, David prenait sa harpe et en jouait?; et Saül en était soulagé
, Sacy, Bible, Rois, I, XVI, 23.Ainsi nous, quand nous donnons une harpe à David, ce n'est que par conjecture?; ils [les Juifs] avaient des instruments à huit et à dix cordes
, Fleury, M?urs des Israél. tit. XV, 2e par. p. 193, dans POUGENS.Fig. et populairement. Il est parent du roi David, et joue de la harpe, se dit d'un filou, par un jeu de mots entre harpe et harper 2.
Qu'auraient fait de plus des filous?? Tu sais donc jouer de la harpe??
J. Moreau, Suite du Virgile travesti, XI. -
2Chez les modernes, instrument de musique de forme semblable à la harpe juive, mais aussi haut que l'homme, et qui a une quarantaine de cordes. Jouer, pincer de la harpe.
Un autre instrument pincé, qui, depuis cinq à six ans est fort fêté à Paris, c'est la harpe, surtout telle qu'elle est travaillée à présent, c'est-à-dire avec des pédales qui la rendent chromatique,
Dict. des arts et mét. Luthier (1767) -
3Harpe éolienne, instrument à cordes monté de manière à rendre des sons quand le vent vient à le frapper.
Corinne lui dit que c'étaient des harpes éoliennes que le vent faisait résonner et qu'elle avait placées dans quelques grottes du jardin, pour remplir l'atmosphère de sons aussi bien que de parfums
, Staël, Corinne, VIII, 4. -
4 Fig. La poésie religieuse, sans doute par allusion à la harpe de David et à ses psaumes.
Ah?! si jamais ton luth [de Byron], amolli par les pleurs, Soupirait sous tes doigts l'hymne de tes douleurs?, Jamais, jamais l'écho de la céleste voûte, Jamais ces harpes d'or que Dieu lui-même écoute, Jamais des séraphins les ch?urs mélodieux De plus divins accords n'auraient ravi les cieux
, Lamartine, Méd. I, 2.Ma harpe fut souvent de larmes arrosée
, Lamartine, ib. II, 5.Harpe se dit quelquefois de la poésie en général, comme tout autre instrument de musique.
Tremble, mol et faible la Harpe, Crains l'avenir où je t'attends?; Mon âpre luth vaincra ta harpe, Mes vers durs dureront longtemps,
Lebrun, Épigr. (C'est Lemierre, poëte fort dur, qui est censé parler). -
5Nom vulgaire d'un poisson, la triple lyre de Linné (océan Atlantique, Méditerranée).
Coquille univalve.
HISTORIQUE
XIIe s. Regehissez [confessez] al segnur en harpe, en saltier de dis cordes, cantez à lui
, Liber psalm. p. 39.
XIIIe s. Plus lor plaist [la nouvelle] à ouïr que harpe ne vielle
, Audefroi le Bastard, Romancero, p. 17.
XVe s. C'estoit [certains conseils] la chançon et la herpe Dont la saincte femme le berse
, Deschamps, Miroir de mariage, p. 121.
XVIe s. David d'une harpe on decore
, Marot, J. V, 300. Aux saules verts nos harpes nous pendismes
, Marot, IV, 334.
Encyclopédie, 1re édition
HARPE, s. f. (Hist. anc. & Lutherie.) instrument de Musique. Son origine est fort ancienne ; David en joüoit pour chanter les loüanges du Seigneur, & les sons mélodieux qu'il en tiroit empêchoient Saül d'être tourmenté du démon. La harpe du prophete-roi n'étoit pas celle d'aujourd'hui ; il n'auroit pû danser devant l'arche en joüant de cet instrument. On ignore & quelle étoit la harpe de David, & quel est l'inventeur de la nôtre. Les noms des inventeurs des choses utiles ou agréables sont presque tous ensevelis dans les ténebres des tems, moins parce que les écrits de ceux qui ont voulu conserver ces noms à la postérité sont perdus, que parce que la plûpart de nos inventions sont l'ouvrage, non d'un homme, mais des hommes. En effet, il est assez naturel de penser que ceux qui sont venus après, pressés par les mêmes besoins & excités par les mêmes passions, n'auront pas manqué de perfectionner ce qui n'étoit d'abord qu'imparfaitement ébauché, & qui ne méritoit pas encore auparavant le nom d'invention.
Il y a apparence que la harpe a pris naissance, de même que tous les instrumens de Musique, dans des tems d'abondance & de joie, ou qu'elle est le fruit des recherches de quelque spéculatif amateur de Musique.
Cet instrument (Pl. de Luth.) est composé de trois parties principales ; 1°. d'une caisse A, faite de bois leger & sonore ; 2°. d'un montant B, solide quand la harpe est simple, mais creux quand la harpe est organisée ; 3°. d'une bande C à chevilles pour attacher les cordes qui tiennent par l'autre extrémité, à la table ou partie supérieure de la caisse sonore. Cette bande contient encore des crochets d, qui peuvent avancer & reculer, pour faire les dièses. On étoit obligé, pour faire ces tons sur la harpe, d'appuyer sur un de ces crochets avec la main gauche, jusqu'à ce qu'il touchât la corde ; ce qui la raccourcissoit de la seizieme partie de sa longueur, & faisoit monter le son d'un semi-ton : mais c'étoit-là un inconvénient. Pour le faire sentir, les lecteurs doivent savoir qu'on fait vibrer les cordes de cet instrument, en les pinçant avec les doigts ; la main droite exécute ordinairement le dessus, & la gauche accompagne : ainsi aux endroits où il y a des dièses on étoit obligé de laisser aller le dessus seul, puisque la main qui devoit l'accompagner se portoit aux crochets. On a remédié à cette imperfection, en ajoûtant des pédales à cet instrument ; & on dit alors qu'il est organisé. Nous allons exposer l'art avec lequel ces pédales sont faites ; ensuite nous expliquerons leur méchanisme : afin de ne pas embrouiller la figure, nous ne tracerons qu'une des pédales ; le lecteur suppléera facilement les autres ; il lui suffit de savoir qu'il doit y en avoir autant que de notes dans l'octave, c'est-à-dire sept. EF est un levier dont l'appui G est dans une chappe qui tient au fond MN de la caisse sonore. Ce levier communique à un autre FI. dont l'appui H est aussi dans une chappe qui tient au même fond. A l'extrémité I est attaché un fil-d'archal IO, d'environ une ligne de diametre, qui tient au bout O du bras OP du levier coudé OPQ. Au point Q tient par une petite charniere simple, une mince lame de fer qui s'attache de même au levier composé RST, dont la partie ST, qui est à-peu-près perpendiculaire à la mince lame QR, est la queue d'un des crochets dièses : une pareille lame tient de même au point R, & communique à un levier semblable au précédent ; ainsi de suite. Le point V du dernier levier composé se joint toûjours par une lame de fer à un ressort X roulé en spirale ; & c'est-là l'assemblage de toutes les pieces qui composent une pédale dans cet instrument. Venons maintenant à son jeu, je dis à son jeu, parce qu'on ne sauroit expliquer le méchanisme de l'une, qu'en même tems on n'explique celui des autres.
Si l'on met le pié sur le bras EG du levier EH, que je suppose être la pédale d'ut, le point I descendra, de même que l'extrémité O ; alors les points R Y Z, &c. des leviers composés décriront des arcs en s'approchant de la tête de la harpe ; & les queues ST des crochets sortiront par rapport à la face A de la bande, ou rentreront par rapport à la face W : alors les crochets D sont montés à vis sur leurs queues, de maniere qu'ils toucheront toutes les cordes ut, lesquelles au lieu de vibrer depuis la table jusqu'aux obstacles 2, ne vibreront que depuis la table jusqu'aux obstacles 3, c'est-à-dire qu'elles seront raccourcies de la partie 3, 2, qui est égale à un seizieme de toute la corde : mais la tension restant la même, si une corde se raccourcit, elle doit rendre un nouveau son qui soit au premier réciproquement comme les longueurs des cordes. Or par la supposition, la corde est raccourcie d'un seizieme ; donc le premier son est au second comme 15 est à 16, c'est-à-dire que le dernier est plus haut que l'autre d'un semi-ton majeur ; mais le premier par l'hypothèse est l'ut naturel ; donc le second est l'ut dièse : & c'est ce qu'il falloit expliquer.
En cessant d'appuyer le pié sur la pédale, le ressort spiral, que la pression du pié avoit forcé à se bander, remettra, en se rétablissant, les choses comme elles étoient auparavant. Mais s'il y a des dièses tout le long de la piece, par exemple, si la note ut est par-tout dièse, quand on aura baissé la pédale, pour n'être pas obligé d'avoir toûjours le pié posé dessus, on la poussera à côté. Pour favoriser ce mouvement, le levier EF est brisé en K ; de maniere que sa partie EK peut se mouvoir horisontalement autour du point K, mais seulement d'un côté : étant poussée, comme nous venons de dire, la pédale ne pourra remonter, à-cause qu'elle rencontrera la cheville L, placée exprès pour cela en cet endroit : par ce moyen, tous les ut seront dièses ; & le pié qui sera libre pourra faire les dièses accidentels qui pourroient se rencontrer dans la piece.
Pour empêcher que le bas des pédales ne se détruise, soit par l'humidité, par la poussiere, ou par le choc de quelques autres corps étrangers, on adapte un double fond 4, 5, à la harpe, & on enveloppe l'entre-deux par une bande légere de bois, ou par la continuité des faces latérales de la caisse sonore, en laissant de petites fenêtres pour passer les queues des pédales. Enfin on couvre le devant du montant B, de même que le devant de la bande C, l'un & l'autre d'une planche mince, afin de garantir d'insulte ce que chacune de ces pieces contient dans son intérieur.
Il nous reste encore à dire pourquoi la bande C est courbée en-dedans, & pourquoi la caisse sonore est plus grosse vers le bas. 1°. Ceux qui joüent de cet instrument ont remarqué, lorsque la bande C est droite, que quoique les cordes les plus minces soient beaucoup plus courtes que les grosses, cependant elles cassoient constamment plus souvent que les autres : d'où ils ont conclu qu'il falloit, pour leur donner plus de résistance, les raccourcir davantage ; & c'est ce qu'on a fait en courbant la traverse. 2°. Comme les petites cordes s'attachent vers le haut de la caisse sonore, & les grosses vers le bas, & que les sons que rendent celles-ci ont plus d'intensité que les sons que rendent celles-là ; il étoit nécessaire de faire la caisse plus vaste & plus forte aux endroits où sont attachées les grosses, qu'à ceux où sont attachées les petites : afin qu'il y eût dans le bois de la caisse une inertie proportionnée à l'intensité des sons, & que le volume d'air renfermé, de même que celui qui environne la caisse immédiatement, fût dans une espece de proportion avec la force de ces sons. La meilleure harpe sans doute seroit celle où la force du son seroit en équilibre avec les parties correspondantes de la caisse sonore.
Cet instrument rend des sons doux & harmonieux ; il est très-touchant & plus propre à exprimer la tendresse & la douleur, que les autres affections de l'ame. Les cordes de la harpe veulent être touchées avec modération ; autrement elles rendroient des sons confus, comme feroit le clavecin, si les vibrations des cordes n'étoient pas arrêtées par un obstacle. Enfin je dirai pour finir, que les Irlandois sont entre tous les peuples ceux qui passent pour joüer le mieux de cet instrument. Cet article a été donné par M. le comte de Hoghenski, qui veut bien nous permettre de lui rendre ici, en le nommant, un témoignage public de reconnoissance : c'est peut-être le plus modeste & le plus habile joüeur de harpe. Il y joint la connoissance de la plus profonde & brillante harmonie au goût noble d'un homme de qualité qui a bien profité d'une éducation proportionnée à sa haute naissance. (B)
Harpe, (Mythologie.) c'est un symbole d'Apollon ; de sorte que sur les médailles, une ou deux harpes marquent les villes où ce dieu étoit adoré comme chef des Muses. Quand la harpe est entre les mains d'un centaure, elle désigne Chiron, maître d'Achille ; quand elle est jointe au laurier & au couteau, elle marque les jeux apollinaires. (D. J.)
Harpe, (Hist. nat.) c'est le nom que l'on donne à une coquille bivalve, à cause de sa ressemblance avec une harpe : il y a des auteurs qui l'appellent la lire.
* Harpe, (Art milit.) espece de pont-levis ainsi appellé de sa ressemblance avec la harpe, instrument de Musique. Ce pont de membrures appliqué perpendiculairement contre la tour, avoit, comme la harpe, des cordes qui l'abaissoient sur le mur, par le moyen de poulies ; & aussi-tôt des soldats sortoient de la tour pour se jetter sur le rempart par ce passage. Dictionn. de Trév.
Harpes, (Maçonnerie.) pierres qu'on laisse alternativement en saillie à l'épaisseur d'un mur, pour faire liaison avec un autre qui peut être construit dans la suite. On appelle aussi harpes les pierres plus larges que les carreaux dans les chaînes, jambes-boutisses, jambes sous poutre, &c. pour faire liaison avec le reste de la maçonnerie d'un mur. (P)
Étymologie de « harpe »
Provenç. espagn. et ital. arpa?; portug. harpa?; du bas-lat. harpa, qui désignait un instrument de musique usité chez les Germains, et qui vient du germanique?: anc. scand. harpa?; anglo-sax. hearpe?; anc. h. allem. harpha?; allem. mod. Harfe. Diez pense que harpa a été dit ainsi de sa forme en crochet, et que c'est le même mot que harpe 2 (voy. HARPER 2).
harpe au Scrabble
Le mot harpe vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot harpe - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot harpe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
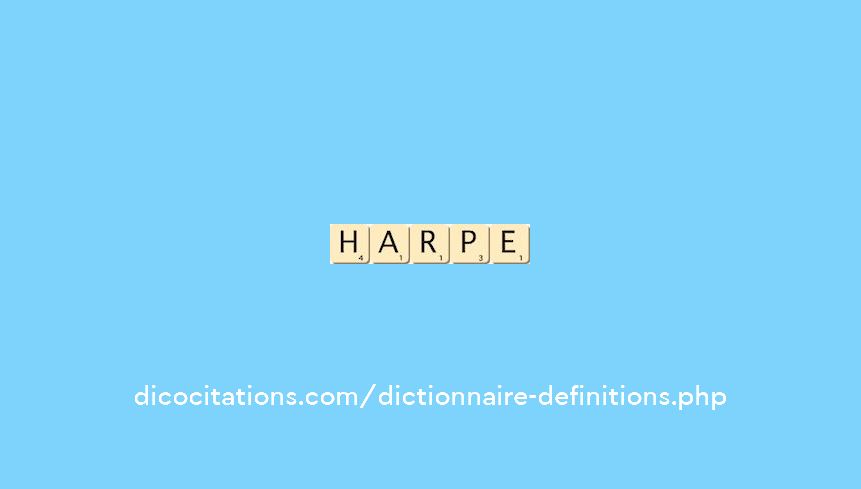
Les rimes de « harpe »
On recherche une rime en RP .
Les rimes de harpe peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Rp
Rimes de serpes Rimes de extirpent Rimes de écharpe Rimes de serpe Rimes de Erpent Rimes de péricarpe Rimes de scirpes Rimes de harpe Rimes de escarpes Rimes de Merdorp Rimes de Langdorp Rimes de Opdorp Rimes de Neerpelt Rimes de métacarpe Rimes de écharpe Rimes de harpes Rimes de Tourpes Rimes de écharpent Rimes de contrescarpe Rimes de extirpe Rimes de usurpent Rimes de Erps-Kwerps Rimes de Steendorp Rimes de Overpelt Rimes de Rumsdorp Rimes de Dworp Rimes de écharpes Rimes de carpes Rimes de scirpe Rimes de écharpes Rimes de carpe Rimes de ErpeMots du jour
serpes extirpent écharpe serpe Erpent péricarpe scirpes harpe escarpes Merdorp Langdorp Opdorp Neerpelt métacarpe écharpe harpes Tourpes écharpent contrescarpe extirpe usurpent Erps-Kwerps Steendorp Overpelt Rumsdorp Dworp écharpes carpes scirpe écharpes carpe Erpe
Les citations sur « harpe »
- Les rues étaient envahies, le soir, par la même foule où dominaient seulement les pardessus et les écharpes.Auteur : Albert Camus - Source : La Peste (1947)
- Adossés aux immeubles, les fumeurs, écharpes autour du cou, font le pied de grue. D'autres, en manteaux, consument aux terrasses.Auteur : Chantal Dupuy-Dunier - Source : Des villes, parfois... (2014)
- Elle n'ose pas lui dire que son corps a vieilli mais c'est quand même en le regardant qu'ellea eu l'idée de s'acheter un sharpeÏ.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
- Qui veut guérir son oeil, se mette le bras en écharpe.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- Ca va se construire : une charpente d'illusions sur les fondations du doute, les murs vaporeux de la métaphysique, le mobilier périssable des convictions, le tapis volant des sentiments...Auteur : Daniel Pennac - Source : Monsieur Malaussène au théâtre (1996)
- La décadence de l'amour! Les termites! Ces insectes qui bouffent les poutres et les charpentes. On ne les voit pas, on ne les entend pas, ils grignotent jusqu'à ce qu'un jour la maison s'écroule.Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt - Source : Petits crimes conjugaux (2003)
- Après lui, descendit le chevelu Orfée,
Qui tenait en ses mains une harpe étoffée
De deux coudes d'ivoire, où par rang se tenaient
Les cordes, qui d'en haut inégales venaient
A bas l'une après l'autre en biais chevillées.Auteur : Pierre de Ronsard - Source : Premier livre des hymnes (1555), Calays et Zethés - « Je voulais que tu comprennes ce qu'est le vrai courage, au lieu de t'imaginer que c'est un homme avec un fusil à la main. Le vrai courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même sans s'arrêter. » Harper LEE
Auteur : Guillaume Musso - Source : La Fille de papier (2010)
- Laharpe a caractérisé par le mot «fanatisme» l'idiome révolutionnaire. Si on entend par là une dévotion portée à la fois jusqu'au sacrifice de soi et des autres, le mot est juste.Auteur : Ferdinand Brunot - Source : Histoire de la langue française (1905-1938)
- Les socialistes révolutionnaires me font penser à celui qui, ayant un piano désaccordé, dirait : « Brisons ce piano et jetons-en les morceaux au feu à la place, nous installerons une harpe éolienne. »Auteur : Remy de Gourmont - Source : Des pas sur le sable (1914)
- Les constructeurs d'aqueducs conduisent l'eau à leur gré; celui qui fabrique les flèches les façonne; les charpentiers tournent le bois; le sage se façonne lui-même.Auteur : Bouddha - Source : Le Dhammapada
- Il est certain que Charpentier contribua beaucoup, par son travail et par son zèle, à la belle suite de médailles qui furent frappées sous le règne de Louis XIV.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Charpentier
- On peut se représenter le sommeil sous plusieurs formes. Écharpe grise, écran de fumée, sonate. Vol plané d'un grand oiseau pâle, portail vert entrouvert. Plaines. Mais aussi noeud coulant, gaz asphyxiant, clarinette basse. Insecte rétracté sur sa vie brève, dernier avis avant saisie. Rempart. C'est une question de style, c'est selon la manière dont chacun dort ou pas, selon les rêves qui l'éborgnent ou qui l'épargnent. Auteur : Jean Echenoz - Source : Les Grandes Blondes (1995)
- C'était un grand gaillard, fortement charpenté, négligemment vêtu, à la mode des pionniers américains, d'une vareuse lâche, d'une chemise de laine sans col et d'un pantalon de velours à côtes, engouffré dans de grosses bottes.Auteur : Jules Verne - Source : Les 500 millions de la Bégum (1879)
- Qu'est-ce qu'un ange sans sa harpe sinon un démon triste et nu, et que serait pour lui le paradis hormis un exil plein d'ennui ?Auteur : Mohammed Moulessehoul, dit Yasmina Khadra - Source : Les Anges meurent de nos blessures (2013)
- La capacité de recommencement des femmes, et des hommes parfois, me terrasse, et m'émeut. C'est là, c'est donné, il suffit de regarder et d'écouter. Les femmes surtout, certaines, comme elles sont vaillantes, comme elles veulent y croire, et paient de leur personne, de tout leur corps qui fabrique les enfants, et les nourrit ; et elles se penchent, vêtent, nouent les écharpes, ajustent les manteaux, consolent vérifient admonestent caressent, ça ne finit pas. Comme elles sont dévorées et y consentent ou n'y consentent pas ou n'y consentent plus mais peuvent encore, font encore, parce qu'il le faut et que quelque chose en elles résiste, continue. C'est chaque jour et au bout des jours ça fait une vie. Auteur : Marie-Hélène Lafon - Source : Nos vies
- M. de la Harpe, avec qui j'ai le plaisir de parler souvent de vous, pourra vous dire combien je vous suis attaché, et combien je suis vôtre à la vie, à la mort.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 28 janvier 1768
- Les escales se succédaient, toutes semblables et différentes. Partout brillaient les feux d'une harpe, partout l'hégémonie diffuse du maître des mailles rappelait au Nomade sa condition de paria.Auteur : Stéphane Boillot-Cousin, dit Johan Heliot - Source : La Harpe des Etoiles (2003)
- Ne me touchez pas ! Vous n'avez pas le droit de me toucher ! Personne ne me touche, ma personne est sacrée. Je suis parlementaire. Pour vous en convaincre... C'est moi Mélenchon avec mon écharpe tricolore... Auteur : Jean-Luc Mélenchon - Source : Perquisitionné à son domicile parisien, M. Mélenchon a filmé la scène avec son portable pour la diffuser en direct sur Facebook le 16 octobre 2018
- Blême et les poings crispés, il frémissait comme une harpe dont les cordes vont éclater.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Salammbô (1862)
- La cheville est la compagne du charpentier.Auteur : Proverbes russes - Source : Proverbe
- Deux mains cherchant passage. Un sourire strié. La harpe vous partage Hélène, en deux moitiés dont chacune est en cage.Auteur : Jean Tardieu - Source : Hélène ou la harpiste
- Les charpentiers se mirent à édifier, à l'abri d'immenses boucliers, des machines de siège en bois, des tours et d'énormes béliers mobiles qui s'appuyaient en partie sur les ponts des bateaux et en partie sur les remparts de la citadelle.Auteur : Jean d'Ormesson - Source : La Gloire de l'Empire (1971)
- Elle trouvait au fond de mon regard quelque blessure, car elle me disait: You carry your heart in a sling (vous portez votre coeur en écharpe). Je portais mon coeur je ne sais comment.Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 1, Livre 11, Chapitre 2
- Sur les rives vertes du Shannon, quand Sheelah était proche,
Aucun jeune irlandais joyeux n'était aussi heureux que moi ;
Aucune harpe comme la mienne ne pouvait jouer aussi joyeusement,
Et où que j'aille, mon pauvre chien Tray était là.Auteur : Thomas Campbell - Source : The Harper, st. 1 (1799)
Les mots proches de « harpe »
Harangue Haranguer Harangueur Haras Harassant, ante Harassé, ée Harassement Harasser Harcelage Harcelant, ante Harcelé, ée Harcèlement Harceler Harcèlerie Harde Harde Hardé Harder Hardes Hardi, ie Hardiesse Hardiment Harem Hareng Harengaison Harengère Harengerie Harfang Hargnerie Hargneux, euse Haria Haricot Haricot Haridelle Harmattan Harmonica Harmonie Harmonieux, euse Harmonique Harmoniquement Harmoniser Harmoniste Harnachement Harnacher Harnacheur Harnais ou harnois Haro Harpaille Harpailler (se) HarpeLes mots débutant par har Les mots débutant par ha
hara-kiri Haramont harangua haranguaient haranguait haranguant harangue harangue harangué haranguée haranguer haranguerais harangues harangués haranguez harari haras harassaient harassant harassant harassante harassantes harassants harasse harassé harassé harassée harassée harassées harassées harassement harassent harasser harassés harassés Haraucourt Haraucourt Haraucourt-sur-Seille Haraumont Haravesnes Haravilliers Haravilliers Harbonnières Harbouey Harcanville harcela harcelai harcelaient harcelais harcelait
Les synonymes de « harpe»
Les synonymes de harpe :- 1. lyre
2. luth
3. cithare
4. pentacorde
5. psaltérion
synonymes de harpe
Fréquence et usage du mot harpe dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « harpe » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot harpe dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Harpe ?
Citations harpe Citation sur harpe Poèmes harpe Proverbes harpe Rime avec harpe Définition de harpe
Définition de harpe présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot harpe sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot harpe notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.

