La définition de Spasme du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Spasme
Nature : s. m.
Prononciation : spa-sm'
Etymologie : Prov. lespasme ; esp. espasmo ; ital. spasmo, spasimo ; du lat. spasmus, du grec, tirer, contracter ; comp. SPONTANÉ.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de spasme de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec spasme pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Spasme ?
La définition de Spasme
Terme de médecine. Contraction involontaire des muscles, notamment de ceux qui n'obéissent pas à la volonté.
Toutes les définitions de « spasme »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Médecine. Contraction involontaire, mouvement convulsif de certains organes. Avoir des spasmes gastriques.
Littré
- Terme de médecine. Contraction involontaire des muscles, notamment de ceux qui n'obéissent pas à la volonté.
Spasme cynique, contraction des muscles de la face, qui donne à la physionomie l'aspect du chien qui gronde et cherche à mordre.
Spasme de la glotte, affection des enfants surtout, consistant en contractions convulsives du diaphragme caractérisées par de courts accès de suffocation, survenant tout à coup, sans prodromes.
HISTORIQUE
XIIIe s. Apopletique, paralitike, espame
, Alebrand, f° 6.
XVIe s. Spasme ou convulsion est retraction et mouvement involontaire des nerfs, et par consequent des muscles?
, Paré, VII, 8. Tel spasme [pâmoison] luy dura tant sans revenir à soy?
, Don Flores de Grece, f° 146. Un spasme, une foiblesse, un morne estonnement Qui pallit mon visage
, Desportes, ?uvres, p. 281, dans LACURNE.
Encyclopédie, 1re édition
SPASME, s. m. (Médec. Patholog.) ce mot est pris assez ordinairement, sur-tout par les auteurs grecs & latins, comme synonyme à convulsion, & dans ce sens il est employé pour désigner la contraction non-naturelle de quelque partie. Quelques médecins françois ont évité de confondre ces deux mots, appellant spasme la disposition des parties à la convulsion, & convulsion le complément de cette disposition, ou ce qui revient au même, un spasme plus fort & plus sensible : il me semble qu'on pourroit en distinguant ces deux états, établir la distinction sur des fondemens moins équivoques, & pour cela je remarque que deux sortes de parties peuvent être le sujet ou le siege du spasme, ou de la convulsion : les unes ont un mouvement considérable, mais soumis à l'empire de la volonté ; tels sont les muscles destinés à exécuter les mouvemens animaux : les autres ont une action plus cachée, un mouvement moins remarquable, mais indépendant de l'arbitre de la volonté ; de ce nombre sont tous les organes qui servent aux fonctions vitales & naturelles. Le spasme ou la convulsion ne sauroient s'évaluer de la même façon dans l'un & l'autre cas : on juge que les muscles soumis à la volonté sont dans une contraction contre nature, lorsque cette contraction n'est point volontaire, c'est ce que j'appelle proprement convulsion. Cette mesure seroit fautive à l'égard des parties qui se contractent naturellement sans la participation de la volonté ; on ne doit donc décider leur contraction non-naturelle que lorsqu'elle sera portée à un trop haut point, que le mouvement tonique sera augmenté de façon à entraîner une lésion sensible dans l'exercice des fonctions. Cette seconde espece me paroît devoir retenir le nom plus approprié de spasme ; la différence que je viens d'établir dans la nomenclature se trouve encore fondée sur la façon ordinaire de s'exprimer ; ainsi on dit : Un homme est tombé dans les convulsions, il avoit le bras en convulsion, &c. lorsqu'il s'agit de ces contractions contre nature extérieures involontaires, & l'on dit au contraire : Le spasme des intestins, de la vessie, des extrémités artérielles des différens organes, &c. lorsqu'on veut exprimer l'augmentation de ton de ces parties intérieures. En partant de ces principes, je crois qu'on peut dire qu'une convulsion suppose un spasme violent ; & dans ce cas, il sera vrai que le spasme est une disposition prochaine à la convulsion. Cette assertion est fondée sur ce que tous les symptomes apparens ont pour cause un dérangement intérieur que nous croyons analogue.
Quel est donc ce dérangement intérieur, & quelle en est la cause ? Champ vaste ouvert aux théoriciens, sujet fertile en discussions, en erreurs & en absurdités. Les partisans de la théorie ordinaire confondant toujours spasme & convulsion, les ont regardés comme des accidens très-graves, qu'ils ont fait dépendre d'un vice plus ou moins considérable dans le cerveau ; les uns ont cru que ce vice consistoit dans un engorgement irrégulier des canaux nerveux ; d'autres l'ont attribué à un fluide nerveux, épais & grumelé, qui passoit avec peine & inégalement dans les nerfs, & excitoit par-là cette irrégularité dans les mouvemens. La plûpart ont pensé que la cause du mal étoit dans les vaisseaux sanguins du cerveau, & que leur disposition vicieuse consistoit en des especes de petits anévrismes extrèmement multipliés, qui rendoient la circulation du sang déja épais & sec, plus difficile, & en troubloient en même tems l'uniformité. Tous enfin ont recours à des causes particulieres, presque toutes vagues, chimériques, ou peu prouvées pour l'explication d'un fait plus général qu'on ne le pense communément.
Et c'est précisément de tous les défauts qu'on pourroit, par le plus léger examen, découvrir dans ces théories, celui qui est le plus remarquable, & qu'il est le plus important d'approfondir ; rien n'est plus nuisible aux progrès d'une science, que de trop généraliser certains principes, & d'en trop particulariser d'autres. La circulation du sang, simple phénomene de Physiologie, dont la découverte auroit dû, ce semble, répandre un nouveau jour sur la Médecine théorique, n'a fait qu'éblouir les esprits, obscurcir & embrouiller les matieres, parce que tout aussi-tôt on l'a regardée comme un principe général, & qu'on en a fait un agent universel. Erreur dont les conséquences ont toujours été de plus en plus éloignées du sanctuaire de la vérité ou de l'observation ; donnant dans l'écueil opposé, on n'a considéré le spasme que sous l'aspect effrayant d'un symptome dangereux, tandis qu'avec une idée plus juste de l'économie animale on n'y auroit vu qu'un principe plus ou moins général, qui, vrai Protée, changeoit de forme à chaque instant, & produisoit dans différentes parties & dans différentes circonstances des effets très différens. C'est par la lecture de quelques ouvrages modernes, specimen novi medicinæ conspectus, idée de l'homme physique & moral, &c. & des différens écrits de M. de Bordeu, que partant d'une connoissance exacte de l'économie animale, voyez ce mot ; on pourra sentir de quelle importance il est d'analyser plus profondément qu'on ne l'a fait jusqu'ici le spasme, & d'en examiner de beaucoup plus près la nature, le méchanisme, la marche, les especes & les variations.
A mesure que les sujets sont plus intéressans, on doit chercher davantage à trouver de grands points de vûe pour les mieux appercevoir, pour les considérer en grand, & les suivre dans toutes leurs applications ; mais il faut bien prendre garde aux fondemens sur lesquels on établit de grands principes. Il est incontestable qu'en Médecine de pareils fondemens ne peuvent être assis que sur l'observation ; & comme les différentes théories qui se sont succédées jusqu'à présent n'ont été reçues que sur la foi d'un pareil appui, & qu'il est probable que leurs auteurs étoient persuadés de les avoir ainsi fondés, il en résulte nécessairement qu'il en est de l'observation, comme Montagne le disoit de la raison, que c'est un pot à deux anses, une regle de plomb & de cire alongeable, ployable & accommodable, à tous sens & à toutes mesures. Il y a donc une maniere de saisir l'observation pour en tirer les lumieres qu'elle doit fournir ; il faut donc un point de vûe propre à saisir le fonds de l'observation, avant que de pouvoir se flatter d'en tirer assez de parti pour former une théorie également solide & profonde.
Insantum corpus loeditur in quantum convellitur ; c'est un grand & important axiome que le célebre auteur des ouvrages cités plus haut, établit pour fondement de la théorie des maladies, il découle naturellement des principes justes & feconds qu'il a exposés sur l'économie animale ; il est d'ailleurs appuyé sur des observations multipliées, & sur-tout sur le genre d'observation le plus lumineux & le moins équivoque ; c'est celui dont on est soi-même l'objet : voilà donc le spasme proposé comme cause générale de maladie, suivons l'auteur dans les différens pas qu'il a faits pour venir à cette conséquence, & examinons sans prévention les preuves sur lesquelles il en étaye la vérité. Jettons d'abord un coup d'?il sur l'homme sain, & sans remonter aux premiers élémens peu connus dont il est composé, fixons plus particulierement nos regards sur le tableau animé que présentent le jeu continuel des différentes parties & les fonctions diversifiées qui en résultent.
Qu'est-ce que l'homme ? ou pour éviter toute équivoque, que la méchanceté & la mauvaise foi sont si promptes à faire valoir ; qu'est-ce que la machine humaine ? Elle paroît à la premiere vûe, un composé harmonique de différens ressorts qui mûs chacun en particulier, concourent tous au mouvement général ; une propriété générale particulierement restreinte aux composés organiques, connue sous les noms d'irritabilité ou sensibilité, se répand dans tous les ressorts, les anime, les vivifie & excite leurs mouvemens ; mais modifiée dans chaque organe, elle en diversifie à l'infini l'action & les mouvemens ; par elle les différens ressorts se bandent les uns contre les autres, se résistent, se pressent, agissent & influent mutuellement les uns sur les autres ; cette commixture réciproque entretient les mouvemens, nulle action sans réaction. De cet antagonisme continuel d'actions, résulte la vie & la santé ; mais les ressorts perdroient bientôt & leur force, & leur jeu, les mouvemens languiroient, la machine se détruiroit, si l'Etre suprème qui l'a construite n'avoit veillé à sa conservation, en présentant des moyens pour ranimer les ressorts fatigués, & pour ainsi dire débandés, pour rappeller les mouvemens & remonter en un mot toute la machine ; c'est-là l'usage des six choses connues dans le langage de l'école sous le nom des six choses non naturelles, & qui sont absolument nécessaires à la vie : l'examen réfléchi des effets qui résultent de l'action de ces causes sur le corps & de quelques phénomenes peu approfondis, l'analogie qu'il doit y avoir nécessairement entre la machine humaine & les autres que la main des hommes a su fabriquer, & plusieurs autres raisons de convenance, ont fait penser qu'il devoit y avoir dans le corps un premier & principal ressort, dont le mouvement ou le repos entraîne l'exercice ou l'inaction de tous les autres, voyez ?conomie animale ; observation si frappante, qu'il est inconcevable comment elle a pû échapper à l'esprit de comparaison & aux recherches des Méchaniciens modernes. Parmi les différentes parties, celles dont le département est le plus étendu, sont sans contredit, la tête & le ventre, l'influence de leurs fonctions est la plus générale ; ces deux puissances réagissent mutuellement l'une sur l'autre, & par cette contranitence d'action, lorsqu'elle est modérée, se conservent dans une tension nécessaire à l'exercice de leurs fonctions respectives ; mais leurs efforts se réunissent sur le diaphragme, cet organe le premier mû dans l'enfant qui vient de naître, doit être regardé comme le grand mobile de tous les autres ressorts, comme la roue maîtresse de la machine humaine, comme le point ou les dérangemens de cette machine viennent se concentrer, où ils commencent & d'où ils se répandent ensuite dans les parties analogues.
Partons de ce point de vûe lumineux, pour promener avec plus de fruit nos regards attentifs sur l'innombrable cohorte de maladies qui se présente à nos yeux ; tâchons de pénétrer dans l'intérieur de la machine pour y appercevoir les dérangemens les plus cachés : supposons parmi cette multitude de ressorts qui se résistent mutuellement & qui par cette contranitence réciproque, entretiennent leurs mouvemens & concourent par-là à l'harmonie générale ; supposons, dis-je, un de ces ressorts altéré, affoibli, par l'abus de ce qui sert à l'entretenir, destitué de la force nécessaire pour réagir efficacement contre le ressort sympathique ; aussi-tôt cette égalité d'action & de réaction qui constitue une espece de spasme naturel est troublée ; ce dernier ressort augmente la sphere de ses mouvemens, les fibres qui le composent sont irritées, tendues, resserrées, & dans un orgasme qui constitue proprement l'état spasmodique contre nature. Mais remontons à la source du dérangement d'un organe particulier, nous la trouverons dans le diaphragme, qui par le tissu cellulaire, par des bandes aponévrotiques & par les nerfs, communique comme par autant de rayons aux différentes parties ; l'action de cet organe important est entretenue dans l'uniformité qui forme l'état sain par l'effort réciproque & toujours contre-balancé de la tête & de l'épigastre ; si l'une de ces deux puissances vient à agir avec plus ou moins de force, dès-lors l'équilibre est rompu, le diaphragme est affecté, son action cesse d'être uniforme, une ou plusieurs de ses parties sont dérangées, & par une suite de son influence générale sur tous les visceres, le dérangement, l'affection, la maladie plus ou moins considérable se propage & se manifeste dans les organes qui répondent aux parties du diaphragme altérées, par un spasme plus ou moins sensible, plus ou moins facilement réductible à l'état naturel.
Les deux pivots sur lesquels roule le jeu du diaphragme & en conséquence tous les mouvemens de la machine, & où prennent naissance les causes ordinaires de maladie, sont comme nous l'avons déja remarqué, la tête & le bas-ventre ; toute la force du bas-ventre dépend de l'action tonique des intestins & de l'estomac, & de leur effort contre le diaphragme ; les alimens qu'on prend en attirent par le méchanisme de la digestion, l'influx plus considérable de toutes les parties sur la masse intestinale, en augmente le jeu, & remonte pour ainsi dire ce ressort qu'une trop longue abstinence laissoit débandé, sans force & sans action ; il agit donc alors plus fortement sur le diaphragme ; le dérangement qui en résulte très-sensible chez certaines personnes leur occasionne pendant la digestion une espece de fievre ; si la quantité des alimens est trop grande, ou si par quelque vice de digestion ils séjournent trop long-tems dans l'estomac, l'égalité d'action & de réaction de la tête avec cet organe est sensiblement troublée, & ce trouble se peint tout aussi-tôt par l'affection du diaphragme & des parties correspondantes. Les mêmes effets suivront si les humeurs abondent en quantité à l'estomac & aux intestins, si leurs couloirs sont engorgés, si des mauvais sucs s'accumulent dans leur cavité, &c. appliquons le même raisonnement à la tête, & nous verrons l'équilibre disparoître par l'augmentation des fonctions auxquelles la masse cérébrale est destinée ; ces fonctions sont connues sous le nom générique de passions ou affections de l'ame, elles se réduisent au sentiment intérieur qui s'excite par l'impression de quelque objet sur les sens, & à la durée du sentiment produit par ces impressions ; ce sont ces deux causes dans la rigueur, réductibles à une seule, qui entretiennent le ressort de la tête ; & son augmentation contre nature est une suite de leur trop d'activité ; ainsi les passions modérées ne concourent pas moins au bonheur physique, c'est-à-dire à la santé, qu'au bonheur moral : le corps seroit bien moins actif, les sommeils seroient bien plus longs, les sens seroient dans un engourdissement continuel, si nous n'éprouvions pas cette suite constante de sensations, de craintes, de réflexions, d'espérance ; si nous étions moins occupés de notre existence & des moyens de l'entretenir, & si à mesure que le soin de la vie animale nous occupe moins, nous ne cherchions à donner de l'exercice à la tête par l'étude, par l'accomplissement de nouveaux devoirs, par des recherches curieuses, par l'envie de se distinguer dans la société, par l'ambition, l'amour, &c. ce sont-là tout autant de causes qui renouvellent le ressort de la tête, & qui entretiennent son antagonisme modéré avec celui du bas-ventre ; mais si ces causes deviennent plus actives ; si une crainte excessive ou une joie trop-vive nous saisit ; si l'esprit ou le sentiment est trop occupé d'un seul objet, il se fatigue & s'incommode, le ressort de la tête augmentant & surpassant celui du bas-ventre, devient cause de maladie. Théorie importante qui nous manquoit, qui nous donne un juste coup-d'?il pour exciter & modérer nos passions d'une maniere convenable.
De cette double observation naît une division générale de la pathologie en maladies dûes au ressort augmenté de la tête, & en celles qui sont produites par l'augmentation du ressort du bas-ventre : cette division va paroître plus importante & plus féconde en se rapprochant du langage ordinaire des médecins ; pour cela qu'on fasse attention que le dérangement du ressort du bas-ventre reconnoît pour cause, des mauvaises digestions, des amas d'humeurs viciées, &c. dans l'estomac & les intestins ; & d'un autre côté que le ressort de la tête est altéré par des sensations trop vives, par des passions violentes, par des méditations profondes, des veilles excessives, des études forcées, & l'on s'appercevra que la division précédente se reduit à la distinction connue, mais mal approfondie, des maladies en humorales & nerveuses : double perspective qui se présente dans un lointain très-éclairé au médecin observateur.
Les maladies purement nerveuses dépendantes d'une lésion particuliere de sentiment, doivent être appellées plus strictement spasmodiques ; l'état de spasme est l'état premier & dominant, le seul qu'il soit alors nécessaire d'attaquer & de détruire ; mais il arrive souvent qu'à la longue la masse intestinale, dérangée par l'affection constante du diaphragme, donne lieu à de mauvaises digestions, & entraîne bientôt après un vice humoral ; ou au contraire dans des sujets sensibles très-impressionables, qui ont le genre nerveux très-mobile, l'affection humorale étant essentielle & protopathique, occasionne par la même raison des symptomes nerveux ; le genre mixte de maladies qui résulte de cette complication de quelque façon qu'elle ait lieu, est le plus ordinaire ; lorsque la maladie est humorale ou mixte, la cause morbifique irrite, stimule les forces organiques, augmente leurs mouvemens, & les dirige à un effort critique, ou, ce qui est le même, excite la fievre, pendant le premier tems de la fievre, qu'on appelle tems de crudité ou d'irritation ; l'état spasmodique des organes affectés, & même de toute la machine, est peint manifestement sur le pouls, qui, pendant tout ce tems, est tendu, serré, précipité, convulsif : lorsque par la réussite des efforts fébrils le spasme commence à se dissiper, les symptomes diminuent, le tems de la coction arrive, le pouls est moins tendu, il commence à se développer ; la solution du spasme annonce, détermine, & prépare l'évacuation critique qui terminera la maladie ; à mesure qu'elle a lieu, les accidens disparoissent, la peau est couverte d'une douce moiteur, l'harmonie se rétablit dans la machine, le spasme se dissipe, le pouls devient plus mol, plus égal, plus rapprochant en un mot de l'état naturel : si, au contraire, quelqu'obstacle vient s'opposer à l'accomplissement de la crise, tout aussi-tôt les efforts redoublent, la constriction des vaisseaux augmente, leur spasme devient plus sensible, le pouls reprend un caractere d'irritation ; dans les maladies nerveuses où il ne se fait point de crise, le pouls conserve pendant tout le cours de la maladie son état convulsif, image naturel de ce qui se passe à l'intérieur.
Nous ne poussons pas plus loin ces détails, renvoyant le lecteur curieux aux ouvrages mêmes dont nous les avons tirés ; les principes plus rapprochés des faits y paroîtront plus solidement établis, & plus féconds ; les conséquences mieux enchainées & plus naturellement déduites, les vûes plus vastes, les idées plus justes & plus lumineuses ; mais pour juger sainement de la bonté de cette doctrine, il ne faut pas chercher à la plier aux minutieuses recherches anatomiques ; ce n'est point à la toise des théories ordinaires qu'il faut la mesurer ; on tâcheroit envain de la soumettre aux lois peu connues & mal évaluées de la circulation du sang ; mesures fautives & sur la valeur desquelles tous ceux qui les admettent ne sont pas d'accord ; c'est dans l'observation répétée, & surtout dans l'étude de soi-même, qu'il faut chercher des raisons pour la détruire ou la confirmer ; appliquons-lui avec l'auteur ce que Stahl disoit avec raison de toutes ces discussions frivoles, qui ne font qu'embrouiller les faits, avec lesquels elles sont si rarement d'accord : mussitant hic subtilitates nudæ, eo nil faciunt speculationes anatomicorum à viis & mentibus petitæ, sed motus naturæ hic considerari debet. Qu'on fasse attention d'ailleurs que ces principes pathologiques, très-conformes aux lois bien fixées de l'économie animale, aux dogmes les plus sacrés, établis par les anciens, & reconnus par les modernes, à la doctrine des crises, aux nouvelles découvertes, enfin à la plus exacte observation, fournissent encore l'explication naturelle de plusieurs phénomenes dont les théoristes modernes avoient inutilement cherché les raisons ; les métastases entr'autres, les douleurs vagues qu'on sent courir en différens endroits du corps, les maladies qui changent à chaque instant de place, & plusieurs autres faits analogues, écueils où se venoient briser la sagacité & l'imagination de ces auteurs, se déduisent si naturellement de ce système, qu'ils en paroissent la confirmation.
Quelle que soit la fécondité des principes que nous venons d'exposer, quelle que soit la multiplicité & la force des preuves qui étaient la doctrine dont ils sont les fondemens ; une raison plus victorieuse encore combat en leur faveur ; un avantage infiniment plus précieux aux yeux du praticien éclairé s'y rencontre ; c'est que cette théorie loin de gêner, d'asservir l'observateur, de lui fasciner pour ainsi dire les yeux, & de diriger sa main, ne fait au-contraire que lui servir de point de vue fixe pour discerner plus exactement les faits ; bien éloignée en cela des théories ordinaires qui tyrannisent le praticien, & l'asservissent au joug souvent funeste du raisonnement. Pour faire sentir cette différence & le prix de cet avantage, je propose l'épreuve décisive de la pratique : qu'un malade se présente avec une fievre assez considerable, difficulté de respirer, point de côté assez vif, crachement de sang, &c. le médecin imbu des théories ordinaires, s'avance avec d'autant plus de courage qu'il a moins de lumiere, & au premier aspect de ces symptomes, ce despote absolu dit : « je prouve par mes raisonnemens que ces phénomenes sont des signes assurés d'une inflammation de la plevre ou du poumon ; je tiens pour maxime incontestable que les saignées sont le remede unique & par excellence de toute inflammation ; on ne sauroit trop en faire, & le moindre retardement est un grand mal ». En conséquence, il ordonne qu'on fasse coup-sur-coup plusieurs saignées, secours jamais curatif, quelquefois soulageant, & souvent inutile ou pernicieux ; il fait couler à grands flots le sang de l'infortuné malade, qui atteint d'une affection humorale, meurt bientôt après victime de ce théoriste inconsidéré ; que le même malade tombe entre les mains d'un médecin qui aura adopté la théorie que nous venons d'exposer ; moins prompt à se décider, s'il est conséquent à ses principes, il examinera attentivement, & les symptomes qui paroissent, & les causes qui ont précédé, attribuant tous ces symptomes au pervertissement de l'action du diaphragme, à un spasme plus ou moins étendu, il se rappellera en même tems que ce dérangement intérieur peut être l'effet de deux vices très-différens, ou produit par l'augmentation du ressort de la masse intestinale qu'auront occasionnée la présence & l'accumulation de mauvais sucs dans les premieres voies, ou tout-à-fait indépendant de cette cause ; considerant la maladie sous ce double aspect, il vient à-bout de décider par un examen plus réfléchi des symptomes propres, à quelle cause elle doit être attribuée : c'est là que s'arrête le théoricien ; le praticien observateur muni de ces connoissances, appelle à son secours les observations antérieures pour classer la maladie, & déterminer par quel genre de remedes il doit attaquer la cause qui se présente, comment il doit employer ces remedes, les varier, & dans quel tems il doit les administrer. Suivons-le dans le traitement de cette maladie pour indiquer combien cette théorie s'applique heureusement à la pratique : supposons que cette prétendue fluxion de poitrine soit du nombre de celles qui ne dépendent que du mauvais état de l'estomac & des intestins ; après une ou deux saignées & l'émétique que la violence des accidens peut exiger, il tournera toutes ses vues du côté du bas-ventre, il sollicitera par des purgatifs legers la solution du spasme de ce côté, & préparera par-là une crise prompte & salutaire. Attentif à suivre tous les mouvemens de la nature, si le spasme critique paroît se diriger vers quelqu'autre couloir ; instruit par divers signes, & surtout par le pouls de cette détermination, il secondera la nature en poussant les humeurs vers les couloirs indiqués ; ainsi, jamais asservi par la théorie à telle ou telle pratique, il n'en sera que plus éclairé pour mieux saisir & suivre l'observation ; d'où il résulte évidemment que quand même les fondemens de ce système seroient aussi foibles qu'ils sont solides, il n'en seroit pas moins infiniment préférable à tous ceux que nous connoissons. (m)
Wiktionnaire
Nom commun - français
spasme \spasm\ masculin
-
(Médecine) Contraction involontaire, mouvement convulsif de certains muscles lisses ou striés.
- Le spasme la raidit, la tint frémissante? Puis la tête retomba et je serrai le petit corps tout faible contre moi. ? (Pierre Louÿs, Trois filles de leur mère, René Bonnel, Paris, 1926, chapitre I)
- Les maladies du système nerveux central sont susceptibles de provoquer l'apparition de spasmes, souvent déclenchés, comme dans le cas du tétanos, par des stimulations nerveuses brutales telles qu'un bruit soudain de forte intensité. ? (Archie Hunter, Gerrit Uilenberg, Christian Meyer, et al., Santé animale, vol 1. Généralités, Coll. Agricultures tropicales en poche, Cirad/CTA/Karthala/MacMillan, 2006, page 109)
-
Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de givre.
Ah ! comme la neige a neigé !
Qu'est-ce que le spasme de vivre
À la douleur que j'ai, que j'ai.
? (Émile Nelligan, Soir d'hiver (poème), 1898) - Spasme gastrique. Spasme musculaire. Spasme tonique.
Trésor de la Langue Française informatisé
SPASME, subst. masc.
Spasme au Scrabble
Le mot spasme vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot spasme - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot spasme au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
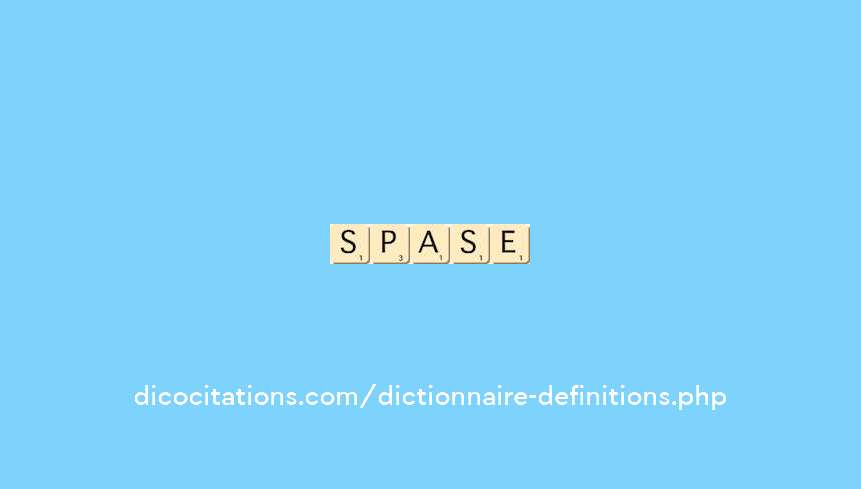
Les mots proches de Spasme
Spacieux, euse Spaciosité Spadassin Spadassiner Spadille Spagirie Spagirique Spahi Sparadrap Spare Sparmannie Sparte Sparterie Spartiate Spasme Spasmodique Spath Spathe Spathiforme Spathique Spatule spa Spa spacieuse spacieuses spacieux Spada spadassin spadassins spadille spaghetti spaghettis spahi spahis Spalbeek spamming sparadrap sparadraps sparring-partner Sparsbach spartakistes spartakistes sparte spartéine sparterie spartiate spartiate spartiates spartiates spas spasme spasmes spasmodique spasmodiquement spasmodiques spasmophile spasmophilie spasticité spastique spath spatial spatial spatiale spatialement spatiales spatiaux spatio-temporel spatio-temporelle spationaute spatiotemporel spatuleMots du jour
-
emportait martelées coéquipière volaillers éboulent égotistes hennissantes fenians engagerai brasero
Les citations avec le mot Spasme
- Les prêtres fuient dans la liturgie de la messe les spasmes du Crucifié.Auteur : Antonin Artaud - Source : Suppôts et Supplications (1947)
- Il m'éblouit, il goûte le bonheur des dieux cet homme qui devant toi prend place et près de toi écoute, captivé, la douceur de ta voix.
Ah ! ce désir d'aimer qui passe dans ton rire. Et c'est bien pour cela qu'un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine. Car si je te regarde, même un instant, je ne puis plus parler.
Mais d'abord ma langue est brisée, un feu subtil soudain a couru en frisson sous ma peau, mes yeux ne me laissent plus voir, un sifflement tournoie dans mes oreilles.
Une sueur glacée couvre mon corps, et je tremble, tout entière possédée, et je suis plus verte que l'herbe. Me voici presque morte, je crois.
Mais il faut tout risquer... puisque...Auteur : Sapho - Source : Odes et fragments, Sappho (trad. Yves Battistini), éd. Gallimard, coll. « Poésie », 2005 - J'ai dit quelque part que je savais mieux faire l'amitié que l'amour. L'amour est à base de spasmes brefs. Si ces spasmes nous déçoivent l'amour meurt.Auteur : Jean Cocteau - Source : La Difficulté d'être (1947)
- Il serait là, solitaire et secoué de spasmes, dans la puanteur ammoniacale, l'âcre odeur d'excréments, de cigare refroidi et de désinfectant.Auteur : Claude Simon - Source : Le Palace (1962)
- Et ma bouche gémissante, Messieurs les jurés, toucha presque son cou nu pendant que j'écrasais sous sa fesse gauche le dernier spasme de l'extase la plus longue qu'un homme ou monstre ait connue.Auteur : Vladimir Nabokov - Source : Lolita (1955)
- La femme porte au-dedans d'elle-même un organe susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle et suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce.Auteur : Denis Diderot - Source : Sur les Femmes
- La certitude qu'elle allait disparaître lui infligea ce serrement de la gorge, ce spasme de la poitrine qui décèlent le désarroi produit dans notre système nerveux par un choc trop intense.Auteur : Paul Bourget - Source : Un Divorce (1904)
- La mort (ou la vie) n'est plus qu'un instant éternel des plus ultimes délices. Plus rien n'existe désormais sinon de voguer ici, à l'intérieur, sur des ondes sirupeuses, au gré des spasmes et des stalagmites flexibles qui gouvernent Hermann Klock, le malaxent, le lèchent, le liquéfient, le digèrent, l'épuisent de caresses qui atteignent jusqu'à l'âme. Dans sa dérive il macère et se décompose. La glu qui l'environne le pénètre jusqu'à le faire à sa ressemblance Auteur : Claude Mathieu - Source : La mort exquise
- Un animalcule mis en circulation par un spasme, et nous voilà sur la terre, un microbe mis en mouvement par un miasme, et nous voilà dessous.Auteur : Alexandre Dumas fils - Source : Préface de Plaisirs vicieux, Léon Tolstoï, éd. Charpentier, 1892, p. 16
- Le rire est un phénomène toujours semblable à lui-même, tout au moins dans sa manifestation principale, la contraction plus ou moins violente du grand zygomatique, accompagnée d'une sorte de spasme des voies respiratoires. Auteur : Marcel Pagnol - Source : Notes sur le Rire (1947)
- Quand t'ai-je fécondée à jamais ? Oh ! ce dut être un spasme intéressant ! Mais quel fut mon but ?Auteur : Jules Laforgue - Source : Les Complaintes (1885)
- La peur (et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur), c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du coeur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Contes de la bécasse (1883), la Peur
- Lorsque le rire va jusqu'au fou rire, il s'agit en effet d'une véritable folie physique, d'un orage de réflexes qui s'ajoutent ou se contrarient, et le rieur, qui ne se gouverne plus, en arrive à des spasmes douloureux. Auteur : Marcel Pagnol - Source : Notes sur le Rire (1947)
- Il y a à la fois relâchement et spasme (dans ma maladie); les docteurs y perdront leur latin, et moi l'espérance.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 28 avril 1783
Les citations du Littré sur Spasme
- La maniere de la generasion de spasme de inanitionAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 65
- De quoy ces princes rioient si fort, qu'ils en tomboient en spasme et estazeAuteur : CARL. - Source : V, 26
- Labourer environ icelui [membre], qui est jà spasme, par doutouse medecineAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 66
- Preservation de spasmeAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 65
- Spasme est une maladie nerveuse, ouquel spasme les nerfs sont retraisAuteur : LANFRANC - Source : f° 20
- Spasme n'est nule fois entroduit en la plaie, se forte doulour ne va devantAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 66
- Le mire [médecin], devant parfait nettoiement du panicle [périoste], consolida la plaie dehors ; dont le panicle s'endaigna, et fu cause de spasmeAuteur : LANFRANC - Source : f° 20
- Les diverses espoisses du spasmeAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : ib. f° 66
- La maniere qui est preservative que spasme ne soit engendré es plaiesAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 64, verso.
- Tel spasme [pâmoison] luy dura tant sans revenir à soy.... Don Flores de Grece, f° 146. Un spasme, une foiblesse, un morne estonnement Qui pallit mon visageAuteur : DESPORTES - Source : Oeuvres, p. 281, dans LACURNE
- Spasme ou convulsion est retraction et mouvement involontaire des nerfs, et par consequent des muscles....Auteur : PARÉ - Source : VII, 8
- Spasme est accident damagableAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 47, verso.
- Spasme qui est fait en la plaie pour le nerf ou pour la corde ou semblable, en lieu touchable....Auteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 66
Les mots débutant par Spa Les mots débutant par Sp
Une suggestion ou précision pour la définition de Spasme ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 22h47

- Sacrifice - Sacrilege - Sage - Sagesse - Sagesse_populaire - Saint_Valentin - Salete - Sante - Santé - Sante - Satisfaction - Satyre - Savant - Savoir - Savoir_vivre - Scandale - Scepticisme - Science - Scrupule - Sculpture - Secret - Secte - Seigneur - Sein - Semblable - Sens - Sensibilite - Sentiment - Separation - Séparation - Serenite - Sérénité - Sérieux - Service - Servitude - Seul - Seule - Sexe - Sexologie - Sexualite - Silence - Simplicite - Sincère - Sincerite - Sincérité - Singe - Snob - Sobre - Sociabilite - Societe - Sociologie - Sodomie - Soi_même - Soleil - Solitude - Solution - Sommeil - Sondage - Songe - Sot - Sottise - Soucis - Souffrance - Souffrir - Soulage - Soupçon - Sourire - Souvenir - Specialiste - Spectacle - Sport - Stabilite - Star - Statistiques - Stimulation - Stress - Style - Subjonctif - Succes - Suggestion - Suicide - Superflu - Superiorite - Supermarche - Superstition - Supplice - Survie - Suspicion - Systeme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur spasme
Poèmes spasme
Proverbes spasme
La définition du mot Spasme est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Spasme sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Spasme présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
