Définition de « ironie »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot ironie de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur ironie pour aider à enrichir la compréhension du mot Ironie et répondre à la question quelle est la définition de ironie ?
Une définition simple : (fr-rég|i.??.ni) ironie (f)
Définitions de « ironie »
Trésor de la Langue Française informatisé
IRONIE, subst. fém.
 ). Signe de ponctuation proposé par Alcanter de Brahm pour indiquer au lecteur les passages, les phrases ironiques. Alcanter de Brahm imagina sur la fin du xixesiècle un signe [
). Signe de ponctuation proposé par Alcanter de Brahm pour indiquer au lecteur les passages, les phrases ironiques. Alcanter de Brahm imagina sur la fin du xixesiècle un signe [ ] qu'il nomma point d'ironie (A. Doppagne, La Bonne ponctuation, Paris, Duculot, 1978, p. 57).
] qu'il nomma point d'ironie (A. Doppagne, La Bonne ponctuation, Paris, Duculot, 1978, p. 57).Wiktionnaire
Nom commun - français
ironie \i.??.ni\ féminin
-
(Rhétorique) Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre.
- Ce compliment n'est qu'une ironie.
- L'ironie abonde dans les lettres provinciales, dans les lettres persanes.
- Il a une grande facilité à manier l'ironie.
- Il y a un tour de Fiction, au moyen duquel la pen?ée ne doit pas être entendue littéralement comme elle e?t énoncée, mais qui lai??e apercevoir le véritable point de vûe en le rendant ?eulement plus ?en?ible & plus intére??ant par la Fiction même. De là naissent l'Hyperbole, la Litote, l'Interrogation, la Dubitation, la Prétérition, la Réticence, l'Interruption, le Dialogi?me, l'Épanortho?e, l'Épitrope, & l'Ironie ; celle-ci ?e ?oudivi?e, à raison des points de vûe ou des tons, en ?ix e?pèces ; ?avoir, la Mimè?e, le Chleua?me ou Per?ifflage, l'A?téi?me, le Charienti?me, le Dia?irme, & le Sarca?me. ? (Encyclopédie méthodique : Grammaire et Littérature, tome second, Panckoucke / Plomteux, Paris / Liège, 1784)
- Ces quatre sources sont 1° le besoin ; 2° le pléonasme ; 3° la métathèse ; 4° l'énallage. Parmi les figures de pensées, au nombre de dix-huit, il [Ph?bammon] en distingue deux nées du besoin : l'aposiopèse et l'épitrochasmos ; six nées du pléonasme : la prodiorthose, l'épidiorthose, la procatalepse, la paralipse, la diotypose, l'épimone ; six nées de la métathèse : la prosopopée, l'éthopée, la figure appelée ??????, parce qu'elle tient de l'une et de l'autre, l'interrogation appelée ????????, l'interrogation appelée ??????, et la prétérition ; quatre nées de l'énallage : l'ironie, la dubitation, l'allusion satirique, l'apostrophe. ? (Étienne Gros, Étude sur l'état de la rhétorique chez les Grecs, Typographie de Firmin Didot Frères, Paris, 1835)
- Quelque citation latine banale de ci, de là, un aphorisme philosophique ou pédagogique, une ironie forcée mais acerbe, rehaussent son prestige. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Des figures de style comme l'ironie introduisent la possibilité que l'orateur dise autre chose que ce qu'il pense, qu'il use de détours, qu'il cache le fond de sa pensée, voire qu'il mente. ? (Marie de Gandt, Sous la plume. Petite exploration du pouvoir politique, Éditions Robert Laffont, Paris, 2013, page 152)
- Attitude sarcastique par laquelle on regarde les autres de haut.
- Un malentendu existe entre lui et les simples mortels [?] Il arbore superbement un scepticisme, un snobisme de décadence qui leur reste inaccessible et fermé. Son ironie naturelle les gêne et les déconcerte. Il est ennuyé, blasé [?] ? (Anatole Claveau, Le Tout-Paris, dans Sermons laïques, Paul Ollendorff, Paris, 1898, 3e éd., page 31)
- J'ai rêvé d'un ironiste qui, un beau jour, tout à coup, perdait son ironie. ? (Franc-Nohain [Maurice Étienne Legrand], Guide du bon sens, Éditions des Portiques, 1932)
- Mon ironie, ce cynisme des eunuques volontaires, s'accompagne d'une fascination absolue pour les idées fixes des autres. ? (Philippe Delaroche, Caïn et Abel avaient un frère, Éditions de l'Olivier / Le Seuil, 2000, page 15)
- Propos sarcastiques.
- Lancelot du Lac ? Je serai là dans peu de temps. Quand je rallumerai ce feu, Arthur sera mort. C'est tout, c'est simple, ça se passe de vos ironies. ? (Kaamelot, livre V, épisode 28, Exsecutor)
- Toutefois, dans son aveuglement judéophobique, il fait de cette ironie non pas un simple bon mot, fruit éphémère d'un jeu de manche rhétorique, mais une attaque en règle contre les Juifs de Rome. ? (Philippe Borgeaud, À chacun sa religion, chapitre 11 de Exercices d'histoire des religions: Comparaisons, rites, mythes et émotions, textes réunis & édités par Daniel Barbu & Philippe Matthey, Boston : Brill, 2016, page 177)
-
(Figuré) Ce qui, dans sa dérision ou sa contradiction, ressemble à une plaisanterie.
- Le lieutenant-colonel du Paty de Clam est en prison. Ô lendemains des jours de victoire. Du Paty de Clam est en prison, et dans la propre cellule de Dreyfus, pour comble d'ironie. ? (Georges Clemenceau, Au Cherche-Midi dans L'Aurore, 3 juin 1899, en réunion dans Justice militaire, Stock, 1901, page 96)
- Il y a une grande ironie : on cherche la perle rare et on tombe sur quelqu'un de banal. ? (Iegor Gran, Entretien avec Daniel Delattre, papyrologue : « Avec la technologie, on a l'impression de comprimer le temps », dans Charlie hebdo n° 1240 du 27 avril 2016, page 15)
- Ironie de l'actualité, le procès de l'Union des banques suisses (UBS) s'est ouvert au début d'octobre à Paris, pour démarchage illicite de clients français. ? (Mathilde Damgé, Comment la France a raté le coche de la fin du secret bancaire suisse, Le Monde. Mis en ligne le 18 octobre 2018)
- Les cinquante titres récupèrent et déroutent, avec un zeste d'ironie et, parfois, avec un léger effet captieux, le lexique sur la pandémie de COVID-19, le vocabulaire et les syntagmes titrés dans les journaux.? (Cornéliu Tocan, Aux confins de l'invisible. Haïkus d'intérieur illustrés, Créatique, Québec, 2020, page 8)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Ce compliment n'est qu'une ironie. L'ironie abonde dans les Lettres provinciales, dans les Lettres persanes. Il a une grande facilité à manier l'ironie. Par extension,
IRONIE signifie plus ordinairement Moquerie sarcastique dans le ton ou dans l'attitude. Il l'intimidait par son ironie continuelle. Il y avait de l'ironie dans sa façon de le regarder. Il dit cela par ironie. Ironie fine. Ironie amère, cruelle. Il mit dans ses paroles une nuance d'ironie. Ironie socratique, se dit des Interrogations par lesquelles Socrate, discutant avec les sophistes, les amenait peu à peu à se contredire. Fig., Ironie du sort, Accident qui arrive à quelqu'un si fort à contretemps qu'il paraît une moquerie du sort; ou encore, Contraste étrange que présentent deux faits historiques rapprochés par quelque côté. C'est comme par une ironie du sort que le dernier empereur d'Occident s'appela Romulus Auguste.
Littré
- 1Proprement, ignorance simulée, afin de faire ressortir l'ignorance réelle de celui contre qui on discute?; de là l'ironie socratique, méthode de discussion qu'employait Socrate pour confondre les sophistes.
-
2 Par extension, raillerie particulière par laquelle on dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre. Ce compliment n'est qu'une ironie.
Dans les premières paroles que Dieu a dites à l'homme depuis sa chute, on trouve un discours de moquerie et une ironie piquante, selon les Pères
, Pascal, Prov. X.Voilà l'homme qui est devenu comme l'un de nous, ce qui est une ironie sanglante et sensible dont Dieu le piquait vivement, selon saint Chrysostome et les interprètes
, Pascal, ib.Il a une facilité merveilleuse à manier l'ironie
, Boileau, Sublime, 28.Point d'injures, beaucoup d'ironie et de gaieté?; les injures révoltent, l'ironie fait rentrer les gens en eux-mêmes, la gaieté désarme
, Voltaire, Lett. d'Argental, 18 mai 1772.Il [Racine] met quelques ironies dans la bouche d'Hermione
, Voltaire, Comm. Corn. Médée, II, 2.Le roi le lui fit sentir froidement, avec une nuance d'ironie
, Genlis, Mme de Maintenon, t. II, p. 109, dans POUGENS.Et l'ironie au ris moqueur
, Delille, Convers. III.Toujours son ironie, inféconde et morose
, Hugo, Chants du crépuscule, XII.Par extension, retour sur soi-même par lequel, semblant se moquer du malheur, on en exprime plus fortement l'impression.
Il y a une autre espèce d'ironie qui est un retour sur soi-même, et qui exprime parfaitement l'excès du malheur?; c'est ainsi qu'Oreste dit dans l'Andromaque?: Oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance
, Voltaire, Comm. Corn. Rem. Médée, II, 2.Fig. L'ironie du sort, événement malheureux qui semble être une moquerie du destin.
Cette amère ironie du malheur
, Staël, Corinne, XVII, 4.
HISTORIQUE
XIVe s. Yronie est quant l'en dit une chose par quoy l'en veult donner à entendre le contrairo
, Oresme, Thèse de MEUNIER.
Encyclopédie, 1re édition
IRONIE, sub. fém. (Gram.) « c'est, dit M. du Marsais, Tropes II. xiv. une figure par laquelle on veut faire entendre le contraire de ce qu'on dit?
» M. Boileau, qui n'a pas rendu à Quinault toute la justice que le public lui a rendue depuis, en parle ainsi par ironie ». Sat. 9.
Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire ;
Et pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis,
Réparer en mes vers les maux qu'ils ont commis :
Puisque vous le voulez, je vais changer de style.
Je le déclare donc, Quinault est un Virgile.
Lorsque les prêtres de Baal invoquoient vainement cette fausse divinité, pour en obtenir un miracle que le prophete Elie savoit bien qu'ils n'obtiendroient pas ; ce saint homme les poussa par une ironie excellente ; III. Reg. xviij. 27. il leur dit : Clamate voce majore ; Deus enim est, & forsitan loquitur, aut in diversorio est, aut in itinere, aut certè dormit, ut excitetur.
L'épître du P. du Cerceau à M. J. D. F. A. G. A. P. (Joli de Fleuri, avocat général au parlement) est une ironie perpétuelle, pleine de principes excellens cachés sous des contre-vérités ; mais l'auteur, en s'y plaignant de la décadence du bon goût, y devient quelquefois la preuve de la vérité & de la justice de ses plaintes.
« Les idées accessoires, dit M. du Marsais, ibid. sont d'un grand usage dans l'ironie : le ton de la voix, & plus encore la connoissance du mérite ou du démérite personnel de quelqu'un, & de la façon de penser de celui qui parle, servent plus à faire connoître l'ironie, que les paroles dont on se sert. Un homme s'écrie, ô le bel esprit ! Parle-t-il de Cicéron, d'Horace ; il n'y a point-là d'ironie ; les mots sont pris dans le sens propre. Parle-t-il de Zoïle ; c'est une ironie : ainsi l'ironie fait une satyre, avec les mêmes paroles dont le discours ordinaire fait un éloge ».
Quintilien distingue deux especes d'ironie, l'une trope, & l'autre figure de pensée. C'est un trope, selon lui, quand l'opposition de ce que l'on dit à ce que l'on prétend dire, ne consiste que dans un mot ou deux ; comme dans cet exemple de Cicéron, 1. Catil. cité par Quintilien même : à quo repudiatus, ad sodalem tauri, virum optimum M. Marcellum demigrasti, où il n'y a en effet d'ironie que dans les deux mots virum optimum. C'est une figure de pensée, lorsque d'un bout à l'autre le discours énonce précisément le contraire de ce que l'on pense : telle est, par exemple, l'ironie du P. du Cerceau, sur la décadence du goût. La différence que Quintilien met entre ces deux especes est la même que celle de l'allégorie & de la métaphore ; ut quemadmodum ?????????? facit continua ????????, sic hoc schema faciat troporum ille contextus. Inst. orat. IX. iij.
N'y a-t-il pas ici quelque inconséquence ? Si les deux ironies sont entre elles comme la métaphore & l'allégorie, Quintilien a dû regarder également les deux premieres especes comme des tropes, puisqu'il a traité de même les deux dernieres. M. du Marsais plus conséquent, n'a regardé l'ironie que comme un trope, par la raison que les mots dont on se sert dans cette figure, ne sont pas pris, dit-il, dans le sens propre & littéral : mais ce grammairien ne s'est-il pas mépris lui-même ?
« Les tropes, dit-il, Part. I. art. iv. sont des figures par lesquelles on fait prendre à un mot une signification qui n'est pas précisément la signification propre de ce mot ».
Or il me semble que dans l'ironie il est essentiel que chaque mot soit pris dans sa signification propre ; autrement l'ironie ne seroit plus une ironie, une mocquerie, une plaisanterie, illusio, comme le dit Quintilien, en traduisant littéralement le nom grec ????????. Par exemple, lorsque Boileau dit, Quinault est un Virgile ; il faut 1°. qu'il ait pris d'abord le nom individuel de Virgile, dans un sens appellatif, pour signifier par autonomase excellent poëte : 2°. qu'il ait conservé à ce mot ce sens appellatif, que l'on peut regarder en quelque sorte comme propre, relativement à l'ironie ; sans quoi l'auteur auroit eû tort de dire,
- Puisque vous le voulez, je vais changer de style ;
Il avoit assez dit autrefois que Quinault étoit un mauvais poëte, pour faire entendre que cette fois-ci changeant de style, il alloit le qualifier de poëte excellent. Ainsi le nom de Virgile est pris ici dans la signification que l'autonomase lui a assignée ; & l'ironie n'y fait aucun changement. C'est la proposition entiere ; c'est la pensée qui ne doit pas être prise pour ce qu'elle paroît être ; en un mot, c'est dans la pensée qu'est la figure. Il y a apparence que le P. Jouvency l'entendoit ainsi, puisque c'est parmi les figures de pensées qu'il place l'ironie : & Quintilien n'auroit pas regardé comme un trope le virum optimum que Cicéron applique à Marcellus, s'il avoit fait réflexion que ce mot suppose un jugement accessoire, & peut en effet se rendre par une proposition incidente, qui est vir optimus. (B. E. R. M.)
Étymologie de « ironie »
Provenç. espagn. ironia?; du lat. ironia, qui vient du grec ????????, ironie.
- (XIIIe siècle) Apparaît sous la graphie yronie. Emprunté au latin ironia, lui même du grec ancien ????????, eirôneía (« action d'interroger en feignant l'ignorance »), dérivé du participe présent ????? (« qui interroge, et par extension qui feint l'ignorance ») du verbe ?????? (« demander, interroger »).
- Le grec classique, essentiellement grâce à Platon et à Aristophane, possédait un système remarquablement complet et cohérent de termes créés par suffixation à partir du radical eirô-. Leurs équivalents modernes ironique, ironiquement, ironiste, ironiser, ironisme, ne rendent pas suffisamment compte de l'étymon « question faussement naïve » qui fonde l'ironie inventée par la fameuse maïeutique de Socrate.
- L'ironia du latin classique ne garde de ses origines grecques que la notion de « fausseté » ; c'est une dissimulatio, c'est-à-dire une forme de plaisanterie ou de raillerie dissimulée sous un ton sérieux et qui consiste, par inversio verborum, à dire le contraire de ce qu'on veut dire.
- (XIIIe siècle) Apparaît sous la graphie yronie. Emprunté au latin ironia, lui même du grec ancien ????????, eirôneía (« action d'interroger en feignant l'ignorance »), dérivé du participe présent ????? (« qui interroge, et par extension qui feint l'ignorance ») du verbe ?????? (« demander, interroger »).
- Le grec classique, essentiellement grâce à Platon et à Aristophane, possédait un système remarquablement complet et cohérent de termes créés par suffixation à partir du radical eirô-. Leurs équivalents modernes ironique, ironiquement, ironiste, ironiser, ironisme, ne rendent pas suffisamment compte de l'étymon « question faussement naïve » qui fonde l'ironie inventée par la fameuse maïeutique de Socrate.
- L'ironia du latin classique ne garde de ses origines grecques que la notion de « fausseté » ; c'est une dissimulatio, c'est-à-dire une forme de plaisanterie ou de raillerie dissimulée sous un ton sérieux et qui consiste, par inversio verborum, à dire le contraire de ce qu'on veut dire.
Mise à jour de la notice étymologique par le programme de recherche TLF-Étym :
Histoire :
A. « figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre ». Attesté depuis 2e quart 13e siècle (Marshall, Miroir in AND1 = DEAF : Ceste demande est ironie, Ço est eschar [« moquerie, raillerie »] u gaberie [« plaisanterie »]). -
B. « ignorance simulée, s'exprimant en des interrogations naïves ». Attesté depuis 1654 (Guez De Balzac, Dissertations critiques, page 668, dissertation 23, in Frantext : et s'il avoit pris, à parler sans embarras, la peine qu'on prend, à debarrasser ses paroles, il n'y auroit point eu de proces. On n'auroit recours, ni à l'interrogation, ni à l'ironie : son attention nous eust espargné la nostre, et nous nous fussions bien passez du soin que nous donne sa negligence). -
Origine :
Transfert linguistique : emprunt au latin ironia subst. fém. « sens philosophique, méthode interrogative qu'employait Socrate pour confondre les sophistes », « trope » (attestés depuis Cicéron, < grec ?????????, TLL 7/2, 381?382). Cf. von Wartburg in FEW 4, 814a, ironia ; Städtler in DEAF I, 443.
Rédaction TLF 1983 : Équipe diachronique du TLF. - Mise à jour 2006 : Aurore Koehl. - Relecture mise à jour 2006 : Nadine Steinfeld ; Thomas Städtler ; Éva Buchi.
ironie au Scrabble
Le mot ironie vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot ironie - 6 lettres, 4 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ironie au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
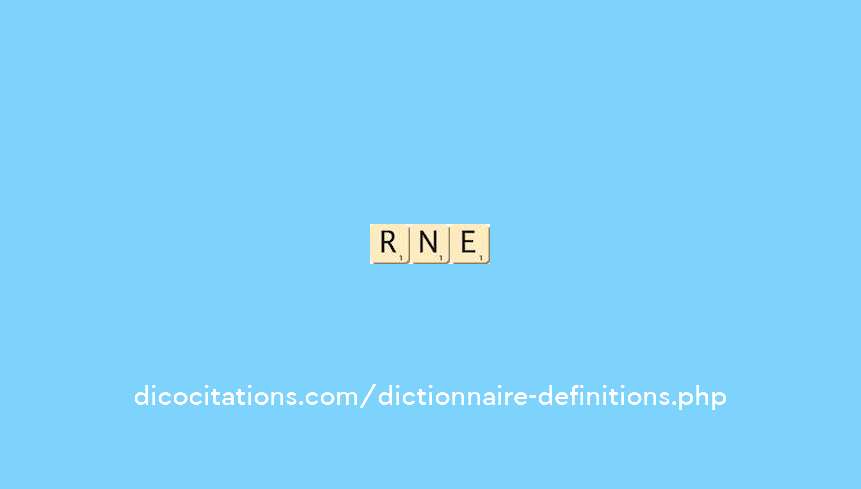
Les rimes de « ironie »
On recherche une rime en NI .
Les rimes de ironie peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ni
Rimes de macaronis Rimes de litanies Rimes de calomnie Rimes de décennie Rimes de symphonie Rimes de tournis Rimes de unit Rimes de mini Rimes de finie Rimes de garnit Rimes de penny Rimes de punit Rimes de tonie Rimes de mnémotechnie Rimes de dévernies Rimes de brunis Rimes de myasthénie Rimes de nient Rimes de télégénie Rimes de garni Rimes de vilenie Rimes de garni Rimes de excommunie Rimes de définit Rimes de plaignis Rimes de érotomanie Rimes de bénies Rimes de blini Rimes de manies Rimes de munis Rimes de démunie Rimes de vernis Rimes de peignit Rimes de omni Rimes de feignit Rimes de unis Rimes de boni Rimes de Mauritanie Rimes de fournies Rimes de cacophonie Rimes de punies Rimes de graphomanie Rimes de manie Rimes de avanies Rimes de béni Rimes de terni Rimes de ironie Rimes de neutropénie Rimes de désharmonie Rimes de redéfinisMots du jour
macaronis litanies calomnie décennie symphonie tournis unit mini finie garnit penny punit tonie mnémotechnie dévernies brunis myasthénie nient télégénie garni vilenie garni excommunie définit plaignis érotomanie bénies blini manies munis démunie vernis peignit omni feignit unis boni Mauritanie fournies cacophonie punies graphomanie manie avanies béni terni ironie neutropénie désharmonie redéfinis
Les citations sur « ironie »
- Point d'injures, beaucoup d'ironie et de gaieté. Les injures révoltent, l'ironie fait rentrer les gens en eux-mêmes, la gaieté désarme.Auteur : Voltaire - Source : Correspondance, au comte d'Argental, 18 mai 1772
- ... Sachant que c'est à l'ironie - Que commence la liberté.Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859), Rupture avec ce qui amoindrit
- Je ne m'exprime librement qu'avec des gens dégagés de toute opinion et placés au point de vue d'une bienveillante ironie universelle.Auteur : Ernest Renan - Source : Sans référence
- Rien ne stérilise tant un écrivain que la poursuite de la perfection. Pour produire, il faut se laisser aller à sa nature, s'abandonner, écouter ses voix..., éliminer la censure de l'ironie ou du bon goût...Auteur : Emil Cioran - Source : Carnets 1957-1972, janvier 1960
- L'inconscience est une protection contre l'ironie.Auteur : Bruno Roy - Source : Les mots conjoints : aphorismes
- L'ironie est une manière de guérilla. Auteur : Georges Picard - Source : Petit traité à l'usage de ceux qui veulent toujours avoir raison (1999)
- Dans l'univers de la mode, à une certaine altitude, la tendance beauf est une valeur sûre. L'équivalent de l'ironie, mais dans un monde sans humour. Auteur : Jean-Christophe Grangé - Source : La Ligne noire
- L'humour, à l'inverse (de l'ironie), est une manifestation de la générosité: sourire de ce qu'on aime c'est l'aimer deux fois plus.Auteur : Christian Bobin - Source : L'éloignement du monde
- Le sens de l'ironie est une forte garantie de liberté.Auteur : Maurice Barrès - Source : Le Culte du Moi, Sous l'oeil des Barbares (1888)
- Songe que l'ironie est la plus grande source des consolations. Aide-la à ronger la douleur qui sommeille dans ton coeur comme dans celui de tous les hommes.Auteur : Maurice Duwez, dit Max Deauville - Source : Contes Persans (1928)
- Rien n’est désagréable comme l’ironie. Celle d’un mort est la pire de toutes. Auteur : Maurice Duwez, dit Max Deauville - Source : Contes Persans (1928)
- Cherchez la profondeur des choses : l'ironie ne descend jamais jusque-là.Auteur : Rainer Maria Rilke - Source : Lettres à un jeune poète 1903-1908 (1929)
- Je déteste tellement le cynisme et l'ironie que j'étais prêt à ne plus utiliser l'humour.Auteur : Dany Laferrière - Source : Contact, l'encyclopédie de la création (Emission de TV canadienne).
- Les martyrs manquent d'ironie et c'est la un défaut impardonnable, car sans l'ironie le monde serait comme une forêt sans oiseaux; l'ironie c'est la gaieté de la réflexion et la joie de la sagesse.Auteur : Anatole France - Source : La Vie littéraire (1888)
- L'univers était né d'une goutte d'ironie dont l'humanité n'est qu'un des sourires.Auteur : Romain Gary - Source : Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable (1975)
- Voilà à peu près ce qu'elle disait : l'héritage, comme le milieu où nous avons grandi et le statut social, sont des cartes que l'on distribue à l'aveuglette au début du jeu. Il n'y a aucune liberté là-dedans : on se contente de prendre ce que le monde nous donne arbitrairement. Mais, poursuivait ta mère, la question est de savoir comment chacun dispose des cartes qu'il a reçues. Il y en a qui jouent formidablement avec des cartes médiocres, et d'autres qui font exactement le contraire : ils gaspillent et perdent tout, même avec des cartes exceptionnelles ! Voilà où réside notre liberté : nous sommes libres de jouer avec les cartes que l'on nous a distribuées. Et nous sommes également libres d'y jouer comme nous l'entendons, en fonction - là est l'ironie - de la chance de chacun, de sa patience, de son intelligence, son intuition et son audace : vertus qui sont également des cartes distribuées au hasard au début du jeu. Que reste-t-il donc de la liberté de choix dans ce cas ? Pas grand-chose, selon ta mère, sauf peut-être la liberté de rire de notre situation ou de la déplorer, de jouer ou de ne plus jouer, d'essayer plus ou moins de comprendre les tenants et les aboutissants ou d'y renoncer, bref - nous avons le choix entre passer notre vie sur le qui-vive ou dans l'inertie. C'est en gros ce que disait ta mère, mais avec des mots à moi. Pas les siens. Avec les siens, je n'en suis pas capableAuteur : Amos Oz - Source : Une histoire d'amour et de ténèbres , 2002
- Je considère la foi comme une ironie, et c'est peut-être pourquoi les seuls élans de foi dont je suis capable sont ceux exigés par l'imagination créatrice, par les fictions qui ne prétendent pas être des faits, et qui donc finissent par dire la vérité.Auteur : Salman Rushdie - Source : La Terre sous ses pieds (1999)
- L'ironie sentimentale est un chien qui aboie à la lune cependant qu'il compisse les tombes.Auteur : Karl Kraus - Source : Dits et contredits (1975)
- Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux; l'ironie, c'est la gaité de la réflexion et la joie de la sagesse.Auteur : Anatole France - Source : La Vie littéraire (1888)
- Sous cette meurtrière ironie, la petite maison de Marie-Anne Sellier restait les volets clos, émouvante de silence et de tristesse.Auteur : Maurice Barrès - Source : La Colline inspirée (1913)
- Ironie de la vie: la femme se donne comme récompense au faible et comme appui au fort. Et personne n'a jamais son dû.Auteur : Cesare Pavese - Source : Le Métier de vivre (1952)
- Je peux bien me décarcasser à faire de l'ironie, elle n'a même pas l'air d'entendre.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Julie de Carneilhan
- La genèse d'un esprit: 1, stupéfaction, 2, ironie, 3, enthousiasme.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 17 avril 1896
- Les esprits forts savent-ils qu'on les appelle ainsi par ironie? Quelle plus grande faiblesse que d'être incertains quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin?Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 16, I, Des femmes
- Les gens qui ne peuvent pas admettre l'ironie me donnent de l'inquiétude à leur propre sujet.Auteur : Sacha Guitry - Source : L'Esprit (1958)
Les mots proches de « ironie »
Ironie Ironique Ironiquement Ironiser IronisteLes mots débutant par iro Les mots débutant par ir
Irodouër Iron ironie ironies ironique ironiquement ironiques ironisa ironisai ironisais ironisait ironise ironisé ironisent ironiser ironisme ironiste irons iront iroquois iroquois iroquoise Irouléguy
Les synonymes de « ironie»
Les synonymes de ironie :- 1. humour
2. esprit
3. verve
4. malice
5. légèreté
6. persiflage
7. moquerie
8. raillerie
9. sarcasme
10. gaieté
11. dérision
12. plaisanterie
13. quolibet
14. lazzi
15. pointe
synonymes de ironie
Fréquence et usage du mot ironie dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « ironie » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot ironie dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Ironie ?
Citations ironie Citation sur ironie Poèmes ironie Proverbes ironie Rime avec ironie Définition de ironie
Définition de ironie présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot ironie sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot ironie notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
