Définition de « m »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot m de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur m pour aider à enrichir la compréhension du mot M et répondre à la question quelle est la définition de m ?
Une définition simple : (lettre|m|M|?m) m (m) (inv) (anciennement (f))
Définitions de « m »
Trésor de la Langue Française informatisé
M, m, subst. masc.
La treizième lettre de l'alphabet; un spécimen de cette lettre:M, m, subst. masc.
La treizième lettre de l'alphabet; un spécimen de cette lettre:Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Une M. La treizième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Quand M est précédée de A, E I ou Y, O, U, elle forme souvent avec cette lettre une voyelle nasale, et, par suite, ne se prononce pas, comme dans Champ, Chambre, Temple, Sembler, Faim, Timbre, Thym, Bombe, Dompter, Ombre, Parfum. Elle ne se prononce pas non plus dans Damné, Automne. Elle se prononce, au contraire, dans certains mots d'origine latine ou étrangère, comme Album, Ultimatum, Pensum, Abraham, Jérusalem, Éphraïm, Stockholm. Quand l'M est redoublée, après A, E I ou Y, O, U, tantôt la seconde m seule se prononce, comme dans Gramme, Femme, Homme, Somme, tantôt les deux M se prononcent, comme dans Grammaire, Immédiatement, Immense, Comminatoire. Lorsque cette lettre est redoublée dans les mots composés de la préposition En, la première m se prononce comme n. Ainsi on prononce Emmener, Emmailloter, etc., comme si on écrivait Enmener, Enmailloter. Elle se prononce également dans certains mots où cette lettre est suivie de l'n comme Amnistie, Somnifère, Memnon.
Littré
-
1La treizième lettre de notre alphabet. Une M majuscule.
Pour le B, la lèvre supérieure prend son appui au-dessous de l'inférieure?; et pour l'M les deux lèvres, d'un mouvement égal, ne font que s'unir et se détacher
, Marmontel, Élém. litt. ?uv. t. VIII, p. 504, dans POUGENS.Ici l'M à son tour sur ses trois pieds se dresse
, De Piis, Harmon. imit. I. - 2Suivant l'épellation nouvelle, M se nomme me et est masculin?: un me majuscule.
- 3M, devant un nom propre, signifie monsieur?; MM signifie messieurs?; Mme signifie madame?; et Mlle signifie mademoiselle.
-
4Dans les chiffres romains, M est le signe numérique de 1000. CM veut dire 900.
Surmontée d'une ligne horizontale, cette lettre vaut mille fois 1000, ou un million.
- 5M est la marque des anciennes monnaies françaises qui ont été frappées à Toulouse. M M. celles des monnaies fabriquées à Marseille.
- 6Les médecins, dans leurs ordonnances, se servent de la lettre M pour signifier une mesure qui se nomme manipule?; et pour le mot latin misce, qui signifie mêlez, ou mixtio, mélange (f. m. s. a.?: fiat mixtio secundum artem).
HISTORIQUE
XIIIe s. La bone loi nous vint par m, Qui des lettres est dame et geme?; M a trois piés en sa figure
, Senefiance de l'ABC, dans JUBINAL, t. II, p. 280.
Encyclopédie, 1re édition
, Subs. fém. (Gram.) c'est la treizieme lettre
& la dixieme consonne de notre alphabet : nous la nommons emme ; les Grecs
la nommoient mu, ??, & les Hébreux men. La facilité
de l'épellation demande qu'on la prononce me
avec un e muet ; & ce nom alors n'est plus féminin,
mais masculin.
L'articulation représentée par la lettre M est labiale & nasale : labiale, parce qu'elle exige l'approximation des deux levres, de la même maniere que pour l'articulation B ; nasale, parce que l'effort des levres ainsi rapprochées, fait refluer par le nez une partie de l'air sonore que l'articulation modifie, comme on le remarque dans les personnes fort enrhumées qui prononcent b pour m, parce que le canal du nez est embarrassé, & que l'articulation alors est totalement orale.
Comme labiale, elle est commuable avec toutes les autres labiales b, p, v, f ; c'est ainsi que scabellum vient de scamnum, selon le témoignage de Quintilien ; que fors vient de ?????, que pulvinar vient de pluma : cette lettre attire aussi les deux labiales b & p, qui sont comme elle produites par la réunion des deux lettres ; ainsi voit-on le b attiré par m dans tombeau dérivé de tumulus, dans flambeau formé de flamme, dans ambigo composé de am & ago ; & p est introduit de même dans promptus formé de promotus, dans sumpsi & sumptum qui viennent de sumo.
Comme nasale, la lettre ou articulation M se change aussi avec N : c'est ainsi que signum vient de ?????, nappe de mappa, & natte de matta, en changeant m en n ; au contraire amphora vient de ???????, amplus de ????????, abstemius d'abstineo, sommeil de somnus, en changeant n en m.
M obscurum in extremitate, dit Priscien (lib. I. de accid. litt.) ut templum : apertum in principio, ut magnus : mediocre in mediis, ut umbra. Il nous est difficile de bien distinguer aujourd'hui ces trois prononciations différentes de m, marquées par Priscien : mais nous ne pouvons guere douter qu'outre sa valeur naturelle, telle que nous la démêlons dans manie, m?urs, &c. elle n'ait encore servi, à peu-près comme parmi nous, à indiquer la nasalité de la voyelle finale d'un mot ; & c'est peut-être dans cet état que Priscien dit, M obscurum in extremitate, parce qu'en effet on n'y entendoit pas plus distinctement l'articulation m, que nous ne l'entendons dans nos mots françois nom, faim. Ce qui confirme ce raisonnement, c'est que dans les vers toute voyelle finale, accompagnée de la lettre m, étoit sujette à l'élision, si le mot suivant commençoit par une voyelle :
Divisum imperium cum Jove Cæsar habet :
dans ce tems-là même, si l'on en croit Quintilien, Inst. IX. 4. ce n'est pas que la lettre m fût muette, mais c'est qu'elle avoit un son obscur : adeo ut penè cujusdam novæ litteræ sonum reddat ; neque enim eximitur, sed obscuratur. C'est bien là le langage de Priscien.
« On ne sauroit nier, dit M. Harduin, Rem. div. sur la prononc. p. 40. que le son nasal n'ait été connu des anciens. Nicod assûre, d'après Nigidius Figulus, auteur contemporain & ami de Cicéron, que les Grecs employoient des sons de ce genre devant les consonnes y, x ». Mais Cicéron lui-même & Quintilien nous donnent assez à entendre que m à la fin étoit le signe de la nasalité. Voici comme parle le premier, Orat. XXII. p. 156. Quid ? illud non det unde sit, quod dicitur cum illis, cum autem nobis non dicitur, sed nobiscum ? Quia si ita diceretur, obscænius concurrerent litteræ, ut etiam modò, nisi autem inter posuissem, concurrissent. Quintilien, Instit. VIII. 3. s'exprime ainsi dans les mêmes vûes, & d'après le même principe : Vitanda est junctura deformiter sonans, ut si cum hominibus notis loqui nos dicimus, nisi hoc ipsum hominibus medium sit, in ????????? videmur incidere : quia ultima prioris syllabæ littera (c'est la lettre m de cum) quæ exprimi nisi labris coëuntibus non potest, aut ut intersistere nos indecentissimè cogit, aut continuata cùm N insequente in naturam ejus corrumpitur. Cette derniere observation est remarquable. si on la compare avec une autre remarque de M. Harduin : ibid. « Le même Nigidius, dit-il, donne à entendre que chez les Latins n rendoit aussi la voyelle nasale dans anguis, increpat, & autres mots semblables : in his, dit-il, non verum n, sed adulterinum ponitur ; nam si ea littera esset, lingua palatum tangeret ». Si donc on avoit mis de suite cum nobis ou cum notis, il auroit fallu s'arrêter entre deux, ce qui étoit, selon la remarque de Quintilien, de très-mauvaise grace ; ou, en prononçant les deux mots de suite, vu que le premier étoit nasal, on auroit entendu la même chose que dans le mot obscène, cunno, où la premiere étoit apparemment nasale conformément à ce que nous venons d'apprendre de Nigidius.
Qu'il me soit permis, à cette occasion, de justifier notre ortographe usuelle, qui représente les voyelles nasales par la voyelle ordinaire suivie de l'une des consonnes m ou n. J'ai prouvé, article H, qu'il est de l'essence de toute articulation de précéder le son qu'elle modifie ; c'est donc la même chose de toute consonne à l'égard de la voyelle. Donc une consonne à la fin d'un mot doit ou y être muette, ou y être suivie d'une voyelle prononcée, quoique non écrite : & c'est ainsi que nous prononçons le latin même dominos, crepat, nequit, comme s'il y avoit dominose, crepate, nequite avec l'e muet françois ; au contraire, nous prononçons il bat, il promet, il fit, il crut, sabot, &c. comme s'il y avoit il ba, il promè, il fi, il cru, sabo sans t. Il a donc pu être aussi raisonnable de placer m ou n à la fin d'une syllabe, pour y être des signes muets par rapport au mouvement explosif qu'ils représentent naturellement, mais sans cesser d'indiquer l'émission nasale de l'air qui est essentielle à ces articulations. Je dis plus : il étoit plus naturel de marquer la nasalité par un de ces caracteres à qui elle est essentielle, que d'introduire des voyelles nasales diversement caractérisées : le méchanisme de la parole m'en paroît mieux analysé ; & l'on vient de voir, en effet, que les anciens Grecs & Latins ont adopté ce moyen suggéré en quelque sorte par la nature.
Quoi qu'il en soit, la lettre m à la fin du mot est en françois un simple signe de la nasalité de la voyelle précedente ; comme dans nom, pronom, faim, thim, &c. il faut excepter l'interjection hem, & les noms propres étrangers, où l'm finale conserve sa véritable prononciation ; comme Sem, Cham, Jérusalem, Krim, Stokolm, Salm, Surinam, Amsterdam, Rotterdam, Postdam, &c. Il y en a cependant quelques-uns où cette lettre n'est qu'un signe de nasalité, comme Adam, Absalom : & c'est de l'usage qu'il faut apprendre ces différences, puisque c'est l'usage seul qui les établit sans égard pour aucune analogie.
M au milieu des mots, mais à la fin d'une syllabe, est encore un signe de nasalité, quand cette lettre est suivie de l'une des trois lettres m, b, p ; comme dans emmener, combler, comparer. On en excepte quelques mots qui commencent par imm, comme immodeste, immodestie, immodestement, immaculée conception, immédiat, immédiatement, immatriculé, immatriculation, immense, immensité, immodéré, immunité, &c. on y fait sentir la réduplication de l'articulation m.
On prononce aussi l'articulation m dans les mots où elle est suivie de n, comme indemniser, indemnité, amnistie, Agamemnon, Memnon, Mnémosine, &c. excepté damner, solemnel, & leurs dérivés où la lettre m est un signe de nasalité.
Elle l'est encore dans comte venu de comitis, dans compte venu de computum, dans prompt venu de promptus, & dans leurs dérivés.
M. l'abbé Regnier, Gramm. franç. in-12. p. 37. propose un doute sur quatre mots, contemptible, qui n'est, dit-il, plus guere en usage, exemption, rédemption & rédempteur, dans lesquels il semble que le son entier de m se fasse entendre. A quoi il répond : « Peut-être aussi que ce n'est qu'une illusion que fait à l'oreille le son voisin du p rendu plus dur par le t suivant. Quoi qu'il en soit, la différence n'est pas assez distinctement marquée pour donner lieu de décider là-dessus ». Il me semble qu'aujourd'hui l'usage est très-décidé sur ces mots : on prononce avec le son nasal exemt, exemption, exemtes sans p ; & plusieurs même l'écrivent ainsi, & entre autres le rédacteur qui a rendu portatif le dictionnaire de Richelet ; le son nasal est suivi distinctement du p dans la prononciation & dans l'orthographe des mots contempteur, contemptible, rédemption, rédempteur.
M en chiffres romains signifient mille ; une ligne horisontale au-dessus lui donne une valeur mille fois plus grande, M vaut mille fois mille ou un million.
M, dans les ordonnances des Médecins, veut dire misce, mêlez, ou manipulus, une poignée ; les circonstances décident entre ces deux sens.
M, sur nos monnoies, indique celles qui sont frappées à Toulouse.
M, (Ecriture.) dans sa forme italienne, ce sont trois droites & trois courbes ; la premiere est un I, sans courbe ; la seconde est un I parfait, en le regardant du côté de sa courbe ; la troisieme est la premiere, la huitieme, la troisieme, la quatrieme & la cinquieme partie de l'O. L'm coulée est faite de trois i liés ensemble. Il en est de même de l'm ronde.
Ces trois m se forment du mouvement composé des doigts & du poignet. Voyez les Planches d'Ecriture.
Étymologie de « m »
Lat. m (dit em suivant Priscien)?; grec ???; du phénicien mim.
m au Scrabble
Le mot m vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot m - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot m au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
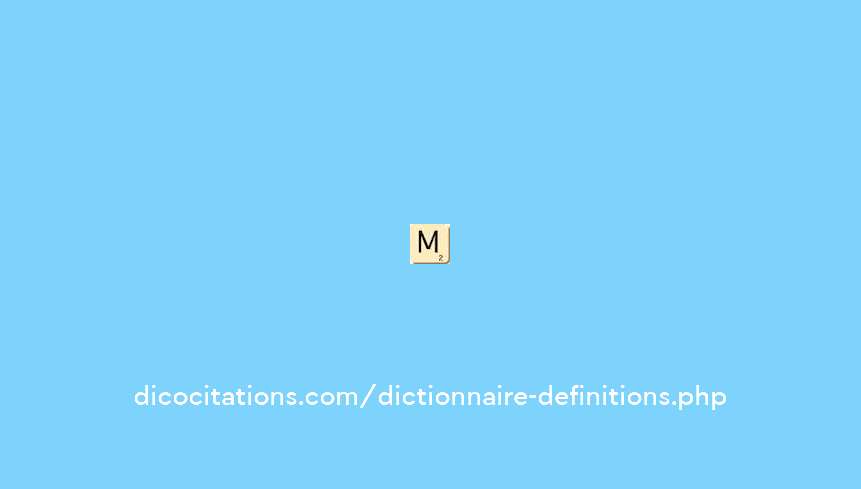
Les rimes de « m »
On recherche une rime en EM .
Les rimes de m peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Em
Rimes de Beernem Rimes de Eliksem Rimes de Ledegem Rimes de café-crème Rimes de Idegem Rimes de bohèmes Rimes de Boorsem Rimes de cinquièmes Rimes de Ooigem Rimes de Strijtem Rimes de dixièmes Rimes de Balegem Rimes de louchébème Rimes de trente-huitième Rimes de Godveerdegem Rimes de crème Rimes de Vinkem Rimes de suprême Rimes de quarante-troisième Rimes de Rekem Rimes de Anzegem Rimes de Zomergem Rimes de blêmes Rimes de Zwevegem Rimes de Snellegem Rimes de Veldegem Rimes de cinquièmes Rimes de neuvièmes Rimes de Zonnegem Rimes de douzièmes Rimes de Elsegem Rimes de moi-même Rimes de extrême Rimes de vingtième Rimes de ixième Rimes de Landegem Rimes de Brustem Rimes de Okegem Rimes de centième Rimes de trente-quatrième Rimes de deuxièmes Rimes de suprêmes Rimes de millionième Rimes de modem Rimes de nième Rimes de quantièmes Rimes de Hundelgem Rimes de quarante-huitième Rimes de cinquante-sixième Rimes de crèmeMots du jour
Beernem Eliksem Ledegem café-crème Idegem bohèmes Boorsem cinquièmes Ooigem Strijtem dixièmes Balegem louchébème trente-huitième Godveerdegem crème Vinkem suprême quarante-troisième Rekem Anzegem Zomergem blêmes Zwevegem Snellegem Veldegem cinquièmes neuvièmes Zonnegem douzièmes Elsegem moi-même extrême vingtième ixième Landegem Brustem Okegem centième trente-quatrième deuxièmes suprêmes millionième modem nième quantièmes Hundelgem quarante-huitième cinquante-sixième crème
Les citations sur « m »
- Elle faisait l'amour comme on se taille une tranche de pain. Tous ses mouvements avaient la précision d'une machine.Auteur : Albert Ehrenstein - Source : Tubutsch
- Les défaites d'un homme ne jugent pas les circonstances mais lui-même.Auteur : Albert Camus - Source : Le mythe de Sisyphe (1942)
- Toujours, ou presque toujours, les hommes ont poursuivi la vérité absolue, le mot de la charade, la suprême pensée.Auteur : André Maurois - Source : Etudes littéraires, IV, 3
- L'amour et la haine sont un voile devant les yeux: l'un ne laisse voir que le bien; et l'autre, que le mal.Auteur : Proverbes arabes - Source : Proverbe
- Telle femme eût résisté à l'amour qu'elle éprouve, qui ne résiste pas à l'amour qu'elle inspire.Auteur : Cécile Brucy, dite Cécile Fée - Source : Pensées (1832)
- C'est se manquer à soi-même que de manquer à ce qu'on doit aux autres.Auteur : Stanislas Leszczynski - Source : Pensées diverses in Oeuvres choisies de Stanislas I, Roi de Pologne
- Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- La compagnie de ma famille suffit amplement à mon bonheur et la modestie chaleureuse des petits logis en bois me convient d'avantage que la prétention des palais. Laisser couler les jours me semble être une occupation idéale, parce qu'essentielle. Auteur : Jean-Paul Belmondo - Source : Mille vies valent mieux qu'une (2016)
- Février, bon mois, - Pour semer carottes et pois.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Les hommes, ma chère, m'ont paru généralement très laids. Ceux qui sont beaux nous ressemblent en mal.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Mémoires de deux jeunes mariées (1841)
- Je fais le plus de choses que je peux par amour pour me reposer d'en faire tant par nécessité.Auteur : Marie Rouget, dite Marie Noël - Source : Notes intimes (1978)
- Mon éducation et celle de mes condisciples noirs étaient très différentes de l'éducation de nos camarades d'école blancs. En classe, nous apprenions le participe passé mais, dans la rue et chez nous, nous apprenions à laisser tomber le "s" des pluriels et les désinences des verbes. Nous avions conscience de l'abîme qui sépare le mot écrit du langage parlé. Nous apprenions à passer de l'un à l'autre sans nous en apercevoir. A l'école, dans une situation donnée, nous pouvions répondre avec un : " Ce n'est pas inhabituel." Mais dans la rue, confronté à la même situation, nous disions facilement : "C'est comme ça des fois." Auteur : Maya Angelou - Source : Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage (2008)
- La vie humaine est un combat contre la malice de l'homme même.Auteur : Baltasar Gracián y Morales - Source : L'Homme de cour (1647)
- Je travaille un peu partout, j'aime beaucoup les endroits où il y a du passage, les aéroports, les gares, car il y a une innocence du temps qui passe. On se dit “je suis en voyage”, on verra après, et c'est justement dans ces moments-là que l'inspiration vient plus facilement.Auteur : Jean-Loup Dabadie - Source : Masterclass de Jean-Loup Dabadie, à l'occasion du Festival Lumière, En octobre 2016.
- L'élégance et la sobriété dont rêvent tous les auteurs sont intimidantes, on éloigne le public avec un message trop classieux. J'ai donc cessé de m'indigner des photos mises de travers, contournées, ou retournées pour que le visage soit orienté vers le milieu de la page. J'ai cessé de défendre la modernité et la pureté d'une ligne esthétique. Qu'on m'enfouisse dans un délire de graphiste, je n'en serai pas moins lue, les lecteurs qui m'importent braveront les barrières du mauvais goûtAuteur : Macha Méril - Source : Jury
- Le destin aime à nous laisser exsangues de ce qui nous a tenus debout et, pour ceux qui le regardent sans ciller, à décupler la force de son châtiment.Auteur : Muriel Barbery - Source : Une heure de ferveur (2022)
- Le fou écarte les barreaux de l'espace et saute en lui-même. Il disparaît d'emblée en s'avalant.Auteur : Octavio Paz - Source : Liberté sur parole (1958)
- La seule chose terrible au monde est l'ennui. C'est le seul péché pour lequel il n'existe pas de pardon...Auteur : Oscar Wilde - Source : Le Portrait de Dorian Gray (1891)
- Les mouches et les taons piquent avant le mauvais temps.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- O joie des oiseaux! c'est parce qu'ils ont le nid qu'ils ont le chant. L'amour est une respiration céleste de l'air du paradis.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862), IV, Un coeur sous une pierre
- L'ambition est une guerre inachevable, dans laquelle les objectifs et les ennemis changent en fonction des besoins.Auteur : Vincent Cespedes - Source : L'Ambition, ou l'épopée de soi (2013)
- On commence à haïr. On hait l'obscurité. On hait les bouffées de puanteur venues des charognes et des rêves. On hait son propre instinct de prendre abri. On hait ses propres réflexes. On hait ceux qui marchent à côté, en avant, en arrière. On hait ceux qui commandent. On se hait soi-mêmeAuteur : Jean-Jules Richard - Source : Neuf jours de haine
- Voilà les hommes qui sollicitent nos suffrages et, de guerre lasse, les obtiennent. Ils nous représentent. Vous voyez maintenant qu'ils nous représentent mal, et même qu'ils ne nous représentent pas du tout.
Auteur : Jean Giono - Source : Les Trois Arbres de Palzem, 1984
- Elle sentit toute l'inutilité, tout le ridicule qu'il y avait, au premier tiers du XXe siècle, à poursuivre pendant des heures le volcelest d'un cerf, la petite empreinte fourchue enfoncée dans les glèbes labourées et les prairies humides.Auteur : Maurice Druon - Source : Les Grandes Familles II, La Chute des corps (1950)
- N'y a-t-il vraiment pas d'autre voie, pas d'autre espace pour les choses qui ne relèvent ni de la croyance ni de l'incrédulité - ni pure religion ni pure raison? Un troisième chemin pour les gens comme moi? Pour ceux d'entre nous qui trouvent les dualités trop rigides et ne souhaitent pas s'y conformer? Parce qu'il en existe sûrement qui partagent mes sentiments. Comme si je cherchais une langue nouvelle. Une langue fugace qui n'est parlée par personne d'autre que moi...Auteur : Elif Shafak - Source : Trois filles d’Eve, Elif Shafak, éd. Flammarion, coll. « J’ai lu », 2018
Les mots proches de « m »
M Mab Macabre Macadamisation Macaire ou robert macaire Macaraqueau Macarite Macaronée Macaroni Macaronique Macédoine Macération Macérer Mac-ferlane Mâché, ée Mâchecoulis ou mâchicoulis Mâchefer Mâchefer Mâche-laurier Mâchelier, ière Mâchement Mâcher Machiavélique Machiavéliquement Machiavéliser Machiavélisme Machiavéliste Machicot Machicotage Machicoter Machin Machinal, ale Machinalement Machinateur, trice Machination Machine Machiné, ée Machiner Machineur Machinisme Machiniste Machinule Mâchoire Mâchonner Machurer Mâchurer Macis Macle Macle MacleLes mots débutant par m Les mots débutant par m
m m m m'as-tu-vu M?rnach M?urs-Verdey M?uvres ma ma ma-jong Maarke-Kerkem Maarkedal Maaseik Maasmechelen Maast-et-Violaine Maâtz Mably Mabompré maboul maboul maboule maboule maboules maboules mabouls mabouls mac macabre macabres macache macadam macadamia Macao macaque macaque macaques macaques macarel macarelle macareux macaron macaroni macaronique macaronis macarons macassar Macau Macaye maccarthysme macchab
Les synonymes de « m»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot m dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « m » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot m dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de M ?
Citations m Citation sur m Poèmes m Proverbes m Rime avec m Définition de m
Définition de m présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot m sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot m notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 1 lettres.
