La définition de Nard du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Nard
Nature : s. m.
Prononciation : nar ; le d ne se prononce et ne se lie j
Etymologie : Lat. nardus ; hébreu, nerd ; persan, nard.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de nard de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec nard pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Nard ?
La définition de Nard
Rhizome ou racine aromatique dont les anciens se servaient à titre de parfum, et qu'on croit être le spicanard.
Toutes les définitions de « nard »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Huile parfumée que les Anciens tiraient de certaine racines. Il se dit, par extension, d'une Sorte de lavande très odoriférante, d'un genre de graminées, etc.
Littré
-
1Rhizome ou racine aromatique dont les anciens se servaient à titre de parfum, et qu'on croit être le spicanard.
Une femme qui portait un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard d'épi de grand prix, entra lorsqu'il était à table
, Sacy, Bible, Évang. St Marc, XIV, 3.Ô myrrhe?! ô cinname?! Nard cher aux époux?!
Hugo, F. d'aut. 37. -
2 Terme de botanique. Plante aromatique, genre de graminées.
Le nard indien ou indique (spicanard) est l'andropogon nardus, L. (graminées), dont on nous apporte la racine des Indes orientales.
Nard celtique, la valériane celtique, dont la racine nous est envoyée de la Suisse et du Tyrol en paquets ronds et plats, encore garnie de feuilles et mêlée de terre sablonneuse.
Nard de Crète ou de montagne, la grande valériane.
Nard sauvage, le cabaret.
HISTORIQUE
XVIe s. Huile d'aneth, de nard, de noix muscade?
, Paré, XX, 27.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
NARD. - HIST. Ajoutez?: XIVe s. Comme le roy fust assis en son siege, ma narde [nardus est du féminin] donna son odeur
, Mir. de Nostre Dame par personnages, éd. G. Paris et U. Robert, t. I, p. 103.
Encyclopédie, 1re édition
NARD, s. m. (Botan.) genre de plante graminée dont voici les caracteres distinctifs selon Linn?us. Il n'y a point de calice ; la fleur est composée de deux valvules qui finissent en épi. Les étamines sont trois filets capillaires. Les antheres & le germe du pistil sont oblongs. Les stiles sont au nombre de deux, chevelus, réfléchis, cotonneux. La fleur est ferme, même attachée à la graine. La semence est unique, longue, étroite, pointue aux deux extrémités.
Le nard est une plante célebre chez les anciens, qu'il importe de bien décrire pour en avoir une idée claire & complette.
On a donné le nom de nard à différentes plantes. Dioscoride fait mention de deux sortes de nards, l'un indien, l'autre syriaque, auxquels il ajoute le celtique & le nard de montagne, ou nard sauvage ; enfin il distingue deux especes de nard sauvage, savoir l'asarum & le phu.
Le nard indien, ou spic nard des Droguistes, s'appelle chez les Botanistes, nardus indica, spica, spica nardi, & spica indica, ?????? ??????, Dioscor.
C'est une racine chevelue, ou plûtôt un assemblage de petits cheveux entortillés, attachés à la tête de la racine, qui ne sont rien autre chose que les filamens nerveux des feuilles fausses, desséchées, ramassées en un petit paquet, de la grosseur & de la longueur du doigt, de couleur de rouille de fer, ou d'un brun roussâtre ; d'un goût amer, âcre, aromatique ; d'une odeur agréable, & qui approche de celle du souchet.
Cette partie filamenteuse de la plante dont on fait usage, n'est ni un épi ni une racine ; mais c'est la partie inférieure des tiges, qui est d'abord garnie de plusieurs petites feuilles, lesquelles en se fanant & se desséchant tous les ans, se changent en des filets ; de sorte qu'il ne reste que leurs fibres nerveuses qui subsistent.
Le nard a cependant mérité le nom d'épi, à cause de sa figure ; il est attaché à une racine de la grosseur du doigt, laquelle est fibreuse, d'un roux foncé, solide & cassante. Parmi ces filamens, on trouve quelquefois des feuilles encore entieres, blanchâtres, & de petites tiges creuses, canelées ; on voit aussi quelquefois sur la même racine, plusieurs petits paquets de fibres chevelues.
Le nard indien vient aux Indes orientales, & croît en quantité dans la grande Java, cette île que les anciens ont connue, & ce qui est remarquable, qui portoit déja ce nom du tems de Ptolomée. Les habitans font beaucoup d'usage du nard indien dans leurs cuisines, pour assaisonner les poissons & les viandes.
Dioscoride distingue trois especes de nard indien, savoir le vrai indien, celui de Syrie, celui du Gange. On n'en trouve présentement que deux especes dans les boutiques, qui ne different que par la couleur & la longueur des cheveux.
Il le faut choisir récent, avec une longue chevelure, un peu d'odeur du souchet, & un goût amer.
La plante s'appelle gramen cyperoides, aromaticum, indicum, Breyn. 2°. Prodr. On n'en a pas encore la description. Ray avance comme une chose vraissemblable, que la racine pousse des tiges chargées à leurs sommets d'épis ou de pannicules, ainsi que le gramen ou les plantes qui y ont du rapport. Si l'on en juge par le goût & l'odeur, les vertus du nard indien dépendent d'un sel volatil huileux, mêlé avec beaucoup de sel fixe & de terre.
Il passe pour être céphalique, stomachique & néphrétique, pour fortifier l'estomac, aider la digestion, exciter les mois, & lever les obstructions des visceres. On le réduit en poudre très fine, & on le donne dans du bouillon ou dans quelqu'autre liqueur. On en prescrit la dose depuis demi-drachme jusqu'à deux drachmes en substance, & depuis demi-once en infusion, jusqu'à une once & demie.
Cependant toutes les vertus qu'on lui donne sont exagérées. Celle d'être céphalique ne signifie rien ; sa vertu néphrétique n'est pas vraie ; son utilité dans les maladies malignes n'est pas mieux prouvée : l'éloge qu'en fait Riviere pour la guérison de l'hémorrhagie des narines est sans fondement ; mais cette plante par sa chaleur, son aromat & son amertume, peut être utile dans les cas où il s'agit d'inciser, d'atténuer, d'échauffer, d'exciter la sueur, les regles, ou de fortifier le ton des fibres de l'estomac.
Dans les Indes, suivant le rapport de Bontius, on fait infuser dans du vinaigre le nard indien séché, & on y ajoute un peu de sucre. On emploie ce remede contre les obstructions du foie, de la rate & du mésentere, qui sont très-fréquentes. On en applique aussi sur les morsures des bêtes venimeuses.
Les anciens en préparoient des collyres, des essences & des onguens précieux. L'onguent de nard se faisoit de nard, de jonc odorant, de costus, d'amome, de myrrhe, de baume, d'huile de ben ou de verjus ; on y ajoutoit quelquefois de la feuille indienne. Galien a guéri Marc-Aurele, & jamais il n'a guéri personne qui valût mieux que ce prince, d'une foiblesse d'estomac qui faisoit difficilement la digestion, en appliquant sur la partie de l'onguent de nard. Quel bonheur pour les peuples, s'il eût pû prolonger les jours de cet empereur, corriger son fils corrompu dans ses inclinations, & sa femme diffamée par son incontinence !
Le nard indien entre dans un grand nombre de compositions, dont l'usage est intérieur ou extérieur. Il est employé dans la thériaque, le mithridat, l'hiera picra de Galien, l'hiera de coloquinte, les trochisques de camphre, les pilules fétides, le syrop de chicorée composé, l'huile de nard, l'huile de scorpion de Matthiol, l'onguent martiatum, la poudre aromatique de roses, &c.
Il ne paroît guere douteux que notre spic-nard ne soit le nard indien des anciens, quoi qu'en disent Anguillara & quelques autres botanistes. La description de la plante, son lieu natal, ses vertus, tout s'accorde. Garcias nous assure qu'il n'y a point différentes especes de nard dans les Indes, & les gens qui ont été depuis sur les lieux nous confirment la même chose. Il ne faut pas inférer du grand prix où le nard étoit chez les anciens, comme Pline nous l'apprend, que notre spic-nard soit une plante différente. Les Romains recevoient leur nard par de longs détours, indirectement, rarement, & l'employoient à des essences, des parfums qui renchérissoient beaucoup le prix de cette plante ; tout cela n'a pas lieu parmi nous.
Les anciens ignoroient quelle est la partie du nard qu'il faut regarder comme l'épi, ou le ??????. Galien croyoit que c'étoit la racine ; mais nous savons que ce n'est ni la racine ni l'épi de la plante, & que c'est la partie inférieure de ses tiges. On a donné le nom d'épi aux petites tiges de cette plante, parce qu'elles sont environnées de feuilles capillacées, qui ont quelque ressemblance à des racines.
Le nard celtique s'appelle nardus celtica, spica gallica, spica romana, ?????? ??????? & ?????????, Dioscor. Alnardin Alsimbel, Arab.
C'est une racine fibreuse, chevelue, roussâtre, garnie de feuilles ou de petites écailles d'un verd jaunâtre ; d'un goût âcre, un peu amer, aromatique ; d'une odeur forte & un peu desagréable. On doit choisir cette racine récente, fibreuse & odorante.
Elle a été célebre dès le tems de Dioscoride. On la nomme celtique, parce qu'autrefois on la recueilloit dans les montagnes de la partie des Gaules, appellée Celtique. On en trouve encore aujourd'hui dans les montagnes des Alpes qui séparent l'Allemagne de l'Italie, dans celles de la Ligurie & de Gènes.
La plante est appellée valeriana celtica par Tournefort, I. R. H. nardus celtica Dioscoridis, par C. B. P. nardus alpina, par Clusius. Sa racine rampe de tous côtés, & se répand sur la superficie de la terre parmi la mousse : les petits rameaux qu'elle jette sont longs, couchés sur terre, couverts de plusieurs petites feuilles en maniere d'écailles seches ; ils poussent par intervalle des fibres un peu chevelues & brunes ; ils donnent naissance dans leur partie supérieure à une ou deux petites têtes, chargées de quelques feuilles, étroites d'abord & ensuite plus larges, assez épaisses & succulentes, qui sont vertes en poussant, jaunâtres au commencement de l'automne, & d'un goût un peu amer.
Du milieu de ces feuilles s'éleve une petite tige à la hauteur d'environ neuf pouces, & quelquefois plus, assez ferme, noueuse, ayant sur chaque n?ud deux petites feuilles opposées : à l'extrémité de l'aisselle des feuilles, naissent de petits pédicules qui portent deux ou trois petites fleurs de couleur pâle, d'une seule piece, en forme d'entonnoir, découpées en plusieurs quartiers, soutenues chacune sur un calice qui dans la suite devient une petite graine oblongue & aigrettée.
Toute la plante est aromatique, elle imite l'odeur de la racine de la petite valériane. Selon Clusius, elle fleurit au mois d'Août, presque sous les neiges sur le sommet des Alpes de Styrie : les feuilles paroissent ensuite lorsque les fleurs commencent à tomber. Les habitans la ramassent sur la fin de l'été & lorsque les feuilles viennent à jaunir ; car alors son odeur est très-agréable.
Le nard celtique a les mêmes vertus que le spica indien, & convient dans les mêmes maladies. Quelques-uns prétendent, j'ignore sur quelles expériences, qu'on l'emploie plus utilement pour fortifier l'estomac & dissiper les vents. Il entre dans la thériaque, le mithridat, l'emplâtre de mélilot, & dans quelques autres onguens échauffans, ainsi que dans les lotions céphaliques.
Le nard de montagne se nomme, en Botanique, nardus montana ou nardus montana tuberosa ; ?????? ??????, Diosc. Alnardin Gebali, Arab. C'est une racine oblongue, arrondie, & en forme de navet, de la grosseur du petit doigt ; sa tête est portée sur une petite tige rougeâtre, & est garnie de fibres chevelues, brunes ou cendrées, & un peu dures ; son odeur approche de celle du nard, & elle est d'un goût âcre & aromatique.
La description que fait Dioscoride du nard de montagne, est si défectueuse qu'il est difficile de décider si nous connoissons le vrai nard de montagne de cet auteur, ou s'il nous est encore inconnu.
On nous apporte deux racines de plantes sous le nom de nard de montagne. La premiere s'appelle valeriana maxima, pyrenaïca, cacaliæ folio, D. Fagon, I. R. H. Cette plante pousse en terre, une racine épaisse, longue, tubéreuse, chevelue, vivace, d'une odeur semblable à celle du nard indien, mais plus vive, d'un goût amer. De cette racine s'éleve une tige de trois coudées, & même plus haute, cylindrique, lisse, creuse, noueuse, rougeâtre, de l'épaisseur d'un pouce. Ses feuilles sont deux à deux, opposées, lisses, crenelées, semblables aux feuilles du cacalia, de la longueur d'une palme, & appuyées sur de longues queues. Au haut de la tige naissent des fleurs purpurines, & des graines qui sont semblables aux fleurs & aux graines de la valériane.
La seconde s'appelle valeriana alpina minor, C. B. P. nardus montana, radice olivari, C. B. P. nardus montana, radice oblongâ, C. B. P. Sa racine tubéreuse, tantôt plus longue, tantôt plus courte, se multiplie chaque année par de nouvelles radicules. Elle a beaucoup de fibres menues à sa partie inférieure ; & vers son collet elle donne naissance à des rejettons qui, dans leur partie inférieure, sont chargés de feuilles opposées, d'un verd foncé & luisant, unies, sans dentelures, & ensuite d'autres feuilles découpées, à-peu-près comme celles de la grande valériane, mais plus petites ; & à mesure que les rejettons grandissent, les feuilles sont plus découpées. Au sommet des tiges, naissent de gros bouquets de fleurs semblables à celles de la petite valériane ; elles sont odorantes, moins cependant que n'est la racine de cette plante. Le nard de montagne a les mêmes vertus que le celtique, peut-être plus foibles.
Nous avons dit que les anciens composoient avec le nard une essence dont l'odeur étoit fort agréable. Les femmes de l'Orient en faisoient un grand usage ; le nard dont j'étois parfumée, dit l'épouse dans le Cantique des Cantiques, répandoit une odeur exquise. La boîte de la Magdeleine, quand elle oignit les piés du Sauveur (Marc, ch. xiv. ?. 3. Luc, vij. ?. 37. Jean, xij. ?. 3.), étoit pleine de nard pistique, c'est-à-dire selon la plûpart des interpretes, de nard qui n'étoit point falsifié, du mot grec ??????, fides, comme qui diroit du nard fidele, sans mélange, ni tromperie.
Les latins ont dit nardus, f. & nardum, n. Le premier signifie communément la plante, & le second la liqueur, l'essence aromatique. Horace, l. V. ode 13. donne au nard l'épithete d'achæmenio, c'est-à-dire, de Perse, où Achémene avoit régné :
Nunc & achæmenio
Perfundi nardo juvat :
Ne songeons qu'à nous parfumer des essences des Indes. Les Indiens vendoient le nard aux Persans, & ceux-ci aux Syriens chez qui les Romains alloient le chercher. De-là vient que dans un autre endroit Horace l'appelle assyrium. Mais après l'année 727 qu'Auguste conquit l'Egypte, les Romains allerent eux-mêmes aux Indes chercher les aromates & les marchandises du pays, par le moyen de la flotte qui fut établie pour cela dans le golfe arabique. (D. J.)
Nard-sauvage, (Botan.) asarum, nardus rustica. Voyez Cabaret, (Botan.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
nard \na?\ masculin
-
(Botanique) Nardus, genre de plantes herbacées aromatiques des prés de la famille des Poacées (ou graminées) qui comprend une unique espèce, le nard raide (Nardus stricta).
- Le Nard, espèce de grande plasticité écologique, se développe indifféremment sur les sols acides de nos tourbières à Sphaignes et sur les terrains peu humifères ; il semble toutefois rechercher une atmosphère humide ; [?]. ? (Gustave Malcuit, Contributions à l'étude phytosociologique des Vosges méridionales saônoises : les associations végétales de la vallée de la Lanterne, thèse de doctorat, Société d'édition du Nord, 1929, p. 130)
-
(Botanique) Nardostachys, genre de plantes herbacées de la famille des valérianacées comportant plusieurs espèces dont le très odoriférant Nardostachys jatamansi.
- La valériane celtique (Valeriana celtica) est une plante alpestre au parfum capiteux, appelée également nard celtique.
- (Botanique) Synonyme de lavande aspic.
-
(Par métonymie) Huile ambrée parfumée que les anciens tiraient de certaines racines, en particulier de la valériane celtique.
- [?], si vous vous sentez au c?ur un nard céleste à répandre, comme fit Madeleine aux pieds de Jésus ; laissez-vous apprécier par un homme digne de vous, et devenez ce que doit être toute bonne jeune fille : une excellente femme, [?]. ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- Leur lèvre rouge, leurs yeux humides et brillant dans l'ombre, leurs longs regards, me pénétraient jusqu'aux moelles. Fardées et peintes, sentant le nard et la myrrhe, macérées dans les aromates, leur chair est d'un goût rare et délicieux. ? (Anatole France, L'Étui de nacre, 1892, réédition Calmann-Lévy, 1923, page 22)
- Ainsi, t'emportes-tu aujourd'hui contre cette femme qui vient d'arroser mes pieds d'un nard payé très cher, comme si mes pauvres ne devaient jamais profiter de l'industrie des parfumeurs. ? (Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, 1936, pages 58-59)
- Le nard des pinèdes peut être utilisé dans des tisanes ou pour devenir des épices à viande. ? (Radio-Canada, À la découverte du nard des pinèdes, radio-canada.ca, 10 avril 2021)
Trésor de la Langue Française informatisé
NARD, subst. masc.
BOTANIQUENard au Scrabble
Le mot nard vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot nard - 4 lettres, 1 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot nard au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
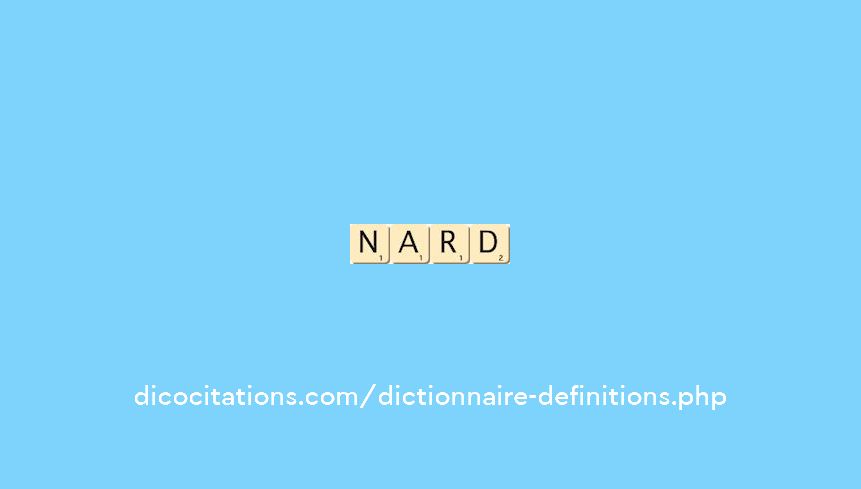
Les mots proches de Nard
Narcisse Narcisse Narcose Narcotique Nard Narghileh ou narguilé Nargue Narguer Narine Narquois, oise Narquoiserie Narrateur, trice Narratif, ive Narration Narrative Narré Narrer Narthex Narval Narbéfontaine Narbief narbonnais Narbonne Narbonne Narbonne Narbonne Narcastet narcisse narcisse narcisses narcissique narcissiquement narcissiques narcissisme narcissiste narco-analyse narcolepsie narcoleptique narcose narcotique narcotique narcotiques narcotiques narcotrafic narcotrafiquants Narcy Narcy nard nards narghilé narghileh Nargis nargua narguaient narguais narguait narguant nargue nargué narguées narguent narguer nargues narguez narguilé narguilés narguons narine narinesMots du jour
Calmar Tilla Détournement Embourbement Circonlocution Complaindre Ressuscité, ée Inabordé, ée Métriopathie Entage
Les citations avec le mot Nard
- Les plus beaux portraits de Titien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des sentiments exaltés, qui, sous diverses conditions, engendrent d'ailleurs tous les chefs d'oeuvre.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Comédie humaine (1842-1852)
- Qui se met au service du renard,
Doit se faire son caudataire.Auteur : Proverbe écossais - Source : Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels ... (1856) - Charles Cahier - Ce monde serait meilleur pour les enfants si c'était les parents qui étaient obligés de manger les épinards.Auteur : Julius Marks, dit Groucho Marx - Source : Sans référence
- Paysages de peintres: Toujours des plats d'épinards.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- J'aime vos aphorismes qui vont à l'essentiel. Ils atteignent souvent- pour moi il en est qui me touchent plus que d'autres le coeur ou l'esprit comme un petit poignard cruel ou tendre, ou simplement vrai. (A propos dePapiers collés de Georges Perros)Auteur : Gérard Philipe - Source : Correspondance : 1946-1978 de Gérard Philipe
- Les affaires d'abord, les plaisirs après, comme dit le roi Richard quand il poignarde l'autre dans la tour, avant d'étouffer les moutards.Auteur : Charles Dickens - Source : Les Papiers posthumes du Pickwick Club ou Les Aventures de Mr. Pickwick (1836-1837)
- Quand la nation se trouve sous le canon des ennemis et sous le poignard des traîtres, l'indulgence est parricide.Auteur : Anatole France - Source : Les Dieux ont soif (1912)
- ... la girouette de M. Bonnard. Elle est rouillée et grince aigrement au vent.Auteur : Anatole France - Source : Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881)
- Le pic du Teide à Tenerife est fait des éclairs du petit poignard de plaisir que les jolies femmes de Tolède gardent jour et nuit contre leur sein.Auteur : André Breton - Source : L'Amour fou (1937)
- Tous les enquêteurs qui ont du succès doivent beaucoup à Dame Fortune. Et aucun ne voit poindre la solution s'il n'est pas poussé par la curiosité. Chance et curiosité, et un peu de raisonnement inductif sur le comportement des renards et des aigles porteront n'importe quel policier jusqu'au sommet.Auteur : Arthur Upfield - Source : Sinistres augures (1954)
- Et le coup de pioche du bagnard, qui humilie le bagnard, n'est point le même que le coup de pioche du prospecteur, qui grandit le prospecteur.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Terre des hommes (1938)
- Si Leonardo Da Vinci avait accepté des centaines de commandes lucratives du Vatican sur des thèmes chrétiens, c'était pour financer son train de vie et ses recherches scientifiques, plus que pour illustrer ses croyances personnelles.Auteur : Dan Brown - Source : Da Vinci Code (2003)
- Il y a deux choses qu'il n'est pas aisé de trouver sous le ciel c'est un Italien sans poignard, et une Italienne sans amant.Auteur : Victor Hugo - Source : Lucrèce Borgia (1833)
- Renard n'est pas juge à un concours d'oies.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- Les mecs sont devenus tous identiques, on dirait qu'ils prennent des cours du soir pour se ressembler le plus possible. Si on pouvait ouvrir le cerveau de Laurent en deux pour lui regarder la mécanique, on y trouverait exactement le même arsenal de conneries que dans celui du cadre sup en détresse qui fait ses abdos à côté d'eux: des poulettes ultra light, de la verroterie Rolex et une grosse maison sur la plage. Que des rêves de connard. Auteur : Virginie Despentes - Source : Vernon Subutex, Tome 2 (2016)
- La différence entre les gens et les canards en métal est, entre autres, que nos ressorts peuvent guérir avec le temps.Auteur : Katarina Mazetti - Source : Le Mec de la tombe d'à côté (2006)
- Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes, comme disait ce renard qui avait la queue coupée.
Auteur : Paul-Jean Toulet - Source : Le carnet de monsieur du Paur, homme public
- Les renards peuvent oublier le piège, mais le piège n'oublie pas les renards.Auteur : Franz-Olivier Giesbert - Source : Dictionnaire d'anti-citations : Pour vivre très con et très heureux (2013)
- Il est avis au renard, que chacun mange poules comme lui.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Un arrêté préfectoral ayant interdit la chasse aux canards autrement qu'en bateau, M. Binet, malgré son respect pour les lois, se trouvait en contravention.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857)
- Bon renard ne se prend pas deux fois au même piège.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Dans le monde ou nous vivons il n'y a pas de pitié. Les canards avalent les vers, les renards tuent les canards, les hommes abbattent les renards et le diable poursuit les hommes!Auteur : Ken Follett - Source : Les Piliers de la terre (1989)
- Ainsi dit le renard; et flatteurs d'aplaudir.Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fables (1668 à 1694), Livre septième, I, les Animaux malades de la peste
- On guérit d'un coup de poignard, tandis que les coups de plume sont empoisonnés.Auteur : Emile Zola - Source : Son Excellence Eugène Rougon (1876)
- Le renard change de poil, mais non de naturel.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
Les citations du Littré sur Nard
- Je saurai le surprendre avec son Atalide, Et, d'un même poignard les unissant tous deux, Les percer l'un et l'autre, et moi-même après euxAuteur : Jean Racine - Source : Bajaz. IV, 4
- Clergesse, elle fait jà la leçon aux prêcheurs, Elle lit saint Bernard, la guide des pécheursAuteur : RÉGNIER - Source : Sat. XIII
- Les enfants se moquent du corbeau et s'affectionnent tous au renardAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Ém. II
- Un robuste gentilhomme campagnard, chassant six mois de l'année et passant les six autres mois à des parties de pêche ou à des parties de ramsAuteur : A. THEURIET - Source : Rev. des Deux-Mondes, 15 avril 1876, p. 734
- La subtilité du renard, la stolidité de l'asneAuteur : PARÉ - Source : Anim. 1
- Il m'a paru par les expériences que j'ai faites sur le mélange du chien avec le loup et avec le renard, que la répugnance à l'accouplement venait du loup et du renard plutôt que du chien, c'est-à-dire de l'animal sauvage et non pas de l'animal domestiqueAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. VII, p. 248
- Il suffit qu'on y puisse cognoistre le bon esprit et entendement de l'architecte, et que ses inventions y soient plus louables que la mignardise....Auteur : PHILIBERT DELORME - Source : De l'architecture, I, 11
- Ellipse particulière qui a lieu quand, après avoir employé un mode, on en prend subitement un autre que n'admet pas la construction ordinaire ; comme dans cette phrase : Ainsi dit le renard et flatteurs d'applaudirAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VII, 1
- Le poignardeur de la reine de Suède s'appelle Sentinelli [celui qui poignarda Monaldeschi]Auteur : GUI PATIN - Source : Lettres, t. II, p. 375
- Quant au mot de caignard, cela depend d'une histoire dont je puis estre temoin ; de tant qu'en ma grande jeunesse, ces faineants avoient accoustumé au temps d'esté de se venir loger sous les ponts de Paris.... ce lieu estoit appelé le caignardAuteur : PASQUIER - Source : Recherches, VIII, 42
- Marcellin : Et de quoi s'agit-il à présent, monsieur Marcellin ? - Léonard : De lire, parapher et signer. - Marcellin : Eh bien ! lisons, paraphons et signonsAuteur : PICARD - Source : Marionnettes, II, 9
- Disoient les fols et les outrageux [de Gand] : Laissons les ouvrer, se Audenarde estoit ores d'acier, si ne pourroit elle durer contre nous, quand nous voudronsAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 63
- Mignard aurait peint les courtisans du dernier siècle avec des fraises ou des collets montésAuteur : FÉN. - Source : XXI, 283
- Compère le renard se mit un jour en frais, Et retint à dîner commère la cigogneAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. I, 18
- Aux traces de son sang un vieux hôte des bois, Renard fin, subtil et matois, Blessé par des chasseurs et tombé dans la fange, Autrefois attira ce parasite ailé Que nous avons mouche appeléAuteur : Jean de La Fontaine - Source : ib. XII, 13
- Le sultan fit venir son visir le renard, Vieux routier et bon politiqueAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. XI, 1
- C'étaient [chat et renard] deux vrais tartufs, deux archipatelinsAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fab. IX, 14
- C'était plonger le poignard dans le sein maternelAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Hél. I, 29
- Il [Aristote] dit que les lions, les ours, les renards naissent informes, presque inarticulésAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. III, p. 116
- Un gros prieur son petit fils baisoit, Et mignardoit au matin en sa coucheAuteur : MAROT - Source : III, 64
- Le regnard est pris, lasche les poulesAuteur : ID. - Source :
- Lequel, ayant esté pris petit enfant au siege de Patras, fut mignardement nourri au sarrail, et puis affriandé de tous honneursAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 242
- Vous allez voir quelle différence il y a d'elle à vos goguenardes de femmes qui ne songent qu'à la bagatelle !Auteur : BRUEYS - Source : Grondeur, II, 14
- De Leonard Gaultier la manière un peu dure A pourtant sa beauté, surtout dans ses portraitsAuteur : M. DE MAROLLES - Source : le Livre des peintres, etc. p. 44
- De tels engins de canons, de bombardes, de truies e de moutons se mettoient en peine ceux de Gand de adommager ceux de OudenardeAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 161
Les mots débutant par Nar Les mots débutant par Na
Une suggestion ou précision pour la définition de Nard ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 09h29

- Nain - Naissance - Naitre - Naître - Naivete - Nation - Nature - Necessite - Neutre - Noblesse - Noël - Noir - Normalisation - Normalite - Nostalgie - Nourriture - Nouveau - Nouvel_an - Nuit
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur nard
Poèmes nard
Proverbes nard
La définition du mot Nard est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Nard sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Nard présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
