La définition de Oratoire du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Oratoire
Nature : adj.
Prononciation : o-ra-toi-r'
Etymologie : Lat. oratorius, de orator, orateur.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de oratoire de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec oratoire pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Oratoire ?
La définition de Oratoire
Qui appartient à l'orateur. Style oratoire. Le ton, le geste oratoire. Un mouvement oratoire.
Toutes les définitions de « oratoire »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
. Qui appartient à l'orateur. L'art oratoire. Figure oratoire. Genre oratoire. Style oratoire. Débit oratoire. Précautions oratoires, Moyens adroits et détournés qu'on emploie, dans un discours ou même dans la conversation, pour se concilier la bienveillance de ses auditeurs ou pour atténuer les préventions qui pourraient s'élever contre l'objet qu'on se propose.
Littré
- Qui appartient à l'orateur. Style oratoire. Le ton, le geste oratoire. Un mouvement oratoire.
L'art oratoire ne pourrait même durer chez des peuples libres, s'il ne s'occupait d'affaires importantes, et ne conduisait l'homme d'une naissance obscure aux premières fonctions de l'État
, Diderot, Claude et Nér. I, 16.Tout ce qui dans la description oratoire n'intéresse que l'imagination, est superflu et vicieux?; un modèle de ce genre est la description du supplice de Gavius dans la cinquième des Verrines
, Marmontel, Élém. litt. t. VI, p. 459, dans POUGENS.Il [Ney] n'a point harangué?; il marche, donnant l'exemple, qui, dans un héros, est de tous les mouvements oratoires le plus éloquent et de tous les ordres le plus impérieux
, Ségur, Hist. de Nap. X, 8.Richardson n'est pas, comme Rousseau, un écrivain savamment artificiel, un grand maître de la parole oratoire
, Villemain, Litt. franç. t. I, XVIIIe siècle, 1re leçon.Le génie oratoire, en touchant la philosophie de l'histoire, la transforme en discours qui résument et expliquent les révolutions et les guerres
, Taine, Essai sur Tite-Live, Conclusion.Le nombre oratoire, voy. NOMBRE, n° 11.
Encyclopédie, 1re édition
ORATOIRE, s. m. (Hist. ecclésiast.) petit édifice, ou partie d'édifice dans une grande maison près de la chambre à coucher, & consacré à la priere en particulier. L'oratoire d'une maison differe de la chapelle, en ce que la chapelle a un autel où l'on célebre les saints mysteres ; au lieu que l'oratoire n'a point un pareil autel ; car quoiqu'il y ait une table en forme d'autel, on n'y célebre point.
On commença à appeller oratoire, les petites chapelles qui étoient jointes aux monasteres, où les moines faisoient leurs prieres, avant qu'ils eussent des églises. Ce mot a passé depuis aux autels, ou chapelles qui étoient dans les maisons particulieres, & même aux chapelles bâties à la campagne qui n'avoient point droit de paroisse.
Dans le vj. & vij. siecle, un oratoire étoit une espece de chapelle placée souvent dans les cimetieres, & qui n'avoient ni baptistaire comme les églises titulaires, ni office public, ni prêtre cardinal. L'évêque y envoyoit un prêtre quand il jugeoit à propos d'y faire célébrer la messe ; cependant quelques oratoires avoient un prêtre cardinal pour y célébrer la messe quand le fondateur le desiroit, ou quand le concours des fideles le demandoit ; c'étoit comme de moindres titres. Enfin, il y avoit déja dans ce tems-là comme à présent des oratoires chez les hermites, & dans les maisons particulieres. Le conciliabule de Constantinople, tenu en 861 par Photius, défend de célébrer la liturgie, & de baptiser dans les oratoires domestiques.
On voit en France beaucoup de bourgs & de villages du nom d'Oroir, Oroair, Ozouer, Orouer, Aurouer, Oradour, qui prennent leur nom & leur origine de quelques oratoires de religieux retirés dans des hermitages de la campagne voisine. (D. J.)
Oratoire des Hébreux, (Critique sacrée.) voyez Proseuche.
Oratoire, (Hist. des congrég.) titre d'une congrégation particuliere d'ecclésiastiques, instituée en France par le cardinal de Bérulle, sur le modele de celle de Rome, qui a été établie par Philippe Néri florentin, sous le titre de l'oratoire de sainte Marie en la Vaticelle.
Il y a néanmoins cette différence entre la congrégation des peres de l'oratoire de Rome & celle de France, que la premiere n'a été fondée que pour la seule maison de Rome, sans se charger du gouvernement d'aucune autre maison ; au lieu que celle de France renferme plusieurs maisons qui dépendent d'un chef, lequel prend la qualité de supérieur général, & gouverne avec trois assistans toute cette congrégation.
Le cardinal de Bérulle obtint des lettres patentes de Louis XIII. datées du mois de Décembre 1611, & enregistrées au parlement de Paris, le 4 Décembre 1612, avec cette clause : « à la charge de rapporter dans trois mois le consentement de l'évêque, auquel ils demeureront sujets ».
M. de Bérulle desirant de répandre sa congrégation en France, obtint à cet effet en 1613, une bulle du pape Paul V. en conséquence de laquelle la congrégation de l'oratoire s'étendit en peu de tems en plusieurs villes du royaume.
Ces peres sont différens de tous les ordres religieux ; leur congrégation est la seule où les v?ux sont inconnus, & où n'habite point le repentir. C'est une retraite toujours volontaire aux dépens de la maison ; on y jouit de la liberté qui convient à des hommes ; la superstition & les petitesses n'y deshonorent guere la vertu ; leur général demeure en France, idée si convenable à tous les ordres de l'Eglise ; leurs ouvrages méritent généralement des éloges. Enfin, respectables à tous égards, ils deviendroient encore plus utiles au public, si leurs religieux s'appliquoient aux fonctions des colléges, des seminaires, & des hôpitaux. (D. J.)
Oratoire, harmonie, (Elocut.) l'harmonie oratoire est l'accord des sons avec les choses signifiées. Elle consiste en deux points : 1°. dans la convenance & le rapport des sons, des syllabes, des mots, avec les objets qu'ils expriment : 2°. dans la convenance du style avec le sujet. La premiere est l'accord des parties de l'expression avec les parties des choses exprimées. La seconde est l'accord du tout avec le tout.
L'harmonie des syllabes, des mots avec les objets qu'ils expriment, se fait par des sons imitatifs. On retrouve ces sons imitatifs dans toutes les langues : c'est ainsi qu'on dit en françois, gronder, murmurer, tonner, siffler, gasouiller, claquer, briller, piquer, lancer, bourdonner, &c. L'imitation musicale saisit d'abord les objets qui font bruit, parce que le son est ce qu'il y a de plus aisé à imiter par le son ; ensuite ceux qui sont en mouvement, parce que les sons marchant à leur maniere, ont pu, par cette maniere, exprimer la marche des objets. Enfin, dans la configuration même & la couleur, qui paroissoient ne point donner prise à l'imitation musicale, l'imagination a trouvé des rapports analogiques avec le grave, l'aigu, la durée, la lenteur, la vîtesse, la douceur, la dureté, la légereté, la pesanteur, la grandeur, la petitesse, le mouvement, le repos, &c. La joie dilate, la crainte rétrécit, l'espérance souleve, la douleur abat : le bleu est doux, le rouge est vif, le verd est gai ; de sorte que, par ce moyen, & à l'aide de l'imagination, qui se prête volontiers en pareil cas, presque toute la nature a pu être imitée plus ou moins, & représentée par les sons. Concluons de là que le premier principe pour l'harmonie est d'employer des mots ou des phrases, qui renferment par leur douceur ou par leur dureté, leur lenteur ou leur vîtesse, l'expression imitative qui peut être dans les sons. Les grands Poëtes & les Orateurs ont toujours suivi cette regle.
Pour sentir tout l'effet de cette harmonie, qu'on suppose les mêmes sons dans des mots qui exprimeroient des objets différens : elle y paroîtra aussi déplacée, que si on s'avisoit de donner au mot siffler la signification de celui de tonner, ou celle d'éclater à celui de soupirer : & ainsi des autres.
De même que tous les objets qui sont liés entr'eux dans l'esprit, le sont par un certain caractere de conformité ou d'opposition qu'il y a dans quelqu'une de leurs faces ; de même aussi les phrases qui représentent la liaison de ces idées, doivent en porter le caractere. Il y a des phrases plus douces, plus légeres, plus harmonieuses, selon la place qu'on leur a donnée, selon la maniere dont on les a ajustées entr'elles. Quelque fine que paroisse cette harmonie, elle produit un charme réel dans la composition, & un écrivain qui a de l'oreille ne la néglige pas. Ciceron y est exact autant que qui que ce soit : Etsi homini nihil est magis optandum, quam prospera, æquabilis perpetuaque fortuna, secundo vitæ, sine ulla offensione, cursu : tamen si mihi tranquilla & placata omnia fuissent, incredibili quadam & penè divinâ, quâ nunc vestro beneficio fruor, loetitioe voluptate caruissem. Toute cette période est d'une douceur admirable ; nul choc désagréable de consonne, beaucoup de voyelles, un mouvement paisible & continu que rien n'interrompt, & qui semble aidé & entretenu par tous les sons qui le remplissent.
La seconde espece d'harmonie oratoire est celle du ton général de l'orateur, avec le sujet pris dans sa totalité. L'essentiel est donc de bien connoître le sujet qu'on traite, d'en sentir le caractere & l'étendue ; cela fait, il faut lui donner les pensées, les mots, les tours & les phrases qui lui conviennent. Cours de Belles-Lettres, tome IV. (D. J.)
Oratoire, s. m. oratorio, en musique ; c'est une espece de drame en latin ou en langue vulgaire, divisé par scenes, à l'imitation des pieces de théâtre, mais qui roule toujours sur des sujets pris de la religion, & qu'on met en musique pour être exécuté dans quelque église durant le carême, ou en d'autres tems. Cet usage, assez commun en Italie, n'est pas admis en France, où l'on ne trouve pas que la composition de ces pieces soit convenable à la majesté du lieu destiné à leur exécution. (S)
Wiktionnaire
Nom commun - français
oratoire \?.?a.twa?\ masculin
-
(Religion) Petite chapelle, adjointe à une grande maison (palais, château ou hôtel), où l'on peut prier.
- Monsieur d'Espard, qui a suivi cette affaire, m'a menée à l'Oratoire où cette femme va au prêche, car elle est protestante. ? (Honoré de Balzac, L'Interdiction, 1839)
- Un oratoire (msalla), simple mur en maçonnerie blanchi à la chaux, avait été construit à la hâte sur une colline voisine, toute blanche de pâquerettes. Et c'est là, hier matin, premier choûal, que le Sultan s'est rendu en grande pompe pour remplir ses fonctions d'imâm, de souverain pontife, et y faire la prière à la tête de sa cour et de son armée. ? (Frédéric Weisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 132)
-
(Religion) (En particulier) Chapelle élevée sur le bord d'une route pour conserver un souvenir religieux.
- Cependant, quoique l'oratoire fût dédié à Sainte-Barbe, la statue de Marie-Immaculée occupait la place d'honneur. ? (Ch. de Beaumasset, « Sainte-Barbe et Notre-Dame-de-Bon-Secours à Saint-Étienne », dans L'Écho de Fourvière, chronique lyonnaise, n° 199 du 12 octobre 1867, Lyon, p. 334)
Adjectif - français
oratoire \?.?a.twa?\ masculin et féminin identiques
- Qui appartient à l'orateur.
- Il possède un véritable talent oratoire.
- Qui est propre à la technique du discours.
- [?] ; ses moindres discours étaient accompagnés d'un geste oratoire de la main droite, qu'on aurait pu croire destiné à en marquer la cadence. ? (Julie de Quérangal, Philippe de Morvelle, Revue des Deux Mondes, T.2,4, 1833)
- Mais rien ne put comprimer les battements de leurs c?urs pendant le discours de sir Francis M?, et, de mémoire humaine, ce fut là certainement le plus beau succès oratoire de la Société royale géographique de Londres. ? (Jules Verne, Cinq Semaines en ballon, 1863)
- Elle savait qu'il avait mis un orgueil masochiste (ça existe !) à abaisser son talent, à mirlitonner des vers politiques et à briser la cadence autrefois superbement oratoire de son style. ? (Jean Cau, Une nuit à Saint-Germain-des-Prés, Éditions Julliard, 1977)
Trésor de la Langue Française informatisé
ORATOIRE1, subst. masc.
RELIG. CATH.ORATOIRE2, adj.
Oratoire au Scrabble
Le mot oratoire vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot oratoire - 8 lettres, 5 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot oratoire au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
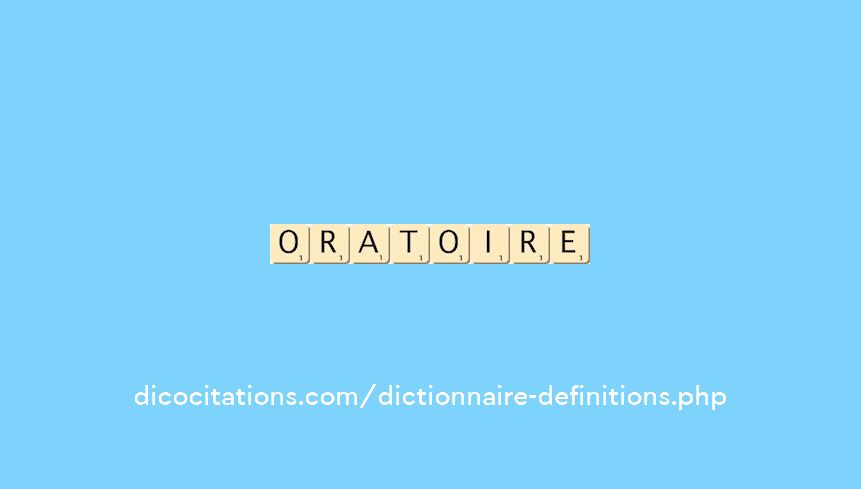
Les mots proches de Oratoire
Oracle Oraculeux, euse Orage Oragé, ée Orager Orageux, euse Oraison Oral, ale Orange Orangé, ée Orangeade Orangeat Oranger Oranger, ère Orangerie Orangiste Orang-outang Orateur Oratoire Oratoire Oratoirement Oratorien Oratorio Oraàs oracle oracles Oradour Oradour Oradour-Fanais Oradour-Saint-Genest Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Vayres orage orages orageuse orageuses orageux Orain Orainville oraison Oraison oraisons oral oral orale oralement orales oralité oranais oranaise orang-outan orang-outang orange orange orangé orangé Orange Orange Orange orangeade orangeades orangée orangée orangées orangées oranger oranger orangeraie orangeraies orangerie orangeries orangers orangesMots du jour
Oxalique Fallacieux, euse Décevoir Fagotage Renfourner Hémistiche Improuver Enjoindre Départi, ie Parenchyme
Les citations avec le mot Oratoire
- Laboratoires et découvertes sont des termes corrélatifs. Supprimez les laboratoires, les sciences physiques deviendront l'image de la stérilité et de la mort.Auteur : Louis Pasteur - Source : La Revue des cours scientifiques, 1er février 1868 et cité par Henri Mondor dans Pasteur (1945).
- Cet homme possédait des dons oratoires capables d'anéantir les mouches en plein vol.Auteur : Carlos Ruiz Zafón - Source : L' Ombre du vent (2001)
- L'homme est un animal singulier. Il a reçu le don de la parole, mais l'abrite souvent sous des précautions oratoires plus ou moins subtiles. « En tout état de cause », «en revanche», «en même temps» précèdent alternativement ce qu'il va dire. Mais la plus étrange est sans doute « c'est pas pour dire », suivie d'un mais qui annonce que l'on va dire beaucoup. En fait, il va moins s'agir de dire que de médire.Auteur : Philippe Delerm - Source : Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire des petites phrases
- La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Les harangues sont une autre espèce de mensonge oratoire que les historiens se sont permis autrefois. On faisait dire à ses héros ce qu'ils auraient pu dire.Auteur : Voltaire - Source : Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand (1759), Préface, VII
- Ces maudits savants torturent les animaux dans leurs laboratoires au nom de ce qu'ils appellent «le savoir», tout comme les Romains le faisaient au nom de ce qu'ils appelaient «le plaisir».Auteur : John Cowper Powys - Source : Camp retranché (1936)
- Mon corps est un laboratoire que j'offre en exhibition, l'unique acteur, l'unique instrument de mes délires organiques. Partitions sur tissus de chair, de folie, de douleur. Observer comme il fonctionne, recueillir ses prestations.Auteur : Hervé Guibert - Source : La Mort propagande (1977)
- C'est un sot que celui qui a dit que les belles paroles ne sauraient remplacer le beurre dans les épinards. La moitié du temps, les épinards de la société ne seraient pas mangeables si on ne les accommodait avec cette sauce oratoire.Auteur : William Makepeace Thackeray - Source : La Foire aux Vanités (1847-1848)
- Si l'on croit les comptes rendus des laboratoires et les procès-verbaux des policiers, il est plus facile de dénombrer à mille près des microbes que des manifestants.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Voici des jeunes gens auxquels nous prétendons dispenser de l'enseignement, au sein de cadres datant d'un âge qu'ils ne reconnaissent plus: bâtiments, cours de récréation, salles de classe, amphithéâtres, campus, bibliothèques, laboratoires, savoirs même.. cadres datant, dis-je, d'un âge et adaptés à une ère où les hommes et le monde étaient ce qu'ils ne sont plus. Auteur : Michel Serres - Source : Petite Poucette (2012)
- Le roman est le laboratoire du récit.Auteur : Michel Butor - Source : Essais sur le roman (1969)
- Parler en public, c'est se déshabiller. L'homme n'y voit pas forcément d'inconvénient : l'art oratoire est pour lui une façon de rivaliser de virilité.Auteur : Frédéric Pagès - Source : Philosopher ou l'art de clouer le bec aux femmes (2006)
- Veuillez, je vous prie, remercier Monsieur le Ministre et l'informer que je n'éprouve pas du tout le besoin d'être décoré, mais que j'ai le plus grand besoin d'avoir le laboratoire.Auteur : Pierre Curie - Source : Pierre Curie par Marie Curie
- C'est ainsi que naissent les grandes inventions: par le contact inopiné de deux produits posés par hasard, l'un à côté de l'autre, sur une paillasse de laboratoire.Auteur : Jean Echenoz - Source : Je m'en vais (1999)
- Laboratoire: Même quand on ne trouve rien, on renifle l'odeur de la vérité qui se cache.Auteur : Jean Rostand - Source : Carnet d'un biologiste (1959)
- Il faut enlever le savoir des églises et des laboratoires pour le rendre aux gens.Auteur : Bernard Werber - Source : Interview à la RTBF, 15 août 2008
- La plante artificialisée ne peut exister que dans ce laboratoire pour végétaux qu'est une serre.Auteur : Gilbert Simondon - Source : Du mode d'existence des objets techniques (1958)
- Nous trouvons de tout dans notre mémoire : elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où on met la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorrhe (1922-1923)
- Il fallait faire la part à son organe enchanteur, à sa beauté séduisante, à son geste fascinateur, à tous ces moyens oratoires par l'emploi desquels un acteur met dans une phrase un monde de sentiments et de pensées.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Séraphîta (1835)
- Le sujet des virus m'a toujours intéressé, mais je voulais l'écrire vraiment à la française. Je ne voulais pas d'une souche volée dans un laboratoire américain, qu'un méchant répandrait parmi la population. Non, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passerait spécifiquement en France, vraiment heure par heure, si une telle situation venait à arriver. Je voulais comprendre comment naît une pandémie. Je me suis donc rapproché de l'Institut Pasteur, à Lille, près de chez moi. Et le scénario développé alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.Auteur : Franck Thilliez - Source : Interview Le Point, par Julie Malaure, le 19/03/2020
- Le laboratoire était blanc et gris, largement baigné d'une froide lumière électrique.Auteur : Maxence Van der Meersch - Source : L'Elu (1936)
- Au laboratoire, on peut carboniser du sucre, non le transformer en alcool et gaz carbonique ainsi que le réalise la levure de bière.Auteur : François Jacob - Source : La Logique du vivant (1976)
- Fasciné par une réalité immédiate qui lui apparut dès lors plus fantastique que le vaste univers de sa propre imagination, il se désintéressa dès lors complètement du laboratoire d'alchimie.Auteur : Gabriel García Márquez - Source : Cent ans de solitude (1967)
- Sida: y a pas de solution! Les rats de laboratoire refusent de s'enculer!Auteur : Coluche - Source : Coluche les inoubliables : Tous ses sketches, toutes ses chansons
- Nous trouvons de tout dans notre mémoire; elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où on met au hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, La Prisonnière (1923)
Les citations du Littré sur Oratoire
- Quand tout cédait à Louis et que nous crûmes voir revenir le temps des miracles où les murailles tombaient au bruit des trompettes, tous les peuples jetaient les yeux sur la reine, et croyaient voir partir de son oratoire la foudre qui accablait tant de villesAuteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Je fus hier à un service de M. le chancelier [Séguier] à l'Oratoire ; ce sont les peintres, les sculpteurs, les musiciens et les orateurs qui en ont fait la dépense, en un mot les quatre arts libéraux ; c'était la plus belle décoration qu'on puisse imaginer.... Madame de Verneuil voulait acheter toute cette décoration un prix excessifAuteur : Madame de Sévigné - Source : 137
- La fin de son art oratoire [d'Épicure], qui estoit perspicuité de langage seulementAuteur : MONT. - Source : I, 192
- J'aurais bien plus écrit ; mais je dois regretter Quelques beaux jours perdus loin de mon oratoire : C'était un vrai roman ; le reste est de l'histoire, Et de la sainte encor [c'est Mme de Genlis qui parle]Auteur : M. J. CHÉN. - Source : les Nouveaux saints.
- Il est un des quatre premiers avec lesquels son instituteur [de l'Oratoire] en a posé les fondementsAuteur : BOSSUET - Source : Bourgoing.
- Un exorde doit être simple et sans affectation ; cela est aussi vrai dans la poésie que dans les discours oratoires, parce que c'est une règle fondée sur la nature, qui est la même partoutAuteur : BOILEAU - Source : Longin, Sublime, Réflexion 2
- Philippe, duc d'Orléans, avait un laboratoire et étudiait la chimieAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 17
- On ne douta point que l'auteur de la lettre ne fût un adepte [en alchimie] ou à peu près ; il fut reçu avec honneur dans le laboratoire et prié d'y faire les fonctions de secrétaireAuteur : FONTEN. - Source : Leibnitz.
- Après s'en va en temple et oratoire Dire oraisons, fait maint riche offertoire En plusieurs lieuxAuteur : J. MAROT - Source : V, 110
- Ces grands hommes se sont expliqués oratoirementAuteur : PATRU - Source : Plaid. 15, dans RICHELET
- Près de quarante mille saumoneaux obtenus dans mon laboratoire ont été portés par mes soins dans les eaux de l'Hérault et de ses affluents principauxAuteur : GERVAIS - Source : Acad. des sc. Comptes rendus, t. LIV, p. 147
- Un très bel messel, bien escrit et bien enluminé, qui est pour le roy en son oratoire, à deux fermoirs d'or, hachiez à fleurs de lys, et les tiroirs des chainettes d'or à un petit lis au boutAuteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 516
- De là vous pouvez connaître combien cette compagnie [l'Oratoire] est redevable aux soins de son général, qui savait si bien conserver en elle l'esprit de son institutAuteur : BOSSUET - Source : Bourgoing.
- On peut dire que la rhétorique de Quintilien, qu'il intitula Institutions oratoires, est la plus complète que l'antiquité nous ait laisséeAuteur : ROLLIN - Source : Hist. anc. Oeuv. t. XI, 2e part. p. 727, dans POUGENS.
- Dans le genre oratoire, il faut se souvenir que rien ne frappe la multitude que les grandes masses : les détails multipliés papillotent aux yeux de l'esprit, se confondent dans la mémoire, et ne font sur l'âme que des impressions légères et fugitives comme euxAuteur : MARMONTEL - Source : Oeuv. t. VII, p. 22
- Les pères de l'Oratoire donnèrent par leur piété aux autels de la chapelle royale leur véritable décoration, et au service divin sa majesté naturelleAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Angl.
- Comme il peut y avoir versification sans poésie, et poésie sans versification, nous avons cru ne devoir regarder la versification que comme une qualité du style, et la renvoyer à l'art oratoireAuteur : D'ALEMB. - Source : Oeuv. t. I, p. 343
- Qui parle longtemps parle trop sans doute ; je ne connais aucun discours oratoire où il n'y ait des longueursAuteur : Voltaire - Source : Lett. Vauvenargues, 1745
- La grande part qu'il a eue à fonder une institution si véritablement ecclésiastique [l'Oratoire]Auteur : BOSSUET - Source : Bourgoing.
- Comme les rhéteurs et M. le Batteux lui-même distinguent fort bien le syllogisme philosophique du syllogisme ou argument oratoireAuteur : DUMARS. - Source : ib. t. III, p. 364
- La syllepse oratoire est une espèce de métaphore ou de comparaison, par laquelle un même mot est pris en deux sens dans la même phraseAuteur : DUMARSAIS - Source : Tropes, II, 11
- Tout ce qui dans la description oratoire n'intéresse que l'imagination, est superflu et vicieux ; un modèle de ce genre est la description du supplice de Gavius dans la cinquième des VerrinesAuteur : MARMONTEL - Source : Élém. litt. t. VI, p. 459, dans POUGENS
- Nous répétâmes, dans mon laboratoire de Montbar, l'expérience de la platine [du platine] malléableAuteur : BUFF. - Source : Min. t. V, p. 456, note o.
- Il n'y a pas vingt ans, on se montrait dans les laboratoires de chimie une substance curieuse, blanche et nacrée, à laquelle on avait donné le nom de paraffine, en raison de son peu d'affinité pour les autres corps (du latin parum affinis) ; découverte en 1831 dans les produits de la distillation de la houille par Reichenbach, cette substance resta sans emploi jusqu'au jour où Sellègue en confectionna des bougiesAuteur : CH. MARTIN - Source : Monit. univ. 28 juin 1867, p. 828, 4e col.
- L'art oratoire ne pourrait même durer chez des peuples libres, s'il ne s'occupait d'affaires importantes, et ne conduisait l'homme d'une naissance obscure aux premières fonctions de l'ÉtatAuteur : DIDER. - Source : Claude et Nér. I, 16
Les mots débutant par Ora Les mots débutant par Or
Une suggestion ou précision pour la définition de Oratoire ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 19h25

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur oratoire
Poèmes oratoire
Proverbes oratoire
La définition du mot Oratoire est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Oratoire sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Oratoire présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
