Définition de « avoine »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot avoine de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur avoine pour aider à enrichir la compréhension du mot Avoine et répondre à la question quelle est la définition de avoine ?
Une définition simple : Commune dans le département 61 (Orne) en région Basse-Normandie (France)
Définitions de « avoine »
Trésor de la Langue Française informatisé
AVOINE, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun - français
avoine \a.vwan\ féminin
- Plante de la famille des Poacées (ou Graminées), et cultivée comme céréale ou comme fourrage.
- [?] ; puis, ayant longé un champ d'avoine, étoilé de bluets et de coquelicots, nous arrivâmes en un verger où des vaches, à la robe bringelée, dormaient couchées à l'ombre des pommiers. ? (Octave Mirbeau, Le Père Nicolas, dans Lettres de ma chaumière, 1885)
- Les champs d'avoine sont, certaines années, envahis par des plantes nuisibles telles que les chardons, les sanves, moutardes sauvages, ravenelles ; [?]. ? (Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts du département de la Lozère, 1903, page 24)
-
« Ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbue, qui sont de si sensibles baromètres. »
Je me gourmande d'avoir égaré, jusqu'au dernier, ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les deux barbes, aussi longues que celles des crevettes-bouquet, viraient, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. ? (Colette, Sido, 1930, Fayard, page 28.) - La femme du pêcheur est assise, un soir, sur le seuil de sa porte, tissant ces brins de paille d'avoine que l'on cueille avant leur maturité sur les froides montagnes de la forêt Noire pour en faire de légères corbeilles et d'élégants chapeaux. ? (Xavier Marmier, Histoire d'un pauvre musicien (1770-1793), 1866)
-
Grain de cette plante.
- Le taureau doit être choisi, comme le cheval étalon, parmi les plus beaux de son espèce. [?]. On lui fait manger alors de l'avoine, de l'orge & de la vesce, pour lui donner de l'ardeur & lui procurer une plus grande abondance de liqueur séminale. ? (Jacques-Christophe Valmont de Bomare, Dictionnaire raisonné universel d'Histoire Naturelle, tome 8, 3e édition, 1776, page 455)
- On fait aussi du pain, mais d'une digestion assez difficile, avec du seigle, de l'orge et même de l'avoine ; [?]. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 117)
-
(Argot) Coup, raclée.
- Faut pas vous gourer, c'est tout cérébral, la flagellation. Y a que des intellectuels pour réclamer l'avoine. ? (René Fallet, Le Beaujolais nouveau est arrivé, chapitre II ; Éditions Denoël, Paris, 1975)
- ? C'est des fascistes ! Des sales cons de putains de fumiers de fascistes ! Mais ma mère, elle leur donnera raison et j'aurai droit à une avoine. ? (François Cavanna, Lune de miel, Gallimard, 2011, collection Folio, page 247)
Littré
- 1Plante de la famille des graminées, qui fournit un aliment aux bêtes de somme.
-
2Le grain. Un picotin d'avoine.
Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé?
, La Fontaine, Fab. I, 4.Balle d'avoine, pellicule qui enveloppe le grain.
- 3 S. f. plur. L'avoine sur pied. Les avoines sont belles cette année.
PROVERBES
Cheval d'aveine, cheval de peine, c'est-à-dire un homme bien payé doit bien travailler.
Cheval faisant la peine ne mange pas l'aveine, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui a le plus de peine qui est le mieux traité.
HISTORIQUE
XIIIe s. Si a choisi [aperçu] en un plessié, Par encoste d'unes avaines, Une abaïe de blans moines
, Ren. 6519. Longue est et megre et lasse et vaine?; Grand soffrette a de pain d'avaine
, la Rose, 10198. Li pains et li avoine lor est tote faillie
, Ch. d'Ant. VII, 414.
XVe s. Le bled et les avoines furent respitées de non ardoir
, Froissart, II, II, 66.
XVIe s. Escouter les aveines lever (proverbe)
, Génin, Récréat. t. II, p. 239.
Encyclopédie, 1re édition
AVOINE, avena, genre de plante dont les fleurs n'ont point de pétales ; elles sont suspendues par petits paquets. Chaque fleur est composée de plusieurs étamines qui sortent d'un calice ; le pistil devient dans la suite une semence oblongue, mince, farineuse, enveloppée d'une capsule qui a servi de calice à la fleur. Les petits paquets de fleurs qui forment l'épi sont disposés de façon, que Dioscoride les compare à de petites sauterelles. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante (I)
* C'est des menus grains, celui qui se seme le premier : on en distingue principalement deux especes, l'une cultivée, l'autre sauvage ; celle-ci ne differe de l'autre, qu'en ce que ses grains sont plus grands & plus noirs.
Il y a la folle avoine, qu'on appelle aussi averon ; elle est stérile & sans grain. Elle infecte un champ, & se repeuple, à moins qu'on ne l'arrache & qu'on n'en coupe les tiges avant sa maturité.
Les Canadiens ont une sorte d'avoine, qu'ils recueillent en Juin ; elle est beaucoup plus grosse & plus délicate que la nôtre, & on la compare au riz pour la bonté.
Il y a des avoines rouges ; il y en a de blanches, & de noires. On croit que la rouge aime les terres légeres & chaudes ; qu'elle résiste moins aux accidens du tems ; qu'elle s'épie plûtôt que la noire, & qu'elle est moins nourrissante & plus chaude. La blanche passe pour avoir moins de substance que l'une & l'autre.
Vers la mi-Février, lorsque les grands froids seront passés, semez l'avoine, à moins que la terre ne soit trop humide. Semez-la plûtôt dans les terres fortes que dans les terres légeres & maigres, si vous craignez qu'elle ne verse. Prenez pour un arpent huit ou neuf boisseaux de semailles. Il faut que les terres où vous la répandrez, ayent eu un premier labour après la récolte des blés, & avant l'hyver. Le tems de sa semaille s'étendra jusqu'à la fin d'Avril : vous donnerez le second labour immédiatement avant que de semer : vous choisirez pour semer un tems un peu humide.
Si votre terre est forte, vous n'employerez point la charrue, pour recouvrir. Vous recouvrirez le grain semé dans les terres légeres, soit avec la charrue, soit avec la herse. Cela s'appelle semer dessous.
Quand vos avoines seront levées, vous les roulerez ; rouler, c'est abattre, adoucir, ou douçoyer, ou ploutrer, ou casser les mottes, & refouler le plant, avec un gros rouleau de bois, qu'un cheval traîne sur toute la piece d'avoine.
Vous n'oublierez pas de sarcler & d'échardonner ; il est aussi bon que vous sachiez que l'avoine dégénere dans les terres froides, & que par conséquent il faut les rechausser avec des fumiers ; que l'avoine que vous battrez pour en faire de la semence, n'ait point été échauffée.
Vous ne dépouillerez vos avoines qu'après les blés, sur la fin d'Août ; quand vous les verrez jaunes ou blanches, elles seront mûres. Il vaut mieux les scier que les faucher. Laissez-les javeller, ou reposer quelque tems sur le champ. Quand la rosée ou la pluie commencera à les noircir, écochelez ; écocheler, c'est ramasser l'avoine en tas avec des fourches, & en former des gerbes. Comme elle n'est pas sujette à germer, on peut la laisser un peu à la pluie, & même l'arroser s'il ne pleut pas.
Un bon arpent d'avoine rapportera cent gerbes ; un mauvais trente au moins ; & les cent gerbes donneront trois septiers-mine. Pour conserver vos avoines sur le grenier, mettez-y des feuilles de laurier. Plus vous les garderez, plus elles décheoiront. Elles veulent être souvent maniées. Ne donnez point d'avoine aux chevaux, sans l'avoir criblée & époussetée.
Les avoines se vendent ordinairement en Carême ; c'est le tems où les grandes maisons & les brasseurs. font leurs provisions. Dans les endroits où l'on rade la mesure, celle d'avoine se rade du côté rond, & les autres grains par la rive quarrée ; c'est la figure des grains qui fait cette différence. Il y a des endroits où elle se livre à la mesure ferue ; c'est-à-dire, qu'on frappe la mesure, soit avec la radoire, quand on ne la donne que rase, soit avec la pelle, quand on la fournit comble. Il y a des provinces où son boisseau est beaucoup plus grand que celui du blé, & où elle est assujettie à la verte moute. Voyez Verte moute, Boisseau, Mesure. Son prix dépend de toutes les causes qui font hausser & baisser les autres grains.
L'avoine sert principalement à nourrir les chevaux : on en fait du pain dans les tems de disette. Le gruau n'est autre chose que de l'avoine mondée. Voyez Gruau. Les Moscovites en tirent par la distillation, une liqueur dont ils usent en guise de vin, & qui n'enivre guere moins.
Il y a dans le Maine une avoine qui se seme avant l'hyver, & se récolte avant les seigles.
L'avoine analysée donne une liqueur limpide, qui a l'odeur & la saveur d'avoine cuite, & qui est un peu acide & obscurément salée ; une liqueur roussâtre, empyreumatique, acide, austere, acre, piquante, avec indice de sel alkali ; une liqueur brune, alkaline, urineuse, & imprégnée de sel volatil urineux ; enfin de l'huile épaisse comme un sirop. La masse noire restée dans la cornue & calcinée pendant douze heures au feu de réverbere, a donné des cendres dont on a tiré par lixiviation du sel alkali. Ainsi l'avoine est composée d'un sel ammoniacal enveloppé dans de l'huile ; ce qui forme un mixte mucilagineux.
Les bouillons d'avoine sont salutaires ; ils adoucissent les humeurs ; ils divisent, ils poussent par les urines, & ils excitent quelquefois la transpiration. Ils sont utiles dans les catarrhes, les enrouemens, la toux, l'ulcération & la secheresse de gorge ; les aphthes, la pleurésie, la péripneumonie, les érésipeles, & les fievres aiguës. L'avoine torréfiée dans une poele avec quelques pincées de sel, mise chaude sur le ventre dans un linge fin, soulage la colique ; surtout si on y ajoûte le genievre & le cumin ; & sa farine en cataplasme desseche & digere médiocrement.
Étymologie de « avoine »
Bourguig. aivonne?; Berry, aveine?; picard, avène?; provenç. et espagn. avena?; portug. avêa?; ital. avena?; du latin avena. Aveine est la prononciation de l'ouest de la France.
- (XVIIe siècle) Des parlers oïliques de l'Est[1] (champenois, lorrain, bourguignon, franc-comtois) et variante de l' ancien français aveine, redevance payée en avoine ; lui-même du latin av?na.
Avoine au Scrabble
Le mot avoine vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot avoine - 6 lettres, 4 voyelles, 2 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot avoine au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
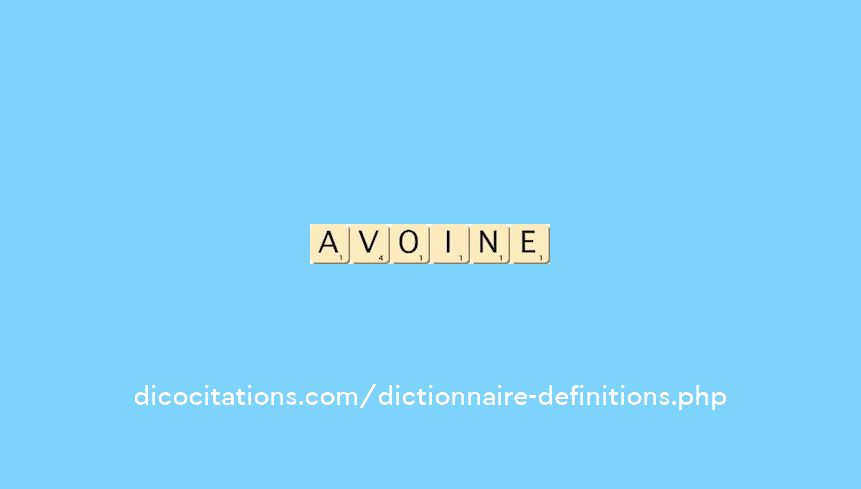
Les rimes de « avoine »
On recherche une rime en AN .
Les rimes de avoine peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en an
Rimes de opiomane Rimes de jerrycans Rimes de caravanes Rimes de morphinomane Rimes de savanes Rimes de castagne Rimes de doberman Rimes de vans Rimes de anglomanes Rimes de self-made-man Rimes de plane Rimes de alezanes Rimes de fan Rimes de birmanes Rimes de opiomane Rimes de platanes Rimes de balzanes Rimes de juan Rimes de castagnent Rimes de stramoine Rimes de pavane Rimes de atellanes Rimes de bagne Rimes de macédoine Rimes de joigne Rimes de champagne Rimes de membranes Rimes de mélomane Rimes de lanthane Rimes de partisanes Rimes de gitanes Rimes de dépannent Rimes de havane Rimes de profane Rimes de iguane Rimes de allemagne Rimes de tranche-montagne Rimes de plane Rimes de porte-cannes Rimes de fanes Rimes de épiphane Rimes de paonne Rimes de toman Rimes de sardoine Rimes de tsiganes Rimes de empoigne Rimes de Guyane Rimes de magnent Rimes de fane Rimes de pyromanesMots du jour
opiomane jerrycans caravanes morphinomane savanes castagne doberman vans anglomanes self-made-man plane alezanes fan birmanes opiomane platanes balzanes juan castagnent stramoine pavane atellanes bagne macédoine joigne champagne membranes mélomane lanthane partisanes gitanes dépannent havane profane iguane allemagne tranche-montagne plane porte-cannes fanes épiphane paonne toman sardoine tsiganes empoigne Guyane magnent fane pyromanes
Les citations sur « avoine »
- La médisance est l'avoine des esprits poussifs.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Je ne crois pas qu'aimer soit plus fort que d'être aimé, mais Balavoine a chanté beaucoup de conneries. C'est ce qui arrive aux chanteurs populaires lorsqu'ils se prennent pour des philosophes.Auteur : Mikaël Hirsch - Source : Avec les hommes (2013)
- Faute de blé on mange de l'avoine.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Le temps passé à l'église, et à donner l'avoine, ne nuit point à une journée.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- Chiffonet: Veux-tu que je me lie par une parole d'honneur? - Machavoine: Oh! oh! les paroles d'honneur... c'est comme la neige... ça fond devant le soleil!...Auteur : Eugène Labiche - Source : Le Misanthrope et l'Auvergnat
- L'avoine de février emplit le grenier.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- La pluie de juin - Fait belle avoine et maigre foin.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- A cheval leste, on augmente sa ration d'avoine.Auteur : Proverbes turcs - Source : Proverbe
- On appelle pareidolie la tendance instinctive à trouver des formes familières dans des images désordonnées. Dans les nuages, dans les constellations, ou même dans les flocons d'avoine qui flottent dans une tasse de lait.Auteur : Donato Carrisi - Source : Le Chuchoteur (2010)
- Cheval de foin, cheval de rien;
Cheval d'avoine, cheval de peine;
Cheval de paille, cheval de bataille.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - L'avoine d'avril, - C'est pour les brebis.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- Le meilleur fouet pour faire tirer le cheval, c'est l'avoine.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- Trop d'avoine fait crever le cheval.Auteur : Proverbes turcs - Source : Proverbe
- A Tarbes j'aurais voulu héberger à l'hôtel de l'Etoile où Froissart descendit avec Messire Espaing de Lyon, «vaillant homme et sage et beau chevalier, et où il trouva de bon foin, de bonnes avoines et de belle rivière».Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 3, Livre 31, Chapitre 1
- Si vous donnez de l'avoine à un âne. il vous paiera avec des pets.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Sur le temps que l'avoine croît, le cheval meurt.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- Le déjeuner du cavalier est la meilleure avoine du cheval.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Les prés les plus hauts entreront en toi avec les couleurs et les odeurs; avec la hampe des avoines, avec le balancement des fétuques chargés de graines.Auteur : Jean Giono - Source : Le Serpent d'étoiles (1931)
- Le cheval ne vaut pas l'avoine.Auteur : Proverbes russes - Source : Proverbe
- Pluie de Saint-Aurélien, - Belle avoine et mauvais foin.Auteur : Dictons - Source : 16 juin
- Je t'avais dit qu'on voulait plus te revoir ! T'es con ou tu veux vraiment une avoine ?Auteur : Alphonse Boudard - Source : La Rouquine propos recueillis par M. Rolland.
- Saint-Ex, qui aurait célébré son centenaire la semaine sernière, n'y parviendra jamais. Coluche, Le Luron et Balavoine non plus. On ne les aura pas vus perdre leurs cheveux, leurs dents et leur gloire.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Il ne faut pas laisser l'avoine dans le bac.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- Année de vin, point d'avoine.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- En mer, un marin n'avait aucune vie privée. Il dormait dans un hamac au coude à coude avec ses voisins. Sa ration de nourriture comportait des pois secs, des biscuits de mer, de la bière, de la bouillie d'avoine et de la viande salée.Auteur : Brian Lavery - Source : La fabuleuse histoire des bateaux (2012)
Les mots proches de « avoine »
Avocasser Avocat Avocate Avocatie Avocette Avoine ou aveine Avoir Avoir Avoisiner Avorté, ée Avortement Avorter Avorton Avoué, ée Avoué Avouer AvouerieLes mots débutant par Avo Les mots débutant par Av
avocaillon avocasseries avocat avocat-conseil avocate avocates avocatier avocats avocette Avocourt avoient avoinaient avoine Avoine Avoine avoiner avoines avoir avoir avoir avoirs Avoise avoisinaient avoisinait avoisinant avoisinant avoisinante avoisinantes avoisinants avoisine avoisinent avoisiner avoisinerait Avolsheim Avon Avon Avon-la-Pèze Avon-les-Roches Avondance avons avons Avord avorta avortait avortant avorte avorté avorté avortée avortée
Les synonymes de « avoine»
Les synonymes de Avoine :- 1. blé
2. céréale
synonymes de Avoine
Fréquence et usage du mot Avoine dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « avoine » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot Avoine dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Avoine ?
Citations avoine Citation sur avoine Poèmes avoine Proverbes avoine Rime avec Avoine Définition de Avoine
Définition de Avoine présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot Avoine sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot Avoine notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
