Définition de « latin »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot latin de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur latin pour aider à enrichir la compréhension du mot Latin et répondre à la question quelle est la définition de latin ?
Une définition simple : latin (msing)
Expression : en perdre son latin
Approchant : latin médiéval, latin classique, bas-latin, latin vulgaire
Définitions de « latin »
Trésor de la Langue Française informatisé
LATIN, -INE, adj. et subst.
Wiktionnaire
Adjectif - ancien français
latin \Prononciation ?\ masculin
-
Latin, romain.
-
Comment li roys latins donna
sa fille a Eneas qui ne l'avoit onques veue. ? (Roman d'Eneas, ms. 60 français de la BnF, f. 162r. c., rubrique (en gris sur le site de la BnF))
-
Comment li roys latins donna
Nom commun - ancien français
latin \Prononciation ?\ masculin
-
(Linguistique) Latin.
- De greu le torna en latin ? (Le Roman de Troie, édition de Constans, tome I, page 8, c. 1165)
-
Langue, parole.
- E parolent plusurs latins ? (Partonopeus de Blois, manuscrit de la Bibliothèque apostolique vaticane. 1175-1200. Fol. 21v.)
- Ramage des oiseaux.
- Ce qu'on a à dire, pensée.
- Avez vous dit votre latin ?
Nom commun - français
latin \la.t??\ masculin, au singulier uniquement
-
Langue indo-européenne dont sont originaires les langues romanes.
- Le bruit courut que les trois frères avaient été empoisonnés, et le public n'eut pas besoin de savoir le latin pour cherchez à découvrir le coupable pas l'application du vieil axiome « is fecit cui prodest ». ? (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Institut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 121)
- La mauvaise foi des « curés » était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. ? (Marcel Pagnol, La gloire de mon père, 1957, collection Le Livre de Poche, pages 21-22)
- « Et puis, au lycée, dit l'oncle, tu apprendras le latin, et je te promets que ça va te passionner ! Moi, du latin, j'en faisais même pendant les vacances, pour le plaisir ! » ? (Marcel Pagnol, Le château de ma mère, 1958, collection Le Livre de Poche, page 94)
- On s'est plu à qualifier le latin de langue de communication universelle. Or, la multiplicité de ses prononciations et la vanité des efforts pour établir une prononciation unique invitent, pour l'époque moderne, à tenir des propos plus nuancés et, dans le temps, à mesurer, à partir d'un exemple précis ? celui de la prononciation ?, l'écart entre les discours élaborés sur le latin et la réalité des faits. ? (Françoise Waquet, Parler latin dans l'Europe moderne. L'épreuve de la prononciation, 1996, page 279)
- Dans cette étonnante maison j'entends affirmer que sans la clé magique du latin il est inutile d'espérer ouvrir les portes du monde et qu'on demeure à jamais aveugle, sourd, invalide (le médecin, du reste, entreprend, dans cette année d'avant la sixième, d'enseigner les déclinaisons à mon amie et à moi et de nous initier à l'épitomé). ? (Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009, collection Folio, pages 131-132)
- [?] le latin est une langue de la famille indo-européenne appartenant au groupe des langues italiques, qui comporte également quelques langues moins répandues, comme par exemple l'osque ou l'ombrien, qui ont laissé peu de traces, alors que le latin a réussi à se faire une place de choix parmi les langues du monde au cours de sa longue histoire. ? (Henriette Walter, Minus, lapsus et mordicus : nous parlons tous latin sans le savoir, Robert Laffont, Paris, 2014, page 129)
- Alphabet utilisé par ces langues.
Adjectif - français
latin \la.t??\
-
(Histoire) Qui est originaire ou se rapporte aux Latins, les habitants du Latium.
- La mythologie latine.
-
(Par extension) Romain, relatif à l'empire romain.
- Le droit latin.
- Empire latin d'Orient.
-
(Linguistique) Relatif au latin, la langue.
- La littérature française du moyen-âge n'a guère que des antécédens latins. Les poésies celtique et germanique n'y ont laissé que de rares et douteux vestiges ; la culture antérieure est purement latine. C'est du sein de cette culture latine que le moyen-âge français est sorti, comme la langue française elle-même a émané de la langue latine. ? (Jean-Jacques Ampère, La Littérature française au moyen-âge, Revue des Deux Mondes, 1839, tome 19)
- L'homme ne doit savoir littérairement que deux langues, le latin et la sienne ; mais il doit comprendre toutes celles dont il a besoin pour ses affaires ou son instruction. ? (Ernest Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883, collection Folio, pages 166-167)
- « Votre castillan et notre français, et l'italien encore ne sont que des dialectes issus du latin parlé », poursuivit Joanny, récitant malgré lui sa grammaire ; « ce sont des langues vulgaires, d'anciens patois de paysans. Un temps viendra, vous dis-je, où de nouveau on enseignera le latin dans toutes les écoles de l'Empire, le latin classique, et où tous les vulgaires seront oubliés. ? (Valery Larbaud, Fermina Márquez, 1911, réédition Le Livre de Poche, pages 143-144)
- Toute la nuit, il avait rêvé qu'il récitait un discours latin en présence de l'Archevêque, et il lui avait semblé prononcer, ore rotundo, un nombre infini de belles terminaisons et de nobles désinences : abunt, arentur, ibus, arum? ? (Valery Larbaud, Fermina Márquez, 1911, réédition Le Livre de Poche, page 210)
- Les plus énormes bêtises qui sortaient de la bouche de Johnson prenaient en effet je ne sais quel accent de véracité qui tenait sans doute au style de l'orateur, à la parfaite symétrie de ses phrases et à son redoutable arsenal de mots savants à désinences latines. ? (Julien Green, Samuel Johnson, dans Suite anglaise, 1972, Le Livre de Poche, page 12)
-
Le jeune jésuite chargé de la classe de latin lit à haute voix les thèmes des élèves sur un ton de persiflage, pour faire rire. Michel en particulier, nouveau venu expulsé depuis peu par une institution laïque, sert de cible.
? Voici, Messieurs, du latin de lycée.
? Cela vous changera de votre latin de sacristie. ? (Marguerite Yourcenar, Archives du Nord, Gallimard, 1977, page 225)
- Qui s'exprime dans cette langue.
- Les auteurs latins.
- ? Je prenais sur mes nuits pour parfaire ma connaissance des maîtres latins. Car je les préfère aux Grecs. Ceux-ci sont plus élégants, peut-être. Mais les autres sont plus vigoureux, et ont davantage le sens du droit. ? (Pierre Benoit, Le lac salé, 1921, réédition Le Livre de Poche, page 203)
-
(Religion) Relatif à l'Église catholique romaine.
- L'église latine ; de rite latin.
- Qui a certaines caractéristiques des habitants du Latium, des anciens Romains et, par extension, des peuples qu'ils ont longtemps et durablement colonisés et influencés.
- Il releva ses cheveux. Sa beauté était célèbre à Tolède : nez aquilin, yeux très grands, le masque conventionnel de beauté latine. ? (André Malraux, L'Espoir, 1937, page 622)
- Qui a pour origine la langue latine, qui à l'origine parlait le latin.
- Les peuples latins.
-
(En particulier) Espagnol, portugais et italien par opposition à anglo-saxon.
- Amérique latine.
Nom commun - français
Latine \la.tin\ féminin (pour un homme, on dit : Latin)
-
Habitante du Latium.
- Celui-ci [l'antimoine] donnait donc le stibium, le mascara de ces Latines de la Rome antique. ? (Anne-Marie Mommessin, Femme à sa toilette: beauté et soins du corps à travers les âges, Altipresse, 2007, p. 92)
-
Habitante d'un pays ou région où les langues sont dérivées du latin : Italie, Espagne, Portugal, France, Roumanie, Suisse (cantons francophones, plus le Tessin italophone) ou Belgique romane.
- Finalement, hormis mon éternel couple d'indécis, venu visiter un appartement, tout en sachant qu'il ne l'achèterait pas, je suis assez satisfait de ma rencontre avec cette Latine, qui me fait littéralement fondre. ? (Jean-Frédéric Toiron, Symphonie au balcon, dans Voyeurisme, ouvrage collectif, Évidence Éditions, 2019)
- Mon père, Fernand, était un solide Bourguignon de Châtillon-sur-Seine et ma mère, Yvonne, une Française d'origine italienne dont la famille était installée en Tunisie depuis longtemps. Pourriez-vous imaginer quel fut le choc des cultures entre cette Latine exubérante et sans-gêne et ce sous-officier réservé qui venait de la de la France profonde et paysanne pour prendre ses quartiers à Bizerte ? ? (Serge Dufoulon, Itinéraire d'une grande gueule: Du Bled à l'Université, Paris : Editions Orizons, 2016, p. 26)
- (Par extension) Habitante d'un pays d'Amérique ayant été colonisé par une nation latine européenne.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui appartient à la race latine. Auteurs latins. Par extension, Dictionnaire latin. Discours latin. Version latine. Thème latin. L'Église latine, Toute l'Église d'Occident, par opposition à l'Église grecque ou d'Orient. Les pères de l'Église latine. On dit de même Le rite latin, Le rite de l'Église romaine. On appelle aussi substantivement Latins Ceux qui sont de l'Église latine. Les Latins et les Grecs diffèrent de croyance et de pratique en plusieurs points. Fig., Le quartier latin, Le quartier qu'occupait autrefois l'Université de Paris et où sont encore la Sorbonne, le Collège de France, les Écoles de Droit et de Médecine, plusieurs lycées, etc. En termes de Marine, Voile latine, Voile faite en forme de triangle, en usage principalement sur la Méditerranée.
LATIN est aussi nom masculin et signifie la Langue latine. Enseigner, apprendre le latin. Savoir bien le latin. Parler latin. Écrire en latin, en bon latin. Mauvais latin. Latin de Cicéron. Ce latin n'est pas pur. Bas latin, Latin des auteurs classiques, parlé et écrit au moyen âge dans l'Église et dans les écoles, mais déformé par le temps et par l'ignorance de ceux qui s'en servaient. Fig. et fam., Latin de cuisine, Fort mauvais latin. Fig. et fam., Il est au bout de son latin, se dit de Quelqu'un qui ne sait plus où il en est, qui ne sait plus que dire, que faire. Il y a perdu son latin, se dit de Quelqu'un qui a travaillé inutilement à quelque chose, qui y a perdu son temps et sa peine. J'y perds mon latin, Je n'y comprends rien.
Littré
-
1Nom d'un ancien peuple de l'Italie, qui habitait le Latium, contrée située entre l'Étrurie et la Campanie, et que Rome finit par conquérir et s'associer.
Plus tard, Latin est devenu le nom de tous les peuples de l'Italie.
Les Latins, les catholiques de l'Église latine. Les Latins et les Grecs diffèrent de croyance et de pratique en plusieurs points.
Latins s'est dit, au temps des croisades, des peuples de l'Occident. L'armée des Latins.
Empereurs latins, les empereurs français qui ont régné à Constantinople de 1204 à 1261.
-
2 Adj. Qui appartient à la nation des latins. Les peuples latins. Les villes latines.
Quand Juvénal? Gourmandait en courroux tout le peuple latin
, Boileau, Sat. VII.Voie latine, route partant de Rome et conduisant à Casilinum.
-
3 Particulièrement. Qui appartient à la langue de Rome, dont le dialecte était latin et devint la langue de toute l'Italie. Mot latin.
La langue latine du temps de Théodose se parlait de Cadix à l'Euphrate
, Voltaire, Ann. Emp. Introd.Discours latin, harangue latine, vers latins, discours, harangue, vers composés en langue latine.
Horace?: Puisque je parle si mal votre langue, croyez-vous, messieurs les faiseurs de vers latins, que vous soyez plus habiles dans la nôtre??
Boileau, Dial. contre les mod. etc.Dictionnaire latin et français, dictionnaire où le latin est interprété par le français. Dictionnaire français et latin, dictionnaire où le français est interprété par le latin. On dit plus souvent sans et?: Dictionnaire latin-français, français-latin.
Terme de grammaire. Cas latin, s'est dit de l'ablatif, parce que cette forme n'existe pas en grec.
Le pays latin, le quartier latin, l'espace qu'occupait autrefois l'université de Paris, c'est-à-dire l'espace entre la Seine et la montagne Sainte-Geneviève, et entre la rue du Bac et celle du Cardinal-Lemoine.
Le navet n'a-t-il pas, dans le pays latin, Longtemps composé seul ton modeste festin??
Rivarol, le Chou et le navet, dans LAHARPE, Correspond. t. IV, p. 3, dans POUGENS.Non loin des bords de la Seine, Paris ne connaît qu'à peine Un quartier sombre et lointain, Qui sur le coteau s'élève, Devers Sainte-Geneviève?: C'est le vieux quartier latin
, G. Nadaud, le Quartier latin.Familièrement. Cela sent le pays latin, se dit de tout ce qui retient un certain air de collége.
-
4L'Église latine, toute l'Église d'Occident, par opposition à l'Église grecque ou d'Orient. Les Pères de l'Église latine.
Le rit latin, le rit de l'Église romaine.
-
5 Terme de marine. Voile latine, voile qui a la forme d'un triangle.
Bâtiment latin, bâtiment gréé de voiles triangulaires.
-
6 S. m. Le latin, la langue latine. Enseigner le latin. Latin de Cicéron, de Tite-Live.
Si les gens de latin des sots sont dénigrés
, Régnier, Sat. III.Je n'aime point céans tous vos gens à latin
, Molière, Fem. sav. II, 7.On veut de votre bien revêtir un nigaud Pour six mots de latin qu'il fait sonner bien haut
, Molière, ib. III, 1.Pour avoir employé neuf ou dix mille veilles à se bien barbouiller de grec et de latin, Et se charger l'esprit d'un ténébreux butin
, Molière, ib. IV, 3.Avant lui [Boileau] Juvénal avait dit en latin Qu'on est assis à l'aise aux sermons de Cotin
, Boileau, Sat. IX.On peut observer que les deux hommes qui ont le plus protégé les lettres ne savaient pas le latin, Louis XIV et M. Colbert
, Voltaire, Louis XIV, Écriv. Gallois.La célèbre marquise du Châtelet apprit le latin en un an, et le savait très bien?; tandis qu'on nous tenait sept années au collége pour nous faire balbutier cette langue, sans jamais parler à notre raison
, Voltaire, Dict. phil. Éducation.Le lendemain matin, on les [des soldats vainqueurs] mène à l'église Rendre grâce au bon Dieu de leur noble entreprise, Lui chanter en latin qu'il est leur digne appui, Que dans la ville en feu l'on n'a rien fait sans lui
, Voltaire, la Tactique.Je m'appliquai particulièrement à l'étude du latin, parce que peu de femmes savent cette langue
, Genlis, Mme de Maintenon, t I, p. 101, dans POUGENS.Bon latin, mauvais latin, emploi correct, incorrect de la langue latine. Le bas-latin, latin parlé ou écrit après la chute de l'empire romain et durant le moyen âge?; on en distingue deux sortes?: l'un antérieur, qui appartient aux premiers siècles et à une latinité encore vivante?; l'autre postérieur, sans existence propre, et qui n'est qu'une forme latine donnée par les notaires et par les moines aux mots de la langue vulgaire.
Latin moderne, le latin écrit par les modernes.
Fig. Être au bout de son latin, ne savoir plus que faire, que dire, être au bout de son savoir.
Leur mécompte pourtant, quel qu'il soit, me console, Et, bien qu'il me réduise au bout de mon latin, Un peu plus en repos j'en attendrai la fin
, Corneille, la Suiv. IV, 4.Et par elle le roi Latin Étant au bout de son latin
, Scarron, Virg. VII.Perdre son latin, travailler inutilement à quelque chose, y perdre son temps et sa peine.
Revêche à mes raisons, il se rend plus mutin?; Et ma philosophie y perd tout son latin
, Régnier, Sat. X.L'aventure me passe, et j'y perds mon latin
, Molière, le Dép. II, 4.Le précepteur et les régents perdaient leur latin en me le voulant apprendre
, Hamilton, Gramm. 3.Il y a à la fois relâchement et spasme [dans ma maladie]?; les docteurs y perdront leur latin, et moi l'espérance
, D'Alembert, Lett. au roi de Prusse, 28 avr. 1783.Préfets, télégraphes, gendarmes? rien n'y sert?; missionnaires, jésuites, aumôniers, y perdent leur peu de latin
, Courier, Lettres au réd. du Censeur, X.Latin de cuisine, mauvais latin?; on a dit que cette expression vient des jésuites qui étaient dans l'usage de faire demander par les élèves aux valets les objets de première nécessité. C'est du latin de cuisine, il n'y a que les marmitons qui l'entendent.
Parler latin devant les cordeliers, parler d'une chose devant des gens qui la savent mieux que nous.
Il parle latin, c'est du latin, s'emploie quelquefois pour dire?: c'est une chose qu'on ne comprend pas, comme on dit?: c'est de l'hébreu.
Parlez latin, se dit à quelqu'un qui raconte quelque chose de leste.
-
7 S. m. Latin s'emploie quelquefois pour latiniste.
Je vous crois grand latin et grand docteur juré
, Molière, Dép. II, 7. -
8À la latine, loc. adv. À la façon de la langue latine.
Il n'est rien si commun qu'un nom à la latine?; Ceux qu'on habille en grec ont bien meilleure mine
, Molière, Fâcheux, III, 2.
HISTORIQUE
XIIe s. Car li vilains le trueve et dist en son latin?
, Roncis. p. 195. Devant la pape esturent li messagier real, Alquant diseient bien, pluisur diseient mal, Li alquant en latin
, Th. le mart. 55.
XIIIe s. Et cil oisel chascun matin S'estudient en lor latin à l'aube du jor saluer, Qui tout lor fait les cuers muer
, la Rose, 8446. Il fut le premier roi latin qui porta couronne au royaume de Jerusalem
, Ass. de Jérus. p. 186, dans LACURNE.
XIVe s. Ens el mois de setembre, qu'estés va à declin, Que cil oisillon gay ont perdu lou latin?
, le V?u du héron, cité dans LACURNE STE-P. Mém. sur l'ancienne chevalerie, t. II, p. 95.
XVIe s. Lors ils commencerent à parler le latin de leur mere [français] et à dire qui ils estoient
, Despériers, Contes, XXII. Vos regens de Paris sont grans latins
, Despériers, ib. XXIII. De beau latin ferré à glace
, Despériers, ib. XLIX. Il obtint sa grace du roi, pour avoir craché quelques mots de latin rosti
, Despériers, ib. CXI. La fin du monde approche, les bestes parlent latin
, Oudin, Curios. franç. Comme on dit en commun proverbe, on y perdroit son latin
, H. Estienne, Apol. pour Hérod. p. 13, dans LACURNE. Il ne faict que escorcher le latin, et cuyde ainsi pindariser
, Rabelais, II, 6.
Étymologie de « latin »
- (Adjectif) Du latin Latinus (« du Latium, latin »).
- (Nom commun) Du latin Lat?num (« langue latine »).
Provenç. latin?; catal. llati?; esp. latino, latin?; ital. latino?; du lat. latinus. Dans l'ancien français, latin signifiait langage, idiome, et surtout la langue vulgaire, et latinier un interprète. Perdre le latin y signifiait perdre la parole, cesser de pouvoir parler sa langue. Quant à y perdre son latin, le sens moderne est?: y employer inutilement son latin?; mais le sens propre et ancien est?: perdre, oublier ce qu'on sait de latin.
latin au Scrabble
Le mot latin vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot latin - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot latin au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
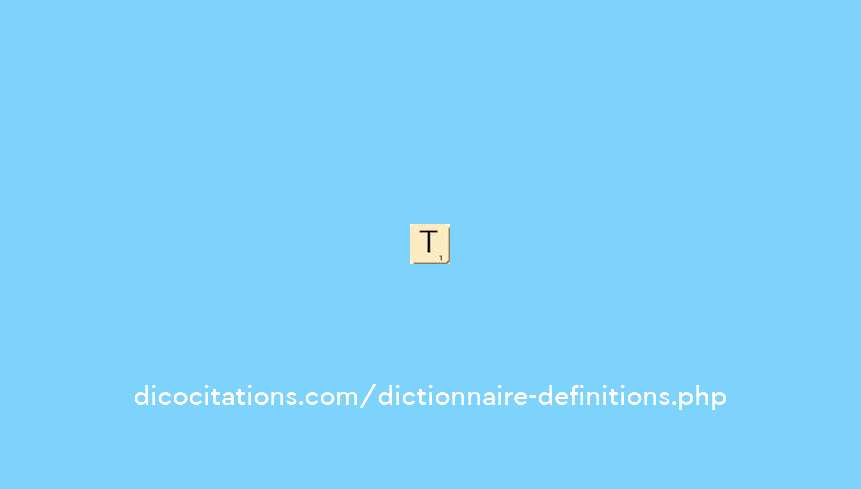
Les rimes de « latin »
On recherche une rime en T5 .
Les rimes de latin peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en t5
Rimes de plaisantin Rimes de putain Rimes de atteins Rimes de piétin Rimes de travertin Rimes de lointains Rimes de pantins Rimes de tins Rimes de festin Rimes de plantains Rimes de tourmentin Rimes de déteints Rimes de indistincts Rimes de lamantin Rimes de routin Rimes de palatin Rimes de bouquetin Rimes de sacristain Rimes de teint Rimes de éteins Rimes de satins Rimes de crottins Rimes de margotins Rimes de tins Rimes de hautains Rimes de baratins Rimes de martin Rimes de valdôtains Rimes de laborantins Rimes de fretin Rimes de scrutins Rimes de distincts Rimes de traîne-patins Rimes de teints Rimes de ultramontain Rimes de obtint Rimes de certain Rimes de châtains Rimes de argentins Rimes de galantins Rimes de cadratin Rimes de fagotins Rimes de tibétains Rimes de clandestins Rimes de éteints Rimes de plantain Rimes de soutînt Rimes de cabotin Rimes de serpentin Rimes de obtinsMots du jour
plaisantin putain atteins piétin travertin lointains pantins tins festin plantains tourmentin déteints indistincts lamantin routin palatin bouquetin sacristain teint éteins satins crottins margotins tins hautains baratins martin valdôtains laborantins fretin scrutins distincts traîne-patins teints ultramontain obtint certain châtains argentins galantins cadratin fagotins tibétains clandestins éteints plantain soutînt cabotin serpentin obtins
Les citations sur « latin »
- Quand les ânes parleront latin.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- La forme actuelle de cette église est celle d'un crucifix ou croix latine.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Mémoires d'un touriste (1838)
- Le Latin possède une extraordinaire capacité d'analyse, en même temps que de généralisation.Auteur : André Siegfried - Source : L'Ame des peuples (1950)
- La botanique est l'art de dessécher des plantes entre des feuilles de papier buvard et de les injurier en grec et en latin.Auteur : Alphonse Karr - Source : Sans référence
- Un homme qui défend le français, le latin ou le grec, ou simplement l'intelligence est un homme perdu.Auteur : Charles Péguy - Source : Pensées
- Lorsqu'une discussion ne tourne pas à notre avantage, il reste, en dernier ressort, à placer une statistique. Les médecins de Molière avaient le grec et le latin ; nous avons les statistiques et les sondages. Jadis, la pédanterie était éloquente ; désormais, elle est sèche et scientifique. Auteur : Georges Picard - Source : Petit traité à l'usage de ceux qui veulent toujours avoir raison (1999)
- Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais, depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde, et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes.Auteur : Paulo Coelho - Source : L'Alchimiste (1988)
- Pourquoi ne pas alors signaler qu'en français aussi, phonétiquement, il existe un lien intime entre beauté et bonté ? Ces deux mots viennent du latin bellus et bonnus, lesquels dérivent de fait d'une racine indo-européenne commune : dwenos. Je n'oublie pas non plus qu'en grec ancien, un même terme, kalosagathos, contient et l'idée de beau (kalos) et l'idée de bon (agathos).
Auteur : François Cheng - Source : Cinq méditations sur la beauté (2006)
- Ta montre est suisse
Ta chemise est indienne
Ta radio est coréenne
Tes vacances sont tunisiennes
Tes chiffres sont arabes
Ton écriture est latine
Et tu reproches à ton voisin d'être étranger.Auteur : Julos Beaucarne - Source : J'ai vingt ans de chansons (1987), Ton Christ Est Juif - De tous les proverbes latins, c'est celui que Séléné connaît le mieux. Pas besoin de le lui rappeler, il la suit sans cesse, ronronne derrière elle comme un chat familier, souviens-toi de te méfier.Auteur : Françoise Chandernagor - Source : La Reine oubliée, Les Dames de Rome (2012)
- Tous les mots latins en "or" ont donné des mots français en "eur": horreur, honneur... Sauf un ! Lequel ? Le mot amour. Amor a donné amour. Pourquoi ? Il semble qu'il ait été inventé par les troubadours de langue d'oc à l'occasion du départ pour les croisades. Il s'agissait alors de chanter les princesses lointaines. Ainsi, c'est comme si l'amour avait été inventé pour et par le virtuel. "L'absence est à l'amour ce qu'au feu est le vent, il éteint le petit, il allume le grand", écrivait Bussy-Rabutin. Nous sommes des bêtes à virtuel depuis que nous sommes des hommes. Pendant que je parle, une partie de mes pensées est à ce que je dois faire ensuite, une partie est à mes cours de Stanford, une autre se souvient de mon dernier voyage en Afrique du Sud... Toutes nos technologies sont le plus souvent du virtuel.Auteur : Michel Serres - Source : Interview Le Monde le 18 juin 2001
- Le socialisme aux Etats-Unis diffère totalement du socialisme européen. L'idéal du travailleur américain est de devenir patron, alors que l'ouvrier latin rêve surtout la suppression du patron.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Les Incertitudes de l'heure présente
- C'est du latin, petit. Il n'y a pas de langues mortes, il n'y a que des cerveaux engourdis.Auteur : Carlos Ruiz Zafón - Source : L'Ombre du vent (2001)
- Le lendemain de notre conversation, Hannah avait voulu savoir ce que j'apprenais au lycée. Je lui parlai des poèmes homériques, des discours de Cicéron, et de l'histoire d'Hemingway sur le vieil homme et son combat avec le poisson et avec la mer. Elle voulut entendre à quoi ressemblaient le grec et le latin, et je lus à haute voix des passages de l'Odyssée et des Catilinaires. Auteur : Bernhard Schlink - Source : Le Liseur (1996)
- Que l'on adjousteroit un jour d'avantage aux feries latines, et que desormais on en festoyeroit et chommeroit quatre.Auteur : Jacques Amyot - Source : Camille, 73
- Si j'ai pris quelque chose dans les Grecs et dans les Latins, je n'ai rien pris du tout dans les Italiens, dans les Espagnols ni dans les Français, me semblant que ce qui est étude chez les Anciens est volerie chez les Modernes.Auteur : Georges de Scudéry - Source : Alaric ou Rome vaincue (1654), Préface
- Pour arriver à cette connaissance (des tours de la langue latine), il faut avoir vu ces mots, ces tours et ces phrases, maniés et ressassés, si je puis ainsi parler, dans mille occasions différentes.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Latin des modernes
- Mais qu'est-ce que c'est encore, M. Le Curé ? Déjà qu'on dit plus la messe en latin, c'est pas que vous allez mettre du plastique sur les murs, non ?Auteur : Pierre Christin - Source : Légendes d'aujourd'hui, Le Vaisseau de pierre (1976)
- ... l'homme se distingue avant tout du reste de la nature par une couche glissante et gélatineuse de mensonge qui l'enveloppe et le protège.Auteur : Hermann Hesse - Source : Peter Camenzind
- Que pouvait bien apporter l'étude des classiques de l'Antiquité aux jeunes esprits des temps modernes ? se demandaient ces philosophes. Locke, comme encore beaucoup de parents aujourd'hui, se gaussait : que gagnerait un ouvrier à savoir le latin ? À quoi Wolf répliquait : la connaissance de la nature humaine. Auteur : Daniel Mendelsohn - Source : Une Odyssée : Un père, un fils, une épopée (2019)
- L'amour et la scarlatine sont plus dangereux à proportion qu'on a vieilli.Auteur : Paul-Jean Toulet - Source : Monsieur du Paur, homme public (1898)
- Certains nuages en effet semblent surplomber tous les autres, et s'étirent comme des griffures de chat ou des crinières, en longues fibres parallèles ou divergentes, presque diaphanes ; Howard les nomme des filaments : ce seront, en latin, les cirrus.Auteur : Stéphane Audeguy - Source : La Théorie des nuages (2005)
- Il faut d'abord bien savoir le latin. Ensuite il faut l'oublier.Auteur : Charles de Secondat, baron de Montesquieu - Source : Mes Pensées
- Un homme comme Montaigne est un Latin, de sentiments, de pensée et même de style; un homme comme Rabelais est un Grec, de sentiments et de pensée au moins; de langue parfois.Auteur : Emile Faguet - Source : Etudes littéraires du seizième siècle
- En latin legere signifie lire et signifie cueillir. Cette langue latine est charmante.Auteur : Emile Faguet - Source : L'Art de lire (1912)
Les mots proches de « latin »
Latemment Latent, ente Latéral, ale Laticlave Latin, ine Latineur Latiniser Latiniseur Latinité Latitant, ante Latitude Latitudinarien Latitudinarisme Latrie Latrines Lattage Latte LatterLes mots débutant par lat Les mots débutant par la
Lataule latence latences latent latente latentes latents latéral latérale latéralement latérales latéralisée latéralité latéraux latérite Latet Latette latex Lathuile Lathus-Saint-Rémy Lathuy laticlave latifundistes Latillé Latilly latin latin latine latine latines latines latinisaient latinisé latinisée latinismes latiniste latinistes latinité latinités Latinne latino latino-américain latino-américaine latino-américains latinos latins latins latitude latitudes Latoue
Les synonymes de « latin»
Les synonymes de latin :- 1. romain
synonymes de latin
Fréquence et usage du mot latin dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « latin » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot latin dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Latin ?
Citations latin Citation sur latin Poèmes latin Proverbes latin Rime avec latin Définition de latin
Définition de latin présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot latin sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot latin notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 5 lettres.
