La définition de Merveilleux, Euse du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Merveilleux, euse
Nature : adj.
Prononciation : mèr-vè-lleû, lleû-z', ll mouillées, et n
Etymologie : Merveille ; Berry, marveilleux ; bourg. morvouillou ; provenç. meravillos, meravillios ; catal. maravellos ; espagn. maravilloso ; ital. maraviglioso.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de merveilleux, euse de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec merveilleux, euse pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Merveilleux, Euse ?
La définition de Merveilleux, Euse
Qui tient de la merveille.
Toutes les définitions de « merveilleux, euse »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui cause une grande admiration, mêlée d'une sorte de surprise. Un esprit merveilleux. C'est un homme merveilleux. On ne vit jamais rien de plus merveilleux. C'est une pièce merveilleuse. Cela a produit un effet, obtenu un succès merveilleux. Un événement merveilleux. Un récit accompagné de circonstances merveilleuses. Il signifie aussi Qui est excellent en son espèce. Les muscats ont été merveilleux cette année. Les draps de cette fabrique sont merveilleux. Fam. et par ironie, Vous êtes un homme merveilleux, Vous êtes un homme étrange, extraordinaire par vos sentiments, par vos manières.
MERVEILLEUX s'emploie comme nom dans le langage de la littérature pour signifier l'Intervention des êtres surnaturels dans un poème épique ou dramatique. Le merveilleux de la mythologie. Il a emprunté le merveilleux de son épopée à la magie, à la féerie. Dans ce poème, le merveilleux se réduit à l'emploi de personnages allégoriques. On distingue le merveilleux chrétien et le merveilleux païen. Il signifie aussi Ce qui, dans un événement, dans un récit, s'éloigne de l'ordre naturel et du cours ordinaire des choses. Voilà le merveilleux de l'aventure, de l'histoire. Il s'est dit aussi substantivement, à l'époque du Directoire, de Celui, de celle qui affectaient une élégance excentrique. Un merveilleux, une merveilleuse.
Littré
-
1Qui tient de la merveille.
Et loin de te blâmer, tant que j'aurai de voix, Je pourrai publier tes merveilleux exploits
, Mairet, Mort d'Asdr. II, 3.Seigneur, cette surprise est pour moi merveilleuse
, Corneille, Pomp. I, 4.Je ne sais qui fut ta nourrice?; Mais ton corps me paraît en merveilleux état
, La Fontaine, Fabl. II, 16.C'était le temps où elle devait être livrée à elle-même, pour mieux sentir dans la suite la merveilleuse victoire de la grâce
, Bossuet, Anne de Gonz.De ses traits et des miens le merveilleux rapport Ne saurait envers vous justifier sa mort
, Quinault, Agrip. II, 4.Ce cousin des quatre fils Aimon Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire
, Boileau, Ép. X.Et en effet, grand Dieu?! vos serviteurs pourraient-ils mener sur cette terre de malédiction la vie sainte et merveilleuse qu'ils mènent, si vous n'étiez sans cesse avec eux??
Massillon, Paraph. ps. XV, V. 2.Il se dit aussi des personnes.
Vous savez comme le roi a donné deux mille livres de pension à Mlle de Scudéry? elle fut remercier Sa Majesté? c'était une affaire que de recevoir cette merveilleuse Muse
, Sévigné, 5 mars 1683.La Mousse [un cartésien] est fort glorieux d'avoir fait en vous une si merveilleuse écolière
, Sévigné, à Mme de Grignan, 20 sept. 1671.Et les villes, et les montagnes, et les pierres mêmes y parlaient de ces hommes merveilleux
, Bossuet, Hist. II, 3.Il n'est plus question, à l'heure qu'il est, de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des hommes merveilleux?; c'est une chose sans contestation, puisque vingt siècles en sont convenus?: il s'agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux
, Boileau, Longin, Subl. réfl. 7.Quel sera quelque jour cet enfant merveilleux??
Racine, Athal. II, 9.Parut-il jamais un homme plus merveilleux [que Jésus-Christ], plus divin dans ses ?uvres et dans toutes les circonstances de sa vie??
Massillon, Avent, Divinité de J. C.Par plaisanterie.
Embrasse-moi, car tu es trop merveilleux
, Hamilton, Gramm. 3.Par ironie.
Toi qui crois tout savoir, merveilleux Furetière
, La Fontaine, Épigr. contre Furetière.Le monde est merveilleux dans ses idées, et prend bien plaisir à se tromper
, Bourdaloue, Pensées, t. I, p. 418.Familièrement et par ironie. Vous êtes un merveilleux homme, c'est-à-dire vous êtes un homme étrange, extraordinaire par vos sentiments, par vos manières.
-
2Excellent en son espèce. Voilà du vin merveilleux.
Du Metz avait remarqué dès hier un endroit qu'il prétend merveilleux pour battre la citadelle à revers
, Pellisson, Lett. hist. t. III, p. 212, dans POUGENS.Ces poulets sont d'un merveilleux goût
, Boileau, Sat. III.Voilà donc le fruit de cette éducation merveilleuse dont ton père était si vain?!
Diderot, Père de famille, II, 8. -
3 S. m. Ce qu'il y a d'excellent.
Il a du bon et du louable, qu'il gâte par l'affectation du grand et du merveilleux
, La Bruyère, XI.À l'égard de son éducation si vantée, je n'en vois pas le merveilleux
, Genlis, Adèle et Théod. t. III, p. 161, dans POUGENS. -
4Ce qui, dans un événement, dans un récit, s'éloigne du cours ordinaire des choses.
[Corneille] inspiré d'un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens, accorda heureusement la vraisemblance et le merveilleux, et laissa bien loin derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux
, Racine, Disc. pron. à la récept. de Th. Corn.Le comte, qui n'avait point parlé jusque-là, tant il était frappé du merveilleux de cette aventure?
, Lesage, Diable boit. ch. 5, dans POUGENS.Le merveilleux, qui n'est que le faux qui fait plaisir à croire, augmente et croît à mesure qu'il passe par un plus grand nombre de têtes
, Buffon, Quadrup. t. VI, p. 6. -
5Ce qui est produit par l'intervention des êtres surnaturels.
Tite-Live, à qui le merveilleux fait tant de plaisir à raconter
, Buffon, Hist. min. Introd. ?uvr. t. VII, p. 210.C'est surtout sur le siècle de Thésée que les Grecs se sont plu à répandre un merveilleux qui fait connaître leur esprit et leur caractère
, Condillac, Hist. anc. I, 13.L'homme aime le merveilleux?; moi-même je me surprends à tout moment sur le point de m'y livrer
, Diderot, Opin. des anc. philos. (pythagorisme).Le merveilleux naturel est pris, si je l'ose dire, sur la dernière limite des possibles? le merveilleux surnaturel est l'entremise des êtres qui, n'étant pas soumis aux lois de la nature, y produisent des accidents au-dessus de ses forces, ou indépendants de ses lois
, Marmontel, Élém. litt. ?uvr. t. VIII, p. 363, dans POUGENS.L'histoire, assujettie aux lois de la critique, rejetait le merveilleux
, Barthélemy, Anach. Introd. part. II, sect. 3. -
6L'intervention d'êtres surnaturels comme dieux, anges, démons, génies, fées, dans les poëmes et autres ouvrages d'imagination.
Les poëmes ont plus du merveilleux, quoique toujours invraisemblables?; les romans ont plus du vraisemblable, quoiqu'ils aient quelquefois du merveilleux
, Huet, Origine des romans, p. 5.Le merveilleux même doit être sage?; il faut qu'il conserve un air de vraisemblance, et qu'il soit traité avec goût
, Voltaire, Ess. poésie ép. ch. 9.Les poëtes n'ont pas su tirer du merveilleux chrétien tout ce qu'il peut fournir aux muses
, Chateaubriand, Génie, II, V, 7.Merveilleux allégorique, celui où, au lieu de personnages surnaturels, on personnifie les facultés ou les sentiments et on leur suppose une action physique sur ceux qui les possèdent. Le merveilleux allégorique est toujours froid.
Notre religion est très susceptible d'une espèce de merveilleux que Voltaire a jugé praticable puisqu'il a essayé de le mettre en ?uvre, et il n'a su qu'une fois en tirer parti
, La Harpe, Lycée, III, I, 2. -
7Dans le langage familier, un merveilleux, une merveilleuse, celui, celle qui affecte de belles manières, et qui a beaucoup de prétentions. Un jeune merveilleux.
Non, tous nos merveilleux près d'elle ont échoué
, Lanoue, Coquette corr. I, 1.Ils aiment beaucoup mieux Dans les sociétés faire les merveilleux
, Al. Duval, Tyran domest. I, 6.Adjectivement.
Mon cher marquis, M. le vicomte de Melville est beaucoup trop merveilleux pour moi
, Genlis, Théât. d'éduc. le Voyageur, II, 6.Merveilleuse pour femme à la mode s'est dit particulièrement sous le Directoire.
HISTORIQUE
XIe s. Dist Blancandrins?: merveillus hom est Charles
, Ch. de Rol. XXVII. La bataille est merveilluse et pesant
, ib. CCXLV.
XIIe s. Il lui dona un mervellos destrier
, Roncisv. 30. La bataille est mout merveillose et dure
, ib. 64.
XIIIe s. Par foi, fit ele alors, merveille ai egardée [d'une épée fée qui avait tranché une enclume]?; Pour che vueil que soiez merveilleuse apelée
, Doon de Maïence, V. 6924. Celle berrie [plaine] commençoit à unes tres grans roches merveilleuses qui sont en la fin du monde devers Orient
, Joinville, 262.
XVe s. Les fortunes de mer sont perilleuses et pernicieuses, et l'air de Portingal chaud et merveilleux
, Froissart, II, III, 18. Les Romains, qui sont merveilleux et traitres, seront maistres et seigneurs
, Froissart, II, II, 20. Et conceut une très merveilleuse haine contre luy
, Commines, III, 2.
XVIe s. Il advint, pendant qu'on les bastissoit, un accident merveilleux
, Amyot, Pér. 30. Les Atheniens firent une merveilleuse responce aux Lacedemoniens, de laquelle Aristide fut auteur
, Amyot, Arist. 25.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
MERVEILLEUX. Ajoutez?:
Rayure merveilleuse, voy. RAYURE.
Carabine merveilleuse, ancienne carabine rayée qui présentait jusqu'à 133 rayures.
Encyclopédie, 1re édition
MERVEILLEUX, adj. (Littérat.) terme consacré à la poésie épique, par lequel on entend certaines fictions hardies, mais cependant vraissemblables, qui étant hors du cercle des idées communes, étonnent l'esprit. Telle est l'intervention des divinités du Paganisme dans les poëmes d'Homere & de Virgile. Tels sont les êtres métaphysiques personnifiés dans les écrits des modernes, comme la Discorde, l'Amour, le Fanatisme, &c. C'est ce qu'on appelle autrement machines. Voyez Machines.
Nous avons dit sous ce mot que même dans le merveilleux, le vraissemblable a ses bornes, & que le merveilleux des anciens ne conviendroit peut-être pas dans un poëme moderne. Nous n'examinerons ni l'un ni l'autre de ces points.
1°. Il y a dans le merveilleux une certaine discrétion à garder, & des convenances à observer ; car ce merveilleux varie selon les tems, ce qui paroissoit tel aux Grecs & aux Romains ne l'est plus pour nous. Minerve & Junon, Mars & Venus, qui jouent de si grands rôles dans l'Iliade & dans l'Enéide, ne seroient aujourd'hui dans un poëme épique que des noms sans réalité, auxquels le lecteur n'attacheroit aucune idée distincte, parce qu'il est né dans une religion toute contraire, ou élevé dans des principes tout différens. « L'Iliade est pleine de dieux & de combats, dit M. de Voltaire dans son essai sur la poésie épique ; ces sujets plaisent naturellement aux hommes : ils aiment ce qui leur paroît terrible, ils sont comme les enfans qui écoutent avidement ces contes de sorciers qui les effraient. Il y a des fables pour tout âge ; il n'y a point de nation qui n'ait eu les siennes ». Voilà sans doute une des causes du plaisir que cause le merveilleux ; mais pour le faire adopter, tout dépend du choix, de l'usage & de l'application que le poëte fera des idées reçues dans son siecle & dans sa nation, pour imaginer ces fictions qui frappent, qui étonnent & qui plaisent ; ce qui suppose également que ce merveilleux ne doit point choquer la vraissemblance. Des exemples vont éclaircir ceci : qu'Homere dans l'Iliade fasse parler des chevaux, qu'il attribue à des trépiés & à des statues d'or la vertu de se mouvoir, & de se rendre toutes seules à l'assemblée des dieux ; que dans Virgile des monstres hideux & dégoutans viennent corrompre les mets de la troupe d'Enée ; que dans Milton les anges rebelles s'amusent à bâtir un palais imaginaire dans le moment qu'ils doivent être uniquement occupés de leur vengeance ; que le Tasse imagine un perroquet chantant des chansons de sa propre composition : tous ces traits ne sont pas assez nobles pour l'épopée, ou forment du sublime extravagant. Mais que Mars blessé jette un cri pareil à celui d'une armée ; que Jupiter par le mouvement de ses sourcils ébranle l'Olympe ; que Neptune & les Tritons dégagent eux-mêmes les vaisseaux d'Enée ensablés dans les syrtes ; ce merveilleux paroît plus sage & transporte les lecteurs. De-là il s'ensuit que pour juger de la convenance du merveilleux, il faut se transporter en esprit dans les tems où les Poëtes ont écrit, épouser pour un moment les idées, les m?urs, les sentimens des peuples pour lesquels ils ont écrit. Le merveilleux d'Homere & de Virgile considéré de ce point de vue, sera toujours admirable : si l'on s'en écarte il devient faux & absurde ; ce sont des beautés que l'on peut nommer beautés locales. Il en est d'autres qui sont de tous les pays & de tous les tems. Ainsi dans la Lusiade, lorsque la flotte portugaise commandée par Vasco de Gama, est prête à doubler le cap de Bonne-Espérance, appellé alors le Promontoire des Tempêtes, on apperçoit tout à-coup un personnage formidable qui s'éleve du fond de la mer, sa tête touche aux nues ; les tempêtes, les vents, les tonnerres sont autour de lui ; ses bras s'étendent sur la surface des eaux. Ce monstre ou ce dieu est le gardien de cet océan, dont aucun vaisseau n'avoit encore fendu les flots. Il menace la flotte, il se plaint de l'audace des Portugais qui viennent lui disputer l'empire de ces mers ; il leur annonce toutes les calamités qu'ils doivent essuyer dans leur entreprise. Il étoit difficile d'en mieux allégorier la difficulté, & cela est grand en tout tems & en tout pays sans doute. M. de Voltaire, de qui nous empruntons cette remarque, nous fournira lui-même un exemple de ces fictions grandes & nobles qui doivent plaire à toutes les nations & dans tous les siecles. Dans le septieme chant de son poëme, saint Louis transporte Henri IV. en esprit au ciel & aux enfers ; enfin il l'introduit dans le palais des destins, & lui fait voir sa postérité & les grands hommes que la France doit produire. Il lui trace les caracteres de ces héros d'une maniere courte, vraie, & très-intéressante pour notre nation. Virgile avoit fait la même chose, & c'est ce qui prouve qu'il y a une sorte de merveilleux capable de faire par-tout & en tout tems les mêmes impressions. Or à cet égard il y a une sorte de goût universel, que le poëte doit connoître & consulter. Les fictions & les allégories, qui sont les parties du système merveilleux, ne sauroient plaire à des lecteurs éclairés, qu'autant qu'elles sont prises dans la nature, soutenues avec vraissemblance & justesse, enfin conformes aux idées reçues ; car si, selon M. Despréaux, il est des occasions où
- Le vrai peut quelquefois n'être pas vraissemblable,
à combien plus forte raison, une fiction pourra-telle ne l'être pas, à moins qu'elle ne soit imaginée & conduite avec tant d'art, que le lecteur sans se défier de l'illusion qu'on lui fait, s'y livre au contraire avec plaisir & facilite l'impression qu'il en reçoit ? Quoique Milton soit tombé à cet égard dans des fautes grossieres & inexcusables, il finit néanmoins son poëme par une fiction admirable. L'ange qui vient par l'ordre de Dieu pour chasser Adam du Paradis terrestre, conduit cet infortuné sur une haute montagne : là l'avenir se peint aux yeux d'Adam ; le premier objet qui frappe sa vue, est un homme d'une douceur qui le touche, sur lequel fond un autre homme féroce qui le massacre. Adam comprend alors ce que c'est que la mort. Il s'informe qui sont ces personnes, l'ange lui répond que ce sont ses fils. C'est ainsi que l'ange met en action sous les yeux mêmes d'Adam, toutes les suites de son crime & les malheurs de sa postérité, dont le simple récit n'auroit pû être que très froid.
Quant aux êtres personnifiés, quoique Boileau semble dire qu'on peut les employer tous indifféremment dans l'épopée,
Là pour nous enchanter tout est mis en usage,
Tout prend un corps, une ame, un esprit, un visage.
il n'est pas moins certain qu'il y a dans cette seconde branche du merveilleux, une certaine discrétion à garder & des convenances à observer comme dans la premiere. Toutes les idées abstraites ne sont pas propres à cette métamorphose. Le péché par exemple, qui n'est qu'un être moral, fait un personnage un peu forcé entre la mort & le diable dans un épisode de Milton, admirable pour la justesse, & toutefois dégoutant pour les peintures de détail. Une regle qu'on pourroit proposer sur cet article, ce seroit de ne jamais entrelacer des êtres réels avec des êtres moraux ou métaphysiques ; parce que de deux choses l'une, ou l'allégorie domine & fait prendre les êtres physiques pour des personnages imaginaires, ou elle se dément & devient un composé bisarre de figures & de réalités qui se détruisent mutuellement. En effet, si dans Milton la mort & le péché préposés à la garde des enfers & peints comme des monstres, faisoient une scene avec quelque être supposé de leur espece, la faute paroîtroit moins, ou peut-être n'y en auroit-il pas ; mais on les fait parler, agir, se préparer au combat vis-à-vis de satan, que dans tout le cours du poëme, on regarde & avec fondement, comme un être physique & réel. L'esprit du secteur ne bouleverse pas si aisément les idées reçues, & ne se prête point au changement que le poëte imagine & veut introduire dans la nature des choses qu'il lui présente, sur-tout lorsqu'il apperçoit entre elles un contraste marqué : à quoi il faut ajouter qu'il en est de certaines passions comme de certaines fables, toutes ne sont pas propres à être allégoriées ; il n'y a peut-être que les grandes passions, celles dont les mouvemens sont très-vifs & les effets bien marqués, qui puissent jouer un personnage avec succès.
2°. L'intervention des dieux étant une des grandes machines du merveilleux, les poëtes épiques n'ont pas manqué d'en faire usage, avec cette différence que les anciens n'ont fait agir dans leurs poésies que les divinités connues dans leur tems & dans leur pays, dont le culte étoit au-moins assez généralement établi dans le paganisme, & non des divinités inconnues ou étrangeres, ou qu'ils auroient regardé comme faussement honorées de ce titre : au-lieu que les modernes persuadés de l'absurdité du paganisme, n'ont pas laissé que d'en associer les dieux dans leurs poëmes, au vrai Dieu. Homere & Virgile ont admis Jupiter, Mars & Vénus, &c. Mais ils n'ont fait aucune mention d'Orus, d'Isis, & d'Osiris, dont le culte n'étoit point établi dans la Grece ni dans Rome, quoique leurs noms n'y fussent pas inconnus. N'est-il pas étonnant après cela de voir le Camouens faire rencontrer en même tems dans son poëme Jesus. Christ & Vénus, Bacchus & la Vierge Marie ? saint Didier, dans son poëme de Clovis, ressusciter tous les noms des divinités du paganisme, leur faire exciter des tempêtes, & former mille autres obstacles à la conversion de ce prince ? Le Tasse a eu de même l'inadvertance de donner aux diables, qui jouent un grand rôle dans la Jérusalem délivrée, les noms de Pluton & d'Alecton. « Il est étrange, dit à ce sujet M. de Voltaire dans son Essai sur la poésie épique, que la plûpart des poëtes modernes soient tombés dans cette faute. On diroit que nos diables & notre enfer chrétien auroient quelque chose de bas & de ridicule, qui demanderoit d'être ennobli par l'idée de l'enfer payen. Il est vrai que Pluton, Proserpine, Rhadamante, Tisiphone, sont des noms plus agréables que Belzebut & Astaroth : nous rions du mot de diable, nous respectons celui de furie ».
On peut encore alleguer en faveur de ces auteurs, qu'accoûtumés à voir ces noms dans les anciens poëtes, ils ont insensiblement & sans y faire trop d'attention, contracté l'habitude de les employer comme des termes connus dans la fable, & plus harmonieux pour la versification que d'autres qu'on y pourroit substituer. Raison frivole, car les poëtes payens attachoient aux noms de leurs divinités quelque idée de puissance, de grandeur, de bonté relative aux besoins des hommes : or un poëte chrétien n'y pourroit attacher les mêmes idées sans impiété, il faut donc conclure que dans sa bouche le nom de Mars, d'Apollon, de Neptune ne signifient rien de réel & d'effectif. Or qu'y a-t-il de plus indigne d'un homme sensé que d'employer ainsi de vains sons, & souvent de les mêler à des termes par lesquels il exprime les objets les plus respectables de la religion ? Personne n'a donné dans cet excès aussi ridiculement que Sannazar, qui dans son poëme de partu Virginis, laisse l'empire des enfers à Pluton, auquel il associe les Furies, les Gorgones & Cerbere, &c. Il compare les îles de Crete & de Delos, célebres dans la fable, l'une par la naissance de Jupiter, l'autre par celle d'Apollon & de Diane, avec Bethléem, & il invoque Apollon & les Muses dans un poëme destiné à célébrer la naissance de Jesus-Christ.
La décadence de la Mythologie entraîne nécessairement l'exclusion de cette sorte de merveilleux dans les poëmes modernes. Mais à son défaut, demande-t-on, n'est-il pas permis d'y introduire les anges, les saints, les démons, d'y mêler même certaines traditions ou fabuleuses ou suspectes, mais pourtant communément reçues ?
Il est vrai que tout le poëme de Milton est plein de démons & d'anges ; mais aussi son sujet est unique, & il paroit difficile d'assortir à d'autres le même merveilleux. « Les Italiens, dit M. de Voltaire, s'accommodent assez des saints, & les Anglois ont donné beaucoup de réputation au diable ; mais des idées qui seroient sublimes pour eux ne nous paroîtroient qu'extravagantes. On se moqueroit également, ajoûte-t-il, d'un auteur qui emploieroit les dieux du paganisme, & de celui qui se serviroit de nos saints. Vénus & Junon doivent rester dans les anciens poëmes grecs & latins. Sainte Génevieve, saint Denis, saint Roch, & saint Christophle, ne doivent se trouver ailleurs que dans notre légende.
Quant aux anciennes traditions, il pense que nous permettrions à un auteur françois qui prendroit Clovis pour son héros, de parler de la sainte ampoule qu'un pigeon apporta du ciel dans la ville de Rheims pour oindre le Roi, & qui se conserve encore avec foi dans cette ville ; & qu'un Anglois qui chanteroit le roi Arthur auroit la liberté de parler de l'enchanteur Merlin?? Après tout, ajoute-t-il, quelque excusable qu'on fût de mettre en ?uvre de pareilles histoires, je pense qu'il vaudroit mieux les rejetter entierement : un seul lecteur sensé que ces faits rebutent, méritant plus d'être ménagé qu'un vulgaire ignorant qui les croit ».
Ces idées, comme on voit, réduisent à très-peu de choses les privileges des poëtes modernes par rapport au merveilleux, & ne leur laissent plus, pour ainsi dire, que la liberté de ces fictions où l'on personnifie des êtres : aussi est-ce la route que M. de Voltaire a suivie dans sa Henriade, où il introduit à la vérité saint Louis comme le pere & le protecteur des Bourbons, mais rarement & de loin-à-loin ; du-reste ce sont la Discorde, la Politique, le Fanatisme, l'Amour, &c. personnifiés qui agissent, interviennent, forment les obstacles, & c'est peut-être ce qui a donné lieu à quelques critiques, de dire que la Henriade étoit dénuée de fictions, & ressembloit plus à une histoire qu'à un poëme épique.
Le dernier commentateur de Boileau remarque, que la poésie est un art d'illusion qui nous présente des choses imaginées comme réelles : quiconque, ajoute-t-il, voudra réflechir sur sa propre expérience se convaincra sans peine que ces choses imaginées ne peuvent faire sur nous l'impression de la réalité, & que l'illusion ne peut être complette qu'autant que la poésie se renferme dans la créance commune & dans les opinions nationales : c'est ce qu'Homere a pensé ; c'est pour cela qu'il a tiré du fond de la créance & des opinions répandues chez les Grecs, tout le merveilleux, tout le surnaturel, toutes les machines de ses poëmes. L'auteur du livre de Job, écrivant pour les Hébreux, prend ses machines dans le fond de leur créance : les Arabes ; les Turcs, les Persans en usent de même dans leurs ouvrages de fiction, ils empruntent leurs-machines de la créance mahométane & des opinions communes aux différens peuples du levant. En conséquence on ne sauroit douter qu'il ne fallût puiser le merveilleux de nos poëmes dans le fond même de notre religion, s'il n'étoit pas incontestable que,
De la foi d'un chrétien les mysteres terribles
D'ornemens égayés ne sont point susceptibles.
C'est la réflexion que le Tasse & tous ses imitateurs n'avoient pas faite. Et dans une autre remarque il dit que les merveilles que Dieu a faites dans tous les tems conviennent très-bien à la poësie la plus élevée, & cite en preuve les cantiques de l'Ecriture sainte & les pseaumes. Pour les fictions vraissemblables, ajoute-t-il, qu'on imagineroit à l'imitation des merveilles que la religion nous offre à croire, je doute que nous autres François nous en accommodions jamais : peut-être même n'aurons-nous jamais de poëme épique capable d'enlever tous nos suffrages, à-moins qu'on ne se borne à faire agir les différentes passions humaines. Quelque chose que l'on dise, le merveilleux n'est point fait pour nous, & nous n'en voudrons jamais que dans des sujets tirés de l'Ecriture-sainte, encore ne sera-ce qu'à condition qu'on ne nous donnera point d'autres merveilles que celles qu'elle décrit. En vain se fonderoit-t-on dans les sujets profanes sur le merveilleux admis dans nos opera : qu'on le dépouille de tout ce qui l'accompagne, j'ose répondre qu'il ne nous amusera pas une minute.
Ce n'est donc plus dans la poésie moderne qu'il faut chercher le merveilleux, il y seroit déplacé, & celui seul qu'on y peut admettre réduit aux passions humaines personnifiées, est plûtôt une allégorie qu'un merveilleux proprement dit. Princip. sur la lecture des Poëtes, tom. II. Voltaire, Essai sur la poésie épique, ?uvres de M. Boileau Despréaux, nouvelle édit. par M. de Saint-Marc, tom. II.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
merveilleux \m??.v?.jø\ ou \m??.ve.jø\ masculin (pour une femme, on dit : merveilleuse) singulier et pluriel identiques
-
(Histoire) (À l'époque) Personne qui affectait une élégance excentrique.
- Un merveilleux, une merveilleuse.
- Ce qui est charmant, ce sont les beaux chevaux de selle andalous, sur lesquels se pavanent les merveilleux de Madrid. ? (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, 1859)
- Je ne comprends pas que les femmes, ordinairement clairvoyantes en ce qui concerne leur beauté, ne s'aperçoivent pas que leur suprême effort d'élégance arrive tout au plus à les faire ressembler à une merveilleuse de province, résultat médiocre. L'ancien costume est si parfaitement approprié au caractère de beauté, aux proportions et aux habitudes des Espagnoles, qu'il est vraiment le seul possible. ? (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, 1859)
- (Cuisine) Petit gâteau originaire de Belgique.
- (Textile) Satin de soie épais utilisé pour la doublure des chapeaux.
Nom commun 1 - français
merveilleux \m??.v?.jø\ ou \m??.ve.jø\ masculin singulier
-
(Littéraire) Intervention des êtres surnaturels, dans un poème épique ou dramatique.
- [?] leur penchant naturel pour le merveilleux se trouva stimulé par l'air de satisfaction avec lequel l'éminent personnage qui présidait l'assemblée écoutait leur récit. ? (Walter Scott, Ivanhoé, ch. XXXVII, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- Un autre capitaine [?] se promenait avec une Bible et exploitait le goût des indigènes pour le merveilleux et leur penchant à discuter les légendes bibliques, qui par certains côtés ressemblent à leurs légendes païennes, [?] ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil, tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- Grâce au monde végétal va s'ouvrir la porte du merveilleux : ainsi, le parfum des plantes touchées par un arc-en-ciel, aussi suave, selon Pline, que celui de l'alhagi. ? (André-Julien Fabre, Mythologie et plantes médicinales de l'Antiquité, publié dans Histoire des Sciences Médicales. volume 37(1), 2003, page 65)
- Ce qui, dans un événement, dans un récit, s'éloigne de l'ordre naturel et du cours ordinaire des choses.
- Notre incompréhension devant l'inconnu a dressé aux quatre coins du monde un atlas mythologique. Des centaines d'endroits où la virginité et le merveilleux se sont mués en eldorados, en paradis perdus, en enfers verts, en mirages et en abîmes. ? (Michel Udiany, L'histoire des mondes imaginaires: De la Tour de Babel à l'Atlantide, Éditions Jourdan, 2015, en avant-propos)
Adjectif - français
merveilleux \m??.v?.jø\ ou \m??.ve.jø\
- Qui cause une grande admiration, mêlée d'une sorte de surprise.
- Un esprit merveilleux. - C'est un homme merveilleux. - On ne vit jamais rien de plus merveilleux. - C'est une pièce merveilleuse.
- Cela a produit un effet, obtenu un succès merveilleux. - Un événement merveilleux. - Un récit accompagné de circonstances merveilleuses.
- Sa gourmandise était merveilleuse et les gens du pays en tiraient orgueil. Il restait à table six heures d'affilée, sans parler, sans tourner la tête, sans remuer seulement le bout des pieds, mangeant, mangeant, mangeant. ? (Ernest Pérochon, Nêne, 1920)
- Qui est excellent en son espèce.
- À l'en croire, c'était lui qui dansait, qui levait la jambe, qui se dandinait, tellement il se donnait de mal pour communiquer à ces merveilleuses mais stupides créatures un peu du feu sacré dont il les prétendait dépourvues. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
- Les muscats ont été merveilleux cette année. - Les draps de cette fabrique sont merveilleux.
-
(Familier) (Ironique) Étrange, extraordinaire par ses sentiments, par ses manières.
- Vous êtes un homme merveilleux.
Trésor de la Langue Française informatisé
MERVEILLEUX, -EUSE, adj. et subst.
Merveilleux, Euse au Scrabble
Le mot merveilleux, euse vaut 28 points au Scrabble.
Informations sur le mot merveilleux--euse - 15 lettres, 8 voyelles, 7 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot merveilleux, euse au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
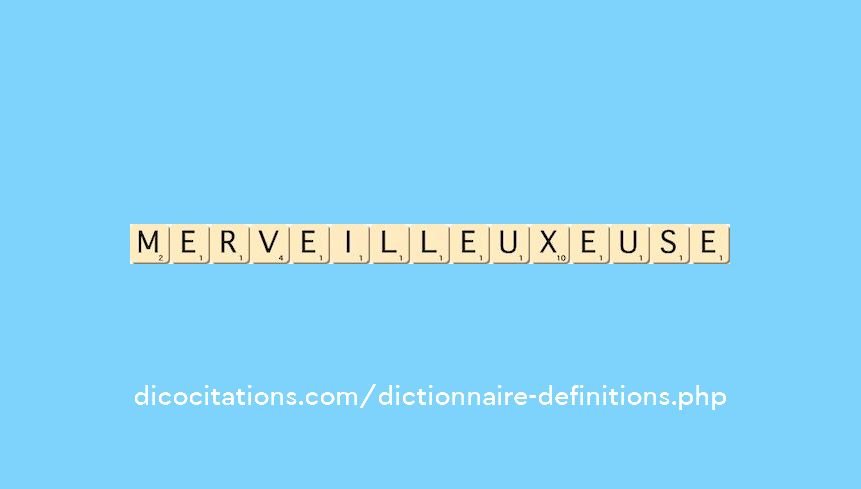
Les mots proches de Merveilleux, Euse
Mer Mercantile Mercantille Mercenaire Mercenairement Mercenarité Mercerie Merci Mercier, ière Mercredi Mercure Mercurial Mercuriale Mercuriale Mercuriel, elle Merdaille Merde Merdeux, euse Mère Mère Méreau Mérellé, ée Méridien Méridien, ienne Méridional, ale Mérille Meringue Meringué, ée Mérinos Merise Merisier Mérite Mérité, ée Mériter Méritoire Méritoirement Merlan Merle Merlin Merlus Merrain Mersion Merveille Merveilleusement Merveilleux, euse mer Mer mer-air Méracq Méral Méras Merbes-le-Château Merbes-Sainte-Marie Merc?ur Merc?ur mercanti mercantile mercantiles mercantilisme mercantis mercaptan Mercatel Mercenac mercenaire mercenaire mercenaires mercenaires mercerie merceries mercerisé Merceuil Mercey Mercey-le-Grand Mercey-sur-Saône merchandising Merchtem merci merci mercier mercière mercière mercières merciers Mercin-et-Vaux mercis Merck-Saint-Liévin Merckeghem mercredi mercredis Mercuer Mercuès mercure mercurey Mercurey mercurialeMots du jour
-
devinettes rassembla ambrés superficielle approbatrice aplatissais dépouillant renaudent dépossédait fixe-chaussettes
Les citations avec le mot Merveilleux, Euse
Les citations du Littré sur Merveilleux, Euse
Les mots débutant par Mer Les mots débutant par Me
Une suggestion ou précision pour la définition de Merveilleux, Euse ? -
Mise à jour le mardi 27 janvier 2026 à 10h27

- Machiavelisme - Magie - Main - Maison - Maitre - Maître - Maitresse - Maîtresse - Maitrise - Mal - Malade - Maladie - Male - Malheur - Malheureux - Malveillance - Maman - Maman Enfant - Maman Fille - Maman Fils - Maman - Management - Manger - Manie - Manque - Marcher - Mari - Mariage - Mariage amour - Mariage heureux - Marseillais - Masturbation - Materialisme - Mathematique - Matiere - Maux - Maxime - Mechancete - Méchanceté - Méchant - Medaille - Medecin - Médecin - Medecine - Medias - Mediocrite - Medisance - Méfiance - Mefiance - Meilleur - Melancolie - Melomane - Memoire - Mémoire - Mensonge - Menteur - Mentir - Mepris - Mere - Mère_enfant - Mère_fils - Mère_fille - Mériter - Metaphysique - Methode - Metier - Métier - Meurtre - Militaire - Miracle - Miroir - Misère - Misere - Misogyne - Mode - Moderation - Moderne - Modestie - Moeurs - Mondanite - Monde - Mondialisation - Monogamie - Montagne - Monture - Moquerie - Moquerie - Morale - Mort - Mot - Mots d'amour - Motivation - Mourir - Mouvement - Moyens - Musique - Mystere - Mysticisme - Mythe - Mythologie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur merveilleux, euse
Poèmes merveilleux, euse
Proverbes merveilleux, euse
La définition du mot Merveilleux, Euse est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Merveilleux, Euse sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Merveilleux, Euse présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
