La définition de Orgue du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Orgue
Nature : s. m.
Prononciation : or-gh'
Etymologie : Wallon, ôre : provenç. orgue ; espagn. órgano ; portug. Orgao (a accent long) ; ital. órgano ; du lat. órganum, instrument en général (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de orgue de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec orgue pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Orgue ?
La définition de Orgue
Orgue hydraulique ou orgues hydrauliques, instrument de musique, dans lequel le vent était poussé dans les tuyaux par la pression de l'eau ; invention attribuée à Ctésibius, célèbre mathématicien d'Alexandrie, environ 120 ans avant l'ère chrétienne.
Toutes les définitions de « orgue »
Wiktionnaire
Nom commun - français
orgue \???\ masculin (mais féminin quand le mot est utilisé au pluriel pour faire référence à un unique instrument)
-
(Orgues) Instrument de musique à vent, à clavier et à pédalier, composé de tuyaux de différentes sortes et de différentes grandeurs, alimentés d'air par des soufflets et que l'on fait résonner en appuyant sur les touches d'un ou de plusieurs claviers.
- Au son de la cloche de la tour du palais, à Toulouse comme à Paris, le parlement se rendait en corps et en grand costume à la messe du Saint-Esprit, dite aussi la messe Rouge, pontificalement célébrée, avec orgue et musique, par un des évêques du ressort, officiellement invité par le premier président au nom du parlement. ? (Henri Bruno Bastard d'Estang, Les parlements de France: essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité, vol.1, page 147, Didier & Cie, 1857)
- Hanser enseigna d'abord a Méhul les premières règles du contrepoint rigoureux, et le mit bientôt en état de le remplacer à l'orgue pour les offices du matin. ? (Castil-Blaze, Étienne Nicolas Méhul, dans la Revue de Paris, 1834, volume 1, page 24)
- En 1973, quand le centre d'activités culturelles et de loisirs de Sully organisait son « florilège musical » en présentant un récital de guitare, un récital d'orgue et un concert de l'Ensemble instrumental Andrée Colson, tu n'étais pas intéressé encore ; [?]. ? (Colette Bissonnier, Chroniques du festival, Éditions Publibook, 2011, page 21)
- Il ne pouvait entendre sans une pieuse émotion les anciennes hymnes catholiques, et sans une sorte de ravissement, certains sons de l'orgue. Il regardait avec une profonde admiration l'artiste qui, en promenant ses doigts sur les touches du gigantesque instrument, le faisait tantôt retentir comme la foudre, tantôt soupirer comme la brise printanière, tantôt gémir comme la voix humaine ? (Xavier Marmier, Histoire d'un pauvre musicien (1770-1793), 1866)
-
Lieu élevé où les orgues sont placées dans une église.
- II ouvrit la petite porte de la tour par où l'on monte aux orgues, [?]. Une fois dans les orgues, nous prîmes à gauche du soufflet, et nous montâmes jusqu'aux cloches. ? (Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, J. Hetzel, 1864)
-
(Par analogie) (Géologie) Colonnes prismatiques de basalte dont la disposition rappelle les tuyaux d'un orgue.
- Les orgues de Murat.
- Des orgues marines.
- C'est la ville de Zadar qui a eu les premières orgues marines au monde ; elles émettent des sons musicaux uniquement sous l'effet du vent et des vagues.
-
(Héraldique) Meuble représentant l'instrument à vent du même nom dans les armoiries. Il peut être représenté dans son ensemble quand il fait référence à un instrument spécifique, mais généralement, il est représenté sous la forme d'un ensemble de tubes accolés (dont le nombre peut être blasonné), de longueurs différentes.
- Coupé, au premier de gueules à une ancre d'argent accostée de deux étoiles du même, au second d'argent à un orgue d'azur chaussé du même, qui est de la commune de Saint-Clément-de-Valorgue du Puy-de-Dôme ? voir illustration « armoiries avec un orgue »
- Meuble présentant une palette de produits.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Littré
-
1Orgue hydraulique ou orgues hydrauliques, instrument de musique, dans lequel le vent était poussé dans les tuyaux par la pression de l'eau?; invention attribuée à Ctésibius, célèbre mathématicien d'Alexandrie, environ 120 ans avant l'ère chrétienne.
Voyez cette machine étonnante et magnifique, cet orgue hydraulique composé de tant de parties différentes, de tant de jointures, de tant de pièces formant une si grande masse de sons et comme une armée de tuyaux, et cependant tout cela pris ensemble n'est qu'un seul instrument
, Tertullien, dans D'ORTIGUE, Dict. de plain-chant, Orgue. -
2Instrument de musique à vent, composé de tuyaux de différentes dimensions, communiquant d'une part à un ou plusieurs claviers et jeux de pédales, d'autre à un ou plusieurs soufflets. Toucher de l'orgue.
Le pape Paul Ier envoie au roi des livres, des chantres et une horloge à roues?; Constantin Copronyme lui envoie aussi un orgue et quelques musiciens
, Voltaire, Ann. Emp. Charlemagne, 766.Vous opposerez l'univers à la rue Saint-Jacques? peut être alors auront-ils quelque honte d'avoir cru que les orgues de la paroisse de Saint-Séverin donnaient le ton au reste du monde
, Voltaire, Dict. phil. Géographie.Lorsque l'instrumentation n'avait pas encore acquis d'importance dans la musique d'église, l'orgue était presque le seul instrument dont on faisait usage pour ce genre de musique
, Fétis, la Musique, II, 16.Il n'est personne qui, après avoir entendu un orgue de dimension suffisante, ne convienne que cet instrument est le plus puissant, le plus magnifique, le plus varié de tous, celui dont la conception est la plus merveilleuse, l'effet le plus grandiose, l'aspect le plus imposant
, Lafage, Rapport fait à la Société libre des beaux-arts sur l'orgue de l'église royale de Saint-Denis.L'introduction de l'orgue en Europe doit être placée suivant Éginhart en 757?; à cette époque, Pépin reçut de l'empereur de Constantinople, avec d'autres présents, un orgue mécanique
, De Laborde, Émaux, p. 418.L'orgue majestueux se taisait gravement Dans la nef solitaire, L'orgue, le seul concert, le seul gémissement Qui mêle aux cieux la terre
, Hugo, Chants du crépuscule, 33.L'orgue? sacerdotal par sa destination, architectural par sa forme, chef-d'?uvre de l'esprit humain dans sa structure
, D'Ortigue, Dictionnaire de plain-chant, Orgue.Orgue expressif ou orgues expressives, espèce d'orgue, construit de telle sorte que l'exécutant peut augmenter ou diminuer à volonté et graduellement l'intensité des sons.
Orgue pneumatique, l'orgue ordinaire.
Familièrement. Ils sont comme des tuyaux d'orgue, se dit de plusieurs enfants d'une taille inégale.
Il est féminin au pluriel. De belles orgues. Clavier d'orgues.
Fig.
On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l'homme?; ce sont des orgues à la vérité, mais bizarres, changeantes, variables?; ceux qui ne savent toucher que les ordinaires ne seraient pas d'accord sur celles-là?; il faut savoir où sont les tuyaux
, Pascal, Pens. XXV, 118, éd. HAVET. - 3Le lieu de l'église où sont les orgues. Aller à l'orgue, aux orgues. Il était dans l'orgue.
- 4Buffet d'orgue ou d'orgues, la construction de menuiserie qui renferme toute la machine d'un orgue d'église.
-
5Orgue de Barbarie, instrument portatif fait à l'instar de l'orgue, et mis en jeu au moyen d'un cylindre qu'on fait mouvoir.
Debraux, dix ans, régna sur la goguette, Mit l'orgue en train et les ch?urs des faubourgs
, Béranger, Ém. Debraux.Orgue de Barbarie est une corruption pour orgue de Barberi, fabricant de Modène.
L'orgue de Barbaris s'est dit autrefois cabinet d'orgue.
-
6 Terme de musique. Point d'orgue, trait de la partie chantante pendant lequel l'accompagnement est suspendu.
Point d'orgue, signe qui indique un temps d'arrêt, soit pour un trait, soit simplement pour suspendre la mesure.
- 7Ancien terme de fortification. Espèce de herse avec laquelle on fermait les portes d'une ville assiégée.
- 8Ancien terme de guerre. Machine composée de plusieurs canons de mousquet attachés ensemble, dont on se servait pour la défense des brèches dans une ville assiégée.
- 9Orgues géologiques, espèces de puits naturels.
-
10 Terme de marine. Tuyau de plomb qui sert de conduite à l'eau des dallots, des gaillards et des ponts inférieurs.
Se dit aussi des montants de la poupe.
- 11Orgue de mer, nom vulgaire donné au polypier appelé par des naturalistes le tubipore musique (mers de l'Inde, mer Rouge, signalé aussi sur les côtes d'Amérique).
- 12Le canard siffleur, anas penelope, L.
REMARQUE
Cette différence de genre du singulier au pluriel est un bien grand inconvénient, car on ne peut pas dire?: Cet orgue est un des plus beaux que j'aie vus. Autrefois l'Académie donnait le genre féminin aux deux nombres, et c'était bien plus naturel?; qu'on lui donne aujourd'hui le genre masculin aux deux nombres, si l'on veut, mais que du moins le genre soit constant, PAUTEX., Cette remarque est parfaitement juste. D'après Chifflet, Gramm. p. 250, orgue au singulier est mieux masculin, et au pluriel mieux féminin. Le meilleur parti à prendre pour rompre le moins possible avec la tradition serait de faire orgue des deux genres.
HISTORIQUE
XIIe s. Et David sunout [sonnait] une maniere de orgenes, ki esteient si aturné ke l'um les liout [liait] as espaldes celi kis [de celui qui les] sunout
, Rois, p. 141.
XIIIe s. Es sauz [saules] pendismes nous nos orgres [organa]
, Psautier, f° 166.
XIVe s. Orgues seans et portatives
, Hist. litt. de la France, t. XXIV, p. 752. Cuides tu que ce soyent des orgues Qu'on faict chanter à tous les dois??
Nat. à l'alch. 722. Et de tous instrumens le roi, Dirai ici comme je croi, Orgue?
, Machaut, dans D'ORTIGUE, Dict. de plain-chant.
XVe s. Et là ouïs sonner et jouer des orgues aussi melodieusement comme je fis oncques?
, Froissart, II, III, 15.
XVIe s. Elle faisoit conscience d'assister à une noce ou d'ouïr sonner d'orgues à une eglise
, Marguerite de Navarre, Nouv. XXX. Fauconnaux, verses, fleutes, orgues [pièce d'artillerie]
, Paré, Préf. IX. Ny ame si revesche qui ne se sente touchée de quelque reverence à? ouïr le son devotieux de nos orgues
, Montaigne, II, 363.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
ORGUE. Ajoutez?: - REM. Les orgues géologiques ne sont pas des puits naturels?; ce sont des masses de basalte prismatique, imitant par leur disposition l'aspect d'un jeu d'orgues, comme les orgues de Bort (Corrèze), les orgues de Murat (Cantal)?; les masses de basalte en prismes verticaux qui, lorsqu'elles sont au fond des vallées ou dans la plaine, s'appellent chaussée basaltique, chaussée des géants, comme au pont de la Baume, (Ardèche) et dans la célèbre grotte de Fingal, prennent le nom d'orgues lorsqu'elles sont situées à une certaine hauteur, par exemple au sommet d'un mamelon ou d'une colline?; alors la ressemblance avec les jeux d'orgues des églises en est plus frappante,
Castel, ingénieur en chef des mines à Rodez.
Encyclopédie, 1re édition
ORGUE, s. m. (Instrument à vent.) c'est le plus grand & le plus harmonieux des instrumens de cette espece ; c'est pourquoi on lui a donné le nom d'orgue, ???????, qui signifie l'instrument par excellence.
L'invention des orgues est aussi ancienne, que leur méchanique est ingénieuse.
L'usage de l'orgue n'a commencé dans nos églises qu'après S. Thomas d'Aquin, en l'année 1250.
Le premier que l'on a eu en France fut donné en présent au roi Pepin par Constantin Copronyme en 1267.
On peut distinguer dans cet instrument deux sortes de parties, les intégrantes & les ministrantes. On traitera des unes & des autres dans la description suivante.
Description de l'orgue. L'orgue est composé d'un buffet de menuiserie plus ou moins enrichi de sculpture, qu'on appelle fût, voyez Fut ; de deux sommiers sur lesquels sont arrangés les tuyaux ; soit d'étain, de plomb ou de bois, d'un ou de plusieurs claviers. On donne le vent aux tuyaux par plusieurs grands soufflets ; il est conduit aux sommiers par des tuyaux de bois qu'on appelle porte-vents.
Il paroît par ce que nous venons de dire, que les matieres qui composent un orgue sont le bois, l'étain & le plomb, auxquelles on peut ajouter le cuivre pour la fabrique des anches, & le fer qui sert à deux usages, comme dans toutes sortes de machines.
L'ordre de sinthese demande qu'avant de décrire l'orgue, & d'en expliquer la facture, nous expliquions l'apprêt des différentes matieres qui le composent : nous commencerons par le bois.
Le bois dont on se sert dans la fabrique des orgues, est de deux sortes, par rapport aux différens emplois qu'on en fait. Celui qui est destiné pour faire les tuyaux de bois, les sommiers, les claviers, les abregés, doit être du chêne, connu sous le nom de bois d'Hollande, parce que c'est les Hollandois qui en font commerce. Le plus parfait ne sauroit être trop bon, principalement pour la fabrique des tuyaux & des sommiers. L'autre sorte de bois dont on se sert dans la fabrique des orgues, est connu sous le nom de bois de vauge ; c'est aussi du bois de chêne, mais moins parfait que celui d'Hollande. On s'en sert pour faire le buffet, & quelques parties de l'orgue qui ne demandent point du bois si parfait, comme par exemple, les tables des soufflets, &c.
L'étain dont on se sert dans la fabrique des orgues, est l'étain fin d'Angleterre : on peut cependant, à son défaut, en employer d'autre.
Le plomb est le plomb ordinaire. On réduit ces deux métaux en lames ou feuilles minces, longues & larges autant qu'il est besoin : ce qui se fait de la maniere suivante.
Maniere de couler les tables d'étain ou de plomb qui servent à faire les tuyaux d'orgue. On prépare une table (fig. 49. Pl. X. d'orgue) de bois de chêne aussi longue & aussi large qu'il est besoin ; on fait en sorte, au moyen de plusieurs barres clouées à la partie inférieure de la table, qu'elle soit inflexible : sur cette table, qui doit être parfaitement plane, on étend une piece de coutil que l'on attache sur les côtés avec des clous d'épingle, en sorte qu'elle soit bien tendue ; sur cette piece de coutil on en met une autre moins parfaite, ou même que l'usage a à-demi-usée, & la table est préparée.
On prépare ensuite le table représenté, fig. 60. Le rable est une caisse sans fond ABCDEF. Le côté AB du rable ne doit point porter sur la table, comme on le voit à la fig. 59. qui représente le rable en situation sur la table ; & le côté EDCF doit être plus élevé, afin de compenser l'inclinaison de cette table, que l'on incline plus ou moins, ainsi que l'on voit dans la figure, en la soutenant à une de ses extrémités par un tréteau G, & dans différens points de sa longueur, par des calles ou chantiers HHI ; & pour empêcher la table de couler sur ses appuis, on la retient par la partie supérieure, au moyen d'une corde K qui y est attachée, & qui est liée à un crampon scellé à la muraille de l'attelier.
La table ainsi préparée, & le rable placé dessus à la partie supérieure, on enduit les joints qu'il fait avec la table, d'une ou de plusieurs couches de blanc-d'Espagne détrempé dans de l'eau, afin de fermer parfaitement toutes les ouvertures que les petites inégalités du coutil pourroient laisser entr'elles & les parties du rable qui s'y appliquent.
Pendant toutes ces préparations, le métal que l'on se propose de couler en table, est en fusion dans une chaudiere de fer, semblable en tout à celle des plombiers. Lorsque c'est de l'étain que l'on veut couler, on jette dans la chaudiere un peu de poix-résine & de suif, tant pour purifier le métal, que pour revivifier les parties que l'ardeur du feu auroit pû calciner : on écume ensuite le métal fondu, en sorte qu'il ne reste plus de scories ; & lorsqu'il est refroidi au point qu'un papier ne s'y emflamme plus, on le puise avec une cuillere, & on le verse dans le rable, dont on a couvert le fond d'une feuille de papier pour garantir le coutil. Pendant cette opération, un ouvrier appuie sur le rable pour empêcher que la pesanteur du métal ne le fasse couler avant qu'il en soit suffisamment rempli.
On connoît qu'il est tems de tirer la table d'étain, lorsqu'on s'apperçoit qu'il commence à grener, c'est-à-dire lorsqu'il se forme de petits grains à sa surface, comme lorsqu'il commence à se figer ; au contraire, le plomb doit être tiré le plus chaud qu'il est possible, sans cependant qu'il puisse enflammer un rouleau de papier que l'on y plongeroit.
Pour tirer la table d'étain ou de plomb, on conduit le rable, rempli de métal fondu, le long de la table couverte de coutil, soit en le tirant en marchant à-reculons, ou en le poussant en marchant devant soi, & en appuyant sur le rable. Lorsqu'il est arrivé au bas de la table, on laisse tomber par terre ou dans une auge, qui est placée vis à-vis, le reste du métal.
Par cette opération le métal fondu que le rable contient, s'attache à la table, & y forme une feuille plus ou moins épaisse, selon que l'on a tiré le rable plus ou moins vîte, ou que la table est moins ou plus inclinée.
Les tables ainsi tirées, on les laisse refroidir. On ébarbe ensuite celles d'étain, dont les bords sont entourés d'un grand nombre d'aiguilles, qui blesseroient les ouvriers sans cette précaution : on les roule pour s'en servir, ainsi qu'il sera dit ci après On continue de même jusqu'à ce que la fonte soit épuisée.
Les plus grandes tables que l'on fasse de cette maniere sont de 16 piés de long, sur 3 piés de large, ou seulement de 18 pouces. Si les tuyaux sont de deux pieces, ainsi que cela se pratique ordinairement, lorsque les tuyaux ont une certaine grandeur ; on conçoit bien par conséquent que la table & le rable doivent être d'une grandeur proportionnée.
Lorsque le coutil dont la table est couverte est neuf, les tables qui sont coulées dessus sont ordinairement défectueuses, soit parce que l'humidité du coutil cause de petits bouillons, ou parce que les petits poils qui les rendent velues font le même effet, on est obligé de couper les tables, & de les remettre à la fonte.
Après que les tables ont été coulées, ainsi qu'il a été dit, on les forge, on plane sur un tas avec le marteau, représenté fig 62. Ce marteau est rond, plan par une de ses extrémités pour planer, & un peu convexe par l'autre pour forger. L'effet de ces deux opérations est d'écrouir le métal, & par conséquent en le rendant plus roide, le rendre plus propre à soutenir la forme que l'on lui donne dans l'emploi qu'on en fait. On saura aussi que l'étain est très dur à forger, au lieu que le plomb est très-doux.
Après que les tables sont forgées & planées, on les étend sur un établi qui doit être bien uni, en les frappant avec une batte. Voyez Batte, & la fig. 65. Les tables de plomb ainsi étendues sont brunies avec le brunissoir d'acier, fig. 64. voyez Brunissoir. Après cette opération elles sont entierement achevées : celles d'étain au contraire demandent un peu plus de travail. Après qu'elles sont étendues sur l'établi avec la batte, on les rabotte avec la galere, voyez Galere, & la fig. 63. qui la représente. Cette galere est un rabot dont la semelle est de fer, & dont le fer est presque à-plomb. La raison de cette disposition est que si le fer étoit oblique, il mordroit trop, & emporteroit la piece ; au lieu qu'il faut qu'il ne fasse que racler un peu fort, & emporter des copeaux légers. Par cette opération on égalise les tables d'épaisseur, ce qui s'acheve avec le racloir des ébénistes. Voyez Racloir. Cette opération se fait des deux côtés de la table d'étain ; car pour celles de plomb, on ne les rabote que quand elles sont plus épaisses à un endroit qu'à l'autre ; & le côté raboté des tables de plomb se met toujours en dedans du tuyau.
On doit observer aussi que pour raboter l'étain, on doit graisser un peu la semelle de la galere ; & que pour le plomb on doit le mouiller avec de l'eau, & en remettre souvent ; car plus le plomb est mouillé, plus la galere emporte de forts copeaux.
Après toutes ces opérations, on polit les tables d'étain en cette maniere. On prend de l'eau & du savon ; on met de l'eau sur la table, & on la frotte avec le savon : on brunit ensuite avec le brunissoir, qui doit être très-poli : on enduit pour cela une planche de sapin de potée & d'huile ; on frotte le brunissoir dessus jusqu'à ce qu'il soit bien poli ; on l'essuie avec un morceau de serge, & on brunit ensuite la table d'étain en la frottant dans toute son étendue avec le brunissoir.
Lorsque la table est bien également brunie, on écrase du blanc-d'Espagne que l'on seme dessus ; on frotte ensuite avec un morceau de serge jusqu'à ce que la table soit bien éclaircie : alors elle est entierement achevée de polir. On se doute bien qu'on ne polit ainsi que le côté qui doit se trouver en-dehors du tuyau ; car polir le dedans seroit un travail superflu, & même on ne polit que l'étain qui doit servir à faire les tuyaux de montre, c'est-à-dire ceux qui paroissent au-dehors.
Le cuivre dont on se sert dans la fabrique des orgues, est du laiton réduit en table de différentes épaisseurs, & en fil.
Le fer sert à faire les pattes des roule
Trésor de la Langue Française informatisé
ORGUE, subst. masc.;ORGUES, subst. masc. ou fém. plur.
Orgue au Scrabble
Le mot orgue vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot orgue - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot orgue au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
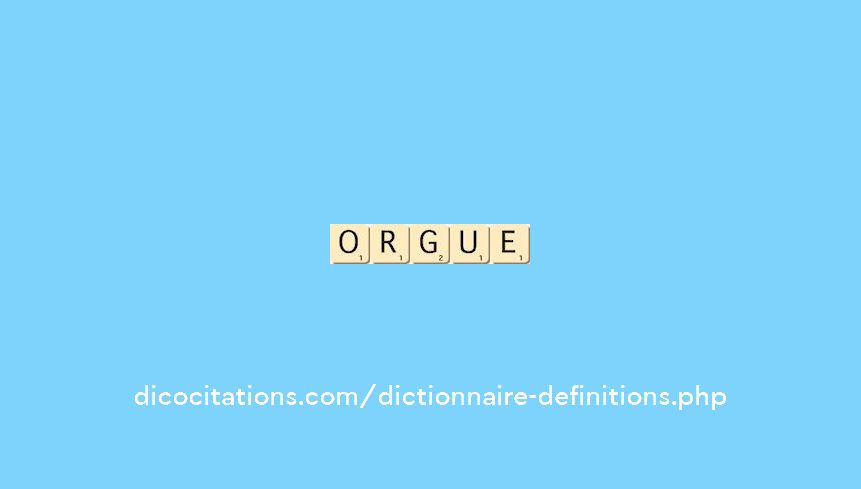
Les mots proches de Orgue
Organe Organicien Organier Organique Organique Organisant, ante Organisation Organisé, ée Organiser Organisme Organiste Organogénésie ou organogénie Organsin Organsiné, ée Organsiner Orgasme Orge Orgeat Orgéons Orgerie Orgies Orgue Orgueil Orgueilleusement Orgueilleux, euse Orgyie Organ organdi organdis organe organes organiciser organigramme organique organiquement organiques organisa organisai organisaient organisais organisait organisâmes organisant organisât organisateur organisateur organisateurs organisateurs organisation organisationnelle organisations organisatrice organisatrice organise organisé organisé organisée organisée organisées organisées organisent organiser organisera organiserai organiserais organiserait organisèrent organiserez organiseriez organiserons organiseront organises organisés organisés organiseur organisezMots du jour
Mat Assavoir Emplastrer Émoi Pressurer Pugnace Entre-séduire (s') Personnalité Ribon-ribaine Injection
Les citations avec le mot Orgue
- Elle joue sa rose embocalée, comme celle du Petit Prince. Droite, fière et vexée.
Toutes épines dehors. Ma mère est une fleur terriblement orgueilleuse. Auteur : Michel Bussi - Source : Le Temps est assassin
- La gloire qui dîne de l'orgueil, fait son souper du mépris.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Il y a des gens qui ne dépouillent jamais leur orgueil. Leurs fautes, s'ils les passent en revue, c'est à cheval.Auteur : Paul Masson - Source : Cité par Willy, dans l'Année fantaisiste, 1893.
- Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Je me sentais des forces infinies: il fallait seulement leur trouver un point d'application. Ce n'était pas la pauvreté qui faisait obstacle à ces forces: en Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien. L'obstacle était plutôt dans les préjugés et la bêtise. J'avais là toutes les occasions de développer une castillanerie qui m'a fait bien du tort, que raille avec raison mon ami et mon maître Jean Grenier, et que j'ai essayé en vain de corriger, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait une fatalité des natures. Il valait mieux alors accepter son propre orgueil et tâcher de le faire servir plutôt que de se donner, comme dit Chamfort, des principes plus fort que son caractère. Mais, après m'être interrogé, je puis témoigner que, parmi mes nombreuses faiblesses, n'a jamais figuré le défaut le plus répandu parmi nous, je veux dire l'envie, véritable cancer des sociétés et des doctrines.Auteur : Albert Camus - Source : Préface de L'envers et L'endroit
- Voix de l'orgueil: un cri puissant, comme d'un cor, - Des étoiles de sang sur des cuirasses d'or.Auteur : Paul Verlaine - Source : Sagesse (1874)
- Orgueil! ton goût d'absinthe remonte donc dans toutes les bouches et tous les coeurs te ruminent!Auteur : Gustave Flaubert - Source : Par les champs et par les grèves
- Garde-moi de l'ennui, de la vieillesse immonde
Et poète vêtu d'orgueilleuse splendeur,
O Reine qui formes et gouvernes le monde
Avant tout garde-moi de l'infâme laideur.Auteur : Laurent Tailhade - Source : Au pays du mufle (1891) - L'orgueilleux préfère n'être rien que pas grand chose.Auteur : Bernard Willems-Diriken, dit Romain Guilleaumes - Source : Le Bûcher des Illusions, A vrai dire (2007-2008)
- L'orgueil et la paresse qui sont les deux sources de tous les vices.Auteur : Blaise Pascal - Source : Pensées (1670)
- De là des sympathies nombreuses et qui l'enorgueillit fort.Auteur : Georges Courteline - Source : Messieurs les ronds-de-cuir (1893)
- L'ode dont l'orgueil rejette encore plus ce qui est commun dans les expressions que dans les idées.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, La Motte
- La peur de décevoir est une des pires décimales de l'orgueil.Auteur : Georges Perros - Source : Pour ainsi dire (2004)
- Ai-je été trop peu disponible ? Ou trop peu généreux ? Ai-je manqué une occasion de tendresse, de douceur féminine ? Ça m'est arrivé, dans ma jeunesse, de manquer ces choses-là. L'orgueil de la solitude, de la différence, vous joue des tours, souvent.Auteur : Jorge Semprún - Source : Adieu, vive clarté... (1998)
- Dès l'entrée, les orgues avaient éclaté en un chant triomphal, une acclamation tonitruante de peuple heureux, d'ou se dégagea bientôt une céleste voix d'ange, d'une allégresse aiguë, pure comme le cristal.Auteur : Emile Zola - Source : Lourdes (1894)
- Si nous avions un peu plus de modestie, nous trouverions bien moins d'orgueil dans les autres.Auteur : Félix Guillaume Marie Bogaerts - Source : Pensées et Maximes
- L'illusion orgueilleuse de l'indépendance exige la pudeur des sentiments.Auteur : Kimitake Hiraoka, dit Yukio Mishima - Source : Pèlerinage aux Trois Montagnes (1946-1965)
- Faire la leçon aux autres n'est pas de la franchise, mais de l'orgueil.Auteur : Eugène Marbeau - Source : Remarques et pensées (1901)
- C'est (la mélancolie) la maladie de celui qui, dépité de n'être pas tout, choisit, par un revers enfantin de l'orgueil, de n'être rien, ne gardant du monde que ce qui lui ressemble: le morne et le pluvieux.Auteur : Christian Bobin - Source : L'inespérée
- L'homme orgueilleux seul croit qu'il vivra toujours.Auteur : Albert Cohen - Source : Solal (1930)
- Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci. Jamais parler. Jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C'est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour nous essayons de nous tuer, de tuer. Non seulement on ne se parle pas mais on ne se regarde pas. Du moment qu'on s'est vu, on ne peut pas regarder. Regarder c'est avoir un mouvement de curiosité vers, envers, c'est déchoir. Aucune personne regardée ne vaut le regard sur elle. Il est toujours déshonorant. Le mot conversation est banni. Je crois que c'est celui qui dit ici le mieux la honte et l'orgueil. Auteur : Marguerite Duras - Source : L'Amant (1984)
- Ses guerres (de Louis XIV) souvent très injustes, son faste, son orgueil, son intolérance, sa révocation de l'édit de Nantes, son dévouement aux jésuites, tout cela, sire, met contre lui un furieux poids dans la balance.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 30 novembre 1770
- Sans l'orgueil, la vie serait lamentable.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Son suprême orgueil est de se croire libre !Auteur : Bernard Werber - Source : L'Empire des anges (2000)
- Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence.Auteur : Confucius - Source : Entretiens du Maître avec ses disciples
- L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664)
Les citations du Littré sur Orgue
- De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendreAuteur : Molière - Source : Tart. III, 6
- Il [Jésus-Christ] a mis dans son église une autorité seule capable d'abaisser l'orgueil et de relever la simplicitéAuteur : BOSSUET - Source : Anne de Gonz.
- Orgueil, contrepesant toutes les misères ; ou il cache ses misères, ou, s'il les découvre, il se glorifie de les connaîtreAuteur : Blaise Pascal - Source : ib. II, 2
- Cède-moi la terre, dit l'orgueilleux Sicambre. - La terre que je te céderai, s'écria le Gaulois, tu la garderas éternellementAuteur : CHATEAUBR. - Source : Mart. VI
- ... Un orgueil insensé Armant de ses neveux [d'Adam] la gigantesque engeance, Dieu résolut enfin, terrible en sa vengeance, D'abîmer sous les eaux tous ces audacieuxAuteur : BOILEAU - Source : Sat. XII
- Il [Mazarin] relâcha même beaucoup de la morgue des cardinaux les plus ordinairesAuteur : RETZ - Source : Mém. t. I, liv. II, p. 97, dans POUGENS
- Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil, et sous lequel on s'abaisse sans désespoirAuteur : Blaise Pascal - Source : ib. XVII, 7
- Soyez béni, mon Dieu, vous qui daignez me rendre L'innocence et son noble orgueilAuteur : GILBERT - Source : Derniers vers.
- Dans leurs prospérités [de ses amis], il estima leur modération, et se réserva le droit de les avertir de leur orgueilAuteur : FLÉCH. - Source : duc de Mont.
- Voici de quoi détruire et de quoi renverser Ce colosse orgueilleux si fort à terrasserAuteur : ROTR. - Source : Bélisaire, IV, 5
- Les bruits ont éveillé les bruits, la forêt est tout harmonie ; est-ce les sons graves de l'orgue que j'entends ?Auteur : Chateaubriand - Source : Amérique, Journal sans date.
- Après lui vient le paon de lui-même ébloui ; Son plumage superbe, en cercle épanoui, Déploie avec orgueil la pompe de sa roue : Iris s'y réfléchit, la lumière s'y joueAuteur : DELILLE - Source : Paradis perdu, VII
- Tu aurais fait quelque autre faute ; car il fallait que tu en fisses, étant aussi gâté que tu l'étais par la mollesse, par l'orgueil, et par la haine des conseils sincèresAuteur : FÉN. - Source : Dial. des morts anc. (Xercès et Léonidas).
- L'orgueil est le premier des tyrans ou des consolateursAuteur : DUCLOS - Source : Consid. moeurs, 10
- Combien de gens, seigneur, s'ils faisaient même chose, Sachant ce qu'ils étaient et voyant ce qu'ils sont, Auraient à votre cour moins d'orgueil qu'ils n'en ont !Auteur : BOURSAULT - Source : Ésope à la cour, v, 3
- Vendôme, que soutient l'orgueil de sa naissance, Au même instant dans l'onde impatient s'élanceAuteur : BOILEAU - Source : Épît. IV
- Les mauvais succès sont les seuls maîtres qui peuvent nous reprendre utilement, et nous arracher cet aveu qui coûte tant à notre orgueilAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Les passions vicieuses sont toujours un composé d'orgueil, et les passions vertueuses un composé d'amourAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, II, III, 1
- Notre orgueil aveugle, nous remplissant de nous-mêmes, nous érige en de petits dieux ; eh bien ! ô superbe, ô petit dieu, voici le grand Dieu vivant qui s'abaisse pour te confondreAuteur : BOSSUET - Source : 1er sermon, Nativ. de N. Seigneur, 3
- Il fait que tout prospère aux âmes innocentes, Tandis qu'en ses projets l'orgueilleux est trompéAuteur : Jean Racine - Source : Esth. I, 1
- Trop enorgueillis du faste de leurs roisAuteur : Voltaire - Source : Orphel. II, 7
- L'orgueil ne veut pas devoir, et l'amour-propre ne veut pas payerAuteur : LA ROCHEFOUC. - Source : ib. 228
- Refrener la fierté et l'insolence d'un peuple enorgueillyAuteur : AMYOT - Source : Pér. et Fab. comp. 3
- Le christianisme nous donne l'habitude de soumettre cet orgueil ; le monde nous donne l'habitude de le cacherAuteur : Montesquieu - Source : Déf. Espr. lois, part. 3
- L'orgueil du roy Tarquin avoit esté cause que la liberté nouvellement acquise fust plus agreable au peuple romainAuteur : BERCHEURE - Source : f° 27, verso
Les mots débutant par Org Les mots débutant par Or
Une suggestion ou précision pour la définition de Orgue ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 02h50

- Oasis - Obéir - Obeissance - Obligation - Obscurite - Occasion - Occident - Odeur - Oeuvre - Offenser - Oil - Oisivete - Olympique - Ombre - Opinion - Opportuniste - Optimisme - Ordinateur - Ordre - Organisation - Orgasme - Orgueil - Orgueil - Originalite - Origine - Orthographe - Oubli - Oublier - Ouvrage
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur orgue
Poèmes orgue
Proverbes orgue
La définition du mot Orgue est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Orgue sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Orgue présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
