La définition de Tribu du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Tribu
Nature : s. f.
Prononciation : tri-bu
Etymologie : Provenç. trip, trep ; espagn. tribu ; ital. tribù, tribo ; du lat. tribus, qui représente, d'après Saumaise, la traduction en grec par, gens. Au contraire, Corssen, Ausspr. I, 163, le tire de tri, trois, et un radical bu, représentant le sanscr bhu, le latin fu, le grec, être.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de tribu de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec tribu pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Tribu ?
La définition de Tribu
Certaine division du peuple, chez quelques nations anciennes.
Toutes les définitions de « tribu »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Chacune des divisions du peuple, chez quelques nations anciennes. Le peuple d'Athènes, de Rome était divisé en tribus. Il a eu les suffrages de toutes les tribus. Une tribu tout entière. Il se disait, chez les Juifs, de Tous ceux qui étaient sortis d'un des douze fils de Jacob. Les douze tribus d'Israël. La tribu de Juda. Il se dit encore d'une Peuplade relativement à une grande nation dont elle fait partie. Une tribu de Tartares. Une tribu de Germains. Une tribu de sauvages. Il se dit figurément et familièrement d'une Famille, d'une coterie, d'un groupe nombreux. Ils étaient toute une tribu. En termes de Botanique et de Zoologie, il se dit d'une Division de la classification qui prend place entre la famille et le genre.
Littré
-
1Certaine division du peuple, chez quelques nations anciennes.
Romulus commença par distribuer tous les citoyens en tribus et en légions
, Rollin, Traité des Ét. v, 3e part. 2.Épicure était Athénien, du bourg de Gargette, et de la tribu d'Égée
, Diderot, Opin. des anc. phil. (Épicurisme).Les Athéniens sont partagés en dix tribus
, Barthélemy, Anach. ch. 26.Il n'y en out d'abord que trois [divisions du peuple romain]?; d'où vint, suivant l'opinion commune, le nom de tribu que ces divisions conservèrent, lors même que le nombre en fut augmenté
, Bernardi, Instit. Mém. inscr. et belles-lettres. t. VIII, p. 288.L'hymen dont la solennité Unit la tribu sainte à la tribu guerrière
, Delavigne, Paria, III, 7.À Rome, tribus urbaines, celles qui habitaient la ville?; tribus rustiques, celles qui vivaient à la campagne.
C'était une ignominie d'être transféré d'une tribu rustique dans une tribu urbaine, et même dans une tribu rustique inférieure à celle où l'on se trouvait d'abord placé
, Bernardi, Instit. Mém. inscr. et belles-lettres t. VIII, p. 289. -
2Chez les Juifs, tous ceux qui étaient sortis d'un des douze patriarches.
Saül lui répondit?: Ne suis-je pas de la tribu de Benjamin, qui est la plus petite d'Israël??
Sacy, Bible, Rois, I, IX, 21.Rompez vos fers, tribus captives
, Racine, Esth. III, 9.Les Israélites étaient divisés en douze tribus?: il y avait aussi douze tribus d'Ismaélites, et douze tribus de Perses
, Fleury, M?urs des Israél. tit. v, 2e part. p. 38, dans POUGENS.La tribu sacrée, la tribu sainte, la tribu de Lévi, qui était vouée au culte.
Et Dieu n'est plus servi que dans la tribu sainte
, Racine, Athal. III, 7.Par allusion, dans le style de la chaire, la tribu sacrée, la tribu sainte, l'ordre ecclésiastique.
-
3Peuplade, petit peuple faisant partie d'une grande nation. Une tribu de Germains. Une tribu d'Arabes. Une tribu de sauvages.
Hélas?! nous espérions? Que sur toute tribu, sur toute nation, L'un d'eux établirait sa domination
, Racine, Athal. I, 1.Familièrement, gens de toutes nations et de toutes tribus, gens de toute espèce.
Ne pouvoir se passer de diseurs de riens, d'écoliers, de précieuses ridicules, de fainéants de toutes nations et de toutes tribus??
Anti-Ménagiana, p. 187. -
4 Familièrement. Les divers membres d'une famille.
J'embrasse tout ce qui est autour de vous?; j'ai bien envie de savoir où va votre tribu
, Sévigné, 17 mars 1680.Il se dit, en un sens analogue, des animaux et des végétaux.
La grande tribu des petits oiseaux de rivage
, Buffon, Ois. t. XV, p. 220.Il aperçut une tribu de thons qui suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et s'engageait dans le filet par une ouverture ménagée à cet effet
, Barthélemy, Anach. ch. 74.Mais, lorsqu'un chêne antique ou lorsqu'un vieil érable, Patriarche des bois, lève un front vénérable, Que toute sa tribu, se rangeant à l'entour, S'écarte avec respect, et compose sa cour
, Delille, Jardins, II. - 5 Terme d'histoire naturelle. Division établie dans les familles. La tribu renferme un ou plusieurs genres. La famille des caryophyllées se divise en deux tribus?: les silénées et les alsinées.
-
6 Fig. Coterie, parti.
Son esprit [du duc de Noailles] et sa tribu si établie lui donnait de la crainte [au régent]
, Saint-Simon, 480, 207.Se disait des subdivisions des quatre nations dans l'université de Paris.
Se disait d'une certaine quantité de moines qui avaient un supérieur particulier soumis à l'abbé.
HISTORIQUE
XIVe s. Lignies, c'est tribus en latin
, Bercheure, f° 21, verso.
XVIe s. Qu'il y ait eu du commencement à Rome trois lignées seulement, et non plus, le mot mesme de tribus qui signifie lignée le tesmoigne?; car ainsi les apellent encores les Romains et tribuns ceulx qui en sont chefs
, Amyot, Rom. 30.
Encyclopédie, 1re édition
TRIBU, s. f. (Gram. & Hist. anc.) certaine quantité de peuple distribuée sous différens districts ou divisions.
Tribus des Hébreux, (Hist. sacrée.) les Hébreux formerent douze tribus ou districts, selon le nombre des enfans de Jacob, qui donnerent chacun leur nom à leur tribu ; mais ce patriarche ayant encore adopté en mourant les deux fils de Joseph, Manassé & Ephraïm, il se trouva treize tribus, parce que celle de Joseph fut partagée en deux après la mort de Jacob. La famille de Joseph s'étant multipliée prodigieusement en Egypte, devint si suspecte aux rois du pays, qu'elle se vit obligée de passer dans la terre de Chanaan, sous la conduite de Josué, qui la divisa entre onze tribus de cette famille. On en sait les noms, Ruben, Siméon, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Benjamin, Manassé, & Ephraïm. La tribu de Levi n'eut point de part au partage, parce qu'elle fut consacrée au service religieux ; on pourvut à sa subsistance, en lui assignant des demeures dans quelques villes, les prémices, les dixmes, & les oblations du peuple.
Cet état des douze tribus demeura fixe jusqu'après la mort de Salomon. Roboam qui lui succéda, fit naître une révolte par sa dureté. Dix tribus se séparerent de la maison de David, reconnurent pour roi Jéroboam, & formerent le royaume d'Israël. Il ne resta au fils de Salomon que Juda & Benjamin, qui constituerent l'autre royaume, dans lequel se conserva le culte de Dieu ; mais le royaume d'Israël lui substitua l'idolatrie des veaux d'or.
Dans la suite des tems, Tiglath-Pilésec rendit Samarie tributaire ; Salmanazar ruina la capitale, & le royaume d'Israël s'éteignit. Enfin arriva la captivité de Juda, sous Nabuchodonosor qui prit Jérusalem, la détruisit avec le temple, & transporta tous les habitans dans les provinces de son empire, 588 ans avant Jésus-Christ ; cependant après une captivité de 70 ans, Cyrus renvoya les Juifs dans leur pays, leur permit de rebâtir le temple, & de vivre selon leur loi ; alors la Palestine se repeupla, les villes furent rebâties, les terres cultivées, & les Juifs ne firent plus qu'un seul état gouverné par un même chef, un seul corps, rendant au vrai Dieu leurs adorations dans son temple. Voila l'époque la plus brillante de l'histoire de ce peuple, la suite ne regarde pas cet article. (D. J.)
Tribus d'Athenes, (Hist. d'Athènes) Athènes dans sa splendeur étoit divisée en dix tribus, qui avoient emprunté leurs noms de dix héros du pays ; elles occupoient chacune une partie d'Athènes, & contenoient en-dehors quelques autres villes, bourgs, & villages. Les noms de ces dix tribus reviennent souvent dans les harangues de Démosthène, mais je n'en puis rappeller à ma mémoire que les huit suivans ; la tribu Acamantide, ainsi nommée d'Acamas, fils de Télamon ; l'Antiochide, d'Antiochus fils d'Hercule ; la Cécropide, de Cécrops, fondateur & premier roi d'Athènes ; l'Egéïde, d'Egée, neuvieme roi d'Athènes ; l'Hippothoontide, d'Hippothoon, fils de Neptune ; la Léontide, de Léon, qui voua ses filles pour le salut de sa patrie ; & l'?néïde, d'?neus, fils de Pandion, cinquieme roi d'Athènes.
Mais il faut observer que le nombre des tribus ne fut pas le même dans tous les tems, & qu'il varia selon les accroissemens d'Athènes. Il n'y en avoit eu d'abord que quatre, il y en eut six peu après, puis dix, & enfin treize ; car aux dix nommées par Démosthène, la flaterie des Athéniens en ajouta trois autres dans la suite ; savoir la tribu ptolémaïde, en l'honneur de Ptolomée, fils de Lagus ; l'attalide, en faveur d'Attalus, roi de Pergame ; & l'adrianide, en faveur de l'empereur Adrien. Pour établir ces nouvelles tribus, on démembra quelques portions des anciennes. Au reste les peuples ou bourgades qui composoient toutes ces tribus, étoient au nombre de cent soixante & quatorze. Voyez Suidas, Eustache, & Meursius, & notre article République d'Athènes. (D. J.)
Tribu romaine, (Hist. rom.) nom collectif du partage de différens ordres de citoyens romains, divisés en plusieurs classes & quartiers. Le mot tribu est un terme de partage & de division, qui avoit deux acceptions chez les Romains, & qui se prenoit également pour une certaine partie du peuple, & pour une partie des terres qui lui appartenoient. C'est le plus ancien établissement dont il soit fait mention dans l'histoire romaine, & un de ceux sur lesquels les auteurs sont moins d'accord.
L'attention la plus nécessaire dans ces sortes de recherches, est de bien distinguer les tems ; car c'est le n?ud des plus grandes difficultés. Ainsi il faut bien prendre garde de confondre l'état des tribus sous les rois, sous les consuls & sous les empereurs ; car elles changerent entierement de formes & d'usages sous ces trois sortes de gouvernemens. On peut les considérer sous les rois comme dans leur origine, sous les consuls comme dans leur état de perfection, & sous les empereurs comme dans leur décadence, du-moins par rapport à leur crédit & à la part qu'elles avoient au gouvernement : car tout le monde sait que les empereurs réunirent en leur personne toute l'autorité de la république, & n'en laisserent plus que l'ombre au peuple & au sénat.
L'état où se trouverent alors les tribus nous est assez connu, parce que les meilleurs historiens que nous ayons sont de ce tems-là : nous savons aussi à-peu-près quelle en étoit la forme sous les consuls, parce qu'une partie des mêmes historiens en ont été témoins : mais nous n'avons presque aucune connoissance de l'état où elles étoient sous les rois, parce que personne n'en avoit écrit dans le tems, & que les monumens publics & particuliers qui auroient pu en conserver la mémoire, avoient été ruinés par les incendies.
Les anciens qui ont varié sur l'époque, sur le nombre des tribus, & même sur l'étymologie de leur nom, ne sont pas au fond si contraires qu'ils le paroissent, les uns n'ayant fait attention qu'à l'origine des tribus qui subsistoient de leur tems, les autres qu'à celle des tribus instituées par Romulus & supprimées par Servius Tullius. Il y a eu deux sortes de tribus instituées par Romulus, les unes avant l'enlevement des Sabines, les autres après qu'il eut reçu dans Rome les Sabins & les Toscans. Les trois nations ne firent alors qu'un même peuple sous le nom de Quirites, mais elles ne laisserent pas de faire trois différentes tribus ; les Romains sous Romulus, d'où leur vint le nom de Ramnes ; les Sabins sous Tatius, dont ils porterent le nom ; & les Toscans appellés Luceres sous ces deux princes.
Pour se mettre au fait de leur situation, il faut considérer Rome dans le tems de sa premiere enceinte, & dans le tems que cette enceinte eut été aggrandie après l'union des Romains, des Sabins, & des Toscans. Dans le premier état, Rome ne comprenoit que le mont Palatin dont chaque tribu occupoit le tiers ; dans le second, elle renfermoit la roche tarpéienne ; & la vallée qui séparoit ces deux monticules fut le partage des Toscans, & l'on y joignit le mont Aventin & le Janicule : la montagne qu'on nomma depuis le capitole, fut celui des Sabins, qui s'étendirent aussi dans la suite sur le mont C?lius.
Voilà quelle étoit la situation des anciennes tribus, & quelle en fut l'étendue, tant qu'elles subsisterent ; car il ne leur arriva de ce côté-là aucun changement jusqu'au regne de Servius Tullius, c'est à-dire jusqu'à leur entiere suppression. Il est vrai que Tarquinius Priscus entreprit d'en augmenter le nombre, & qu'il se proposoit même de donner son nom à celles qu'il vouloit établir ; mais la fermeté avec laquelle l'augure Nævius s'opposa à son dessein, & l'usage qu'il fit alors du pouvoir de son art, ou de la superstition des Romains, en empêcherent l'exécution. Les auteurs remarquent qu'une action si hardie & si extraordinaire lui fit élever une statue dans l'endroit même où la chose se passa. Et Tite-Live ajoute que le prétendu miracle qu'il fit en cette occasion, donna tant de crédit aux auspices en général & aux augures en particulier, que les Romains n'oserent plus rien entreprendre depuis sans leur aveu.
Tarquin ne laissa pas néanmoins de rendre la cavalerie des tribus plus nombreuse ; & l'on ne sauroit nier que de ce côté-là il ne leur soit arrivé divers changemens : car à mesure que la ville se peuploit, comme ses nouveaux habitans étoient distribués dans les tribus, il falloit nécessairement qu'elles devinssent de jour en jour plus nombreuses, & par conséquent que leurs forces augmentassent à-proportion. Aussi voyons-nous que dans les commencemens chaque tribu n'étoit composée que de mille hommes d'infanterie, d'où vint le nom de miles, & d'une centaine de chevaux que les Latins nommoient centuria equitum. Encore faut-il remarquer qu'il n'y avoit point alors de citoyen qui fût exemt de porter les armes. Mais lorsque les Romains eurent fait leur paix avec les Sabins, & qu'ils les eurent reçus dans leur ville avec les Toscans qui étoient venus à leur secours ; comme ces trois nations ne firent plus qu'un peuple, & que les Romains ne firent plus qu'une tribu, les forces de chaque tribu durent être au-moins de trois mille hommes d'infanterie & de trois cens chevaux, c'est-à-dire trois fois plus considérables qu'auparavant.
Enfin quand le peuple romain fut devenu beaucoup plus nombreux, & qu'on eut ajouté à la ville les trois nouvelles montagnes dont on a parlé ; savoir le mont Coelius pour les Albains, que Tullus Hostilius fit transférer à Rome après la destruction d'Albe, & le mont Aventin avec le Janicule pour les Latins qui vinrent s'y établir, lorsqu'Ancus Martius se fut rendu maître de leur pays, les tribus se trouvant alors considérablement augmentées & en état de former une puissante armée, se contenterent néanmoins de doubler leur infanterie, qui étoit, comme nous venons de voir, de 9000 hommes. Ce fut alors que Tarquinius Priscus entreprit de doubler aussi leur cavalerie, & qu'il la fit monter à 1800 chevaux, pour répondre aux dix huit mille hommes dont leur infanterie étoit composée.
Ce sont-là tous les changemens qui arriverent aux tribus du côté des armes, & il ne reste plus qu'à les considérer du côté du gouvernement.
Quoique les trois nations dont elles étoient composées ne formassent qu'un peuple, elles ne laisserent pas de vivre chacune sous les lois de leur prince naturel, jusqu'à la mort de T. Tatius : car nous voyons que ce roi ne perdit rien de son pouvoir, quand il vint s'établir à Rome, & qu'il y régna conjointement, & même en assez bonne intelligence avec Romulus tant qu'il vécut. Mais après sa mort les Sabins ne firent point de difficulté d'obéir à Romulus, & suivirent en cela l'exemple des Toscans qui l'avoient déjà reconnu pour leur souverain. Il est vrai que lorsqu'il fut question de lui choisir un successeur, les Sabins prétendirent que c'étoit à leur tour à régner, & surent si bien soutenir leurs droits contre les Romains, qui ne vouloient point de prince étranger, qu'après un an d'interregne on fut enfin obligé de prendre un roi de leur nation. Mais comme il n'arriva par-là aucun changement au gouvernement, les tribus demeurerent toujours dans l'état où Romulus les avoit mises, & conserverent leur ancienne forme tant qu'elles subsisterent.
La premiere chose que fit Romulus, lorsqu'il les eut réunies sous sa loi, fut de leur donner à chacune un chef de leur nation, capable de commander leurs troupes & d'être ses lieutenans dans la guerre. Ces chefs que les auteurs nomment indifféremment tribuni & præfecti tribuum, étoient aussi chargés du gouvernement civil des tribus ; & c'étoit sur eux que Romulus s'en reposoit pendant la paix. Mais comme ils étoient obligés de le suivre lorsqu'il se mettoit en campagne, & que la ville seroit demeurée par-là sans commandant, il avoit soin d'y laisser en sa place un gouverneur qui avoit tout pouvoir en son absence, & dont les fonctions duroient jusqu'à son retour. Ce magistrat se nommoit præfectus urbis, nom que l'on donna depuis à celui que l'on créoit tous les ans pour tenir la place des consuls pendant les féries latines : mais comme les fonctions du premier étoient beaucoup plus longues, les féries latines n'étant que de deux ou trois jours, son pouvoir étoit aussi beaucoup plus étendu ; car c'étoit pour lors une espece de viceroi qui décidoit de tout au nom du prince, & qui avoit seul le droit d'assembler le peuple & le sénat en son absence.
Quoique l'état fût alors monarchique, le pouvoir des rois n'étoit pas si arbitraire, que le peuple n'eût beaucoup de part au gouvernement. Ses assemblées se nommoient en général comices, & se tenoient dans la grande place ou au champ de Mars. Elles furent partagées en différentes classes, les curies, les centuries, & les nouvelles tribus.
Il faut bien prendre garde au reste de confondre les premieres assemblées du peuple sous les rois & du tems des anciennes tribus, avec ces comices des centuries, & encore plus avec ceux des nouvelles tribus ; car ces derniers n'eurent lieu que sous les consuls, & plus de soixante ans après ceux des centuries, & ceux-ci ne commencerent même à être en usage, que depuis que Servius Tullius eut établi le cens, c'est-à-dire plus de deux cens ans après la fondation de Rome.
Les curies étoient en possession des auspices, dont le sceau étoit nécessaire dans toutes les affaires publiques ; & malgré les différentes révolutions arrivées dans la forme de leurs comices, elles se soutinrent jusqu'à la fin de la république. Il y avoit deux sortes de curies à Rome du tems des anciennes tribus : les unes où se traitoient les affaires civiles, & où le sénat avoit coutume de s'assembler, & les autres où se faisoient des sacrifices publics & où se régloient toutes les affaires de la religion. Ces dernieres étoient au nombre de trente, chaque tribu en ayant dix qui formoient dans son enceinte particuliere autant de quartiers & d'especes de paroisses, car ces curies étoient des lieux destinés aux cérémonies de la religion, où les habitans de chaque quartier étoient obligés d'assister les jours solemnels, & qui étant consacrés à différentes divinités, avoient chacune leurs fêtes particulieres, outre celles qui étoient communes à tout le peuple.
D'ailleurs, il y avoit dans ces quartiers d'autres temples communs à tous les Romains, où chacun pouvoit à sa dévotion aller faire des v?ux & des sacrifices, mais sans être pour cela dispensé d'assister à ceux de sa curie, & sur-tout aux repas solemnels que Romulus y avoit institués pour entretenir la paix & l'union, & qu'on appelloit charistia, ainsi que ceux qui se faisoient pour le même sujet dans toutes les familles.
Enfin, ces temples communs étoient desservis par différens colleges de prêtres, tels que pourroient être aujourd'hui les chapitres de nos églises collégiales, & chaque curie au contraire, par un seul ministre qui avoit l'inspection sur tous ceux de son quartier, & qui ne relevoit que du grand curion, qui faisoit alors toutes les fonctions de souverain pontife : ces curions étoient originairement les arbitres de la religion, & même depuis qu'ils furent subordonnés aux pontifes, le peuple continua de les regarder comme les premiers de tous les prêtres après les augures, dont le sacerdoce étoit encore plus ancien, & qui furent d'abord créés au nombre de trois, afin que chaque tribu eût le sien. Voilà quel étoit l'état de la religion du tems des anciennes tribus, & quels en furent les principaux ministres tant qu'elles subsisterent.
Le peuple étoit en droit de se choisir tous ceux qui devoient avoir sur lui quelque autorité dans les armes, dans le gouvernement civil & dans la religion. Servius Tullius fut le premier qui s'empara du trône sans son consentement, & qui changea la forme du gouvernement, pour faire passer toute l'autorité aux riches & aux patriciens, à qui il étoit redevable de son élévation. Il se garda bien néanmoins de toucher à la religion, se contentant de changer l'ordre civil & militaire. Il divisa la ville en quatre parties principales, & prit de-là occasion de supprimer les trois anciennes tribus, que Romulus avoit instituées, & en établit quatre nouvelles, auxquelles il donna le nom de ces quatre principaux quartiers, & qu'on appella depuis les tribus de la ville pour les distinguer de celles qu'il établit de même à la campagne.
Servius ayant ainsi changé la face de la ville, & confondu les trois principales nations, dont les anciennes tribus étoient composées, fit un dénombrement des citoyens & de leurs facultés. Il divisa tout le peuple en six classes subordonnées les unes aux autres, suivant leur fortune. Il les subdivisa ensuite en cent quatre-vingt-treize centuries, par le moyen desquelles il fit passer toute l'autorité aux riches, sans paroître leur donner plus de pouvoir qu'aux autres.
Cet établissement des classes & des centuries, en introduisant un nouvel ordre dans les assemblées du peuple, en introduisit un nouveau dans la répartition des impôts ; les Romains commencerent à en supporter le poids à proportion de leurs facultés, & de la part qu'ils avoient au gouvernement. Chacun étoit obligé de servir à ses dépens pendant un nombre déterminé de campagnes fixé, à dix pour les chevaliers, & à vingt pour les plébéiens ; la classe de ceux qui n'en avoient pas le moyen fut exempte de service, jusqu'à ce qu'on eut assigné une paye aux troupes ; les centuries gardoient en campagne le même rang & les mêmes marques de distinction qu'elles avoient dans la ville, & se rendoient en ordre militaire dans le champ de Mars pour y tenir leurs comices.
Ces comices ne commencerent néanmoins à avoir lieu, qu'après l'établissement des nouvelles tribus, tant de la ville, que de la campagne : mais comme ces tribus n'eurent aucune part au gouvernement sous les rois, qu'on fut même dans la suite obligé d'en augmenter le nombre à plusieurs reprises, & qu'enfin les comices de leur nom ne commencerent à être en usage que sous la république ; nous allons voir comment elles parvinrent à leur perfection sous les consuls.
Pour se former une idée plus exacte des diverses tribus, il est bon de considérer l'état où se trouverent les Romains à mesure qu'ils les établirent, afin d'en examiner en même-tems la situation, & de pouvoir même juger de leur étendue par la date de leur établissement. Pour cela, il faut bien distinguer les tems, & considérer les progrès des Romains en Italie sous trois points de vûe différens ; sur la fin de l'état monarchique, lorsque Servius Tullius établit les premieres de ces tribus ; vers le milieu de la république, lorsque les consuls en augmenterent le nombre jusqu'à trente-cinq ; & un peu avant les empereurs, lorsqu'on supprima les tribus surnuméraires qu'on avoit été obligé de créer pour les différens peuples d'Italie.
Au premier état leurs frontieres ne s'étendoient pas au-delà de six milles, & c'est dans cette petite étendue qu'étoient renfermées les tribus que Servius Tullius établit, entre lesquelles celles de la ville tenoient le premier rang, non-seulement parce qu'elles avoient été établies les premieres ; mais encore parce qu'elles furent d'abord les plus honorables, quoiqu'elles soient depuis tombées dans le mépris.
Ces tribus étoient au nombre de quatre, & tiroient leur dénomination des quatre principaux quartiers de Rome. Varron, sans avoir égard à l'ancienneté des quartiers dont elles portoient le nom, nomme la suburane la premiere ; l'esquiline la seconde ; la colline la troisieme ; & la palatine la derniere : mais leur ordre est différemment rapporté par les historiens.
A l'égard des tribus que Servius Tullius établit à la campagne & qu'on nommoit rustiques, on ne sait pas au juste quel en fut d'abord le nombre, car les auteurs sont partagés sur ce sujet. Comme il est certain que des trente-une tribus rustiques dont le peuple romain étoit composé du tems de Denys d'Halycarnasse, il n'y en a que dix-sept dont on puisse rapporter l'établissement à Servius Tullius, on peut supposer que ce prince divisa d'abord le territoire de Rome en dix-sept parties, dont il fit autant de tribus, & que l'on appella dans la suite les tribus rustiques, pour les distinguer de celles de la ville. Toutes ces tribus porterent d'abord le nom des lieux où elles étoient situées ; mais la plûpart ayant pris depuis le nom des familles romaines, il n'y en a que cinq qui aient conservé leurs anciens noms, & dont on puisse par conséquent marquer au juste la situation : voici leurs noms.
La romulie, ainsi nommée, selon Varron, parce qu'elle étoit sous les murs de Rome, ou parce qu'elle étoit composée des premieres terres que Romulus conquit dans la Toscane le long du Tibre & du côté de la mer.
La veïentine, qui étoit aussi dans la Toscane, mais plus à l'occident, & qui s'étendoit du côté de Veïes ; car cette ville si fameuse depuis le long siege qu'elle soutint contre les Romains, n'étoit pas encore en leur pouvoir.
La lémonienne qui étoit diamétralement opposée à celle-ci, c'est-à-dire du côté de l'orient, & qui tiroit son nom d'un bourg qui étoit proche de la porte Capene, & sur le grand chemin qui alloit au Latium.
La pupinienne, ainsi nommée du champ pupinien qui étoit aussi dans le Latium, mais plus au nord & du côté de Tusculum.
Enfin la Crustumine qui étoit entierement au nord, & qui tiroit son nom d'une ville des Sabins, qui étoit au-delà de l'Anio, à quatre ou cinq milles de Rome.
Des douze autres qui ne sont plus connues aujourd'hui que par le nom des familles Claudia, Æmilia, Cornelia, Fabia, Menenia, Pollia, Voltinia, Galeria, Horatia, Sergia, Veturia & Papiria, il n'y a que la premiere & la derniere dont on sache la situation ; encore n'est-ce que par deux passages, l'un de Tite-Live, qui nous apprend en général que lorsqu'Atta Clausus, qu'on appella depuis Appius Claudius, vint se réfugier à Rome avec sa famille & ses cliens, on lui donna des terres au-delà du Tévéron dans une des anciennes tribus à laquelle il donna son nom, & dans laquelle entrerent depuis tous ceux qui vinrent de son pays ; l'autre passage est de Festus, par lequel il paroit que la tribu papirienne étoit du côté de Tusculum, & tellement jointe à la pupinienne, qu'elles en vinrent quelquefois aux mains pour leurs limites.
Pour les dix autres tribus, tout ce qu'on en sait, c'est qu'elles étoient dans le champ romain, in agro romano ; mais on ne sait d'aucune en particulier, si elle étoit du côté du Latium dans la Toscane ou chez les Sabins. Il y a cependant bien de l'apparence qu'il y en avoit cinq dans la Toscane outre la romulie & la veïentine, & cinq de l'autre côté du Tibre ; c'est-à-dire, dans le Latium & chez les Sabins, outre la papirienne, la claudienne, la lémonienne, la pupinienne & la crustumine ; par conséquent que de ces dix-sept premieres tribus rustiques, il y en avoit dix du côté du Tibre & sept de l'autre ; car Varron nous apprend que Servius Tullius divisa le champ romain en dix-sept cantons, dont il fit autant de tribus ; & tous les auteurs conviennent que la partie de la Toscane qui étoit la plus proche de Rome, s'appelloit Septempagium. On pourroit même conjecturer que toutes ces tribus étoient situées entre les grands chemins qui conduisoient aux principales villes des peuples voisins de maniere que chacun de ces chemins conduisoit à deux tribus, & que chaque tribu communiquoit à deux de ces chemins.
Il faut remarquer que ces dix-sept tribus rustiques devinrent dans la suite les moins considérables de toutes les rustiques, par l'impossibilité où elles étoient de s'étendre, & par le grand nombre de nouveaux citoyens & d'étrangers dont on les surchargeoit. Les Romains avoient coutume d'envoyer des colonies dans les principales villes des pays conquis & d'en transférer à Rome les anciens habitans. Leur politique les empêcha de rien précipiter ; d'abord ils ne refusoient l'alliance d'aucun peuple, & à l'égard de ceux qui leur déclaroient la guerre ou qui favorisoient secrettement leurs ennemis, ils se contentoient de leur retrancher quelque partie de leurs terres, permettoient au reste de se gouverner suivant ses lois, lui accordoient même dans la suite tous les droits des citoyens romains, s'il étoit fidele ; mais ils le traitoient après cela à toute rigueur, s'il lui arrivoit de se révolter. On comptoit alors dans l'Italie dix-huit sortes de villes différentes ; celles des alliés des Romains, celles des confédérés, qui ne jouissoient que conditionnellement de leurs privileges, les colonies composées de seuls romains & les colonies latines, les municipes dont les habitans perdoient leurs droits de citoyens romains, & les autres qui n'en étoient point privés, & les préfectures.
Ce ne fut qu'insensiblement, & à mesure que les Romains étendirent leurs conquêtes, que furent établies les tribus stellatine, sabatine, tromentine, & celle que quelques-uns ont nommée arniensis ou narniensis.
La stellatine étoit ainsi nommée non de la ville de Stellate qui étoit dans la Campanie, mais d'une autre ville de même nom qui étoit dans la Toscane entre Capene, Falerie & Veïes, c'est-à-dire, & à cinq ou six milles de Rome.
La sabatine étoit aussi dans la Toscane, mais d'un côté de la mer, proche le lac appellé aujourd'hui Brachiano, & que les Latins nommoient Sabatinus, de la ville de Sabate qui étoit sur ses bords.
La tromentine tiroit son nom du champ tromentin dont on ne sait pas au juste la situation, mais qui étoit aussi dans la Toscane, & selon toutes les apparences entre les deux tribus dont nous venons de parler.
Enfin celle qui étoit nommée arniensis dans quelques auteurs, comme nous l'avons dit, étoit la derniere & la plus éloignée de toutes les rustiques.
Ces quatre tribus furent établies ensemble l'an 337 de Rome, & neuf ans après la prise de Veïes ; quand Camille eut défait les Volsques, on en établit deux nouvelles dans la partie du Latium qu'ils occupoient, & le sénat voyant toute l'Italie prête à se soulever, consentit enfin en 397 de former du champ Pomptin deux tribus, la pomptine & la publilienne, auxquelles on ajouta successivement la m?cienne, la scaptienne, l'ufentine & la falerine.
La pomptine étoit ainsi nommée, selon Festus, du champ Pomptin qui tiroit lui-même son nom, ainsi que les marais dont il est environné, de la ville de Pométie, que les Latins appelloient Suessa Pometia, Pometia, & Pontia.
La publilienne étoit aussi chez les Volsques, mais on n'en sait pas au juste la situation.
La m?cienne étoit située chez les Latins, & tiroit son nom d'un château qui étoit entre Lanuvium, Ardée & Pométie, & auprès duquel les Volsques avoient été défaits par Camille.
L'autre étoit chez les Herniques, & portoit le nom d'une ville qui étoit située entre Tivoli, Préneste & Tusculum, à quinze milles de Rome.
L'ufentine étoit ainsi nommée du fleuve Ufeus qui passoit à Terracine à l'extrémité du Latium.
La falérine étoit dans la Campanie, & tiroit son nom du territoire de Falerne si renommé chez les anciens par ses excellens vins.
C'est en suivant le même ordre des tems, & après que la révolte des Toscans eut contraint les Romains occupés dans le Latium à tourner leur armes victorieuses contre la Toscane, qu'ils formerent de leurs nouvelles conquêtes la tarentine & celle qui est nommée arniensis.
La tarentine étoit située dans la Toscane, mais on n'en sait au juste ni la situation ni l'étymologie.
L'arniensis tiroit son nom de l'Arne jusqu'où les Romains avoient pour lors étendu leurs conquêtes.
Ce fut au reste l'an 453, que ces deux tribus furent établies.
Enfin c'est chez les Sabins qu'étoient situées les deux dernieres tribus que les consuls instituerent, savoir la véline & la quirine, dont l'une tiroit son nom du lac Velin, qui est a cinquante milles de Rome, & l'autre de la ville de Cures, d'où les Romains tiroient aussi leur nom de Quirites, & ces tribus ne furent même établies que longtems après que les Romains se furent rendus maîtres du pays où elles étoient situées.
Ces tribus au reste furent les deux dernieres des quatorze que les consuls instituerent, & qui jointes aux quatre tribus de la ville & aux dix-sept rustiques que Servius Tullius avoit établies, acheverent le nombre de trente-cinq dont le peuple romain fut toujours depuis composé.
Voilà en quel tems & à quel occasion chacune de ces tribus fut établie, & même quelle en étoit la situation. Ainsi il ne nous reste plus qu'à parler de leur étendue, ce qui est difficile à constater ; car il n'en est pas de ces dernieres tribus, comme de celles que Servius avoit formées.
En effet malgré les changemens qui arriverent aux tribus de la ville à mesure qu'on l'aggrandit, comme elles la partagerent toujours à-peu-près également, il est assez facile de s'imaginer quelle en fut l'étendue selon les tems. Pour les dix-sept tribus rustiques de Servius Tullius, comme elles étoient toutes renfermées dans le champ romain qui ne s'étendoit pas à plus de dix ou douze milles, il s'ensuit que ces tribus ne pouvoient guere avoir que cinq ou six milles, c'est-à-dire, environ deux lieues d'étendue chacune. Mais à l'égard des quatorze qui furent depuis établies par les consuls, comme elles étoient d'abord fort éloignées les unes des autres, & situées non-seulement en différentes provinces, mais encore séparées entr'elles par un grand nombre de colonies, de municipes & de préfectures qui n'étoient point de leur dépendance, il est impossible de savoir au juste quelle en fut d'abord l'étendue ; tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'elles étoient séparées en général par le Tibre, le Nar & l'Anio, & terminées par le Vulturne à l'orient, au midi par la mer, par l'Arne à l'occident, & au septentrion par l'Apennin ; car elles ne passerent jamais ces limites.
Ainsi lorsqu'on voulut dans la suite leur donner plus d'étendue, on ne put les augmenter que du territoire des colonies & des municipes qui n'y étoient point comprises, & elles ne parvinrent même à remplir toute l'étendue du pays qui étoit entr'elles, que lorsqu'on eut accordé le droit de bourgeoisie à tous les peuples des provinces où elles étoient situées, ce qui n'arriva qu'au commencement de la guerre marsique, c'est-à-dire, dans les derniers tems de la république, encore ces peuples ne furent-ils pas d'abord reçus immédiatement dans ces trente-cinq tribus ; car les Romains craignant qu'ils ne se rendissent les maîtres dans les comices, en créerent exprès pour eux dix nouvelles, auxquelles ils ne donnerent point le droit de prérogative, & dont on ne prenoit par conséquent les suffrages, que lorsque les autres étoient partagées. Mais comme ces peuples se virent par-là privés de la part qu'ils espéroient avoir au gouvernement, ils en firent éclater leur ressentiment, & surent si bien se prévaloir du besoin que les Romains avoient alors de leur secours, qu'on fut peu de tems après obligé de supprimer ces nouvelles tribus, & d'en distribuer tous les citoyens dans les anciennes, où ils donnerent toujours depuis leurs suffrages.
Appian nous apprend que ce fut dans le consulat de L. Julius César & de P. Rutilius Lupus, que ces nouvelles tribus furent instituées, c'est-à-dire, l'an 660, & que ce fut l'an 665, sous le quatrieme consulat de L. Cinna, & pendant la censure de L. Marcus Philippus & de Marcus Perpenna, qu'elles furent supprimées.
Il y a bien de l'apparence au reste que les noms des dix ou douze tribus qu'on appelle ordinairement les surnuméraires, & dont il nous reste plusieurs inscriptions antiques, savoir Oericulana, Sapinia, Cluvia, Papia, Cluentia, Camilla, Dumia, Minucia, Julia, Flavia, & Ulpia, étoient les noms mêmes de ces dix nouvelles tribus ou de quelques-unes des anciennes qui changerent de dénomination dans les premiers tems de la république, si l'on en excepte les trois dernieres, Julia, Flavia & Ulpia, qui ne commencerent à être en usage que sous les empereurs, & qui furent données par honneur aux tribus d'Auguste, de Vespasien & de Trajan.
Pour les autres, ce qui fait croire que ce pourroient être les noms des dix nouvelles tribus dont nous avons parlé, c'est qu'il y en a qui sont des noms de familles qui n'étoient point encore romaines lorsque les autres tribus furent établies, comme la papienne & la cluentienne, qui tiroient leur origine de deux chefs de la guerre marsique, dont Appien parle au premier livre de la guerre civile, savoir Papius Mutilus & L. Cluentius, auxquels on accorda pour lors le droit de bourgeoisie, & qui parvinrent depuis à tous les honneurs de la république. D'autres sont des noms de lieux qui ne conviennent ni aux dernieres tribus établies par les consuls dont nous savons la situation, ni aux premieres établies par Servius Tullius, qui étoient toutes renfermées dans le champ romain, comme l'oericulane, la sapinienne & la cluentienne, qui étoient situées dans l'Ombrie, sur le Nac, & chez les Samnites.
Quoi qu'il en soit, il est certain que comme les tribus de la ville étoient en général moins honorables que les rustiques à cause des affranchis dont elles étoient remplies ; les premieres rustiques établies par Servius Tullius l'étoient aussi beaucoup moins que les consulaires, non-seulement parce qu'elles avoient beaucoup moins d'étendue, mais encore parce que c'étoit dans ces tribus qu'étoient distribués tous les nouveaux citoyens & les différens peuples auxquels on accordoit le droit de suffrage, ainsi qu'on peut le faire voir en exposant la forme politique de ces tribus, leurs différens usages selon les tems & les mutations qui leur arriverent depuis leur institution jusqu'à leur décadence.
Mais auparavant il est bon de rappeller l'état des anciennes, afin d'en examiner de suite les changemens, & montrer que tout ce que les nouvelles entreprirent sous les consuls, ne tendoit qu'à recouvrer l'autorité que les anciennes avoient eue sous les cinq premiers rois, & à se tirer de la sujettion où Servius Tullius les avoit asservies, en établissant les comices des centuries.
Les anciennes tribus sous les rois étoient distinguées en général par leur situation & par les différentes nations dont elles étoient composées ; mais elles ne laissoient pas d'avoir les mêmes usages, & leur forme politique étoit précisément la même. Toutes les curies avoient également part aux honneurs civils & militaires. Servius Tullius supprima les anciennes tribus, & leur en substitua de nouvelles qu'il dépouilla de toute autorité ; elles ne servirent jusqu'au jugement de Coriolan, qu'à partager le territoire de Rome, & à marquer le lieu de la ville & de la campagne où chaque citoyen demeuroit.
La condition du peuple romain ne devint pas meilleure par l'établissement des consuls, dont l'autorité ne fut pas suffisamment modérée par l'appel au peuple, ni par le pouvoir de les élire accordé aux centuries. L'abolition des dettes fut le premier coup d'éclat que le peuple frappa contre les patriciens. Il obtint ensuite ses tribuns par sa retraite sur le mont Sacré. Les tribuns n'eurent d'abord d'autre fonction que celle de défendre le peuple contre l'oppression des grands ; mais ils se servirent du droit d'assembler le peuple sans la permission du sénat, pour établir les comices des tribus, pour faire accorder aux mêmes tribus le droit d'élire les magistrats du second ordre, pour arrêter les délibérations du sénat, pour renverser la forme du gouvernement, pour faire parvenir le peuple au consulat, pour s'emparer du sacerdoce, & pour opprimer les patriciens.
Comme les tribus ne commencerent à avoir part au gouvernement que depuis l'établissement de leurs comices ; & que c'est même du pouvoir qu'elles avoient dans ces assemblées, qu'elles tirerent depuis tout leur crédit, il est certain que c'est à ces comices qu'il en faut rapporter le principal usage ; mais comme il en est fait quelquefois mention dans les comices des centuries, tant pour l'élection des magistrats qu'au sujet de la guerre, on ne sauroit douter qu'elles ne fussent aussi de quelque usage dans cette autre sorte d'assemblée, & il ne s'agit plus que de savoir de quel usage elles y pouvoient être, & quand elles commencerent d'y avoir part.
A l'égard de la premiere question, elle ne souffre point de difficulté ; & quoiqu'un passage de L?lius Félix cité par Aulu-Gelle, nous marque expressément que les comices des centuries ne pouvoient se tenir dans la ville, à cause que la forme en étoit militaire : il est certain néanmoins qu'on passoit quelquefois sur la regle en faveur de la commodité ; & qu'alors, pour sauver les apparences, le peuple s'assembloit d'abord par tribus, & se partageoit ensuite par classes & par centuries pour donner ses suffrages.
A l'égard du tems où les tribus commencerent à être en usage dans les comices des centuries ; c'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer, car on n'en trouve rien dans les anciens ; & les modernes qui en ont parlé, sont d'avis entierement contraires. Les uns prétendent que ce ne fut que depuis que le nombre des trente-cinq tribus fut rempli ; les autres au contraire soutiennent que cet usage eut lieu dès l'établissement des centuries, & que leurs comices ne se tinrent jamais autrement ; mais leur conjecture n'est pas mieux fondée : car Denys-d'Halicarnasse qui nous en a laissé un détail fort exact & fort circonstancié, ne dit pas un mot des tribus, & il n'en est pas fait une seule fois mention dans tous les comices dont Tite-Live parle avant le jugement de Coriolan.
Ainsi quoiqu'on ne puisse pas marquer précisément en quel tems les tribus commencerent à avoir part aux comices des centuries, nous croyons néanmoins pouvoir assurer que ce ne fut que depuis l'établissement de leurs comices, & nous ne doutons pas même que ce ne soit des tribus que le droit de prérogatives passa aux centuries, car il est certain qu'originairement il n'étoit point en usage dans leurs comices.
Il y a bien de l'apparence au reste, que ce fut en faveur du peuple, pour rétablir en quelque maniere l'égalité des suffrages dans les comices des centuries, & sur-tout afin de pouvoir les tenir dans la ville sans violer les lois, que cet usage s'établit, & qu'on leur donna cette nouvelle forme.
Il seroit inutile de citer tous les passages qui ont rapport à ce sujet ; nous en choisirons seulement deux ou trois qui puissent nous en apprendre des particularités différentes.
Le premier fait mention en général de toutes les tribus dans une occasion où il étoit question de décider de la guerre, & qui étoit par conséquent du ressort des centuries. Tit. Liv. lib. VI. cap. xxj. Tunc ut bellum juberent latum ad populum est, & ne quicquam dissuadentibus tribunis plebis omnes tribus bellum jusserunt.
Dans le second, il s'agit de l'élection des tribuns militaires qui étoit encore du ressort des centuries, & cependant il y est parlé non-seulement de la tribu prérogative, c'est-à-dire, de celle qui donnoit sa voix la premiere, mais encore de toutes les autres qui étoient ensuite appellées dans leur ordre naturel, & qui se nommoient à cause de cela jure vocatæ : Tit. Liv. lib. V. cap. xviij. Haud invitis patribus, P. Licinium Calvum prærogativa tribunum militum.... creant.... omnesque deinceps ex collegio ejusdem anni refici apparebat..... qui priusquam renuntiarentur jure vocatis tribubus, permissu interregis, P. Licinius Calvus ita verba fecit.
Enfin, le dernier passage regarde l'élection des consuls, & nous donnera lieu de faire encore quelques remarques sur ce sujet : Tit. Liv. lib. XXVI. cap. xxij. Fulvius Romam comitiorum causâ arcessitus, cùm comitia consulibus rogandus haberet prærogativa Veturia juniorum declaravit T. Manlium Torquatum & T. Otacilum. Manlius qui præsens erat, gratulandi causâ cùm turba coiret nec dubius esset consensus populi, magnâ circumfusus turbâ ad tribunal consulis venit, petiitque ut pauca sua verba audiret, centuriamque quæ tulisset suffragium revocari juberet..... Tum centuria & autoritate motâ viri & admirantium circa fremitu, petit à consule ut veturiam seniorum citaret, velle sese cum majoribus-natu colloqui, & ex auctoritate eorum consules dicere. Citatis veturiæ senioribus, datum secretò in ovili cum his colloquendi tempus...... ita de tribus consultatione data, senioribus dimissis, juniores suffragium ineunt, M. Claudium Marcellum...... & M. Valer.. absentem coss. dixerunt auctoritatem, prærogativæ omnes centuriæ secutæ sunt.
On voit par ce passage ; premierement, que le suffrage de la prérogative ne demeuroit point secret, & qu'on avoit coutume de le publier avant que de prendre celui des autres tribus. Secondement, que son suffrage étoit d'un si grand poids, qu'il ne manquoit presque jamais d'être suivi, & qu'on en recevoit sur le champ les complimens, comme si l'élection eut déja été faite ; c'est ce qui a donné lieu à Ciceron de dire, que le présage en étoit infaillible ; Tanta est illis comitiis religio, ut adhuc semper omen valuerit prærogativum, & que celui qui l'avoit eu le premier, n'avoit jamais manqué d'être élu : Prærogativa tantum habet auctoritatis, ut nemo unquam prior eam tulerit, quin renuntiatus sit. Enfin ce passage nous apprend encore que celui qui tenoit ces comices, pouvoit reprendre le suffrage des tribus, & leur permettre même de consulter ensemble pour faire un nouveau choix. Mais en voilà assez sur les comices des centuries, passons à la milice.
Quoique les levées se fussent faites d'abord par les centuries, ainsi que Servius Tullius l'avoit établi, il est sûr qu'elles se firent aussi dans la suite par les tribus : & la preuve s'en tire du lieu même où elles se faisoient ; car c'étoit ordinairement dans la grande place : mais le choix des soldats ne s'y faisoit pas toujours de la même maniere ; c'étoit quelquefois uniquement le sort qui en décidoit, & surtout lorsque le peuple refusoit de prendre les armes.
Quelquefois au contraire, c'étoit en partie par le sort, & en partie par le choix des tribuns qu'ils se levoient ; par le sort pour l'ordre des tribus ; & par le choix des tribuns pour les soldats qu'on en tiroit. Enfin Tite-Live nous apprend que lorsqu'on n'avoit pas besoin d'un si grand nombre de soldats, ce n'étoit pas de tout le peuple qu'ils se levoient, mais seulement d'une partie des tribus que l'on tiroit au sort.
A l'égard du cens, c'étoit une des occasions où les tribus étoient le plus d'usage, & cependant le principal sujet pour lequel les classes & les centuries avoient été instituées. Aussi ne cessoient-elles pas entierement d'y avoir part, & elles y servoient du moins à distinguer l'âge & la fortune des citoyens d'une même tribu jusqu'en l'année 571 que les censeurs en changerent entierement l'ordre, & commencerent à faire la description des tribus selon l'état & la condition des particuliers.
Pour le tems où l'on commença de faire le cens par tribus, comme les anciens ne nous en ont rien appris, c'est ce qu'on ne sauroit déterminer au juste : il y a bien de l'apparence cependant, que ce ne fut que depuis l'établissement des censeurs ; c'est-à-dire, depuis l'an 310, car il n'en est fait aucune mention auparavant, & l'on en trouve depuis une infinité d'exemples.
Quand les nouveaux citoyens étoient reçus dans les tribus, les censeurs ne les distribuoient pas indifféremment dans toutes, mais seulement dans celles de la ville, & dans quelques-unes des rustiques. Ce fut sans doute ce qui rendit les autres tribus plus honorables ; & ce qui fit même qu'entre celles où ils étoient reçus, il y en avoit de plus ou moins méprisées selon les citoyens dont elles étoient remplies ; car il faut remarquer qu'il y avoit de trois sortes de nouveaux citoyens, les étrangers qui venoient s'établir à Rome ou qu'on y transferoit des pays conquis, les différens peuples d'Italie auxquels on accordoit le droit de suffrage, & les affranchis qui avoient le bien nécessaire pour être compris dans le cens.
A l'égard des peuples que l'on transféroit des pays conquis, comme les Romains ne manquoient pas d'y envoyer aussi-tôt des colonies, ils avoient coutume de distribuer ces nouveaux citoyens dans les tribus les plus proches de la ville, tant pour tenir la place des anciens citoyens qu'ils en avoient tirés, qu'afin de les avoir sous leurs yeux, & d'être par-là plus sûrs de leur fidélité.
C'étoit aussi dans ces premieres tribus établies par Servius Tullius qu'étoient reçus les différens peuples d'Italie, auxquels on accordoit le droit de suffrage ; car l'usage n'étoit pas de les distribuer dans les tribus qui étoient sur leurs terres, comme on pourroit se l'imaginer, mais dans celles du champ romain qui portoient des noms de famille, comme on le peut voir par une infinité d'exemples, & entr'autres par celui des Sabins, des Marses, des Péllyniens, & par celui des peuples de Fondi, de Formies & d'Arpinum, desquels Cicéron & Tite-Live font mention.
Pour les affranchis, ce fut presque toujours dans les tribus de la ville qu'ils furent distribués ; mais ils ne laisserent pas d'être quelquefois reçus dans les rustiques, & l'usage changea même plusieurs fois sur ce sujet. Il est bon d'en connoître les variations suivant l'ordre des tems.
Pour cela il faut premierement remarquer qu'ils demeurerent dans les tribus de la ville jusqu'en l'année 441, qu'Appius Claudius les reçut dans les rustiques. Tite-Live nous apprend même que cette action fut agréable à tous les citoyens, & que Fabius en reçut le surnom de Maximus, que toutes ses victoires n'avoient encore pu lui acquérir.
On ne voit point à quelle occasion, ni par quel moyen ils en étoient sortis peu de tems après ; mais il falloit bien qu'ils s'en fussent tirés du consentement ou par la négligence des censeurs. Ils en sortirent plusieurs fois en divers tems, & furent obligés d'y rentrer ; mais cela n'empêche pas que ce ne fût ordinairement dans les tribus de la ville qu'ils étoient distribués, & ces tribus leur étoient tellement affectées, que c'étoit une espece d'affront que d'y être transféré.
C'étoit même la différence qu'il y avoit non-seulement entre les tribus de la ville & celles de la campagne, mais encore entre les premieres rustiques établies par Servius Tullius, & celles que les consuls avoient établis depuis, qui donna lieu à l'usage de mettre entre les différens noms qu'on portoit celui de sa tribu.
La raison, au reste, pour laquelle les Romains mettoient le nom de leurs tribus immédiatement après leurs noms de famille & avant leurs surnoms, c'est que ces sortes de noms se rapportoient à leurs familles, & non pas à leur personne ; & cela est si vrai, que lorsqu'ils passoient d'une famille dans une autre qui n'étoit pas de la même tribu, ils avoient coutume d'ajouter au nom de leur premiere tribu le nom de celle où ils entroient par adoption, comme on le peut voir par une infinité d'exemples.
Il reste à parler de l'usage des tribus par rapport à la religion ; car quoiqu'elles n'eussent aucune part aux auspices, c'étoit d'elles cependant que dépendoit le choix des pontifes & des augures, & il y avoit même des cérémonies où leur présence étoit absolument nécessaire. Immédiatement après la dédicace du temple de Junon Monéta, c'est-à-dire l'an 411, sous le troisieme consulat de C. Martius Rutilus, un esprit de trouble & de terreur s'étant répandu dans toute la ville sur le rapport de quelques prodiges, & la superstition n'ayant point trouvé d'autre ressource que de créer un dictateur pour établir des fêtes & des prieres publiques, il se fit à Rome pendant plusieurs jours des processions solemnelles, non seulement de toutes les tribus, mais encore de tous les peuples circonvoisins.
A l'égard de l'élection des pontifes, il faut remarquer premierement que jusqu'en l'année 850 il n'y avoit que le grand-pontife qui fut élu par les tribus, & que tous les autres prêtres étoient cooptés par les colléges : secondement que ce fut Cn. Domitius, le trisayeul de Néron, qui leur ôta ce droit, & l'attribua au peuple pour se venger de ce qu'ils n'avoient pas voulu le recevoir à la place de son pere : & troisiemement, que l'assemblée où se faisoit l'élection des pontifes & des augures n'étoit composée que de dix-sept tribus, c'est-à-dire de la moindre partie du peuple, parce qu'il ne lui étoit pas permis en général de disposer du sacerdoce, comme on le peut voir par le passage de Cicéron contre Rullus.
Encore faut-il observer premierement que le peuple ne les pouvoit choisir qu'entre ceux qui lui étoient présentés par les colleges ; secondement, que chaque prétendant ne pouvoit avoir plus de deux nominateurs, afin que les colleges fussent obligés de présenter plusieurs sujets, entre lesquels le peuple pût choisir ; troisiemement, que les nominateurs devoient répondre par serment de la dignité du sujet qu'ils présentoient ; & quatriemement enfin, que tous les compétiteurs devoient être approuvés par les augures avant la présentation, afin que le choix du peuple ne pût être éludé.
Mais quoique l'assemblée où se faisoient ces élections ne fût composée que de dix-sept tribus, & portât même en particulier le nom de comitia calata ; comme ces dix-sept tribus néanmoins se tiroient au sort, & qu'il falloit pour cela que toutes les autres se fussent auparavant assemblées, il est certain que c'étoit une dépendance de leurs comices, & même une des quatre principales raisons pour lesquelles ils s'assembloient, car ces comices se tenoient encore pour trois autres sujets.
Premierement, pour l'élection des magistrats du second ordre, minores magistratus, les comices des tribus se tenoient en second lieu pour l'établissement des lois tribuniciennes, c'est-à-dire des plébiscites, qui n'obligerent d'abord que les plébéiens, & auxquels les patriciens ne commencerent d'être tenus que l'an 462 par la loi Hortensia, quoiqu'on eût entrepris de les y soumettre dès l'an 304 par la loi Horatia, & que cette loi eût été renouvellée l'an 417 par le dictateur Publilius. Enfin les tribus s'assembloient encore pour les jugemens qui avoient donné lieu à l'établissement de leurs comices & qui procédoient, ou des ajournemens que les tribus décernoient contre les particuliers, ou de la liberté que les particuliers avoient d'appeller au peuple de tous les magistrats ordinaires : le peuple jouissoit de ce droit dès le tems des rois, & il lui fut depuis sous les consuls confirmé par trois différentes fois, & toujours par la même famille, c'est-à-dire par les trois lois Valeria ; la premiere, de l'an 246 ; la seconde, de l'an 304 ; & la derniere, de l'an 422.
Il faut néanmoins remarquer qu'il n'y avoit que les centuries qui eussent droit de juger à mort, & que les tribus ne pouvoient condamner au plus qu'à l'exil ; mais cela n'empêchoit pas que leurs comices ne fussent redoutables au sénat ; premierement, parce qu'ils se tenoient sans son autorité ; secondement, parce que les patriciens n'y avoient point de part ; & troisiemement, parce qu'ils n'étoient point sujets aux auspices ; car c'étoit-là d'où ils tiroient tout leur pouvoir, & ce qui servoit en même tems à les distinguer des autres.
Ces comices, au reste, continuerent de se tenir toujours régulierement depuis leur institution, si on en excepte les deux années que le gouvernement fut entre les mains des décemvirs ; & quoique Sylla eût entrepris dans les derniers tems d'en diminuer l'autorité, en ôtant aux tribuns du peuple le pouvoir de publier des lois, pour les punir d'avoir favorisé le parti de Marius ; comme cette suspension de la puissance tribunicienne n'empêcha pas les tribus de s'assembler à l'ordinaire, & ne dura même que jusqu'au consulat de Pompée, les comices des tribus conserverent toute leur liberté jusqu'au tems des empereurs ; mais César ne fut pas plutôt dictateur qu'il s'empara d'une partie de leurs droits, afin de pouvoir disposer des charges, & d'être plus en état de changer la forme du gouvernement. L'histoire nous apprend à la vérité qu'Auguste les rétablit dans tous leurs droits dès qu'il fut parvenu à l'empire, mais il est certain qu'ils ne s'en servirent plus que pour prévenir ses ordres ou pour les exécuter, & qu'enfin Tibere les supprima entierement, & en attribua toute l'autorité au sénat, c'est-à-dire à lui-même.
Depuis ce tems, les tribus n'eurent plus de part au gouvernement, & le dessein qu'eut Caligula de rétablir leurs comices n'eut point d'exécution ; mais elles ne laisserent pas néanmoins de subsister jusqu'aux derniers tems de l'empire, & nous voyons même que leur territoire fut encore augmenté sous Trajan de quelques terres publiques par une suscription qu'elles firent élever en son honneur, & qu'on nous a conservée comme un monument de leur reconnoissance envers ce prince.
Telle est l'idée générale qu'on peut se former sur l'origine des tribus romaines, l'ordre de leurs établissemens, leur situation, leur étendue, leur forme politique, & leurs différens usages selon les tems ; M. Boindin, dont j'ai tiré ce détail, a épuisé la matiere par trois belles & grandes dissertations insérées dans le recueil de l'académie des Belles-Lettres. (Le chevalier de Jaucourt.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
tribu \t?i.by\ féminin
-
(Antiquité) Division du peuple, chez quelques nations anciennes.
- Le peuple d'Athènes, de Rome était divisé en tribus.
- Il a eu les suffrages de toutes les tribus.
-
(Religion) Ensemble des descendants d'un des douze fils de Jacob, dans le judaïsme.
- Les disciples sont nettement séparés des foules incroyantes (l3,l0-l7); à la fin des temps, il leur incombera de juger les douze tribus d'Israël (l9,28). ? (Daniel Marguerat, Le Jugement dans l'Évangile de Matthieu, Labor et Fides, 1995, page 240)
-
Peuplade relativement à une grande nation dont elle fait partie.
- Car il y a plus de différence entre telle et telle tribu peau-rouge, qu'entre un Arabe et un Norvégien, un Anglais et un Turc ! ? (René Thévenin et Paul Coze, M?urs et Histoire des Indiens Peaux-Rouges, Payot, 1929, 2e éd., p. 14)
- En 1830, il n'y avait en Algérie, que des tribus ennemies sur lesquelles pesaient, selon les régions, la terreur des Turcs [?], et puis les peuples berbères et arabo-berbères. ? (Bachaga Boualam, Les Harkis au service de la France, p. 137, France-Empire, 1963)
- (Chez les Amérindiens) Plusieurs familles, presque toujours parentes, formaient un clan. Des clans qui possédaient leurs territoires de chasse dans un même bassin hydrographique constituaient une tribu. Une nation rassemblait des tribus qui parlaient le même dialecte et suivaient les mêmes coutumes. [...] Ce n'est qu'aux heures de crise, cependant, que les tribus éprouvaient le sentiment d'appartenir à une même nation. ? (Jean Hamelin (dir.), Histoire du Québec, Edisem, 1977, p. 30)
-
(Figuré) (Familier) Famille ; coterie ou groupe nombreux.
- Les Pasteur labouraient la terre. Ils formaient dans un petit village qui dépendait de Mouthe, le village de Reculfoz, une véritable tribu. Elle se dispersa peu à peu. ? (René Vallery-Radot, La vie de Pasteur, Hachette, 1900, Flammarion, 1941, p.5)
-
(Péjoratif) Groupe de personne qui ont une affinité ou une similitude.
- L'on y rencontre aussi le courtier, [?], sans omettre toute la tribu des maquignons interlopes, véritables propagateurs de maladies contagieuses. ? (Gabriel Maury, Des ruses employées dans le commerce des solipèdes, Jules Pailhès, 1877)
-
(Biologie) Division de la classification qui prend place entre la sous-famille et le genre.
- Comme genre, celui-ci est un des plus remarquables dans la famille des rosacées, tribu des pomacées, en raison de son fruit, ressemblant à une pomme, et qui a comme celle-ci cinq loges et le calice charnu. Sous ces rapports il est aux autres genres de la tribu des pomacées ce que le genre Gaultheria est au genre Vaccinium. Il est vrai que dans quelques autres genres de la même tribu, le péricarpe est sec, tandis que le tube du calice seul est charnu, comme le Cotoneaster (cognassier sauvage) et le genre Photinia. ? (Flore des serres et jardins de l'Angleterre présentant toutes les plantes récemment introduites en Angleterre, Bruxelles : Société encyclographique, 1838, §. 1956)
- (Mathématiques) Structure algébrique.
-
(Suisse) Corporation de métier, société
- À Zurich, chaque industriel appartenait à une tribu en sa qualité de bourgeois, et comme souvent, le même homme exerçait plusieurs métiers, il pouvait, en qualité d'artisan, faire partie de plusieurs tribus à la fois.? (Johannes von Müller, Robert Glutz-Blozheim, Histoire de la Confédération suisse, 1837.)
- Aux treize patriciens qui restèrent dans le Conseil, on joignit les treize tribuns ou chefs des tribus d'artisans, comme celles des merciers, des tailleurs, des boulangers, des tisserands, des maréchaux, des bouchers, des cordonniers, des charpentiers et des tanneurs. Les patriciens réunis formaient la treizième tribu, qui renfermait aussi les rentiers et les gros marchands, et qui figurait pour moitié dans le Conseil. ? (Eusèbe-Henri Gaullieur, Charles Schaub, La Suisse historique, politique et pittoresque, 1855.)
- Alors le chevalier Broun, aidé du conseil de ses amis, donna une nouvelle constitution à la ville. Il divisa tous les artisans en treize tribus, dont les chefs siégeraient dans le conseil; il réunit les gentilshommes en une société particulière, afin de leur ôter toute influence sur les tribus.? (Johann Heinrich Daniel Zschokke, Histoire de la nation suisse, 1823.)
Trésor de la Langue Française informatisé
TRIBU, subst. fém.
Tribu au Scrabble
Le mot tribu vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot tribu - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot tribu au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
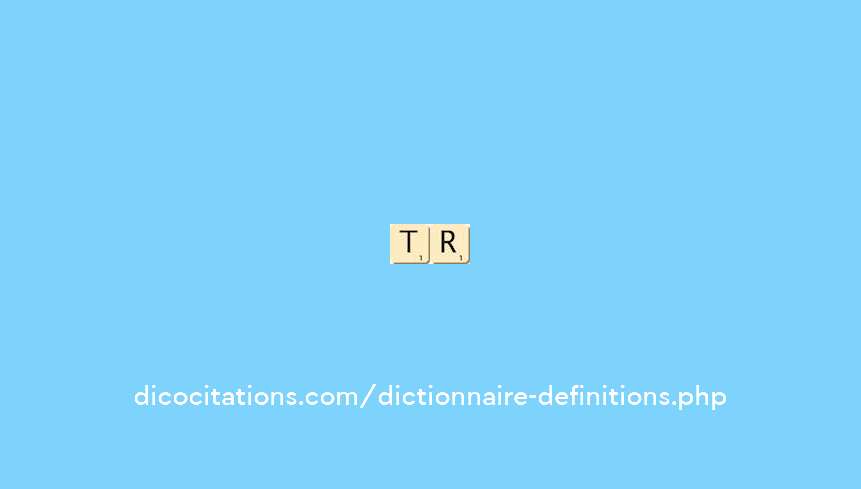
Les mots proches de Tribu
Tri Triable Triacleur Triade Triage Triangle Triangulaire Triau Tribouil Tribouiller Triboulet Tribu Tribulation Tribun Tribunal Tribunat Tribune Tribunitien, ienne Tribut Tributaire Tributif, ive Tricénaire Triceps Tricher Tricherie Tricheur, euse Trichoscope Trichoscopique Triclinium Tricoises Tricolor Tricolorer Tricot Tricot Tricotage Tricoté, ée Tricoter Tricotets Tricoteur, euse Trictrac Trident Tridentin, ine Tridien, ienne Trié, ée Triége Triennal, ale Triennat Trier Triérarque Trière tri tria Triac-Lautrait triade triades Triadou triage triaient triais triait Triaize trial triangle triangles triangulaire triangulaire triangulairement triangulaires triangulaires triangulation trianguler triangulez trianon triant trias triasique triathlète triathlon tribal tribale tribales tribart tribaux Tribehou tribord tribu tribulation tribulations tribun tribunal tribunat tribunaux tribune tribunes tribuns tribus tribut tributaire tributaires tributsMots du jour
-
pardonneras désolai éveillés complètent dominatrice exprimez haranguée sismomètre déculotté important
Les citations avec le mot Tribu
- Le développement de la personnalité chez le primitif, ou mieux, le développement de la personne, est une question de prestige magique. La figure du medecine-man ou celle du chef de la tribu sert de guide : tous deux se distinguent par la singularité des parures, par des signes extérieurs, et par leur façon de vivre, l'ensemble exprimant leur rôle. Les signes extérieurs particuliers délimitent et isolent l'individu ; la possession de secrets rituels renforce cet isolement. Par ces moyens, et par d'autres de même sorte, le primitif se crée une enveloppe que l'on peut appeler sa persona, son masque. Chez le primitif, d'ailleurs [...] il s'agit bien de véritables masques qui, pour les fêtes totémiques par exemple, servent à la transformation et à l'exaltation du personnage. Par le masque, l'individu sélectionné est mis en marge de la sphère de la psyché collective, et, d'ailleurs, dans la mesure où il parvient à s'identifier à sa persona, il s'y dérobe réellement. Cet affranchissement de la psyché collective lui confère aux yeux de sa tribu un prestige magique.Auteur : Carl Gustav Jung - Source : Dialectique du moi et de l'inconscient (1933)
- Le karaté n'est pas un sport olympique. Il est juste autorisé dans les tribunes du Paris-Saint-Germain...Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- La femme a le droit de monter à l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la tribune.Auteur : Olympe de Gouges - Source : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)
- Le monde n'est par lui-même ni bon ni mauvais. La nature, Dieu, ou quelque principe que ce soit à qui nous attribuons la direction de notre existence, n'apportent ni récompense ni châtiment. A nous de tirer leçon de nos expériences. Il n'est qu'une seule faute : l'ignorance.
Auteur : Anne Rice - Source : Les Chroniques des Vampires (1990)
- Le mot de l'énigme est, ce me semble, que la distribution des fortunes dans la société est d'une inégalité monstrueuse.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 30 avril 1770
- Rien ne contribue davantage au bonheur du jour que le bien qu'on a fait la veille.Auteur : Edmé François Pierre Chauvot de Beauchêne - Source : Maximes, réflexions et pensées diverses
- Les chefs-d'oeuvre de la langue française sont les discours de distribution pour les lycées, et les discours académiques.Auteur : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont - Source : Poésies (1870)
- Le voyage est une fuite en avant. L'homme a fui un territoire dans l'espérance de cieux plus cléments ailleurs, l'homme a fui certains mammouths trop agressifs, certaines tribus trop belliqueuses, certaines femmes trop pressantes que sais-je ? L'homme, lâche par définition, a conquis le monde par accident.Auteur : Alexis Michalik - Source : Loin (2021)
- Monsieur mégot, cette fois, vous êtes renvoyé ! en remplaçant les bouteilles de chocolos par des bouteilles de bières dans le distributeur de l'école, vous avez failli provoquer le coma éthylique de douze malheureux bambins !Auteur : Philippe Tome - Source : Le Petit Spirou (1990-2012)
- Lorsqu'il arrive aux puissants de la terre quelque grande calamité, ce n'est plus à la jalousie des dieux qu'on l'attribue, c'est à leur justice.Auteur : Benjamin Constant - Source : De la religion considérée dans sa source, ses formes et son développement (1824-1830)
- Et l'histoire est là, déesse raisonnable, statue figée au milieu de la place des Fêtes, avec pour tribut, une fois l'an, des gerbes séchées de pivoines, et en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux. Auteur : Eric Vuillard - Source : L'ordre du jour
- Pour moi, la masse des connaissances de la science était devenue «une contribution majeure à des besoins mineurs».Auteur : Jean-François Ricard, dit Jean-François Revel - Source : Le Moine et le Philosophe (1997)
- Luc Besson président du jury à Cannes, c'est bien. Ce serait quand même un comble que le réalisateur du Grand Bleu ne sache pas distribuer des palmes.Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Mais pour ces marins, tous les Indiens étaient semblables et ils ne pouvaient pas, comme moi, faire la différence entre les tribus, les régions, les noms. Ils ignoraient que sur quelques lieues vivaient, juxtaposées, plusieurs tribus différentes et que chacune d'elles étaient non pas un simple groupe humain ou la prolongation numérique d'un groupe voisin mais un monde autonome avec ses lois propres, son langage, ses coutumes, ses croyances, vivant dans une dimension impénétrable aux étrangers. Ce n'étaient pas seulement les hommes qui étaient différents, mais l'espace, le soleil, la lune, les étoiles. Chaque tribu vivait dans un univers singulier, infini et unique qui ne recoupait aucunement celui des tribus voisines. Auteur : Juan José Saer - Source : L'ancêtre (1983)
- L'orgueil ! A mes yeux c'était un attribut mixte, moitié vertu, moitié vice. Une vertu en ce qu'il maintient un homme au dessus de la fange, un vice en ce qu'il lui rend le relèvement difficile quand il est une fois déchu.Auteur : Arthur Conan Doyle - Source : Jim Harrison, boxeur (1895)
- Chacun contribua de vin la quatrieme partie de la mesure, que les Grecs appellent cotyle, qui pouvoit estre environ cheopine.Auteur : Jacques Amyot - Source : Camille, 48
- La société n'est qu'un spectacle. Ce qu'on est convenu d'appeler l'ordre social n'en est que la distribution des rôles.Auteur : Nicolas Grimaldi - Source : Le Travail, communion et excommunication (1998)
- La nuit on couvrait d'inscriptions la tribune et le siège sur lequel il rendait la justice comme préteur. La plupart disait à peu près ceci : «Tu dors, Brutus».Auteur : Plutarque - Source : Vies parallèles des hommes illustres (100-110 ap. J.-C.), Vie de César
- Le poster de Playboy a contribué à l'éveil sexuel de beaucoup d'hommes à l'adolescence, d'où cette réflexion: pour une fois qu'une femme se plie (et déplie) à tous nos désirs.Auteur : Damien Caillaud - Source : Une boîte de petits "moi"
- Moi je n'aspire qu'à être singulier, et ça demande bien des efforts quand on a été élevé dans une tribu. Auteur : Anne Percin - Source : Les singuliers (2014)
- Je devinais que la vérité ne se trouvait ni parmi eux dans le camp opposé, chez les contestataires. Elle m'apparaissait simple et lumineuse comme cette journée de février, sous les arbres alourdis de neige. La beauté humble du visage féminin aux paupières baissées rendait dérisoires les tribunes, et leurs occupants, et la prétention des hommes de prophétiser au nom de l'Histoire. La vérité était dite par le silence de cette femme, par sa solitude, par son amour si simple que même un enfant inconnu qui descendait les marches en fut ébloui pour toujours.Auteur : Andreï Makine - Source : Le Livre des brèves amours éternelles (2011)
- Il est certain que Charpentier contribua beaucoup, par son travail et par son zèle, à la belle suite de médailles qui furent frappées sous le règne de Louis XIV.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Charpentier
- Charmantes petites figures en culs-de-lampe au-dessous de la tribune du Comte, représentant les Vertus assises.Auteur : Paul Claudel - Source : Journal, 28 mars 1920
- Qu'attend-on pour créer une nouvelle compagnie de charters? Je pense à «Air Chagrin», spécialisée dans l'acheminement des familles endeuillées sur le lieu d'un crash. Avec distribution de «boîtes noires souvenirs» sur le vol du retour.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort le tribut de sa vie.Auteur : William Shakespeare - Source : La vie et la mort du roi Richard II
Les citations du Littré sur Tribu
- Pompée.... content du tribut qu'il leur imposa.... leur laissa leur prince [aux Juifs] avec toute la juridictionAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 10
- Quiconques ne povoit payer cest treü [tribut] ou escot ou contribucionAuteur : ORESME - Source : Thèse de MEUNIER.
- Lorsque les vrais catholiques tombent en tribulation, pour cela leur ame n'est point troubléeAuteur : LANOUE - Source : 516
- Pierre Ier voulut prendre la pratique d'Allemagne et lever ses tributs en argentAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XIII, 16
- Dans tous les genres, ceux qui se livrent à la pratique ont pour la théorie une aversion qu'il ne faut pas attribuer à leur ignorance et moins encore à l'inutilité de la théorieAuteur : CONDORCET - Source : Duhamel.
- Ces biens devant diz, qui sont de diverses especes, sont appellez biens pour ce que il ont aucune despendence d'une chose ou attribucion à aucune choseAuteur : ORESME - Source : Eth. VII, 12
- On y vit [chez le Tellier] tout l'esprit et les maximes d'un juge qui, attaché à la règle, ne porte pas dans le tribunal ses propres pensées, ni des adoucissements ou des rigueurs arbitrairesAuteur : BOSSUET - Source : le Tellier.
- Il [Socrate] eut deux cent vingt voix pour lui ; cela fait présumer qu'il y avait deux cent vingt philosophes dans ce tribunal ; mais cela fait voir que, dans toute compagnie, le nombre des philosophes est toujours le plus petitAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Socrate.
- Tenez la main à ce que la distribution du vin aux équipages des vaisseaux se fasse avec de pareilles mesures [conformes aux étalons]Auteur : SEIGNELAY - Source : Aux intendants, 1679, dans JAL
- Cette action contribua notablement à sa gloireAuteur : PATRU - Source : Plaidoyer 3, dans RICHELET
- Ce que la nature pratique en petit entre les hommes pour la distribution du bonheur ou des talents, elle l'aura sans doute pratiqué en grand entre les mondesAuteur : FONT. - Source : Mond. 3e soir.
- Une autre chose contribue beaucoup aux longs discours des femmes, c'est qu'elles sont nées artificieuses et qu'elles usent de longs détours pour venir à leur butAuteur : FÉN. - Source : Éduc. filles, 9
- La septieme distribution de la veine cave ascendante dite cervicale, va par les trous des apophyses transverses....Auteur : PARÉ - Source : II, 15
- Les adjectifs nominaux sont ceux qui qualifient par un attribut d'espèce, c'est-à-dire par une qualité inhérente et permanente, soit qu'elle naisse de la nature de la chose, de sa forme, de sa situation ou de son état, tels que bon, noir, simple, beau, rondAuteur : DUMARS. - Source : Oeuv. t. IV, p. 168
- On ne cherche autre chose sinon que les hommes servent à Dieu pour retribution, et soyent comme mercenaires qui lui vendent leur serviceAuteur : CALV. - Source : Instit. 629
- Nous avons les poules naines, très agréables d'aspect ; la race bantam, que l'on attribue au goût et aux soins des Japonais,...Auteur : E. BLANCHARD - Source : Rev. des Deux-Mondes, 5 juin 1874, p. 859
- Chose étrange ! on ose attribuer à Jésus-Christ même toutes ces notes flétrissantes [les caractères de nouveauté et de schisme]Auteur : BOSSUET - Source : 2e instruct. past. 42
- Cette cour [de Rome] où tout se passe en cérémonie, était le tribunal où se jugeaient ces vanités de la grandeur [les préséances]Auteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 7
- Il attribuoit toute la gloire de ses faicts à la fortune, soit qu'il le fist par une maniere de vaine gloire, ou que veritablement....Auteur : AMYOT - Source : Sylla, 11
- Le tribun Ateius se meit au devant d'eulx, et à haulte voix defendit à Crassus, qu'il n'eust à bouger de la ville, avec grandes protestations s'il faisoit au contraireAuteur : AMYOT - Source : Crass. 31
- Un orateur, voyant sa patrie en danger, Courut à la tribune ; et, d'un art tyrannique, Voulant forcer les coeurs dans une république, Il parla fortement sur le commun salutAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VIII, 4
- Quel qu'il soit, il paiera son tribut aux douleursAuteur : DELILLE - Source : Imag. III
- Il y avait quelque danger d'idolâtrie à paraître devant les tribunaux des païens, ne fût-ce qu'à cause des serments ; c'est pourquoi, dans la primitive Église, les évêques ont été les arbitres des différends qui s'élevaient parmi les fidèlesAuteur : CONDIL. - Source : Hist. anc. XV, 5
- Voilà l'influence de la belle nature sur l'âme du braconnier ; car j'attribue ce ramollissement [avoir épargné un renardeau] à la contemplation de l'étoile du berger dans les longues heures d'attenteAuteur : CARTERON - Source : Premières chasses, Papillons et oiseaux, p. 142, Hetzel, 1866
- Il l'exterminera pour jamais de toutes les tribus d'Israël, selon les malédictions qui sont contenues dans ce livre de la loi et de l'alliance du SeigneurAuteur : SACI - Source : Bible, Deutéron. XXIX, 21
Les mots débutant par Tri Les mots débutant par Tr
Une suggestion ou précision pour la définition de Tribu ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 23h13
- Tabac - Tact - Talent - Tao - Tasse - Telephone - Telephone portable - Television - Temeraire - Temps - Tendresse - Tension - Tentation - Terre - Terrorisme - Theatre - Theme - Theologien - Therapie - Timidite - Timidité - Tissus - Titanic - Toilette - Tolerance - Tombe - Torture - Tourisme - Touriste - Tout l'amour - Tradition - Traduction - Trahison - Train - Traite - Transcendance - Transparence - Transport - Travail - Travailler - Trésor - Tricher - Triste - Tristesse - Tristesse - Tromper - Tuer - Tutoyer - Tyrannie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur tribu
Poèmes tribu
Proverbes tribu
La définition du mot Tribu est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Tribu sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Tribu présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
