La définition de Chape du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Chape
Nature : s. f.
Prononciation : cha-p'
Etymologie : Picard, cape ; provenç. et espagn. capa ; ital. cappa ; bas-lat. capa, quia quasi totum capiat hominem, dans Isidore ; du latin capere, contenir, prendre (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de chape de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec chape pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Chape ?
La définition de Chape
Sorte de manteau long, sans plis et agrafé par devant, que portent l'évêque, le célébrant, les chantres, etc. durant l'office ; se dit aussi de l'habit à capuce fourré d'hermine des cardinaux, et du grand manteau de drap ou de serge des chanoines.
Toutes les définitions de « chape »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Vêtement d'église, en forme de manteau, qui s'agrafe par-devant et va jusqu'aux talons, et que portent l'évêque, le prêtre officiant, les chantres, etc., durant certaines parties du service divin. Chape de drap d'or, de satin, de damas. Chape en broderie. Chape violette. Chape noire. Il se dit aussi de l'Habit que portent les cardinaux et qui a un capuce doublé d'hermine. Chape rouge. Il désigne par analogie, en termes d'Arts, Certaines choses qui s'appliquent sur d'autres qui servent à les couvrir, à les envelopper, telles que l'Enduit de mortier dont on recouvre l'extrados d'une voûte, le Couvercle d'un alambic, la Futaille qui recouvre un tonneau de vin, etc. La chape d'une voûte. Mettre la chape sur l'alambic. Chape de poulie.
Littré
-
1Sorte de manteau long, sans plis et agrafé par devant, que portent l'évêque, le célébrant, les chantres, etc. durant l'office?; se dit aussi de l'habit à capuce fourré d'hermine des cardinaux, et du grand manteau de drap ou de serge des chanoines.
L'évêque de Ptolémaïs portait la chape par-dessus la cuirasse
, Voltaire, M?urs, 56.Fig. Se disputer de la chape à l'évêque, se dit de gens se disputant pour une chose qui n'est pas leur et qu'ils ne doivent point obtenir.
De la chape à l'évêque, hélas?! ils se battaient
, La Fontaine, Joc. La chape à l'évêque signifie, suivant une construction ancienne et populaire, la chape de l'évêque. -
2En parlant d'un oiseau, partie du plumage qui recouvre le dos et qui est d'une couleur différente du reste.
Les ?ufs du bouvreuil sont ardoisés comme la chape de son dos
, Chateaubriand, Génie, I, V, 6. -
3Anciennement, chape, le même que cape, sorte d'ample vêtement.
Sous chape, à la sourdine. On dit présentement sous cape.
Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort, Et vous menez, sous chape, un train que je hais fort
, Molière, Tart. I, 1. Les éditions rajeunies ont?: sous cape. -
4Se dit, dans les arts, de certaines choses qui s'appliquent sur d'autres, les couvrent, les enveloppent. La chape d'une voûte, le mortier qui recouvre l'extrados. La chape d'un alambic, le couvercle. Chape de poulie, la monture d'une ou de plusieurs poulies. La chape d'une boucle, la partie par où elle tient au soulier, à la ceinture, etc.
Couvercle bombé qui, mis sur les plats, tient les mets chauds et les préserve de la poussière.
Double futaille qui sert d'enveloppe à un baril de poudre et aux tonneaux de vin que l'on expédie au loin.
Partie des mitaines qui recouvre le dos de la main.
Terme d'imprimerie. Petit calibre de tôle, taillé à l'extrémité comme une matrice de lettre.
Terme de musique. Planches qui, portant les tuyaux d'orgue, servent de couverture au sommier, et où se fait la distribution du vent.
- 5 Terme de marine. Petit cône creux fixé au milieu de l'aiguille d'un compas, et posé sur le pivot vertical qui s'élève du fond de la boîte de la boussole.
- 6Couche de mortier que l'on étale avant de poser le pavé.
-
7Pièce de cuivre qui enveloppe le touret des graveurs sur pierres fines.
Morceau de métal arrondi qui borde l'extrémité supérieure d'un fourneau.
Enveloppe qui assujettit les différentes pièces d'un moule.
Composition dont on couvre les cires pour former le moule dans les grands ouvrages de fonderie.
- 8Chape-chute, voyez CHAPE-CHUTE.
HISTORIQUE
XIe s. N'a tel vassal sous la cape du ciel
, Ch. de Rol. X.
XIIe s. Une chape à pluie afubla, De sus la chape se fist ceindre
, Wace, Rou, 7180. À Lungeville aveit un villan païsant, Qui aveit sis bels boefs e sa charrue avant?; Fame aveit espusée, ne sai s'out nul enfant?; Mez la fame esteit auques de ses mains aerdant [voleuse]?; Chape chaete prist, s'el n'eüst bon garant?; Tant ala cel mestier comme fole menant, Que la fin en fu male, e co [ce] fu avenant
, Wace, Roman de Rou, V. 1904. Dunc s'esteit desparé de l'aube senz delai, En chape e en surpliz remist [resta]?
, Th. le mart. 37. En une chape à pluie qu'il soleit chevalchier
, ib. 160.
XIIIe s. Que li prestre qui avoient capes à manches les averoient reondes
, Chr. de Rains, 88. Demain matin quant tu venras, Soz ta chape en ta main tenras Tot coiement une coignie Qui soit trenchant et aguisie
, Ren. 15972. Cil s'enfuient, Renart eschape, Dès or gart bien chascun sa chape
, ib. 9576. Ge fais entendant par ma chape Que li riches est entechiés, Plus que li povres, de pechiés
, la Rose, 11458. Si ot [vieillesse] d'une chape forrée Moult bien, si cum je me recors, Abrié et vestu son corps
, ib. 398. Vous faites de moi chape à pluie, Quant orendroit lès vous m'apuie
, ib. 8549. Mes orguex, qui toz biens esmonde, I a tant mis iniquité Que par lor grant chape roonde [les ordres mendiants] Ont versé [renversé] l'université
, Rutebeuf, 152. Le chevalier ne fu pas esbahi, aincois le prist par la chape et li dist?
, Joinville, 205.
XVIe s. De chappes, de rochetz?
, Du Bellay, J. VI, 32, verso. Après quelques sacrifices faits, il vest la chappe de pourpre de la deesse Proserpine
, Amyot, Dion, 70. Deux vaisseaux qu'on nomme en un mot alembic?: l'un d'iceux est appelé proprement cucurbite ou vaisseau contenant?: l'autre est dit chapiteau ou chape, auquel sont amassées les vapeurs converties en eau, pour ce qu'il represente quelque certaine forme et figure de chef ou de teste
, Paré, XXVI, 5. Ces couvertures sont grands chapeaux façonnés comme cloches larges par bas, ou comme chapes d'alambics
, De Serres, 545. La chappe ou cloche, sous laquelle s'amassent les vapeurs des matieres distillées
, De Serres, 889. M. de T***, sortant de la maison d'une dame, avoit failli d'estre maltraité par certains ruffians qui cherchent volontiers des chapes cheutes à l'entour de telles personnes
, Régnier de la Planche, dans le Dict. de DOCHEZ.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CHAPE. Ajoutez?:Encyclopédie, 1re édition
CHAPE, s. f. (Hist. eccl.) ornement d'église que portent les choristes ou chantres, & même le célébrant, dans certaines parties de l'office.
La chape est un vêtement d'étoffe de soie, ou d'or & d'argent, avec des franges & des galons, de couleur convenable à la fête ou à l'office que l'on fait ; elle couvre les épaules, s'attache sur la poitrine, & descend jusqu'aux piés. Elle est ainsi principalement nommée d'un chaperon qui servoit autrefois à couvrir la tête, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un morceau d'étoffe hémisphérique, souvent plus riche & plus orné que le fond de la chape. Anciennement on appelloit celle-ci pluvial ; & on la trouve ainsi nommée dans les pontificaux & rituels, parce que c'étoit une espece de manteau avec sa capote que mettoient les ecclésiastiques, lorsque par la pluie ils sortoient en corps pour aller dire la messe à quelque station. Voyez Pluvial & Station.
Quelques-uns ont cru que nos rois de la premiere race faisoient porter en guerre la chape de S. Martin, & qu'elle leur servoit de banniere ou de principal étendart. Pour juger de ce qu'on doit penser de cette opinion, voyez Etendart, Enseignes militaires. (G)
* Chape, en Architecture ; c'est un enduis sur l'extrados d'une voûte, fait de mortier & quelquefois de ciment.
* Chape, (Ceinturier.) ces ouvriers appellent ainsi les morceaux de cuir qui soûtiennent dans un baudrier les boucles de devant, & celles du remontant. Voyez Baudrier.
* Chape, (Cuisine.) couvercle d'argent ou de fer-blanc dont on couvre les plats, pour les transporter des cuisines chaudement & proprement.
* Chape, terme de Fondeur en statues équestres, en canon, en cloche, &c. est une composition de terre, de fiente de cheval & de bourre, dont on couvre les ciris de moules dans ces ouvrages de Fonderie : c'est la chape qui prend en creux la forme des cires, & qui la donne en relief au métal fondu. Voyez les articles Bronze, Canon, Cloche &c.
* Chape, (Fonderie.) c'est cette partie faite en T dans certaine boucles, & percée à jour, & armée de pointes dans d'autres, qui se meut sur la goupille qui traverse en même tems l'ardillon, & dans l'ouverture de laquelle on passe d'un côté une courroie qui arrête la boucle dont l'ardillon entre dans une autre courroie, ou dans le bout opposé de la même. Il y a quatre parties dans une boucle ; le tour qui retient le nom de boucle ; l'ardillon, la goupille, & la chape : la goupille traverse le tour, l'ardillon, & la chape ; les pointes de l'ardillon portent sur le tour supérieur de la boucle ; & le tour inférieur de la boucle porte sur la partie inférieure de la chape.
* Chape, en termes de Fourbisseur, c'est un morceau de cuivre arrondi sur le fourreau qui en borde l'extrémité supérieure. Voyez les figures 12. & 13. qui représentent, la premiere le mandrin des chapes pour les lames à trois quarts ; & la seconde, le mandrin pour les autres lames.
* Chape, en Méchanique, se dit des bandes de fer recourbées en demi-cercle, entre lesquelles sont suspendues & tournent des poulies sur un pivot ou une goupille qui les traverse & leur sert d'axe, & va se placer & rouler dans deux trous pratiqués, l'un à une des ailes de la chape, & l'autre à l'autre aîle : tout cet assemblage de la chape & de la poulie est suspendu par un crochet, soit à une barre de fer, soit à quelqu'autre objet solide qui soûtient le tout. On voit de ces poulies encastrées dans des chapes, au-dessus des puits. Voyez Poulie.
* Chape, (à la Monnoie.) est le dessous des fourneaux où l'on met les métaux en bain. Il est des chapes en massif & en vuide. Voyez Fourneau de monnoyage.
Chape, dans l'Orgue, est la table a, b, c, d, (fig. 9. & 10.) de bois d'Hollande ou de Vauge, dans les trous de laquelle les tuyaux sont placés. Voyez l'article Sommier de grand orgue.
Chape de plein jeu, représentée figure 13. Pl. Org. est une planche A, B, C, D, de bois d'Hollande, de deux pouces ou environ d'épaisseur, sur le champ de laquelle on perce des trous I, II, III, &c. qui tiennent lieu de gravure : ces trous ne doivent point traverser la planche dans toute sa largeur BC ; on doit laisser environ un demi-pouce de bois. Si cependant on aime mieux percer les trous de part en part, on sera obligé de les reboucher ; ce qui se fera avec une bande de parchemin que l'on collera sur le champ de la chape, après que les trous ou gravures que l'on perce avec une tarriere, & que l'on brûle avec des broches de fer ardentes de grosseur convenable, ont été percés. On perce autant de trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le plat de la chape, qu'il doit y avoir de tuyaux sur chaque touche ; ces trous doivent déboucher dans les gravures : on les brûle aussi & on les évase par le haut, afin qu'ils puissent recevoir le pié des tuyaux d, e, que l'on fait tenir debout sur la chape par le moyen d'un faux-sommier. Voyez Faux-sommier.
Lorsque ces pieces sont ainsi achevées & placées en leur lieu, on met des porte-vents de plomb, qui sont des tuyaux cylindriques de grosseur convenable ; ces porte-vents prennent d'un bout dans un trou de la chape du sommier du grand orgue, & vont aboutir de l'autre bout à une des gravures de la chape du plein jeu : ce qui établit la communication. Les porte-vents sont arrêtés dans les trous où ils entrent, par le moyen de la filasse enduite de colle-forte, dont on entoure leurs extrémités. Il suit de cette construction, que le registre du sommier du grand orgue qui passe sous les trous où les porte-vents prennent, étant ouvert, que si l'on ouvre une soûpape, le vent contenu dans la laye entrera dans la gravure ; d'où il passera par les trous de la table du sommier & ceux du registre & de la chape, dans le porte-vent de plomb, qui le conduira dans la gravure correspondante de la chape du plein jeu : ce qui fera parler tous les tuyaux d, e, qui seront sur cette gravure.
Chape, c'est le nom que les Potiers d'étain donnent aux pieces de leurs moules qui enveloppent les noyaux de ces mêmes moules : ainsi, à un moule de vaisselle, la chape qui est creuse, est ce qui forme le dessous qui devient convexe ; il y a une ouverture à cette chape par où on introduit l'étain dans le moule, qu'on appelle le jet. A l'égard des chapes de moules de pots, il y en a deux à chaque moule qui forment le dehors du pot, & les deux noyaux le dedans. Le jet est aussi aux chapes, & le côté opposé s'appelle contre-jet. Elles se joignent aux noyaux par le moyen d'un cran pratiqué à la portée des noyaux. Il faut deux chapes & deux noyaux pour faire un moule de la moitié d'un pot. Voy. Fondre l'étain & la premiere figure des Planches du Potier-d'étain.
* Chape ; on donne ce nom dans les Manufactures de poudre, aux doubles barrils, dont on revêtit ceux qu'on remplit de poudre. On employe ces doubles barrils, pour empêcher l'humidité de pénétrer au-dedans de celui qui contient la poudre, & de l'éventer. On enchape aussi les vins. Il y a vins emballés, vins enchapés. La chape des vins empêche aussi le vin de s'éventer ; mais elle a encore une autre utilité, c'est d'empêcher le voiturier de voler le vin.
Chape, adj. terme de Blason ; il se dit de l'écu, qui s'ouvre en chape ou en pavillon depuis le milieu du chef jusqu'au milieu des flancs. Telles sont les armoiries des Freres-Prêcheurs & des Carmes ; & c'est l'image de leurs habits, de leurs robes, & de leurs chapes.
Brunecost en Suisse, & au comté de Bourgogne, d'argent chapé de gueulles. (V)
Wiktionnaire
Nom commun - français
chape \?ap\ féminin
-
(Habillement) Sorte de manteau long, sans plis et agrafé par devant, allant jusqu'aux talons, que portent l'évêque, le célébrant, les chantres, etc. durant l'office ; se dit aussi du grand manteau de drap ou de serge des chanoines. On nomme aussi ce vêtement un pluvial.
- Vous avez pillé tous mes coffres, déchiré ma chape de dentelles brodées, qui était digne d'un cardinal. ? (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l'anglais par Alexandre Dumas, 1820)
- [?] j'entends toujours ce glas, toujours j'entends le curé me dire en pleurant : « Pauvre petit diable ! », et je revois le bedeau et ses tintenelles, les chantres et leurs chapes. ? (Octave Mirbeau, Contes cruels : Mon oncle)
- L'évêque de Ptolémaïs portait la chape par-dessus la cuirasse. ? (Voltaire, M?urs, 56)
-
(Habillement) Habit que portent les cardinaux et qui a un capuce doublé d'hermine.
- Son costume se compose d'une mitre précieuse, imitant un décor de broderies de perles, et d'une chape à bords orfrayés, recouvrant une tunique à larges manches, retenue au niveau de la poitrine par un gros fermail. ? (Didier Rykner, La Sculpture du XVe siècle en Franche-Comté de Jean sans Peur à Marguerite d'Autriche (1404-1530), Édition des Amis des musées du Jura, 2007, page 121)
-
(Figuré) Ce qui pèse sur l'esprit, sur l'âme.
- D'où cette chape mortifère sous laquelle j'ai vécu, tremblé, pendant des mois sans un cri (sauf à l'infirmerie) sans un pleur (sauf en cachette) et sans pouvoir m'en plaindre à qui que ce soit - à Élise moins qu'à tout autre, qui m'avait placée là pour mon bien : [?]. ? (Vera Feyder, Un manteau de trous, Bruxelles : Éditions le Grand miroir, 2007, page 23)
-
(Zoologie) En parlant d'un oiseau, partie du plumage qui recouvre le dos et qui est d'une couleur différente du reste.
- Les ?ufs du bouvreuil sont ardoisés comme la chape de son dos. ? (François-René de Chateaubriand, Génie, I, V, 6)
-
(Vieilli) Variante de cape.
- Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort, Et vous menez, sous chape, un train que je hais fort. ? (Molière, Tartuffe I, 1 (les éditions rajeunies ont « sous cape »))
- Se dit, dans les arts, de certaines choses qui s'appliquent sur d'autres, les couvrent, les enveloppent.
- La chape d'une voûte : Le mortier qui recouvre l'extrados.
- La chape d'un alambic : Son couvercle.
- Chape de poulie : La monture d'une ou de plusieurs poulies.
- La chape d'une boucle : La partie par où elle tient au soulier, à la ceinture.
- L'ajustage des parties frottantes demande des précautions, notamment celui des coussinets sur les arbres et essieux. On doit leur donner un peu de jeu, surtout à l'entrée, afin d'éviter le pincement qui se produirait si l'axe venait à chauffer et à se dilater. Ils doivent, par contre, être très-exactement retenus dans leur chape ou palier. ? (Jules Gaudry, Traité élémentaire et pratique de la direction, de l'entretien et de l'installation des machines à vapeur fixes, locomotives, locomobiles et marines, première partie (tome I), Victor Dalmont, Éditeur, Paris, 1856)
- (Cuisine) Couvercle bombé qui, mis sur les plats, tient les mets chauds et les préserve de la poussière.
- Double futaille qui sert d'enveloppe à un baril de poudre et aux tonneaux de vin que l'on expédie au loin.
- (Habillement) Partie des mitaines qui recouvre le dos de la main.
- (Imprimerie) Petit calibre de tôle, taillé à l'extrémité comme une matrice de lettre.
- (Musique) Planches qui, portant les tuyaux d'orgue, servent de couverture au sommier, et où se fait la distribution du vent.
- (Marine) Petit cône creux fixé au milieu de l'aiguille d'un compas, et posé sur le pivot vertical qui s'élève du fond de la boîte de la boussole.
- (Maçonnerie) Couche de mortier que l'on étale avant de poser le pavé.
- Pièce de cuivre qui enveloppe le touret des graveurs sur pierres fines.
- Morceau de métal arrondi qui borde l'extrémité supérieure d'un fourneau.
- (Armement) Pièce de métal qui garnit l'extrémité supérieure d'un fourreau d'épée.
- Enveloppe qui assujettit les différentes pièces d'un moule.
- Composition dont on couvre les cires pour former le moule dans les grands ouvrages de fonderie.
- Pièce en forme de U, composant (ou solide), participant à une articulation entre deux solides.
-
(Héraldique) Pièce formée par par deux triangles.
 Senaux : D'or coupé de gueules, chapé, chaussé de l'un en l'autre.
Senaux : D'or coupé de gueules, chapé, chaussé de l'un en l'autre.- La chape est un vêtement de deux triangles rectangles, formés par les bords de l'écu et par deux lignes menées du milieu du chef à chacun des angles de la pointe. ? (P.-B. Gheusi, Le Blason, 1932)
Trésor de la Langue Française informatisé
CHAPE, CHAPPE, subst. fém.
Chape au Scrabble
Le mot chape vaut 12 points au Scrabble.
Informations sur le mot chape - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot chape au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
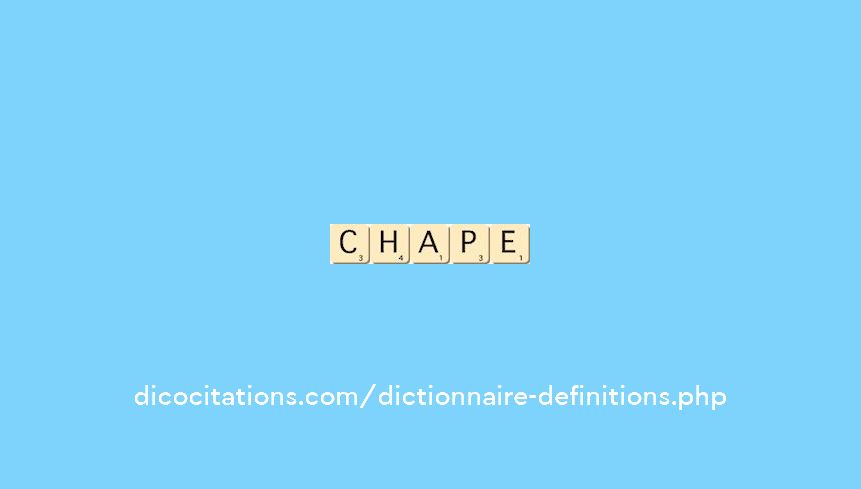
Les mots proches de Chape
Chabichou Chablage Chableur Chablis Chabot Chabrol et chabrot Chacal Chaconne Chacun, chacune Chacunière Chafaud Chagrin Chagrin Chagrin, ine Chagrinant, ante Chagrinement Chagriner Chaillant Chaille Chailleux, euse Chaillot ou chaillou Chaîne Chaînette Chaînier ou chaîniste Chaînon Chaintre Chair Chair Chaire Chaise Chalaine Chaland, ande Chaland ou chalan Chalandise Chalcide Chalcidique Chaldaïque Chaldéen, enne Châle Chalet Chaleur Chaleureusement Chaleureux, euse Chalinoptère Châlit Chaloir Chalon Chalosse Chalot Chaloupe cha-cha-cha chabanais Chabanais Chabanne Chabestan Chabeuil chabichou chabler chablis Chablis chaboisseaux Châbons chabot chabots Chabottes Chabottonnes Chabournay Chabrac chabraque Chabreloche Chabrignac Chabrillan Chabris chabrot chacal chacals Chacé Chacenay chachlik chaconne Chacrise chacun chacune Chadeleuf Chadenac Chadenet Chadrac Chadron Chadurie chafaud chafauds Chaffal Chaffaut-Saint-Jurson Chaffois chafouin chafouin chafouine chafouins chafouins chagatteMots du jour
Tire-laisse Débat Échute Dictionnaire Monnaierie Bigne Sculpter Énif Assouvir Mélodieusement
Les citations avec le mot Chape
- Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la chapelle, connaître le flanc, savoir où l'on est vu et où l'on n'est pas vu.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 21, VIII, De la mode
- Quand on sait que les soldats de la garde royale britannique portent des chapeaux à poils, on est soulagé de constater que la reine porte des chapeaux à plumes.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le chat
- Le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou.Auteur : Ahmadou Kourouma - Source : Allah n'est pas obligé (2000)
- Où Jésus Christ a son église, l'ennemi (le diable) a aussi sa chapelle.Auteur : Proverbes islandais - Source : Proverbe
- Le coup passa si près que le chapeau tomba...Auteur : Victor Hugo - Source : La Légende des siècles (1859), Après la bataille
- Je te rends le chapeau mais en pour, je veux une meule, il crie. - Une meule? Kékcékça? - Une mobylette si tu préfères.Auteur : Jean Vautrin - Source : Bloody Mary (1979)
- Le 30 mars ... je reçois une citation à comparoir comme prévenu d'une tentative de meurtre pour un coup de chapeau!Auteur : Eugène Labiche - Source : Un monsieur qui prend la mouche (1852)
- Marche droit, Anne : si l'on te questionne, jamais cet accident ne doit transparaître, ta patte menace de prison ceux qui l'ont sauvée. Mais… Comment se rappeler la prison, ici ? Comment même y croire ? Ici, tout le monde semble déguisé, et la police omniprésente laisse tranquille la foule à laquelle je ressemble, avec mon chapeau de pacotille et mes lunettes noires. Auteur : Albertine Sarrazin - Source : L'Astragale (1965)
- Ce n'est vraiment pas être un gentleman que de frapper une femme en gardant son chapeau sur la tête.Auteur : Marcel Achard - Source : Sans référence
- Tous les hivers on se coltine la grippe asiatique et ils donnent le prix Nobel de médecine à un Japonais. Je sais pas qui a choisi, mais je tire pas mon chapeau!Auteur : Jean-Marie Gourio - Source : Brèves de comptoir, 1988
- Il faut un intermédiaire plus humble entre lui si grand et elles si petites. Cet intermédiaire, c'est le marabout... C'est donc au tombeau du saint, dans la petite chapelle où il est enseveli, que nous trouverons la femme arabe en prière.Auteur : Guy de Maupassant - Source : La Vie errante (1890), D'Alger à Tunis
- Eunuque: N'a jamais d'enfants... Fulminer contre les castrats de la chapelle Sixtine.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Drôle d'époque où recenser les sujets de préoccupation de ses contemporains revient à ressasser un chapelet de lieux communs.Auteur : Christiane Collange - Source : Ca va les hommes? (1981)
- Qui prêche la guerre, est chapelain du diable.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- Les Européens qui fument de l'opium me font penser aux Chinois qui portent des chapeaux melon.Auteur : Sacha Guitry - Source : L'Esprit
- L'ordinateur est un appareil sophistiqué auquel on fait porter une housse la nuit en cas de poussière et le chapeau durant la journée en cas d'erreur.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Bouvard de A à Z (2014)
- L'obsession que j'ai de toi s'est enfoncée sur ma tête comme un chapeau trop grand. Je suis coiffé de toi. Je ne vois plus que toi.Auteur : Erik Orsenna - Source : La grammaire est une chanson douce (2001)
- Le portable entre nos mains prend la place du chapelet. Facebook est une communion sans Dieu, mêlée de confession.Auteur : Jean d'Ormesson - Source : Un jour je m'en irai, sans en avoir tout dit (2013)
- Son chapeau lui va comme un gant. Trouvez l'erreur...Auteur : Daniel Prévost - Source : Sans référence
- Le prix du chapeau n'est pas en rapport avec la cervelle qu'il coiffe.Auteur : Proverbes américains - Source : Proverbe
- Du point de vue des Indiens des îles Caraïbes, Christophe Colomb, avec son chapeau à plumes et sa cape de velours rouge, était un perroquet aux dimensions jamais vues.Auteur : Eduardo Hughes Galeano - Source : Sens dessus dessous. L'école du monde à l'envers (1998)
- Il a démarré, comme la première fois, sur les chapeaux de roues, et de nouveau, l'automobile a frôlé le portail avant de disparaître.Auteur : Patrick Modiano - Source : Villa triste (1975)
- Si le ciel luit comme un chapeau, - On aura du vin plein le tonneau.Auteur : Dictons - Source : 22 janvier
- Le clan Tiberi réuni autour de lui à l'hôpital, c'est la chapelle Cystite!Auteur : Laurent Ruquier - Source : Vu à la radio (2001)
- Ribouldingue se boyautait tel un chapeau-claque qui aurait des coliques hépatiques. «Ah! l'animal! pouffait-il entre ses dents, c'qu'il en a un culot!»Auteur : Louis Forton - Source : Les Aventures des Pieds Nickelés
Les citations du Littré sur Chape
- L'évêque de Ptolémaïs portait la chape par-dessus la cuirasseAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 56
- Sa tête était emboîtée dans son chapeauAuteur : Paul Scarron - Source : Rom. com. I, 10
- La chapelle de Saint Marc [de Venise], qui est la plus belle et riche chapelle, toute faite de musaïcq en tous endroitsAuteur : COMM. - Source : VII, 15
- Dans la 4e classe des poils de rebut, se trouvent tous les poils provenant de l'éjarrage, du soufflage, du lavage à la chaux, en un mot tout le ploc impropre aux usages de la chapellerie, de la filature et de la brosserieAuteur : C. D'AMEZEUIL - Source : Monit. univ. 5 oct. 1867, p. 1275, 3e col.
- La seule chapelle royale a vu plus de trois cents convertis abjurer saintement leurs erreurs entre les mains de l'aumônierAuteur : BOSSUET - Source : R. d'Angleterre.
- Mesmes en avoit escrit à la Saincteté du pape, lequel luy avoit promis un chapeau pour un de ses serviteursAuteur : M. DU BELL. - Source : 32
- Il reçoit deux coups dans son chapeau et revient gaillardAuteur : Madame de Sévigné - Source : 152
- Olympe quitta sa robe à l'anglaise et son chapeau, pour prendre l'habit uniforme de la maisonAuteur : GENLIS - Source : Veillées du château t. II, p. 406
- Mais grâce.... Au grand épistolier Balzac, à Chapelain l'archipuristeAuteur : MÉNAGE - Source : Requête des dict. à l'Acad.
- Si se devoient assembler ces appointeurs en une chapelleAuteur : Jean Froissard - Source : I, VI, 4
- Et ma tête, ainsi testonnée, D'un chapeau de fleurs fut ornéeAuteur : Paul Scarron - Source : Virg. II
- ....Et se vestirent de poures cotes dechirées et de poures chapeaux, en guise de poures marchands....Auteur : Jean Froissard - Source : I, I, 131
- Maistres Pierres de Chapes et Quenes de Bethune.... alerent aux cinc nés [navires], et proierent à plaintes et à pleurs à ceus qui dedens estoient, que....Auteur : VILLEH. - Source : CXLVII
- Et li atachierent la crois en un grant chapel de coton par devant, pour ce qu'il voloit que tous le veïssentAuteur : VILLEH. - Source : XL.
- Les capitaines des blancs chaperons parlementerent ensemble et manderent aucuns de leurs gens tous les plus outrageus et pieurs de leur compagnieAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 60
- Il n'ouvre la bouche que pour répondre ; il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soiAuteur : LA BRUY. - Source : VI
- Plus vit en paix un poure chapelain Aux frais d'autrui ou par sa pourveance, Ou un cloistrier, [que] ne fait son souverainAuteur : E. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 253, dans LACURNE
- Un chapelet.... Long d'une brasse et gros outre mesureAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Herm.
- Saint-Évremond déposa le corps de la duchesse Mazarin à N. D. de Liesse, où les bonnes gens la priaient comme une sainte et y faisaient toucher leurs chapeletsAuteur : SAINT-SIMON - Source : 69, 128
- Toque au lieu de chapeau, haut-de-chausse troussé : La barbe seulement demeure au personnage [il s'agit d'un homme qui s'habille en page]Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Petit chien
- Les tirans d'une bourse, d'un chaperon de fauconAuteur : COTGRAVE - Source :
- Les plus petits hidalgos venaient tous les jours au château avec le plumet au chapeau et la longue rapière au côtéAuteur : LESAGE - Source : Est. Gonz. 27
- Mon fils le baron, Quoique un peu poltron, Veut avoir des croix ; Il en aura trois ; Chapeau bas, chapeau bas ! Gloire au marquis de Carabas !Auteur : BÉRANG. - Source : Le marquis de Carabas.
- Et li atachierent la crois en un grant chapel de coton [ouatte] par devant, pour ce que il voloit que tous le veissentAuteur : VILLEH. - Source : XL
- Grans chaperons et cornette à visiers, Peaulx de chameulx, et draps fors et entiers ; Garnissez-vous avant qu'iver vous fiere [frappe]Auteur : E. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 234, dans LACURNE
Les mots débutant par Cha Les mots débutant par Ch
Une suggestion ou précision pour la définition de Chape ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h02
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur chape
Poèmes chape
Proverbes chape
La définition du mot Chape est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Chape sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Chape présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

